48.1

Une passerelle par-dessus le torrent. En haut la montagne en bas la plaine. Un aveugle sur le chemin de halage, avec le fleuve, le vent et le soleil qui fait fondre la fausse monnaie.
Jean Prod’hom
Même dispositif que la veille

Même dispositif que la veille, tout le monde sur l'Alpe. Quant à moi, je descends avec mes raquettes sur Dranse, par le Roc de Cornet. Fais une halte Chez Petit. Il y a foule devant le chalet-d’en-bas, une foule qui se disperse, les uns vont à Liddes, d'autres à Bourg-Saint-Pierre ou Martigny. Je parle un peu avec J.-L. qui reste seul, il est à l'AI. Il me raconte que lui et ses frères et soeurs ont laissé aller le domaine depuis 2007, lorsque ses parents sont décédés. Aujourd'hui il ne fait rien, il marche parfois jusqu'au contour, c'est sa promenade. A midi et le soir il va manger chez sa soeur à Liddes. L'idiot est désarmant de tranquillité, si attachant que je ne sais comment demeurer un instant encore avec lui. Je lui demande s'il sait apprivoiser les chevreuils ou les chamois. Tu vois, qu'il me dit, le jour ils ne sont pas là, ils sont craintifs, ils se cachent dans la forêt. Et la nuit on ne les voit pas. Je ne sais pas pourquoi j'aime tant les idiots, ces assistés qui ne seraient rien sans nous. Mais que serions-nous sans eux, sans cette tranquillité, cette paix qu'ils mettent dans tout et qui ne les touche pas ?
Je rejoins le lit de la Dranse après le terrain de foot et la déchèterie, Marche deux bonnes heures sur un sentier qui la longe. Ne rencontrerai qu'une dame de Bourg-Saint-Pierre et une fille qui ne lui ressemble pas. Elle y a vécu toute sa vie, mais il y a quelques mois, elle et son mari ont décidé de partir, en deux étapes. C'est pas simple de quitter son pays. Ils ont vendu leur maison d'en-haut et ont emménagé à Liddes. Avant de trouver un appartement dans la plaine à Martigny. Elle a le visage triste des gens qui sont nés dans le regret, qui ont vécu dans une immense solitude, avec à fleur de peau une gentillesse que les autres n'ont pas.
Un rapace quitte le nid d'aigle situé sur une falaise du côté d'Azenin, il plane en piquant droit sur la Combe de l'A. C'est un aigle.
Bois un café à Bourg-Saint-Pierre, m'informe d'un bus, rien avant une heure. Je rejoins la route que descend du col et demande à un inconnu qui sort d'un bistrot de me ramener à Liddes. La cinquantaine, satisfait de ce qu'il est, de Bex où il vit. Mais il ne comprend pas pourquoi certains vont à pied, dans la neige, montent au sommet des montagnes pour finalement en redescendre. Renonce à lui répondre.
Sandra vient me chercher à Liddes, on boit un verre de vin blanc avant de remonter à Vichères. Tout le monde est là. La vie communautaire reprend.
Jean


Le ciel est tout entier dégagé

Le ciel est tout entier dégagé. Descends à Liddes chercher le pain commandé hier à l’épicerie d’en-haut, je bois un café à l'Hôtel de la Channe. Le patron aux allures d’Hells Angels et son employée qui vient des Antilles remettent de l'ordre dans le café laissé dans un sale état hier soir, on y sent la fumée froide. Le patron aimerait tendre un tissu à motifs sur l'un des murs de la grande salle, quelque chose de bien, quelque chose de beau, un tissu avec des têtes de cerfs, de chamois et de chevreuils. Ou quelque chose qui rappellerait le Brésil, la plage, le soleil, les femmes. Je reviendrai voir l'année prochaine, en attendant je regarde de l’autre côté la route qui monte à Bourg-Saint-Pierre, des enfants jouent dans la cour. Les petits Valaisans n'ont pas de vacances.
On part tous en fin de matinée pour les Bains de Saillon. Je goge deux heures devant le Grand Muveran, la Dent Favre et les Dents de Morcles. Avec au premier plan la passerelle qu'aurait emprunté Farinet, le généreux faux-monnayeur, pour aller se cacher dans les plis des gorges qui descendent du sommet de la montagne.
On partage pain et chocolat sur une place de jeux, sous le soleil, Il fait une douzaine de degrés. Je guette, toujours pas de fleurs, mais les rosiers sont partout taillés. Quelques vignerons s’affairent au pied des ceps de leur vigne. On monte sur la colline de Saillon d’où l'on aperçoit quelques restes des fortifications médiévales, et la plaine du Rhône qui n’est, lorsqu'on la traverse, qu’un chantier en désordre, à l’abandon, friches industrielles ou serres abandonnées, mais qui se révèle, vue d'en haut, vaste pays de cocagne couvert de vergers, abricotiers, poiriers, pommiers, pruniers,...
On fait une halte à Martigny. Sandra y achète des verres de protection, le soleil est vif et la neige fait le reste. Après le repas, vautrés sur des matelas, on regarde Vacances romaines, le film de William Wyler.
J'ai bien regardé aujourd'hui, pas de crocus, – on est pourtant à deux pas des Folaterres et de son climat d’après Valence –, ni primevères ni jonquilles.
Jean


Il y a la généralisation de la priorité à droite

Il y a la généralisation de la priorité de droite
les narcisses
les mésanges
il y a les raccourcis
la fonte des neiges
le bruit de la clé dans la serrure
il y a le revers de ce qu’on croyait savoir
il y a les points d’orgue
Jean Prod’hom
Le soleil se glisse par la petite fenêtre

Le soleil se glisse par la petite fenêtre serrée à l’angle de la charpente. Un oeil et une oreille pour constater que les enfants ne nous ont pas attendus pour démarrer leurs grands travaux. Il fait 4 degrés en-dessus de zéro lorsque Sandra et les autres montent skier au pied de Bavon. Il est près de 11 heures 30 lorsque je me saisis de ma seconde paire de chaussures et de mes raquettes.
Départ devant le chalet, à 1400 mètres, arrivée à Plan Monnay à 2100 mètres, en contournant la croupe qui retombe sur Orsières, dans les sapins et les mélèzes. Mais il reste beaucoup de place encore pour les chevreuils et les chamois dont on voit les traces se croiser en tous sens. on marche dans une succession d’ouvertures. Les Alpes ont un petit air de Jura à cette altitude. Les branches des épicéas chargées de lourdes grappes de pives touchent du bout des doigts la neige abondante encore. Ailleurs des mélèzes soufflés par le vent s’appuient les uns contre les autres et tiennent en équilibre comme un mikado géant. On entend les mésanges, puis on les aperçoit avec du soleil sur les ailes.
Le chemin débouche face au Catogne. On devine le Rhône, son coude sous Morcles, le début du val de Bagnes, les Dents du Midi à l’ouest. Au nord-est l’extrêmité du domaine skiable de Verbier avec un voile de couleur douteuse. Je n'entends par moments que le frottement des raquettes sur la neige dure, c’est comme le bruit d’un papier de verre 80 sur du bois tendre. Je longe par l’est les rochers du Grand Paray d’où les yeux plongent sur le Val Ferret, Praz de Fort et Issert. On devine la Fouly au bout de la route rectiligne qui se perd dans les bois que traverse l’autre Dranse que surplombe de l’autre côté le Mont Dolent, les Planereuses, la Petite Pointe, la Grande, le Clocher. Derrière le dédale des petits cols, la cabane de Saleina, son glacier, sa fenêtre par laquelle on rejoint le Plateau de Trient où je n’irai plus. De l’autre côté le fond de la coquille du Grand Combin. Le vent du nord a brodé d’est en ouest, à même le ciel, une longue bande de laine blanche dont les mailles filent. Ma journée est faite.
Descends en une petite demi-heure sur le domaine skiable, y retrouve les filles au bas du téléski. M’installe sur un transat pendant que les uns et les autres, en petit nombre, montent et descendent.
Il me faudra moins d’une heure pour rejoindre Vichères, en partie sur le postérieur, dans une semoule printannière, lourde et froide.
Puis la vie collective reprend ses droits.
Jean


Il sonne deux coups à l’église de Liddes

Deux chaises récupérées à la déchèterie, bancales, marron et vis apparentes encadrent une table de fer au pied forgé, rongée par la rouille, couches successives d’antirouille et de vernis turquoise. Je m’assieds sur celle de droite, lui manquent deux traverses, dépose ma veste par-dessus un cendrier rempli de mégots détrempés. Derrière, la vitrine d’une épicerie fermée depuis midi. Tout autour le soleil qui fait fondre l’hiver dans un décor de village oublié. La terre apparaît par endroit, une odeur de renouveau sans jonquille ni primevère. Des confettis macèrent dans le bassin. L’eau de la fonte est partout, mousse sous les roues des véhicules en contrebas, glougloute dans les descentes de chenaux, cuivre percé, tôles acides, glisse sur les lauzes, conduits obstrués par les épines des mélèzes, on entend le travail en-dessous des regards de fonte, l'eau coule épaisse au goulot des fontaines.
Me trouve dans une boucle, personne, dedans un lac, l’eau fait le reste, verse vers l’aval dans le lit de la Dranse, Orsières, Sembrancher, Martigny et le Rhône. Ne cède pas à la pente naturelle, mais remonte à contre-courant, sans effort, repassant par d’autres stations jusqu’à ce lac d’altitude en quoi consiste l'enfance. Pas de retenue, un carnaval silencieux, il sonne deux coups à l’église de Liddes.
Jean Prod’hom
Le bruit des petirs

Le bruit des petits, tantôt ici tantôt là, colonise les dortoirs avant de nous parvenir étouffé d'en bas. Une tête apparaît de temps en temps entre deux des poutres de la lourde charpente pour s’assurer que nous sommes bien là. Sandra a reçu un message d’Arthur, peu de mots, ils s’amusent, ils sont 4 dans la chambre, ceux avec lesquels il souhaitait passer cette semaine.
Le bleu s’est établi au-dessus de nos têtes et ne va plus nous quitter de la journée. Il est 11 heures lorsque Sandra, les filles et tous les autres quittent la Tzavannes pour les pistes. Je mets à jour ces notes et vais de mon côté.
A l’aveugle en direction du Petit Vichères, dans un peu de neige, dure, sans les raquettes dont j’ai fait l’acquisition hier. A quoi bon, je fais le pari idiot que le chemin que j'avais emprunté cet automne est un chemin également très utilisé en hiver. Prends conscience rapidement que je me suis trompé. M’enfonce toujours plus, mais avec la certitude qu’en rejoignant le chemin qui vient de l'entrée de la Combe de l’A, tout va s’arranger. Et bien non, j’enfonce un peu plus encore, jusqu’au genou lorsque j’arrive au Roc de Cornet. M’inquiète mais prends conscience rapidement que Dieu a bien fait les choses, deux jambes pour avancer et un entrejambe pour ne pas disparaître au centre de la terre.
Le hameau de Chez Petit paraît bien lointain, je prends alors le parti de me glisser sur le postérieur jusqu’à la route. J’y parviens après une demi-heure de reptation pénible, mouillé jusqu’à l’os, soulagé de mettre le pied sur le bitume noire sans avoir perdu quoi que ce soit. Me promène dans le village de Dranse avant de remonter jusqu’à Liddes. La patronne de l’épicerie du bas a fermé son magasin, il y a peu de passage. Vais voir les morts qui sortent la tête de la neige, au-dessus du cimetière le clocher de pierre entre comme un pic à glace dans le ciel bleu.
En redescendant à Dranse, croise trois vieux qui se promènent, un peu las, ils finissent leur vie dans un des chalets silencieux qui serrent les coudes sur la rive gauche de la Dranse, dans l’ombre. Leurs enfants vivent à Genève ou Martigny, eux sans voiture, une demi-heure à pied pour aller faire des courses, mais sans rancune, sans arrière-pensée, sans plainte.
Je remonte dans l’ombre de la Tour de Bavon, avant de retrouver une coulée de soleil couchant dans le virage qui précède Vichères. Songe aux vignes au-dessous de Ravoire, on les retrouve là, dans l’allure des vieux mélèzes moussus et barbus, vert de pierre, gris lichen. Mais on aperçoit au-dessus des vieilles branches du bas les nouvelles pousses fines, jeunes, presque transparentes, innombrables bourgeons prêts à faire éclater leurs épines vert d'or.
Sitôt arrivé je jette mes chaussures de marche, vieilles et détrempées, irrécupérables. Je me promets de prendre désormais mes raquettes.
Après le repas, notre amie pédiatre parle des héritages familiaux, on discute, on dresse la carte des blessures. Avant de m'endormir, je me souviens d'un ouvrage de Serge Tisseron qui se déplace depuis plusieurs années d’un rayon à l’autre de la bibliothèque et qui me fait signe.
Jean


Ce matin

Ce matin, Sandra a accompagné Arthur à Ropraz et l'a remis aux mains de René et Jean-Daniel, ceux qui nous relaient chaque semaine pour faire grandir le mousse loin de nous. Ils emmènent ce matin les trialistes de Passepartout dans un petit bus pour un camp d’entraînement d’une semaine près de Marseille. Je ne l’aurai pas vu lorsqu'il part, affairé au fond du lit à éponger la fatigue accumulée la semaine passée à Berne.
Lorsque je descends, Sandra prépare la bolognese, pour ce soir à Vichères, et les sacs. Me sens coupable de ne pas en faire assez dans la maison. On déjeune debout.
Les poules sont agressives, leur enclos est étroit. Elles voudraient sortir, élargir leur espace vital. Il faudra qu’elles attendent la semaine prochaine. Je remplis leur mangeoire et l’abreuvoir, ramasse un oeuf, rince l’arrosoir au goulot généreux de la fontaine. Je charge dans la 807 les skis et les souliers, les bâtons, les sacs de couchage.
Lucette et Michel passent en coup de vent. Lucette a besoin d’une signature de Sandra pour des travaux touchant l’immeuble dans lequel elle et son mari ont fait la boulangère et le boulanger. On passe avant de partir à la déchetterie.
Ai décidé de ne pas skier cette année, en sont responsables mon dos et une envie réduite de m'adonner à cette activité qui me laisse toujours plus sur ma faim. Louise dort dans la voiture. On s’arrête à Martigny où je me procure des raquettes, c’est la fin de la saison, elles sont à moitié prix. Il est 14 heures, on s’arrête dans un tea-room pour croquer dans des canapés et les filles salivent devant des tartelettes aux framboises. Et bien n'hésitons pas.
Les vignes en-dessous de Ravoire ont la couleur de la pierre. On imagine difficilement que quelque chose puisse sortir de là, tant l'alignement des plans, la scansion des échalas et le gris des murets des parcelles semblent étrangers à toute idée de fertilité. La proposition d’aller jeter un coup d’oeil à l’exposition de Bieler ne trouve aucun preneur, c'est l’avant-dernier jour. On passe sur les hauts d’Orsières et, du dessus des toits de lauze d’où sort la tête du clocher de l'église, il me semble impossible de vivre. Je sais pourtant qu'il suffirait que je me glisse dans les ruelles pour penser exactement le contraire.
On achète quelques salades dans l’épicerie de Liddes avant de rejoindre Vichères de l’autre côté de la Dranse. Nous sommes parmi les premiers à la Tzavannes. Quelques mots avec le propriétaire qui nous avertit que le temps n’est pas propice pour remonter la Combe de l’A, les avalanches pourraient descendre de la Tour de Bavon, mais surtout de la Crêta de Vella. Le temps s’est couvert. Nous sommes bientôt tous réunis autour d'un plat de pâtes.
Jean


Dernière journée à Berne

Dernière journée à Berne. Les élèves sont aux mains de la liberté, ils la méritent. Je leur ai fait les recommandations d'usage et vais me promener dans la direction opposée. Prends le bus 12 à la Zytglogge jusqu’au terminus, mais le Centre Paul Klee n'ouvre ses portes qu'à 10 heures. Je me promène autour des collines d'acier et de verre, avec le soleil, puis traverse le cimetière. Il règne un sain désordre dans le quartier des enfants, plastiques tapageurs, peluches et babioles, pierres et bouts de bois. Immobiles, vieillis. On devine les plaintes des parents qui en appellent au bon sens, mettez un peu d'ordre dans vos affaires ! ils finissent par élever la voix, les enfants ne les entendent pas, bien loin déjà, dehors avec ceux qui ne sont plus là.
Traverse le parc de sculptures, fers et bronzes raides dans la verdure, elles sont presque de trop entre la saignée de l'autoroute et la barrière des Alpes qui ferment l'accès au sud.
Je bâille à trois reprises, de plaisir d'abord, sur un banc au centre de la salle Müller, avec des images devant, la tête dans les mains. M'endors. Quelques minutes peut-être. Vais faire un tour, passe à la boutique où je fais l'acquisition du Journal de Paul Klee que Klossowski a traduit. En lis quelques pages sur le banc abandonné il y a un instant, un peu de déception, liée peut-être à la fatigue qui m'oblige à fermer les yeux pour la seconde fois, avec des peintures tout autour que je devine et visite comme si elles n'étaient pas là. Je rêve ou me souviens de ce qui s'est peut-être passé avant qu'il y ait quelque chose, et la décision de le montrer, de le faire advenir pour s'assurer qu'il ne pouvait en aller autrement.
M'arrête au retour à la Bärenplatz. Berne, c'est Fribourg en un peu plus grand, l'Aar et la Sarine se copient. J'hésite puis renonce à descendre prospecter sur la grève intérieure de la courbe du bout de la ville, un endroit propice à la récolte des restes de la vaisselle du monde.
Le carnaval se prépare, les hommes sont parés, fardés, déguisés. Mais quelque chose cloche. Je m'en rends compte plus haut dans la ville : les gens ne sont pas ivres.
Dans la cathédrale on entre désormais par la boutique obligeant le visiteur à capitaliser les souvenirs des mystères avant de s'en approcher. Demain, il nous faudra payer pour prier.
Près du choeur, les départs des voûtes d’arête sont appuyés sur des culots ornés de sculptures colorées, où je retrouve les Bernois de carnaval, mais grimaçants, souriants, ivres. Une Déposition dans le bas-côté gauche de 1870, oeuvre d'un admirateur du Bernin, fait voir sur ses flancs la double blessure : celle du corps, celle du marbre.
On se retrouve devant l'Arena mais les modifications du réseau des transports publics imposées par le carnaval du week-end ne nous facilitent pas la tâche. On manque de rater le train, la chance en a voulu autrement, tant mieux. Les visages sont fatigués, je somnole entre Fribourg et Chexbres, m'étonne comme toujours lorsque la vue embrasse le lac. On se sépare dans le grand-hall. Je récupère la voiture de Sandra derrière le cimetière qu’a ramenée Michel, hier ou avant-hier, après les réparations.
Jean


CI

En brûlant les livres de la bibliothèque de son salon, Jean-Rémy crut pouvoir supprimer son ignorance. Il y parvint.
Jean Prod’hom
Gaël

Gaël, dont je n'ai pas vu le travail hier soir, se réveille plus tôt ce matin. Il me soumet son intervention rédigée la veille, un peu gauche mais excellente. Nadia, notre accompagnatrice nous rejoint sur son vélo, emmitouflée, le nez rouge, grosse couverture nuageuse et froid. On part pour le centre-ville, le tram numéro 9 d'abord, le bus 11 ensuite jusqu'au quartier des ambassades, au sud-est de la boucle de l'Aar. Petit bonheur loin des abris, le jour, l'air libre.
Le quartier des représentations ne paie pas de mine, sans caractère, villas cossues et modestes immeubles résidentiels. Devant l'ambassade de Turquie une famille attend, patiente derrière un grillage édredon et sacs de voyage à la main. A côté des militaires armés, devant le portail central une voiture de police. La petite porte voisine s'ouvre à notre demande et le premier conseiller de l'ambassade nous accueille, nous introduit dans le hall, le dispositif de sécurité doit être en panne. Il improvise un discours, évoque à voix basse sa fonction et celle de ses collègues, sous le portrait de Mustafa Kemal Atatürk qui surveille les entrées et les sorties. Notre guide parle à voix basse, comme s'il n'avait pas remarqué que nous étions là, comme s'il se parlait à lui-même ou à la postérité, il remercie naturellement la Suisse et ses bons offices, nous rappelle que Lausanne a accueilli une conférence en 1923 au cours de laquelle les signataires abandonneront le traité de Sèvres qui avait décidé du sort de l'Empire ottoman à la fin de la Grande Guerre et reconnaîtront les frontières encore actuelles de la Turquie. Il vante les charmes de Montreux où, en 1936, la Turquie rétablit sa souveraineté sur le Bosphore et les Dardanelles, commente les accords de Zurich qui réévaluent, à la baisse, le rôle des Britanniques dans le dossier de Chypre. C'était en 1959.
Il nous conduit ensuite le long des couloirs de la section consulaire, on y passe en coup de vent. Les employés y arrivent au compte-gouttes, les mains vides, dans cette bâtisse un peu poussiéreuse que l'on quitte bientôt pour la résidence de l'ambassadeur, de l'autre côté d'une pelouse amaigrie par l'hiver.
Mobilier en chêne, grande table chargée de victuailles. Le conseiller, en bout de table, interroge les élèves sur la vison qu'ils ont de la Turquie, ils n'en ont pas véritablement une. C'est beaucoup trop le demander. En ai-je une ? Mais je devine l'entreprise du bonhomme, il a envie de nous dire que la Turquie n'est pas celle que l'on croit, souhaite redresser nos images d'Epinal. Je le lui accorde bien et le regrette, mais je n'y puis rien : le Turc est fort comme un turc, c'est ainsi, l'école n'a pas été inventée pour se défaire de nos fantômes mais pour les faire renaître. Alors je lui raconte, un peu par provocation, que les élèves helvétiques ne croisent que très peu l'histoire de la Turquie et de l'Empire ottoman. Il y a bien sûr Troie, mais Troie c'est l'Asie mineure, et l'Asie mineure c'est le miracle grec. Il y a les croisades, la prise de Constantinople en 1453, les Ottomans à la porte de Vienne en 1683. Bref une histoire qui ne leur fait pas la part belle. Le temps passe en parlotes tandis que les gosses goûtent sans perdre une miette aux plats que le cuisinier de l'ambassade a préparés.
Passe l'ambassadeur, un bref instant, pour nous faire voir qu'un conseiller d'ambassade peut être obséquieux. C'est au tour du fils en vacances en Suisse, il fait ce qu'il faut faire pour déguerpir au plus vite mais avec les manières. La femme enfin, en poste diplomatique à Ankara, qui profite de notre attention pour vanter les merveilles de la Turquie, le soleil et la plage. Venez ! venez l'été prochain ! vous êtes tous les bienvenus sur les plages de l'Anatolie.
Pour l'instant il nous faut filer sur la place fédérale ou Samuel Schmidt, les responsables du nouveau sponsor, La Mobilière, ceux de l'association Ecoles à Berne nous attendent pour des interviews et des photos. Une journaliste des radios romandes interrogent quelques élèves.
Au moment où il nous faut entrer dans le Palais fédéral, H. et M. sont absentes, on les recupère grace à nos portables. Plusieurs parents sont arrivés, le directeur et S. sont également là. Beau débat, parfois convenu mais belle tenue de chacun, fierté des parents.
Sur le mur contre lequel est adossé le bureau du Conseil, la fresque de Charles Giron : le lac des Quatre-Cantons, les pâturages, l'allégorie de la paix confondue dans les nuages qui surplombent Schwytz, le chemin jusqu'à Brunnen, emprunté lors de ma balade juqu'à Sils Maria. Cachée derrière les Mythen l'abbaye d'Einsiedeln et le chant des Bénédictins qui m'avait tant boulversé.
Je suis assis devant le pupitre 188 du Conseil national, fermé à clef, j'entends pourtant les mandibules d'un animal qui ronge le bois. M'inquiète. On m'apprend qu'il s'agit du bruit d'un appareil électronique oublié par le Conseiller national dont j'occupe la place.
Retour avec le tram 9. Repas de cantine, discours de clôture. Épuisé. Enfin au lit.
Jean


C

Fanfan a voulu donner son corps à la science. Mais la Faculté n'a rien trouvé de bon chez le bonhomme. Coup de téléphone à la veuve :
– Si vous voulez bien le récupérer ...
Jean Prod’hom
Il y a des voix qui sonnent juste

Il y a des voix qui sonnent juste, celle par exemple du conseiller national Christian van Singer rencontré ce matin dans la salle de commission numéro 3 du Palais fédéral, un militant vert honnête, indépendant, phrases courtes, propos sans ambiguïté apparente, sans exagération ni pathos. Avec ce petit air désespéré qui donne un peu de lest aux discours si souvent creux des politiciens, sourcils à la voûte surbaissée, un homme d'un certain âge qui n'a au fond plus rien à perdre, qui ne tient pas à gagner des majorités. De ces gens qu'on imagine ailleurs que dans l'arène politique, sans grande efficacité - ou souterraine - dont la rencontre ne produit pas d'autre effet que le rappel qu'ils existent.
Malgré le froid, cinq degrés au-dessous de zéro, on vit à l'intérieur de soi un temps de primevères, c'est à cause du ciel et de l'étrangeté des lieux, perceptible tout autant derrière le vitrage du café de l'Arena que sur l'esplanade du Palais fédéral. Mais aucune fleur ne se fait voir, on les attend, ce sont des mouchoirs en papier froissés qui traînent dans les jardinets qui s'étendent au pied du mur de soutènement de l'esplanade. Je cherche encore, pas de jonquilles, elles auraient déjà dû apparaître si les choses suivaient le cours de nos désirs.
H. a oublié le cadeau qu'elle a acheté pour Christian van Singer, je retourne au bâtiment de la Zivilschutzanlage pour le récupérer. Je surprends ce lieu qui ne s'attendait pas à mon retour, je ne devrais pas être là, profite sans modération du plaisir qui m'est donné de voir ce que je n'aurais pas dû voir, voir les choses telles qu'elles sont quand je n'y suis pas, c'est-à-dire un peu comme la première fois, ou à revers. On peut, je crois, être dedans et dehors, à certaines conditions que je commence à apprivoiser.
Dans le tram 9 qui me ramène au Palais, une vieille dame me sourit, elle cherche à lire ce qui est écrit sur mon badge. Je lui souris mais hésite pourtant à lui faire voir distinctement ce qui l'intrigue, inquiet de ne pouvoir lui répondre si elle m'adresse la parole. Elle a la peau sur le visage, fine et presque bleue, un ours doré à la feuille épinglé sur le col de son manteau de laine, vert militaire. On voit les os de son crâne, ses mâchoires animales, les orbites de ses yeux. J'aperçois l'objet vers lequelle elle tend. La mort qui rôde n'empêche pas qu'on se sourie.
J'entre dans le Palais avec mon appareil de photos, interdit dans le saint des saints politiques, pour faire quelques photos de la salle de commissions, des élèves avec Christian van Singer.
On se donne rendez-vous à la Zivilschutzanlage, je m'écarte alors du chemin qu'empruntent les élèves en me laissant dériver à l'arrière, fais une photo du Kornplatz aperçu ce matin, dans le soleil et sous les arcades, juste après le pont qu'emprunte le tram numéro 9 pour franchir l'Aar.
Toute l'après-midi et le soir à aider les élèves à rédiger les interventions de demain, j'en sors défait. Puise toutefois encore, dans le peu qui me reste, ce qui me manque pour écrire ces notes.
Jean


A.17

Une constitution fournit à l'homme des idées régulatrices, si bien que les principes qui la constituent n'ont pas force de loi. Leurs pouvoirs sont ceux de la poésie, ils obligent à ouvrir le compas de notre esprit. Leur empan est comparable à celui des énigmes.
Jean Prod’hom
Il y a les passions souveraines

Il y a les passions souveraines
les petits déjeuners
les bréviaires
il y a les rêveries du promeneur solitaire
les couteaux de poche
les échanges bilatéraux
les idées de portée générale
le regard éloigné
le causse Méjean
Jean Prod’hom
Dans le bus

Dans le bus qui me conduit du Mont - où j'ai laissé la Yaris - à la gare, un homme revenu de tout, des vagues immobiles sur son front plissé, un visage fait de plaques se chevauchant ici, se repoussant là, me renvoie à la tristesse des zoos, la solitude des pachydermes. Il descend du bus avec une grosse serviette noire, lourde de papiers qui le tiennent en équilibre, ils font corps tous les deux, c'est un homme honnête bâti par le travail.
Quelques degrés sous zéro, le ciel indécis. Je croise quelques anciens élèves dans le bus, ils vont au gymnase, ça va au pas, les gestes mesurés, l'enthousiasme en berne.
Des clients fument adossés à la grande baie vitrée du Buffet de la gare, c'est la loi. Assis dedans j'apprends dans le 20 Minutes que le Traquet moteux fait plus de 30'000 mille kilomètres chaque année. Ne sais pas bien pourquoi, mais cette nouvelle me réconcilie avec la ville. Les fumeurs rentrent refroidis, avoir cessé de fumer est peut-être la seule chose que j'aie faite en connaissance de cause et que je conduirai peut-être jusqu'au bout, un acte libre.
A l'angle formé par l'avenue Ruchonnet et l'avenue William-Fraisse, le soleil éclaire soudain la proue d'un vaisseau immense qui fend l'extrémité de la Place de la Gare. On est tous là, les élèves silencieux mais les formalités m'auront volé le voyage en train.
Coup de solel sur la Guisanplatz à Berne, les travaux de notre session parlementaire peuvent commencer. Mais je sens que la fatigue me gagne déjà. Pas le temps de prendre un peu de temps dans la vieille ville. On passe l'après-midi dans une caserne pour l'élection de la présidente et de la vice-présidente du Conseil, la fraction du Mont rate de peu la présidence, mais emporte de haute lutte la vice-présidence.
Sandra m'a laissé un message, la 807 est en panne, je l'appelle, elle a pu récupérer la Yaris au Mont. Pour le reste tout va bien. Des travaux ce soir encore avec les présidents des fractions et les présidents des commissions. L'impression pourtant de n'avoir rien pu entrependre librement me pèse avant de me coucher, sous terre, dans l'un des innombrables dormitoirs du réduit national.
Jean


48

Les grognements du sanglier, les cris de la fouine, les grincements de la chauve-souris couvraient autrefois le bruit sauvage que faisait entendre sur le parchemin la plume saturée de fiel des poètes. Ce sont les coups de becs du pic contre l'arbre mort qui couvrent aujourd'hui les activités illicites des poètes, leurs doigts gourds martelant sur leurs machines une étrange litanie, celle des tweets désespérés.
Jean Prod’hom
Arthur est réveillé
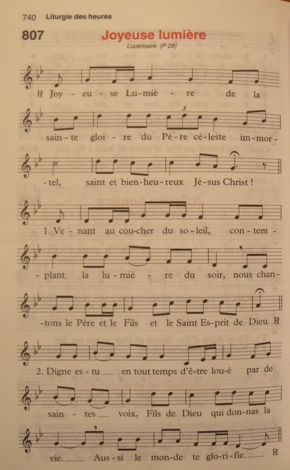
Arthur est réveillé lorsque je me lève à 6 heures et demie, le ciel est dégagé, on part à 8. Petite halte à la COOP de Charmey où le mousse ajoute à son casse-croûte un paquet de bonbons qui n'était pas prévu. Lui retiens la somme sur le salaire que lui vaudra le ravitaillement en bois du mois prochain. Son forfait ne me fait pourtant pas hésiter, je le confie aux amis du club de trial. Il fait grand soleil.
Sors de Charmey par le chemin de la Petite Fin, passe sous le parc à biches, les clôtures ont été déposées. D'en haut on voit le gâchis de la police des constructions. Aucun propriétaire ne s'en cache, chacun en fait à sa tête, veut s'émanciper des idées que la pratique du lego lui a imposées, il y a choisi une construction aux normes minergie, aux formes originales, à l'orientation originale, si originale que toutes ces bâtisses se ressemblent ou ne ressemblent à rien, un chantier où tout semble en sursis. Tout indique que rien ne durera, resteront des ruines trop jeunes pour être crédibles.
La neige fond, fait la place à l'odeur de la terre, quelque chose de la pourriture sur les bas-côtés, la sève aussi, le souvenir du trèfle alpin, l'odeur de résine surchauffée, quelque chose qui rôtit. Plus loin un bassin à l'eau généreuse où je fais le plein, des pains de glace tout autour.
Entame alors 400 mètres de montée dans la neige de printemps, sans rien à me mettre sous les pieds, j'enfonce, brasse la neige, il en est tombé là bien plus qu'au Riau. Me faut-il accélérer l'allure et transpirer, m'alléger ainsi en espérant que le manteau neigeux tiendra ? Des sportifs correctement chaussés, raquettes ou peaux de phoque me dépassent allégrement. Songe à acquérir dès demain une paire de raquettes.
Il me faudra deux bonnes heures avant de parvenir à Vounetz, sur les boulevards offerts à ceux qui n'ont pas d'ailes. Sandra et les filles ont rejoint les skieurs. Je leur envoie un message depuis le téléphone que j'emporte pour la première fois. Ça marche, on se retrouve tous pour le repas de midi, il est une heure.
Décide de redescendre par le même chemin, R. et son frère m'accompagnent. Le premier a des raquettes, je l'observe, ma décision est prise.
A Montminard, entre Vounetz et Charmey, on retrouve la fontaine, le soleil a fait fondre les pains de glace. Victor attend sur un billot d'épicéa la Saint-Joseph. On discute, il a travaillé une grosse partie de sa vie à la scierie, il n'aime pas l'hiver, c'est pour cela qu'il est là, il attend le 19 mars. Il aime les longues marches, partir de nuit, thermos et viande séchée. Je lui demande si je peux faire une photo, oui mais ça coûte de faire le mannequin. Je lui propose un verre à Charmey, ah ! moi les bistrots, faire le mannequin, à 73 ans, tant qu'on peut en rire, le soleil ne coûte rien.
J'ai transporté dans mon petit sac à dos ton Carnet de notes 2001-2010, un petit kilo. Je pensais en lire quelques pages chez Dudu ou à la Vounetz. Pas eu le temps, juste le temps d'avancer, marcher, et ça m'a fait du bien.
Arthur va skier encore un peu, c'est la maman de L. qui le ramènera. La COOP de Charmey où on devait se retrouver pour faire quelques courses est fermée, Sandra et les filles rentrent pour leur compte. A Broc on prépare le carnaval. Je les rejoins au Riau peu après.
Ceci encore : deux mésanges charbonnières. L'une à l'aller, l'autre au retour, toutes les deux le soleil sur le ventre, leur chant dans le ciel.
Jean


Me demande sitôt réveillé

Me demande sitôt réveillé comment je ferai la semaine prochaine à Berne pour tenir ma petite entreprise. Décide de différer jusqu'au soir cette inquiétude pour ne pas assombrir une journée qui ne le demande pas.
Par le velux, un convoi de nuages venant de l'ouest, des lambeaux plutôt, mêlés à de la cendre, étagés, sans qu'on sache vraiment s'il fuient ou vont de l'avant, eux ne se posent pas la question, commandés par l'unique désir d'être la où ils sont avec les autres, c'est en cela qu'ils sont mystérieux. On aperçoit parfois au milieu de cette agitation, derrière le rideau qui s'entrouvre, des morceaux de ciel bleu. Je remue les doigts, puis les bras, mon dos fort pris à parti hier entre Charmey et Vounetz répond à contretemps.
Quelques degrés se sont ajoutés à ceux d'hier dans la maison. On hésite à répéter aux filles, une dernière fois, de mettre une jaquette et des chaussettes au saut du lit. Quelques mouches se réveillent. Je me rendors avec le pressentiment que je ne verrai rien de cette matinée. Les filles nous appellent pour le déjeuner qu'elles ont préparé.
Les enfants travaillent une partie de l'après-midi pour l'école, Sandra avec les filles en-bas, Arthur seul dans sa chambre. Je crois bien qu'ils ne savent pas toujours ce qu'ils font et pourquoi ils le font. On aimerait bien parfois que ceux qui sont à l'origine de ces travaux réfléchissent avec eux.
Grande boucle dans la neige, par le sentier d'en-haut et le refuge de Corcelles. Dans le verger du Chauderonnet, un vieux pommier a versé. Je croise au retour Ch. qui me raconte : c'est la bise et la neige, le vieil arbre n'a pas supporté. Mais les vaches sont un peu responsables aussi, elles viennent pâturer à la belle saison et y frottent leurs flancs, ce sont des pommiers que le grand-père a plantés, ou l'arrière-grand-père. Le plus faible, recouvert de mousse et de lichen, a laissé ses racines dans la terre. Ils vont en planter un nouveau, mais il devront interdire aux vaches de pâturer. Ch. m'apprend qu'il va commencer une école en Valais dans laquelle on apprend les métiers de la terre.
Le temps s'est refermé sur le monde, temps d'huître encore, et pour confirmer cette image, le soleil apparaît pâle comme une perle derrière les nuages.
Je ramasse 4 oeufs au poulailler. A l'ouest, tout à l'ouest, les restes d'un immense incendie, braises lentement noircies par des fumées âcres. Il est temps de préparer ma semaine à Berne.
Jean


Moins de 15 degrés sous zéro

Moins de 15 degrés sous zéro avant le lever du jour, mais la bise ne siffle plus, les tuiles ont cessé de trembler, la charpente se repose désormais. Je fais du feu dans le poêle en écoutant les nouvelles, ici les politiques ne lâcheront plus la langue de bois jusqu'à mars. Il fait encore nuit lorsque je pars au Mont, dans le ciel la lune décroît, elle regarde ailleurs, se détourne de nos affaires – son autre vie – s'impose à d'autres, comme le soleil d'été à l'aurore, lorsque la montagne ne parvient pas à le contenir derrière l'horizon.
Les préparatifs pour Berne vont bon train et quelques élèves de la classe 11 font voir un enthousiasme solide, ils ont compris, ceux-là, que ce qui donne de l'assise à ce qu'ils disent, c'est aussi ce qui les élève. Ainsi H. qui disait sa crainte abyssale de parler en public ne lâche plus désormais la parole lorsqu'on la lui donne, s'en saisit même, convaincue que son propos fera avancer les choses. Et les choses avancent. Pour le reste, bien des aspects de cette semaine que nous allons passer à Berne m'inquiètent un peu. Seront-ils à la hauteur ? Et moi assez détaché pour ne pas les encombrer de ma présence ?
De la classe 9 on n'aperçoit qu'à peine les crêtes du Jura dont d'épaisses poussières ont fait disparaître les contreforts. Le gris du ciel s'est glissé derrière, un timide pinceau d'aquarelle a passé un peu de bleu pour indiquer l'horizon, trait timide mais large qui ondule, plein d'eau et de rondeurs. Rien ne bouge. Certains élèves attendent, ils font ce qui leur est demandé puisqu'il le faut bien, à moins qu'ils parviennent à l'éviter, ils ne se risquent pas à sortir la tête loin de leurs épaules, ils veillent, intègres.
Lance les élèves de la 6 sur l'écriture en creux de cinq événements, – correspondant chacun à l'un des jours qu'ils ont passés à Crans-Montana –, qu'ils auront à taire, ou à représenter comme une empreinte fait voir ce qui n'est plus. Ils disposeront à cet effet d'une subordonnée, d'un groupe prépositionnel et d'un groupe nominal. Pas plus pas moins étant admis qu'ils pourront désobéir.
Le soleil est entré dans la Yaris lorsque je quitte le collège et je le remonte jusqu'au Riau. Ça fait une éternité qu'on ne l'avait pas vu. Les enfant ont le sourire, Arthur part avec Sandra sur Moudon pour s'informer de la voie qu'il pourrait emprunter dès la fin de l'été prochain. Il me semble que les choses sont déjà bien avancées et qu'il se dirige dans la direction qui fut celle de sa mère. Je n'en suis pas mécontent.
Lili me confie, tandis que je l'accompagne à Mézières pour sa leçon de flûte, qu'elle se réjouit de jeudi, à cause de la poterie et de M. qu'elle se réjouit de revoir ; de mercredi et des poneys aussi quand bien même elle n'est pas sûre que le sol du manège soit assez tendre. Pour le reste elle dessine des coeurs, épelle les noms de ses prétendants, demain c'est la Saint-Valentin. Je trouve un peu de temps pour lire quelques pages de ton Carnet, au Central devant un thé. La demi-heure passe sans que je puisse la ralentir.
On se rend à Oron récupérer Louise. On passe d'abord à la boulangerie et on grignote deux pièces sèches percées d'un coeur sur les escaliers du bâtiment dans lequel Louise prend ses cours de guitare et de solfège, on y croise G. et sa fille qui attendent comme nous, Louise sort enfin, enchantée. Elle croque sa pièce sèche. Sitôt rentrée elle joue en boucle une valse de Daniel Fortea qu'elle travaille depuis la semaine passée. Je passe la soirée à la bibliothèque, me couche à plus de minuit. Je crois bien que toutes nos vies se ressemblent, qu'on ne le sait pas toujours, ou seulement tard dans la nuit.
Jean


Un air glacé

Un air glacé m'accueille au bas des escaliers, la porte d'entrée est en effet restée entrouverte toute la nuit. La mauvaise humeur me gagne, incapable de la raisonner : le dernier qui est allé se coucher n'a pas pris la peine de tirer le loquet de la vieille porte qui s'ouvre au moindre coup de vent, je le sais, tout le monde le sait. Qui est donc monté se coucher en dernier ? Pas moi. A quoi bon tous ces efforts pour tenir le froid hors de la maison,... J'ai bien conscience que je file le mauvais coton mais la connaissance de cette vilaine habitude ne suffit pas à m'attendrir, le feu tousse, je m'agite, inquiet que le bus parte sans les garçons, précipitation, je m'en veux. Mes premiers pas dans la journée sont bien aigres.
Petite rédemption au retour. Louise joue en boucle une valse de Daniel Fortea. M'assieds près d'elle, submergé par la douceur de cet air simple, les égards que Louise lui porte, le soin qu'elle y met. Lili s'exerce aux majuscules. L'avenir est à nouveau possible. Tout est beau d'un coup, la route blanche jusqu'au château, noire de pluie au Torel. Je passe à la Goille régler la livraison des deux stères que F. nous a livrées il y a quelques semaines. La valse et le grand air assurent ma guérison.
Prépare avec les élèves le travail de la semaine prochaine, les persuade qu'il y a une vie en mon absence, qu'ils ont toutes les qualités pour ne pas chasser les questions qui tardent à trouver une réponse. La panne de courant au milieu de la matinée réjouit un bref instant les collaborateurs du collège, tout le monde stoppe ses activités, tous, comme si ces petites catastrophes redonnaient un peu de jeu à ce qui n'en a plus guère. Et ce qu'on a perdu de vue revient, on salue cette sensation de vacances qui nous rapproche, à la dérobée, de quelque chose qui fait partie de notre secret. On regarde avec le sourire ceux qui sourient. On rêve que cette panne dure, sème son joli poison plus loin.
Par la fenêtre on aperçoit le Jura desserrer l'étau mou des nuages, le soleil en profite pour s'engouffrer dans la Vallée de Joux, puis c'est au tour des fumées du quartier de briller bleues au-dessus des cheminées. Quelques minutes dans la classe vide, le temps passe, personne, ce n'est pas désagréable de ne pas être là, avec la trotteuse qui court dans le vide et hausse les battements de son coeur. Me lance dans l'air tiède de cette fin d'après-midi, satisfait d'en avoir fini, pressé de retrouver le Riau. On a gagné plus de vingt degrés en deux jours, la pluie a déglacé les alentours, le froid retrouve un nom, la neige colle, le noir se mélange au gris, on se réveille soudain dans le coeur d'une huître.
Jean


(FP) Faire subir aux choses d'infimes variations de langage

Plutôt que de vouloir saisir l'essence immobile des choses, tenter d'en dégager la vérité et le passé qui les vertèbre, sans lesquels elles n'auraient pas reçu de nom, il m'avait confié qu'il souhaitait plus modestement s'en approcher, en tenant compte de ce qui advient d'elles lorsqu'on fait subir, en leur voisinage, d'infimes variations de langage, et qu'on les confronte sans les raidir à la diversité de nos humeurs, à la lenteur des jours qui passent, au temps qu'il fait, à l'horizon, au hasard.
C'est là peut-être que la littérature a tout son sens, parce que c'est elle qui, multipliant les chemins, détours ou raccourcis, nous affranchit de celui qu'on emprunte jusqu'à plus soif, nous détourne de ce qu'on ne cesse de voir, en nous invitant à répéter après elle les formules avec lesquelles elle se confond pour nous orienter autrement hors d'elle. Sans cela le paysage ne serait qu'un visage fini et ton visage une promesse passée.
Si on n'usait de nos forces que pour lever les obstacles qui se présentent et contre lesquels on se bat sans compter jusqu'à l'épuisement, si on ne contournait pas par ruse ce qui jour après jour nous laisse insatisfaits, si on ne mélangeait pas un peu les mots et les choses, dans quelle disposition serions-nous ? Et quel temps nous resterait-il pour aimer ? (P)
Jean Prod’hom
Ici la colonne de mercure

Ici la colonne de mercure remonte vers le zéro, mais la fine couche de neige tombée la veille s'est maintenue, la pluie va se mêler à l'affaire et répandre la grisaille dans les mailles du suaire. Pas trop envie d'aller travailler, c'est ma gorge qui le dit, elle se resserre et tient mon appétit à distance. Le Conseiller d'Etat Pierre-Yves Maillard n'en manque pas. Invité au milieu du déjeuner, il démontre en peu de mots et avec le ton qui convient que l'engagement politique, lorsqu'on a les épaules larges et une modestie bien trempée, n'est pas mort.
Je dépose Arthur et D. au bus et file au Mont pour apporter ma contribution à l'état inquiétant des affaires du monde, goûter peut-être à ces moments de grâce qui voient l'intelligence se lever avec le sourire. Ils ont appris, ceux-là, tant qu'à faire et qu'ils sont là, à se prêter au jeu qu'on a cru bon leur proposer, découvrir en y séjournant ce que d'autres ont été, un peu d'autrefois, un peu d'ailleurs.
Remonte au Riau, ramasse Arthur que je dépose à 13 heures dans un café de Moudon pendant que je passe sur le fauteuil de l'hygiéniste dentaire. Elle est depuis peu la mère d'un petit Alexandre né il y a 4 mois. Tout va bien, la routine déjà, un 40%, les parents pas loin lorsqu'on en a besoin. Il faudra que je repasse dans 15 jours. Arthur a fait ses devoirs devant un chocolat chaud.
On poursuit jusqu'à Lucens pour qu'il remette en ordre son vélo sous l'oeil avisé de D. A moi d'attendre. En profite pour aller jeter un coup d'oeil aux berges de la Broye qu'on avait dit gelée. La révision du vélo ne suffira pas, on est condamné à en acheter un nouveau, D. nous propose un vélo japonais, dont l'importateur est implanté à Zurich. Cette proposition ravit Arthur, elle me rendra aussi la tâche plus facile, incapable que je suis de toute réparation.
Le mousse est venu me rechercher au café du Poids, occupé à lire quelques pages de ton Carnet devant un thé. Difficile. Neuf dames dans la soixantaine assises autour d'une table ronde font tourner les potins de la semaine. S'arrêtent longuement sur le fait que la plupart de leurs petits enfants ne veulent pas faire leur confirmation. Elles font comparaître ensuite chacune des personnes rencontrées dans la région, palabrent avant de décider ce qu'il faudra en dire. Il est 18 heures lorsqu'on rentre. Deux allers et retours encore jusqu'à Ropraz, pour l'entraînement, sur une route à nouveau enneigée, blanc béton.
Eprouve des difficultés avec ma tablette. Elles me rendent de sale humeur et aveugle. Malheureusement je suis obstiné, je n'aurai embrassé avant la nuit ni Sandra ni les enfants. M'en veux.
Jean


Il y a l'avenir qui s'ouvre comme un vase

Il y a l'avenir qui s'ouvre comme un vase
le soleil dehors
le soleil dedans
il y a la pâte qu'on étend
à midi la porte qui claque
il y a les lasagnes qu'on glisse au four
les cris des enfants qui s'éloignent
le petit tour
les débuts d'après-midi mains libres
Jean Prod’hom
C'est un un bruit de crécelle

C'est un un bruit de crécelle, précédé d'un sifflement, qui me réveille, un rouge-queue, le rouge-queue qui niche au-dessus de la porte d'entrée, peut-être. Je me suis réveillé à 5 heures, somnole jusqu'à 6, le jour se lève. Il faisait rose hier soir, il fait rose ce matin. Louise nous régale d'une valse de Bartolomé Calatuyud.
Panique avant de partir à la mine, je ne trouve ni mes clés ni mon sac, le sol s'entrouvre sur le vide : Arthur va rater le bus, je vais devoir le conduire jusqu'à Mézières,... Retrouve bientôt le tout et mes esprits.
Le soleil apparaît au-dessus des Préalpes, comme hier, comme tous les jours, mais aujourd'hui les maisons se tournent vers lui, leur visage s'éclaire, celui des hommes aussi. J'écoute la radio, une femme raconte : Il y a plus de choses que je ne savais pas que de choses que je savais, alors j'ai décidé d'apprendre.
Constate que plus de la moitié des palplanches sont placées au Mottier. M'assieds dans l'un des 6 fauteuils rouges de la salle des maîtres, silence et voix basses, puis la sonnerie annonce la débâcle, la salle se vide, reste la stupeur d'un espace rendu à lui-même. C'est seulement alors que je rejoins les élèves. Leur soumets l'énoncé suivant : la phrase est à la langue ce que le mètre est au système métrique. On se penche ensuite sur le verbe être, son isolement dans le système, son comportement grammatical, sa puissance.
Je pars à 10 heures pour Moudon, avec une sensation de liberté, comme chaque fois que je vais ailleurs, là où je ne devrais pas être. Personne sur la route, ni à Syens, personne non plus dans les autres villages. Le centre de Moudon est désert, la circulation est interdite au pied du chevet de Saint-Etienne : deux ouvriers retirent d'une fouille une vieille ligne téléphonique.
Au cabinet dentaire il y a au contraire du trafic. Mais j'y entre avec la sensation d'être en vacances, une sensation qui s'étend et qui me conduit à penser que tout le monde l'est. Et cette pensée a pour effet d'alléger la vie de chacun, la mienne, la leur, le vide se conjugue avec la brise et les sourires, et j'avance sans rien déranger sur les pavés. Sors pourtant de chez le dentiste avec l'assurance d'y avoir laissé quelque chose : une dent. En échange, l'acceptation du temps qui passe. Le soleil est haut dans le ciel, il est midi.
Sandra et les enfant sont à la véranda, je mange un yoghourt. Elle a trouvé des billets d'avion pour Berlin, puis a déniché un hôtel. On sort la petite table verte et les chaises qui avaient passé l'été dans la serre. Quelque chose a changé dans le jardin, ce sont les couenneaux qui entouraient la demi-douzaine de carreaux dont on peinait à s'occuper. Je les ai retirés dimanche, j'espère secrètement que les cosmos et la rhubarbe reviendront.
Dans les prés, l'herbe nouvelle chasse la vieille filasse sèche. Je lâche Arthur en haut de Ropraz pour qu'il puisse chauffer les freins de son nouveau vélo. Il sonne six coups à l'église de Mézières, bois une camomille à l'auberge en corrigeant les derniers travaux rédigés par les élèves avant la semaine à Berne. Globalement du bon, du très bon travail. Ils sont loin encore pourtant de l'idée qu'une bonne charpente est celle qu'on ne voit pas. Ils ont tendance encore à travailler de proche en proche, ils ajoutent à leur construction qui ne tient pas des contreforts, étendent une nouvelle couche de dispersion par-dessus le salpêtre.
Le tilleul que le voisin a taillé il y a quelques jours donne l'impression d'avoir perdu la tête.
Jean
On a gagné une dizaine de degrés

On a gagné une dizaine de degrés ce matin mais il n'y paraît pas. Edelweiss boit à la fontaine, il fait encore nuit. Lorsque j'accompagne Lili à la patte d'oie, les corneilles se font entendre avec un bel entrain, pour la première fois cette année et une demi-douzaine de moineaux s'ébroue près de l'étang. La couverture nuageuse s'est déchirée à l'est sur la chaîne des Vanils qu'on peine à deviner derrière la bande de stratus. C'est que nous, ici au Riau, on est comme entre ciel et terre. Au retour je vois cette brèche s'élargir et faire sauter le verrou au-dessus de la Mussilly. La neige a pris des teintes bleues, le fût des hêtres aussi.
Tente de régler les problèmes de la chaudière. Monsieur K, l'installateur, soupçonne que les tiges en caoutchouc qui plongent dans les citernes sont poreuses, l'air et la saleté remuée lors du remplissage des cuves remonteraient jusqu'au brûleur. Le fournisseur de mazout ne sait pas trop quoi me dire, je prends conscience que son travail consiste à vendre, rien de plus. Monsieur K passera l'un de ces prochains jours pour voir ce qu'il peut faire. Je prépare une tarte aux pommes pour midi.
Il fait trop froid encore pour s'installer dans la véranda, malgré le soleil qui a dégivré les vitres, Cacao le lapin n'en profite pas non plus, il se terre dans les copeaux. Fleur a pris les devants, va et vient entre les repousses dégarnies du gros tilleul qui se dressent dans le ciel. Enfoncé dans le canapé, sous des couvertures, je poursuis une bonne heure la lecture de ton Carnet – 2007, les heures sombres.
Ce midi, Louise pique-nique à la piscine, Lili mange comme un moineau, tout entière à la Saint-Valentin, Arthur me parle de Charlemagne sur lequel son interrogation d'histoire a porté. Il faut faire vite, on vit ici dans l'urgence, à mi-chemin de l'horaire continu et de la pause dodue dont on disposait il y a quelques décennies entre midi et deux. Une situation qui affecte les affaires des habitants des maisons foraines trop éloignées des centres, on nous a oubliés. Il faut que tu saches que les horaires de nos trois petits sont tous différents si bien que nous faisons chaque jour 12 allers et retours jusqu'au village. En nous organisant avec les parents des enfants du coin, on a divisé cette folie par trois.
Personne ne peut lever les yeux continuellement vers le ciel, il n'y a pas d'autres explications à mon étonnement lorsque je m'aperçois en début d'après-midi que le ciel a blanchi à l'ouest et qu'une fine gaze s'est déposée sur les pavés de la cour. C'est pourtant ce à quoi il faudrait s'astreindre pour comprendre à la fin pourquoi il y a plusieurs jours dans le même jour.
Me décide à faire le petit tour, je m'avise bien vite que la tête ne suit pas le corps, elle traîne en arrière. Je tente sans succès de la remettre à sa place. Vais ainsi jusqu'à la Moille au Blanc en essayant de ruser avec le bruit qui l'agite. C'est seulement lorsque je m'appuierai au dossier du banc détrempé, à côté de la fontaine recouverte de glace, qu'elle me rejoint en se calant tout naturellement sur mes épaules, comme un chien dans sa niche. Il ne faudra rien leur demander jusqu'au retour, ni à l'un ni à l'autre.
Sandra remonte du Mont lorsque je pars récupérer Louise qui crochète un bracelet de coton en m'attendant, assise au fond de l'abri, le bus orange dépose Lili un peu plus tard, un trajet encore pour remonter le mousse et nous voilà tous les cinq autour du poêle comme des grenouilles autour de la mare. Pas longtemps. La nuit tombe et, pendant qu'Arthur s'entraîne à Ropraz, je lis au café de la Croix-d'Or quelques pages de ton Carnet, au pas de course. Aux couples qui font leur entrée, le patron offre une flûte de champagne, c'est la Saint-Valentin.
Jean


Chaumont

Le désert
gesticulations de la maréchaussée
l'homme immobile
horizon terminus

Jean Prod’hom
Dimanche 12 février 2012

Que de choses j'avais oubliées ! Elles seraient comme si elles n'avaient jamais eu lieu, sans les notes que j'ai prises au jour le jour. La vie se perd à mesure. C'est l'artifice de l'écriture qui permet, seul, de tenir l'oubli qui nous talonne en respect, de sauver quelque chose de ce qui s'est passé. Ça effraie.
La bise n'a pas faibli et dans les combles où l'on dort il fait moins de dix degrés ce matin à l'aube. Les filles jouent déjà, chacune à son bureau, on entend leurs rires, Arthur de son côté ne perd pas espoir avec le Rubik's cube. Descends courageusement faire du feu dans le poêle, bois un café avant de reprendre sous une double couette la lecture du Carnet de notes 2001-2010 de Pierre Bergounioux. Je ne dois pas être le seul, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, ces notes sont là. La fatigue me ramène à une demi-inconscience et lorsque j'ouvre les yeux bien décidé à me lever, le soleil a passé la couverture nuageuse et se glisse par la lucarne jusqu'à nous, sans rien chauffer, mais c'est agréable et on se reprend à espérer.



La voiture part au quart de tour, la batterie changée la semaine passée me soulage d'un souci supplémentaire. Dépose à la déchetterie des sacs d'ordures et de vieux jouets que Sandra et les filles ont triés ces derniers jours. Personne sur les routes. Je retrouve au Relais du Grand-Mont les élèves laissés l'été passé. Constamment tournés vers le pupitre trois ans durant, ils se sont désormais engagés sur d'autres chemins qui les réjouissent. Et s'ils nous réjouissent aujourd'hui, nous aussi, ce n'est pas tant parce qu'ils ont eu la délicatesse de nous dire en passant et en souriant que notre travail n'a pas été complètement inutile, c'est parce que ces enfants dont on a eu la charge jour après jour et qui ne le sont déjà plus tout à fait, sont heureux de continuer, débordants d'énergie, ils croquent à pleines dents une pizza (F. une entrecôte, pommes frites et salade) en nous racontant ce qu'ils ont vu après avoir quitté le giron de l'école du Mont, trop proches encore pour le dire objectivement ou disposer des mots susceptibles de circonscrire les terres nouvelles qu'ils abordent.

M'arrête au retour au Chalet-à-Gobet où je poursuis ma lecture du Carnet. Des courageux viennent s'y réchauffer en buvant une tasse de thé. J'y goutte la cadence sur laquelle l'écrivain règle les intempéries du ciel, celles de l'âme, les tâches de la raison et celles du quotidien, en les maintenant à même hauteur, sans que l'une devienne le prétexte de l'autre, se juxtaposant, alternant leur modestes pouvoirs pour dessiner la partition d'une vie en raccourci.
Ainsi la fin de cette note du 15 février 2006 :
Pourquoi ne pas anticiper d'un jour, alors, le service de presse du Carnet de notes ? J'appelle Colette. C'est d'accord. Le moment est déjà venu d'éplucher les légumes.
ou celle-ci, du 27 février 2006 :
Je passe dans le même studio où j'avais dit quelques mots, voilà une dizaine d'années, déjà, et rentre. La lumière n'a pas tenu. De sombres nuages, qu'on sent gros de neige, ont envahi le ciel.



Et surgit une idée digne de me réconforter, une idée qui diminuerait ma tâche sans entamer cette nécessité dans laquelle nous sommes de retenir une ou deux choses de ce qui a été. A voir. A la maison Lili n'a pas ôté son bonnet de la journée, la nuit tombe. Je relis le billet d'Arthur, tente de lui faire toucher les énigmatiques pouvoir du zeugme, on rit. J'ai l'impression ce soir qu'on est de l'autre côté, l'inquiétude que nous ont procurée les pannes de chauffage successives n'est pas étouffée, il y en aura peut-être d'autres, mais le froid va devoir laisser sa place au printemps, c'est sûr, ou à ses promesses.
Tandis que les filles gogent dans un bain chaud, – Lili sans bonnet de laine –, je choisis quelques photos, des couleurs, la neige soufflée, le froid, les bras nus des haies dans le bleu du ciel, le blanc sec et poudreux dont le sel a recouvert la ligne droite de Sainte-Catherine.
Jean Prod’hom
Personne ne les verra pas même ceux qui les ont vus

Les couloirs du collège sont déserts, la bibliothèque aussi, toutes les portes fermées à double tour jusqu'à lundi. Mais ces adolescents-là ne montent pas tous au chalet le week-end, à Villars ou aux Diablerets, il est 17 heures, la bise redouble.
Les politiques locaux n'ont jamais estimé qu'un centre de loisirs fût nécessaire, le tea-room dépasse leurs moyens et le silence dedans l'église les effraie. Je les aperçois alors qui entrent et sortent des toilettes publiques qui jouxtent la salle paroissiale. Ils tardent à rentrer chez eux, mais une maison en ont-ils seulement une ? et quelqu'un les attend-il ? J'y pénètre pour assurer ma conscience que ne s'y déroule pas un drame. Pourquoi pas, ne sommes-nous pas dedans cette fois ? Ils sont trois, je les reconnais, il y a une jeune poète, un enfant placé dans une institution et un pierrot lunaire qui revient d'un pays d'où l'on arrive jamais, tous les trois embonnettés, perdus dans des odeurs de tabac, avec cet air que prennent les repentis et les enfants de choeur dans les lieux exigus. Ils me reconnaissent, le pierrot lunaire tire la fermeture éclair de son petit sac à dos qui se referme sur un énigmatique trésor. Je ne demande rien, eux non plus, ils n'attendent qu'une seule chose, que je me tire, je suis de l'autre côté.
Avant de leur tourner le dos, pourtant, je les encourage, – ne peux pas m'en empêcher –, les encourage à sortir, dire tout haut ce qu'ils ont à dire, je bégaie, me rétracte, me tais, ce ne sont pas des velléitaires, ils ne veulent qu'un peu d'espace pour fourbir les inoffensives armes qui les protégeront des ennemis invisibles qui les assaillent, des mots qui les ont blessés et le doute qui les ronge, ils se réjouissent aujourd'hui, simplement, de ne pas être seuls, ils imaginent qu'ils respirent l'air frais d'une poche qui aurait été oubliée, parlent sans écouter, un peu seulement et chacun son tour, ils ont la révolte disciplinée.
Ce sont eux qui font vivre les dessous des banlieues riches, sans rien demander, pas de place au-dessus, ni grange abandonnée ni réduit de tôles, pas de bouzigues entre les haies et les maisons mitoyennes, on a brûlé les baraque des bûcherons depuis qu'elles ne servent plus, les bois ont fui l'avancée des zones constructibles. Restent les chiottes.
Les damnés fument tout bas, appuyés contre des catelles de faïence bleue, bleu ciel, joints étanches, chauffage au sol, il fait bon dans les chiottes de la commune qu'ils squattent sans pancarte en bordure des trompeuses richesses et à l'abri des assauts de la bise, persuadés que personne ne les verra, pas même ceux qui les ont vus.
Jean Prod’hom
47 (c)

Si, avant de s'éloigner du rivage, les ombres te le demandent, laisse-leur ta barque. Et ne bouge pas.
Jean Prod’hom
Il y a ce que tu sais

Il y a ce que tu sais
ce que tu crois savoir
il y a ce que je veux ignorer
et que tu voudrais connaître
il y a ce que tu oublies
ce que j'oublie
il y a ce dont nous nous souvenons à chaque instant
le temps qui manque
la terre qui s'ouvre sous nos pas
Jean Prod’hom
Dimanche 5 février 2012

L'essentiel sur lequel se greffent nos actions, les grands froids le ramènent d'un coup : rester vivant quoi qu'il en soi, on payera le prix, et veiller à ce qu'on dispose d'un filet d'eau, de pain et de bois secs pour assurer l'avenir de notre progéniture et la pérennité de l'espèce, guère plus. Notre aventure est fragile, on la sent à la merci d'un tremblement qui se prolongerait. C'est sur le terreau du sursis que fleurit le rire de nos enfants.
Ils sont au lit la tête hors-gel, des récits les font patienter tandis que la bise siffle, ils lisent l'autre vie, celle qui se développe dans la chaleur ouatée du leurre, lèvent les paupières par instant et regardent absents par la fenêtre le temps qui bute et qui se prend les pieds dans la glace. Les chenaux sont de pierre, le sable fait masse, les oiseaux voltigent entre les pinces du froid. Je peine à réchauffer quelques idées qui s'égouttent avant de filer au caniveau, puisse le tout tenir jusqu'au printemps.









Jean Prod’hom
Des Forêts et Bergounioux levés de bonne heure

Me 28. 11. 2001
![]()
Levé à six heures. Je prends congé de Cathy, qui se rend au laboratoire et descendra demain à Poitiers. Nous ne serons pas très loin l'un de l'autre. Je couvre deux pages sur le Limousin puis fais mon bagage et me rends à la gare Montparnasse. Je passe au guichet faire modifier mon billet pour Rouen. Départ à trois heures moins le quart. J'avais réservé une place en wagon fumeurs et le regrette. Mon voisin m'asphyxie, avec sa Gitane. J'ai repris Ostinato, entamé il y a quelques années, et délaissé. Décidément réfractaire à ce langage scolaire, aux abstractions («orgueil», «lâcheté», «outil ébréché du langage»), à cette casuistique datée, ébréchée, pour le coup. Un grand bourgeois qui n'a jamais connu de difficultés que génériques et dont les réflexions, le «style», pourtant, sont génériques. J'ai emporté d'autres livres mais j'hésite à les ouvrir de peur d'être fatigué, en soirée, pour parler.
![]() Pierre Bergounioux, Carnet de notes 2001-2010
Pierre Bergounioux, Carnet de notes 2001-2010
![]()
Levé de bonne heure, il ne fait que réitérer la question laissée en souffrance la veille au soir, après quoi, faute de trouver à y répondre, il l'écarte avec dépit pour se remettre à l'ouvrage, mais comment y parvenir tant qu'elle n'aura pas été résolue ? Il se prend alors le front entre les mains, et c'est dans cette posture apparemment réfléchie qu'il commence une journée qui déjà s'annonce aussi ardue que la précédente, comme il en ira sans doute de toutes celles à venir, sauf à passer outre en affectant de tenir la question pour négligeable, et au demeurant rien ne dit qu'elle ne le soit pas.
Quiconque remplit honnêtement sa besogne quotidienne ne gaspille pas son temps à s'interroger sur la manière de s'en acquitter au mieux, il lui suffit, le soir venu, d'éprouver la satisfaction de l'avoir tant bien que mal accomplie, il n'en demande pas davantage, et c'est ainsi qu'il vit en paix avec lui-même, l'heureux homme, qu'on se gardera toutefois de prendre pour modèle, ce qui reviendrait à préférer le réconfort sans risque ni péril au plaisir de la recherche aventureuse.
![]() Louis-René des Forêts, Pas à pas jusqu'au dernier, Mercure de France, 2001
Louis-René des Forêts, Pas à pas jusqu'au dernier, Mercure de France, 2001
Voyage au centre de la terre

La réussite d'une expédition au centre de la terre nécessite en amont de longues et difficiles études, l'aide aussi de ceux qui en savent plus que vous, une préparation soignée, de lourds sacrifices, un peu de hasard, le dos solide et le coeur bien accroché. Axel Lidenbrock et son oncle Otto en savent quelque chose, le chemin est long de la Köningstrasse à Hambourg jusqu'aux contreforts du Sneffels près de Reykjavik. Plus d'un tiers du récit de Jules Verne – publié en 1867 – en témoigne, c'est alors seulement que la descente dans les entrailles de la terre peut commencer : entrés sur les traces d'Arne Saknussemm dans un volcan situé aux confins du monde, dans la région des neiges éternelles, les aventuriers en ressortent sous le ciel de Sicile par la cheminée d'un volcan entouré de verdure infinie : le Stromboli. Des pêcheurs les recueillent, ils ont côtoyé la préhistoire, découvert des trésors, confirmé des hypothèses et frôlé la mort. Un seul regret chez Otto Lidenbrock, celui de ce que les circonstances, plus fortes que sa volonté, ne lui ont pas permis de suivre jusqu'au centre de la terre les traces du voyageur islandais qui l'avait précédé.

Voyage au centre de la terre | Eric Brevig
Si l'adaptation cinématographique qu'Henry Levin fait du récit de Jules Verne en 1960 vaut aujourd'hui pour le vieillissement prématuré des trucages et des incrustations, celle qu'en propose Eric Brevig en 2008 constitue une illustration saisissante de la mutation de nos façons de saisir le monde et du virage épistémologique que vit notre époque : pas besoin de matériel ni de préparatifs pour descendre dans les entrailles de la terre, un petit sac à dos fait l'affaire. Se laisser tomber ensuite dans le puits, se laisser glisser dans la nuit, jouissances et vertiges. La connaissance c'est comme une fête foraine, on y accède sans y toucher, en gardant sa bonne humeur et en variant les attractions : train fantôme et grand huit, chute libre et marelle. Nous y voici, les luminaires ne manquent pas au Luna Park. Il faut le dire, la vérité c'est d'abord une émotion. Trevor, le héros du film l'avoue à plusieurs reprises, ce qu'il déteste par-dessus tout ce sont les sorties pédagogiques. Un bémol pourtant dans cette aventure, un regret, un seul, celui de Sean, le neveu et assistant du savant qui avoue soudain n'avoir jamais lu le récit de Jules Verne.
Jean Prod’hom
A table

Louise :
- Maman, tu sais quoi ! j'ai vu une dame en string sur internet. Je comprends vraiment pas, je cherchais des images de cochons d'Inde.
Arthur
- Ouais, sur internet, tu finis toujours par tomber sur une dame en string.
Sandra :
- Ou sur un cochon d'Inde...
Lili
- Même si tu tapes pompon ?
Jean Prod’hom
Mais cette fois c'est nous qui sommes dedans

En installant ses quartiers à l'arrière, à l'arrière de son for intérieur, en y déambulant durablement et raisonnablement, l'homme laisse s'installer toujours davantage l'idée suivant laquelle le dehors n'est qu'une des humbles annexes du dedans, abandonnant la bride à la raison qui se lance alors à l'assaut de ses marches, sans discontinuer, étendant son chiffre à de nouvelles provinces, dessinant la courbe de sa croissance, affinant sa découpe, dressant la carte de son empire, pointant les connexions et soulignant les subordinations.

On peut certes vivre dedans avec des images du dehors au fond de soi sans jamais en sortir. Jusqu'au jour où les circonstances vous arrachent, sans vous avertir, vous obligent à douter un instant, vous maintiennent incrédule, le temps de passer le seuil, le temps d'un rêve ou d'un réveil, en équilibre, avant de vous déposer dehors, il faut faire vite, le temps d'une bascule. Car ce ne sont pas des images, il faut y croire, cette fois c'est vous qui êtes dedans, nu et neuf. Le temps presse, et si vous voulez vivre encore, vous devez réduire sur le champ la voilure de l'incrédulité qui vous habite, ne pas tenter de fuir, donner votre assentiment à ce dans quoi vous avez été précipités, ce à quoi vous ne songiez même pas parce que vous le mainteniez forclos dans l'imaginaire. Il faut alors vous déposséder de ce que vous étiez autrefois en l'affublant d'une image à laquelle d'autres images viendront s'agréger, batailler ferme depuis un dedans insensé, réinventer le dehors et ses annexes, recommencer.
Mais le réel reste toujours derrière la porte, il neige, sortir si l'on peut, résolument, pour rêver une fois encore qu'il est possible d'éclairer du dehors l'exiguïté du dedans.
Jean Prod’hom