Rien ne fait mieux voir le temps qui passe

Rien ne fait mieux voir le temps qui passe que la rivière pleine à raz bord glissant sur une pente quasi nulle. Qu'on s'y baigne ou pas, c’est toujours la même eau (ou une autre) qui s’éloigne sans demander son reste, sans égard pour les berges ou le morceau de bois flotté qu’on lui jette pour la détourner de son cours. La rivière s'enfuit toute.
La rivière qui roule ses hautes eaux n'est pas un accident du temps, elle est une image du temps qui passe loin du temps qui tourne, comme le torrent capricieux l’est, aux abords des sources, du temps qui résiste, hésite. De l’irrésolu.
Jean Prod’hom
Sous les remparts

Les eaux épaisses du Lez frémissent comme le lait sur le point de bouillir, il est gros des pluies d’hier au-dessus de Miélandre et Teyssières, plus rien désormais ne le retient jusqu’au Rhône ; on aperçoit pourtant ici et là des crêtes d’argent, ce sont les gués aménagés par les enfants en août qui freinent son cours puissant. On se souvient de l’inimaginable, les crues qui ont noyé les flancs du bas du village ; mais les berges résistent aujourd’hui, il suffit de contourner les flaques près de l’ancienne voie ferrée, dans la boue ou les ronces. Coups de feu sur les berges, c’est encore un héron qui fait claquer ses ailes en s’élevant par-dessus les saules et les roseaux avant de disparaître dans la chênaie. Deux vieux de Grignan marqués par la fatigue et les excès promènent leurs chiens, usés comme eux, ils les ressortiront une quatrième fois lorsque la nuit sera tombée. De vieux bus stationnent dans les fossés qui longent les vignes, on les dirait accidentés ; on finit par repérer dans le fatras des sarments qu'ils taillent les silhouettes de vignerons qui passent au pied de la tour de Chamaret.

Dans la petite maison qui domine la pIscine de Grignan, au numéro 10, le vieux sage m'attend, croquant la vie assis dans un transat. Il est sous assistance respiratoire, mais ça ne le gêne pas pour traverser l’après-midi sans boussole, comme un sauvage, et tirer des bords sans prendre de riz. Il évoque ses amis que j’ai eu l’occasion de croiser ou le privilège de connaître ; et les trente ans qui nous séparent nous rapprochent curieusement. L’après-midi lorsque le temps le permet, il descend au garage, prend ses bambous et griffe d’encre son papier à la cuve.
Il revient à plusieurs reprises à sa question initiale, il aimerait que je lui fournisse une réponse, mais je ne lui répondrai jamais complètement. A chaque fois il en profite pour emprunter une nouvelle passe, celle qui se présente, et on fait une pause à Venterol ou Taulignan, à la rue de Bourg ou en Grèce, dans la Broye ou le Gros-de-Vaud. On fait la causette avec Jean-Claude Piguet, Philippe Jaccottet, Jean Dumur, Victor Desarzens, Marcel Poncet. Jean-Claude Hesselbarth n'a pas la tête dans sa poche, il parvient à chaque coup à remonter la chaîne des raisons et des images qui nous ont conduits là où nous nous retrouvons égarés, il me demande à chaque coup émerveillé : « Mais pourquoi je vous dis ça, d'ailleurs ça ne vous intéresse pas. Revenons à vous. » Si bien qu'à la fin on n'a pas fait un pas, et qu'il va bien falloir que je revienne faire l’école buissonnière sous ses remparts. Saucisse au foie et gruyère salé, c’est entendu.
Il est temps parfois de ne plus compter, de ne plus vouloir mettre au pas son énergie. Ne plus hésiter à donner et à qui. Le bonhomme a de quoi faire mille tableaux et d’autres pique-niques, il a rajeuni mais il fatigue en fin d’après-midi, c'est comme si le champagne avait perdu de ses bulles, et qu’il me fallait couper dans la pâte de langue. Il est temps que je m’en aille. Jean-Claude m’offre le petit ouvrage que Jil Silberstein lui a consacré il y a quelques années.
Et puis demain c'est le 31, Philippe et sa femme vont le rejoindre pour l’an neuf. Liliane est allée acheter quelques huîtres chez Grande oreille. Sans compter que l’année prochaine il devra être en forme, des expositions importantes auront lieu, va falloir tenir le rythme. Je traverse en rentrant un bourg qui fait croire en août que tout va pour le mieux. Pas même un fantôme, je rentre à Colonzelle, à pied dans la nuit.





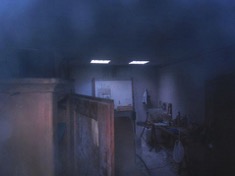
Jean Prod’hom
Teyssières

Perdus dans une mer de ceps et de sarments, deux tailleurs lèvent la tête avant Montbrison, la neige est tombée sur la montagne de la Lance et lui fait une drôle de tonsure. L’alternance des terres rouges, des terres ocres, le gris, les bleus de lavande, le vert des prés maigres, les peupliers, les cyprès, les jeunes oliviers, les vieux, la vigne font penser à la Toscane. Ne seraient les serres et les valats couverts de chênes verts et de pins.

On laisse une voiture près du mas de Miélandre, l’autre à Broc. Un chemin nous conduit au vieux Teyssières d’où une fumée bleue s’échappe ; une voiture belge atteste d'une présence dans le nid d'aigle qui domine la vallée du Lez ; le hameau n’est donc pas abandonné, mais on ignore de quel côté vont basculer les mas de ce hameau. On croise un vieux chien muet qui disparaît.
Sur l’autre rive une chapelle, ses portes sont closes ; pas celles de fer du cimetière dans lequel les morts ne manquent pas de place, il ne semble pas qu’il y ait eu beaucoup de va-et-vient dans le coin. On y meurt au compte-goutte et les enfants ont décidé de naître ailleurs. On a enterré le dernier citoyen il y a trois ans, un Michel qui avait une quarantaine d’années, les morts qui restent s'accrochent à la pente. Tout en haut trône un couple d’Allemands dans un lit de marbre noir, il s’agit de Wilfried et d’Anna sa femme nés dans la premier décennie du XXème siècle, morts respectivement en 76 et 97. Présence étrange dans ce cimetière, à deux pas d’un panneau placé dans le dernier virage de la route qui y conduit, sur lequel on peut lire les hauts faits des hommes du maquis de la Lance.
On a semé des fleurs artificielles dans chacune des concessions, les vraies ne sortiront pas de terre ; il y a Eglantine, Rose et Vermeille, des fleurs auxquelles on ne croit pas vraiment. Philomène, Augustine, poupées de porcelaine, Lydie, Angèle, Adelphine, noms d’anges, noms d’idiots, Florentin, Séraphin, Philidor, Alcide.
On pensait aller jusqu'aux Lunières mais on écourte, faut dire qu’on a rendez-vous. On nous attend à Taulignan pour mettre du bois en tèche.










Jean Prod’hom
Tirer les rideaux

Le fort ralentissement annoncé à la radio entre Confignon et Bardonnex ne nous l'a pas rendu plus séduisant ni ne nous a permis le l’éviter. Dedans jusqu’au cou comme des idiots. Mais comment faire autrement, déserter les grands axes lorsqu’ils ne restent qu’eux ; les leçons ne servent à rien ni l'expérience.

Sandra est au volant, j’en profite pour lire « 14 ». C’est une histoire vraie de la Grande Guerre, pas vraie du tout, racontée par Jean Echenoz, qui a lu consciencieusement les manuels scolaires. Avec l’un de ces décalages continus dont cet émule des Lettres persanes a le secret ; il fait entendre une fois encore la matière qu’on peine à voir, que les livres d’histoire ont la fâcheuse manie de faire disparaître en en déshabillant le souvenir, avant de charger celui-ci de boulets et de poncifs pour le noyer. Je propose qu’on remette à Echenoz tous ces inutiles manuels qui empoussièrent les esprits de nos adolescents et qui verrouillent l’accès à la connaissance, on s’amuserait enfin un peu.
Si comme toutes les vallées celle de l’Isère s’enlaidit, elle ne vieillit pas ; et cette jeunesse, elle la doit aux innombrables plantations de noyers qui ont remplacé dans le dernier quart du XIXème siècle les mûriers sur le déclin depuis la maladie du ver à soie et les vignes attaquées par le phylloxéra. Les noyers solides sur leur jambes lèvent haut leurs bras blancs, pas un gramme de graisse, tout en muscles et en os.
Mais personne dans les noyeraies, ailleurs non plus. Les derniers habitants de la vallée, s’il y en a, se cachent derrière des rideaux de jute. La campagne abandonnée est comme une succession de tableaux de genre que leurs modestes héros auraient désertés, scènes séparées par des haies vives et nues, les treillis n’arrêtent pas le regard, les potagers ressemblent à des cimetières. La herse a noirci la terre, le soleil troué les bois de feuillus. Cours de ferme désertes, fers et ferrailles rouillés aux quatre coins des domaines, flaques immobiles dans les chemins à ornières. Les balles de paille s’affaissent, seules quelques vaches faméliques font bouger le paysage. On sait que l’Isère ne passe pas loin mais on ne sait pas exactement où, un héron soudain remue l’air et grimpe jusqu’au ciel.
On pensait aller vers le soleil, et c'est la tempête qui nous accueille aux portes de Valence, la pluie nous plonge dans un tunnel de lavage dont on ne sort qu’après Montélimar. J’en profite pour continuer la lecture du second tome du journal de Juliet. Quelque chose a changé, les mots de neutre, commun, singulier, universel se sont substitués à ceux de suicide, souffrance, doute. Il écrit le 5 mars 1966 :
On est d'abord une unité indifférenciée dans une masse indifférenciée. Puis on se différence, on prend de la distance, s'établit à l'écart. Enfin, on s’éprouve semblable. Alors on réintègre la communauté, et la singularité s'accroît du commun.
André Gide, auquel Juliet ne semble plus guère attacher d’importance, devient au cours des années le chef de file de ces écrivains qui n’ont jamais cessé d’universaliser leur particularités sans passer par un renoncement à eux-mêmes. Au chant du moi, Charles Juliet oppose le dur retour aux origines. Je m’endors, la pluie a repris de plus belle. Elle ne nous quittera pas avant Colonzelle.
Jean Prod’hom
Ténèbres en terre froide

Remonte sur les traces de Charles Juliet déposées en son temps. Idées noires collectées dans la première partie de son journal qui court les années 1957-1964. Guère d'échappées. Et lorsqu'on a l’impression que l'horizon se dégage un tant soit peu, c'est pour mieux se refermer dans les lignes qui suivent. Les jours s'enchaînent avec la régularité d'un rouleau compresseur : honte, suicide, fatigue, désespoir, dégoût, souffrance, doute. A peine un sourire en 59.
24 novembre
Si je devais mendier, la crainte d’importuner autrui, de lui infliger le spectacle de ma déchéance, m’imposerait d’aller me poster en un coin de la ville où nul ne passerait.
Et un bel exercice d’admiration le 25 octobre 1964, long billet enjoué (le plus long de ce premier volume) dans lequel Charles Juliet évoque sa première rencontre avec Bram van Velde. Il est 18 heures, ils sont timides, alors ils vont marcher, se glissent dans un restaurant. Bram van Velde lui parle de Beckett, de sa gentillesse, de sa générosité, de Descombin qui a joué et jouera encore un si grand rôle dans sa propre vie. Le vieux peintre habite Genève, sans famille, sans appartement, sans atelier. Parfaitement seul. Parfaitement démuni. Merveilleusement libre, serein et déchiré, c’est un miracle. (Charles Juliet ne peut s’empêcher d’ajouter à la fin et entre parenthèses qu’il n’a pas été à la hauteur de celui qui deviendra son ami.)
Je peine à imaginer que c’est un gamin de moins de trente ans ans qui a écrit et ruminé ces notes, et non pas un vieillard abandonné dans un hospice. Disons qu’il lui reste toute une vie pour rajeunir. Et cette idée que les choses ne vont pas comme on le croit, que la liberté ne se gagne et que la jeunesse ne s’obtient qu’à la fin accompagne comme une espérance le jeune homme tout au long de ces sombres années. Le passé est rusé et il convient de se débarrasser des idées qui encombrent. Que l’apaisement ait un prix et qu’il se présente au moment voulu n’est pas pour déplaire aux plus vieux d’entre nous.
Jean Prod’hom
Il y a les lames de fond

Il y a les lames de fond
le bois de la Fin
le pain d’épices
les crocodiles
les ponts de danse
les faux calculs
le grain du feutre
la fonte des neiges
les alibis
Jean Prod’hom
(P. F. 16) Edmond Kaiser

L’enfant remonte l’allée à pas lents, une boule de chiffons dans les mains. Il a ramassé un oiseau qui s’agitait entre deux pavés, les ailes et les pattes prises dans un fil de nylon, ses petits yeux noirs cherchent en vain. Hommes pressés, personne n’a le temps d’aider la bête qui fait le mort ; un regard par-dessus l’épaule, rassurés que ni l’oiseau ni l’enfant ne les suit. Celui-ci s’accroupit, tire un mouchoir de sa poche et enveloppe celui-là. Une vieille lui indique devant le centre commercial l’adresse du vétérinaire chez qui ses chiens et ses chats ont leurs habitudes, tout à côté de l’ancienne poste. En voyant l’air décidé du gamin, le vétérinaire lui propose de repasser le lendemain après l’école. Qui ne parle à personne de son aventure. Le lendemain la mésange s’envole devant son regard médusé.
En rentrant, il aperçoit sur la place du Marché un homme en loques qui parle une autre langue, assis en tailleur devant un gobelet vide et appuyé contre le mur compissé de la boucherie du quartier. Le mendiant lui fait un signe et le gamin lui sourit.
Quelques années plus tard le jeune homme malingre impressionne, il a l’oeil qui tournoie sans lâcher du regard ce qu’il veut. Comme un faucon. Il écrit des lettres où percent ses colères. Ses tourments le font avancer tout droit, ne dédaignant aucun des registres de sa langue, usant tout autant de l’invective que du compliment. Il ne démord pas d’une idée simple selon laquelle la dignité ne souffre d’aucune exception. Il a tantôt la voix ronde de ceux qui savent contourner les obstacles pour raccourcir les distances, tantôt la voix tranchante de ceux que les barbelés n’effraient pas, bien décidé à faire entendre ceux à qui on a dérobé le droit d’être. Ce courage il l’a dans l’âme et dans la peau. Franchir coûte que coûte les obstacles, faire entendre les motifs de ses saintes colères, l’inadmissible, les souffrances du condamné, la solitude des orphelins, sans jamais rien espérer. Nous avons si peu de temps pour comprendre, encore moins pour agir.
Sa voix d’enfant n’a pas quitté le vieillard qu’il est devenu, elle lui souffle aujourd’hui encore la teneur des lettres qu’il adresse aux puissants. Son combat ne prendra pas fin avant que chacun ait retrouvé le sol qui le fonde et le pain qui le nourrit. La dignité de chacun. Toujours la même colère, la même rage, le même corps malingre.
Jean Prod’hom
114 (c)

La naissance d’un enfant condamne à mort ses parents. Qui ont pour tâche, dans le sursis qui leur est accordé, d’assurer la subsistance de leur rejeton jusqu’à l’arrivée de la nouvelle génération.
Il n’a jamais été question de faire la lumière sur toutes choses. Car si l’homme aménage des chemins, c’est tout autant pour sortir de la nuit dans laquelle il vit que pour y rentrer le soir. Et oublier.
A la croisée des chemins, le présent déborde de tous les côtés.
Jean Prod’hom
113 (c)

Les amateurs de plongée sous-marine reviendront sous peu à la plongée intérieure tant les fonds marins, dans leur variété même, sont ennuyeux.
Non seulement je n’ai pas lu le centième de ce qu’ont lu mes amis, mais je ne m’en souviens plus. Je vis caché.
Jean Prod’hom
Dimanche 22 décembre 2013

Les reins nus de la terre,
et l’oeil qui tourne et retourne son corps comme pâte à pain.
Ni le sifflement désespéré d’un passereau blessé au pied d’une plinthe, ni celui d’un mulot pris au piège au fond d’une commode, mais celui de la tige d’un rosier rose caressant du dehors le vieux verre du jardin d’hiver.
Des arbres habillés comme des caniches.
Jean Prod’hom
(P. F. 15) Maurice Chappaz
 Mau
MauC’est après avoir étudié le vol des mésanges et le nid des hirondelles qu’ils avaient élaboré leurs premiers plans. Dans ce village les enfants chantaient bien avant de savoir parler, et quelque chose de ce premier chant les animait lorsqu'ils tenaient leurs conciliabules sous le porche de l’église ou dans les granges, si bien que leurs sourcils battaient d’aise quand, revenant au soleil, ils s’engageaient sur le sentier des mayens.
Le régent leur avait appris dans les premières classes que le monde ne s’ouvrait pas comme un livre, qu’il ne suffisait pas de savoir lire pour y vivre, qu’il convenait plutôt de s’y glisser et de faire corps avec lui en ajoutant sa voix à l'air du temps. En remuant le moins de choses possible. Ces méthodes d’enseignement changeaient tant de choses qu'il était difficile plus tard de les distinguer des herbes hautes et des pierres dans lesquelles ils se fondaient lorsqu’ils gambadaient, de savoir avec certitude s'ils chantaient ou s’adressaient aux chèvres dont à cette époque les adolescents avaient la charge.
Le petit de l'abbaye était un de ces drôles d'oiseau parmi les oiseaux, un de ceux qui ne se laissaient pas attraper. On a beau être curé, régent ou poète, il était impossible de le retenir lorsqu'il regardait par la fenêtre les montagnes dont les cimes étaient recouvertes de neige, le troupeau qu'Armand conduisait au pré, ou les mouchoirs que le papillon agitait pour l'attirer dans son guêpier.
Le soleil rampe jusqu'au bureau surélevé, le prêtre scande des spondées et des dactyles. Mais ces reflets et les chants de Virgile ne lui font pas oublier les pâturages qu’il doit rejoindre lorsque la cloche aura sonné, l’air cru et le chemin qui ne s’arrête pas. Il sort dans le vestibule, attache ses chaussures, salue ses camarades, foule délicatement l'herbe avant d’allonger le pas. Il a hâte d'atteindre le chalet de son oncle, de prolonger jusqu’au col, de revoir ce pays immense qui se cache au-delà, avec ses vallées et ses promesses, de continuer un peu, laisser derrière lui ce qu’il croit connaître et aller vers ce qu’il ignore. Il y a des passés qui aident à avancer sur des chemins à peine tracés. Plus tard il ira au-delà, s’arrêtera sur la terrasse d’une pinte d’alpage, y demeurera jusqu’au soir, demandera l’hospitalité à un berger, se glissera sous une couverture avant de fouler l’herbe aux premières heures du jour, dans ce pays qui ne cesse de s’ouvrir à l’invisible et à l’inattendu.
Jean Prod’hom
(P. F. 14) Corinna Bille
 Corinna
CorinnaLes deux mondes dans lesquels se déroulent essentiellement nos vies coexistent. Certains d’entre nous avancent à cloche-pied dans l’idée de n’en perdre aucune miette, jusqu’à la mort. D’autres tentent de ramener ce qu’ils ont en propre à ce qui est commun à tous, en tordant le cou à leur vie personnelle ou en gonflant la panse du collectif. On ne dira rien de ceux que les circonstances ont obligés à faire le pari inverse, et qu’on croise parfois seuls et tête baissée, dans les allées de nos parcs et de nos asiles.
Restent quelques individus, rares, qui n’ont jamais su qu’il existait un autre monde que celui dont ils sont les honnêtes émanations. Qui jamais n’en ont éprouvé le manque. Elle était de ceux-là, ignorant qu’il puisse en aller autrement. Elle ne comprenait de ce qui l’entourait que ce qui venait de son coeur. Ceux qui avaient voulu la détourner de cette voie bien peu catholique n’avaient trouvé devant eux qu’un mur qui renvoyait en miettes leurs voeux de conformation.
L’écolière qu’elle était oubliait tout des heures passées sur les bancs d’école, ne faisait ses devoirs que parce que ça lui épargnait d’autres soucis. N’en voulait pas à ceux qui désespéraient de son cas. Ses parents l’aimaient et elle les aimait, ne se réjouissant que de les retrouver le soir, eux, la ferme dont ils assuraient le modeste train. Elle rentrait le bétail avec son père, écoutait les récits que lui faisait sa mère à la cuisine. Elle jouait avec les canards et les poules de la basse-cour, s’émerveillait de leurs oeufs, ramenait les plus beaux des cailloux ramassés sur le chemin. Elle ne se sentait pas plus fragile que la vie qu’elle caressait le long du jour du bout des doigts.
Tout était aventure. Des aventures qu’elle racontait à une poupée qui ne sortait pas de sa chambre. Le premier venu se serait inquiété, peut-on vivre ainsi ? Il l’aurait dite en sursis, pas elle ni ses tout proches. Elle attendait, je crois, l’être mystérieux qui ferait correspondre en lui ce qu’elle ne savait pas d’elle. Respirer ensemble, traverser et être traversé par les vents, susciter des rencontres sans s’accrocher à rien, vivre sans effraction, de bouts de chandelles. Ecouter les oracles, croiser les fous, les fonctionnaires, les ivrognes, les meurtriers, les militaires et les menteurs.
Je ne l’ai plus revue depuis cette époque où nous étions assis sur les bancs de la petite école. Cheveux blonds qui ondulaient, elle regardait par la fenêtre quelque chose que nous autres ne voyions pas.
Jean Prod’hom
Un collège à défaut d’une maison

En être à n'importe quel prix, peut-être ; c’est si difficile d'être né la veille. Inutile de te demander de renoncer et de venir du côté du pardon ; et recommencer. C'est seul, je crois, qu'on avance, incrédule comme au premier jour ; en espérant encore, les mauvais matins, qu'on pourrait en être.
Collège, racines coulées dans le béton, gaines techniques à défaut de maison. Les têtes sous cloche ne perçoivent pas les voix du dehors, il n'y a pourtant qu'un pas, sortir et entrer librement. Pourvu que ces voix ne nous abandonnent pas. Il en faut de l'innocence pour demeurer du côté des pierres.
Être divisé l’un dans l’autre. Quelqu’un – ou était-ce un autre ? – m'a fait entendre le rire dans le rire. Surtout bien dormir pour l'entendre encore demain.
Jean Prod’hom
Garder le livre ouvert

On manque d’air au réveil, chacun s’affaire pourtant et tout le monde se tait. On pourrait s’y faire. Mais l’un d’eux sort la tête du tunnel. Il demande quelque chose, à défaut d’étincelle de quoi reprendre des forces, n’importe quoi, mais quelque chose à emporter et y retourner. Le retenir, ne pas suivre son plan. Je lui offre une image qui ressemble à celle d’un tombeau ouvert, puis on parle de choses et d’autres. La salle de classe surplombe le cimetière, il fait beau dans les allées et les contre-allées, fleurs ensoleillées au-dessus du silence des morts.
Ne pas baisser les yeux. Aller se perdre ailleurs que dans ses copeaux, du côté de l’étendue, du vide auquel s’abreuve la diversité des choses qui passent d’une jambe sur l’autre, font des signes. La profusion n’est pas un labyrinthe.
Garder le livre ouvert sur la table pour ne pas se perdre. Mais garder les mains libres et lever les yeux sur le bouquet qui s’offre. Et s’égarer.
Jean Prod’hom
Ne pas broncher

Sa mère n'a jamais voulu savoir où il était, lui non plus. Alors elle l'a mis ailleurs et le voilà nulle part. Il lui raconte que tout va bien, elle se paie de mots, propos sucrés et sourires de satisfaction. Le gamin, yeux de fouine, lance des pierres et tire des lignes avec un cheveu sur la langue.
Défaire les empilements, tailler des marches. Ni forceps ni ruse. Aller, aller jusqu'à ce qu'on y soit, tout au bout. Le gamin s'abandonne à son nouvel état, il suffoque, large sourire dans une déferlante qui le fait aller en tous sens, mais en un autre sens cette fois. Le voilà quelque part et personne à qui parler. La moitié du chemin est faite.
Surtout ne pas broncher, ne rien ajouter.
Jean Prod'hom
Pauvre Zénon

On m’a conduit l’autre nuit à la guillotine. Sans raison apparente. Je ne me souviens en effet d’aucune instruction, d’aucun procès et la grâce n’est jamais venue. Me suis débattu, moi l’innocent, jusqu’au pied de l’échafaud.
Mais il a bien fallu à la fin que je m’y fasse, je me suis donc ressaisi, longuement sermonné. J’y suis parvenu à force de patience : je me ferai trancher la tête et j’irai rejoindre en toute connaissance de cause l’autre rive.
Le couperet allait tomber lorsque je me suis réveillé, déçu d’être demeuré si loin encore de ce dont j’avais été, je le croyais, si proche.
Jean Prod’hom
(P. F. 13) Arthur Maret

Qui sont donc ces hommes qui veulent installer le paradis sur terre ? L’adolescent fait ses devoirs en écoutant distraitement la radio, puis tend l’oreille en direction de la voix grave qui sort du poste. C’est un vieil homme qui raconte ses premiers pas, orphelin de père, commissionnaire sitôt sorti de l’école obligatoire, puis vendeur dans une maison de commerce, voilà comment le vieil homme démarre dans la vie. Un monde les sépare, le gamin ignore tout de ces ateliers d’handicapés et de cette société coopérative que son aîné a fondés, de ces maisons familiales de retraite qu’il a ouvertes. Le vieil homme est né dans un village au-dessus du bourg, a oeuvré dans les années 30 comme syndic du chef-lieu, socialiste et chrétien. Kezaco ?
L’adolescent lève soudain la tête, le bronx ça l’intéresse. En novembre 1932, Le vieil homme et ses amis se réunissent au cercle typographique, c’est leur stam, quelqu’un les a avertis de ce qui s’est passé au bout du lac, une tuerie, treize morts, plus de soixante blessés graves. Ce sont de jeunes recrues qui ont tiré sur des syndicalistes manifestant contre des fascistes. Le vieux et ses amis veulent montrer leur soutien aux ouvriers de la ville du bout du lac, ils se rendent en cortège jusqu’à Saint-François, silencieux. L’adolescent connaît bien l’endroit, mais il ne comprend pas le détail de l’affaire : communistes, fascistes, socialistes, syndicalistes, radicaux, qui est avec et contre qui ? De jeunes recrues débouchent tout à coup de la ruelle Saint-François, matraque levée, foncent sur le cortège et tapent comme des sourds. Il ne comprend pas tout, mais c’était visiblement chaud.
Le vieux apprend au jeune que les magasins restaient ouverts le soir, qu’on tolérait des semaines de travail de 65 heures. Les vacances n’étaient pas payées, on estimait que les ouvriers n’avaient qu’à se reposer pendant les périodes de chômage. La ville regorgeait de taudis, de chômeurs et de vieux dans le besoin. Et même que Bellerive n’existait pas, c’est ce vieil homme qui en est à l’origine, à l’origine aussi de Montchoisi.
Le lien est fait, l’adolescent est allé cet été se baigner à Bellerive, avec Anne; ils ont promis de se retrouver cet hiver sur la glace de Montchoisi pour y tracer main dans la main les boucles qu’ils veulent se passer au doigt, ah! les gamins. Puis ce sera la fin de l’école obligatoire : commissionnaire ou vendeur, flexographe ou mégatronicien. Tout recommence.
Jean Prod’hom
Lemmes 12

Peu de différences en somme de l'école aux vacances : On y fait l’Afrique, l’Océanie. Le tourisme, les régimes alimentaires, la lutte des classes. Les transports maritimes et les récits de voyage, la restauration et la digestion, Cuba, les Maldives, la Bretagne et le change. À quand l'amour et le mur ?
Les sacs à dos font de nos élèves des mules dociles. Besoin ni de fouet ni d’oeillères.
Maître et fonctionnaire, la quadrature du cercle.
Jean Prod’hom
Cisco

Qu'un cheval souffrant de conjonctivite bénigne devienne en quelques mois un cheval aveugle ne présageait rien de bon. Il va guérir, avait dit le vétérinaire à la nouvelle propriétaire, il n’en a rien été, les uvéites se sont succédé, il a fallu accepter le verdict. A commencé ce jour-là une aventure qui ne se distingue guère des autres, au moins en apparence, car un cheval aveugle ça ne saute pas aux yeux. Il s'appelle Cisco, j'ai entendu son nom avant de faire sa connaissance, samedi passé, le jour tombait. Gwenaëlle l’a accueilli à Fey il y a 10 ans, obligeant ses hôtes et ceux qui allaient la rejoindre, hommes, femmes, enfants et chevaux à faire de la vie avec lui une autre vie, habitée par une question qu’il leur poserait à toute heure du jour et de la nuit. A moins de s’en séparer.

C'est dans une dépendance de l’écurie que Gwenaëlle en a parlé. Gwenaëlle c’est l’initiatrice de l’école de L’enfant Takhi. Elle et Cisco ont ensemble arpenté les lisières de Fey, ses bois et ses chemins de terre, longé la Menthue et le Talent, dans un coin du pays de Vaud aux noms rugueux : Echallens, Bercher, Vuarrens et Peyres, Possens, Villars-Mendraz, Dommartin, Rueyres, Boulens, des noms de chêne, de châtelains cossus, de baronnies et de foyards. Gwenaëlle a aidé son protégé à faire ses premiers pas dans la cécité, dedans et dehors, avec d’autres chevaux qui voient clair. Lui, il l’a aidée, c’est sûr, à porter son attention sur cet espèce de silence qu’on oublie si souvent lorsqu’on croit comprendre et dans lequel les aveugles se déplacent avec aisance. Elle lui a appris à prévoir ce qu'il ne verrait pas, à ne rien brusquer, à trotter sans mors. Elle lui a enseigné patiemment un lexique sommaire : lever, baisser. Et attention, le mot par lequel on avertit du danger ceux qui sont faits d’une même substance mais qui sont armés d’attributs différents. Quelques mots seulement, mais qui suffisent à passer partout s’ils sont soutenus par une attention continue. Gwenaëlle me dit tout cela en tenant du bout des doigts des rênes invisibles qui me font relever la tête d'étonnement. C'est un cheval de tête, dit-elle, et les autres chevaux le soutiennent.
C'est autour de Cisco que l'écurie à vécu depuis 2004, c'est autour de lui qu'un spectacle se prépare ce soir dans une petite capite en face des écuries, la nuit est tombée. Gwenaëlle aimerait que la fête ait lieu sous chapiteau, qu’il y ait son protégé et les autres, mais aussi la danse, le jonglage, la comédie, la musique, des acrobaties, et un peu de cette histoire imperceptible qui rampe dans nos nuits, le rêve de l’étrange lumière qui éclairent ceux qui ne voient pas. Des projecteurs nous feront voir quelques-uns des fragments de notre nuit.
C’est la cécité qui devrait guider l’aventure, mais aussi la confiance que cet handicap appelle et le coeur qui l’anime. Avec d’autres chevaux, Stella, Valdine ou Calao. Et des enfants qui s’étonnent en souriant de ce miracle.
Lorsque je sors avec Louise et Lili de cette séance d'informations, on ne voit rien. J’entends une voix qui rappelle les chevaux, des silhouettes précédées de leurs noms traversent la nuit, pas de Cisco. Il est dans son box, sous la lumière d’un néon, sa robe se confond avec le crépi, invisible. Il s'approche lorsque je l’appelle, m’aurait-il entendu ? je m’inquiète de cette confiance qu’il me témoigne, je devine qu’il ne voit rien. Il me regarde, tend son museau, ne m’interdit pas de le regarder. Il y a un mystère, me montrerai-je assez digne d’honorer ce qu’il ne voit pas ?
J’ai rencontré tout ce petit monde samedi passé, il y avait Elsa, la fille de Gwenaëlle, qui découvrait de nouveaux amis, donnait son nom à chacune des parties du visage des gens qui lui étaient familiers. Il y avait toute l’équipe qui a décidé de se lancer dans cette aventure. Je me réjouis de les retrouver dans quinze jours. Au Riau, je suis allé jeter un coup d’oeil sur le site de L’Enfant Takhy, j’y ai trouvé sur la page d’accueil un extrait du Zhuang Zi de Tchouang-tseu.
«Les chevaux ont des sabots pour les porter par-delà le gel et la neige, et des poils pour les protéger du vent et du froid. Ils mangent de l’herbe et boivent de l’eau, et galopent en faisant voltiger leur queue. Les manoirs et les grandes demeures les laissent indifférents… Lorsqu’ils sont contents, ils se frottent les naseaux. Lorsqu’ils sont furieux, ils font volte-face et se décochent des ruades. Telle est la nature des chevaux.»
Je ne peux m’empêcher d’évoquer la suite de ce chapitre 9. Tchouang-tseu y raconte comment Pai-lao apprit aux hommes les violences faites aux chevaux – fers, tonte, bride, entrave, parc – qui conduisirent un tiers des bêtes à mourir prématurément. Les hommes affinèrent plus tard les tourments de leurs protégés : dressage, endurcissement, galop par escadrons, ordre et mesure, le mors et la cravache eurent raison de la moitié restante.
Jean Prod’hom
La terre a la couleur de la molasse

La terre a la couleur de la molasse et la dureté du silex. Les labours se soulèvent raides, désordre de cristaux boueux et immobiles. Le ciel est froid, plus haut et bleu qu’en novembre, lambeaux de neige tombée la semaine dernière, flaques sombres, buvards aveugles qui tiennent à distance le ciel, les nuages et les feux du soleil. On ne joue plus.
J’aperçois Alfred, Daniel et Jean-Paul près de chez eux, ils sont de retour ou sur le départ, un rendez-vous ou une tâche urgente. Tout le monde passe en coup de vent, la campagne n’a ni tache ni répondant.
Cinq jours pourtant que le soleil s’est installé au-dessus des habitants du Riau, alors que le brouillard rampe sur le lac. Mais il y a quelque chose d’inentamable qui nous empêche d’aller au-delà de ce qui apparaît. La terre s’est encroûtée, la sève s’est dérobée. Il n’y a que les haies qui gardent autour d’elles un peu de vie, une variété et une souplesse que les branches nues des frênes et des hêtres n’ont pas à cette saison, et je comprends mieux le plaisir dont parle Trassard à couper les herbes et les ronces à leur pied. Monte de la Broye, qui cherche son chemin dans un épais brouillard, le grondement sourd des voitures qui vont à Berne ou à Lausanne.
En-bas un coeur noir et blanc secoue les parois d’un interminable tunnel. Ici en-haut les fontaines sont généreuses, mais elles auront besoin pourtant de la journée pour se débarrasser des morceaux de glace qui collent à leur nez. Je cherche la prise d’eau du canal de la mécanique, on pénètre facilement les bois qui longent la rivière mais je n’aperçois aucun signe d’anciens travaux. De la fumée sort de la cheminée du Château, mais tous les volets sont clos. Les branches du tilleul font un bruit d’os, le potager a l’allure d’un cimetière abandonné. Ici et là traînent de vieilles machines agricoles, qu’on devait venir chercher le lendemain, mais qui passeront un hiver encore à attendre dans leur rouille. A l’ombre cliquètent des guirlandes de verre cassé. On s’étonne plus loin de la vivacité du gui dans les pommiers d’un ancien verger, il a fait d’immenses bouquets dans lesquels nichent des perles vivantes gorgées de soleil. C’est sûr, la terre grise de molasse prendra ce soir les teintes de la pierre d’Hauterive.
Jean Prod’hom
Il y a les dissidences

Il y a les dissidences
les faillites
le club Med
il y a l’insaisissable
les ordures
les bousculades
les facilités
la fausse monnaie
il y a les circonstances de sa naissance
Jean Prod’hom
(P. F. 12) Jeanne Hersch
 Jeanne
JeanneLa femme est grande, l’homme petit, sans enfant et causeurs devant l’Eternel ; ils réconcilient, elle juive lui chrétien, les innocents du bout du monde dans leur asile de fortune. Ce sont de sales années.
Ils ont accueilli il y a quelques semaine une petite orpheline venue de l’autre côté de la frontière. Elle écoute leurs voix depuis la chambre du fond du couloir. Elle tend l’oreille et comprend toujours mieux qu’il y a dans leurs paroles, leurs rires leurs silences dont elle se sent exclue, dans ce qu’elle ne comprend pas quelque chose à comprendre mais qu’elle a perdu.
Elle les rejoint dans le salon où ils lisent. Il s’aiment, pas de feu dans la cheminée, ce n’est pas la saison. Elle s’approche prudemment, demeure debout quelques instants avant de s’accroupir, elle fait un petit tas de brindilles dans le foyer, ajoutent quelques pives qui traînent dans un panier. L’homme qui l’a vue lui donne deux pages d’un journal qu’il a froissées et lui tend une boîte. Elle frotte la première allumette qui se brise, la seconde ne suffira pas. La femme regarde la fillette avec sollicitude, le feu prend. Mais il n’y a pas de gros bois sous la main, le feu tousse et s’éteint, la boîte d’allumettes est vide, elle court au jardin, le ciel est gris, elle n’a plus rien.
Comment raisonnablement continuer quand tout s’est arrêté, trouver une place, retrouver un peu de la liberté dérobée, et vivre avec. Elle ne sait plus où aller, n’a plus accès à ce qui dépasse nos vies, reste en-deçà d’elle-même.
L’orpheline aurait voulu participer à la fête, mais elle n’a plus à sa disposition qu’un peu de solennité et l’usage de la raison. Elle sent confusément qu’elle a laissé quelques chose qui n’a pas même la forme d’un vieux souvenir, ni sa force, restée en arrière de son âme. Son corps peut-être.
Jean Prod’hom
Dépaysé chez soi

Dans Première neige, Maupassant raconte le destin d’une femme mariée à un gentilhomme normand, solide et rustique, né pour se contenter de ce qu’il est, sera et fera là où il est né et mourra, ne voyant en celle qu’il a épousée que l’une des pièces de son bonheur sédentaire.
Cette nouvelle de 1883 fait la part belle à la jeune dame et met sur le compte de la surdité du bonhomme son ennui et le sombre avenir qui lui est promis.
Incapable d’enfanter, que lui reste-t-il ? Ni espoir ni espérance tandis qu’un feu bien nourri suffit à celui qui fait chambre à part. « Qu'est-ce qu'il te faut pour te distraire ? Des théâtres, des soirées, des dîners en ville ? Tu savais pourtant bien en venant ici que tu ne devais pas t'attendre à des distractions de cette nature ! »
Sourd à ses incessantes demandes il faudra la maladie pour qu’il consente à l’envoyer dans le Midi. Elle y revit alors, regarde le vaste ciel bleu, si bleu, voit et revoit assise sur un banc qu’elle ne quitte plus le massif de l’Esterel, les fidèles îles de Sainte-Marguerite et Saint-Honorat, les villas dormantes. Sédentaire et heureuse dans un monde immobile, comme son gentilhomme de mari là-bas dans son château normand. Sous le même ciel.
J’entends l’avertissement. Est-on condamné à rêver aux terres lointaines qu’on ne rejoindra que lorsqu’on en aura fini. Ou se satisfaire de la terre qui nous a vu naître. Mais est-il bien raisonnable de croire qu’on peut faire du proche un lointain et du lointain un tout proche. Voir ensemble dans l’étrangeté d’où l’on vient l’étrangeté où l’on va. En s’y retrouvant. Dépaysé chez soi.
Jean Prod’hom
On n’en sort pas

On n’en sort pas, le réel est hors d’atteinte, inutile de vouloir trop s’en approcher. Ni espérer pouvoir s’en extraire. Être bien accompagné et accompagner, c’est ce qu’on peut faire de mieux.
Lorsqu’il fait soleil et que la neige demeure sur les flancs de Brenleire et Folliéran, je fais halte dans la véranda où trois chaises entourent une table ronde, y suis à cette occasion pas loin de moi-même. Ce compagnonnage dure une petite heure et c’est bon. On se réconcilie, on parle un peu, en ne bougeant les lèvres qu’à peine, tandis qu’une guêpe ou un bourdon s’acharne contre la vitre. Celui qui est en moi lâche un peu de sa surveillance, je veille de mon côté à ne pas m’enflammer à son insu, on se modère. Il me tance une dernière fois, pour rire, avant de laisser la bride sur mon cou. On s’abandonne les mains croisées, le dedans et le dehors se serrent la main.
Aucune ombre, les écharpes d’inquiétude qui s’accrochaient à mes talons traînent sur le carrelage de la cuisine et l’hiver qui s’est levé cette nuit fait son oeuvre sur les sommets enneigés. Me voici coupé du dedans et à l’abri du dehors, désorienté, sans rien à faire d’autre que tendre l’oreille et fermer les yeux, comme les paysans d’hier qui prenaient un peu de bon temps sous le couvert de la mécanique à l’arrivée des mauvais jours : les champs étaient labourés, les pommes de terre rentrées, la bise pas encore levée.
Les lauriers sont à l’abri, des feuilles multicolores jonchent la plate-bande, l’orange des roses jauni d’or. Le soleil entre à l'horizontale, pas de travail en vue, il y a bien assez à faire tous les deux réunis. Faire se rapprocher nos deux voix de soi-même jusqu’à ce qu’elles ne s’étonnent plus l’une de l’autre, se confondent. Silence. Il n’y a en réalité pas grand chose, un phrasé ponctué de simples, je devine une danse immobile et transparente. Pas surpris de ma présence. Si nous ne nous perdons pas de temps en temps l’un dans l’autre, nous sommes perdus.
Derrière les vitres piquées par le mauvais temps, les événements qui se succédaient au pas de charge s’enlisent. On reste tous les deux en arrière avec un panier de pommes cueillies tout à l’heure, une tèche de bois, une jardinière. Il y a vraiment de belles prisons. Le silence descend l’échelle et nous soulève, le peu que je suis encore se défait et devient toujours moins, jusqu’à disparaître, vide et sans horloge. Ne pas bouger, le moindre geste détruirait tout.
Peut-on dire autre chose que ce qu'on sait obscurément. Écrire dépasse de beaucoup ce qu'on est, sans qu'on soit capable jamais de mettre la main dessus. Mais il nous tire, rend meilleur, purifie ce qui reste en retrait, nous aide à trouver l’invisible axe de notre être au monde.
De là où tu es, vois-tu ce dont je te parle, de ce détour à l'occasion duquel on se perd au plus lointain de ce qui est, de cet asile que je caresse parfois du bout des doigts, à deux pas d’une mélancolie qu’il me faut bien concéder au moment de quitter les lieux. Mais rejoindre le train du monde ne constitue plus une défaite.
Nous vivons dans une boîte transparente où rien n’entre ni ne sort, mais où chaque chose fleurit, lentement, chacune pour soi au midi des autres. On n’en sort pas et j’y retournerai.
Jean Prod’hom

Publié le 1 novembre 2013 dans le cadre du projet de vases communicants chez Virginie Gautier (Carnet des Départs)
Adolescere

Une amie dont je réprouve la propension à excuser les oublis de son fils et à exaucer tous ses désirs, à qui je fais comprendre qu’il aura vraisemblablement à payer à la fin la facture de son laxisme, me répond sans se démonter que c’est précisément pour ces raisons qu’elle sera toujours là pour lui.
Arthur s’enfonce toujours davantage dans le fauteuil près du poêle.
- Je crois bien que je vais monter une startup.
Le temps passe.
- Faudrait d’abord que je trouve un copain.
Plus tard, dans le même fauteuil.
- Possible finalement que la bible ne soit qu’un roman pris un peu trop au sérieux.
Long soupir.
- Comme tant d’autres choses.
Jean Prod’hom
111 (c)

Tu crois pouvoir t’envoler, et finalement tu retombes sur terre sans savoir nager.
On espère toute sa vie que les mots mis en file indienne mènent quelque part. En vain.
Rechercher l’élargissement de la conscience ou sa suppression, c’est en définitive la même chose. Surtout à la fin.
Jean Prod’hom
(P. F. 11) Roland Béguelin

Un mètre trente à peine, chétif et pâle, genoux cagneux et boutons sur le front. Un cérébral morveux, premier de classe, sans fronde, la langue lisse, un peu moqueur, admiré par les vieilles dames qu’il sait complimenter. Pas susceptible pour un sou mais habité par un incompressible orgueil qui le condamne à piquer une colère de temps en temps.
Le gamin veut être au premier rang, déteste la violence mais allume les mèches; s’il peut concevoir le coup fourré, il ne l’imagine que loin de sa vue. Il cache sa faiblesse congénitale derrière une cascade de civilités et des jeux de mots. Dernier descendant d’une famille de la grande bourgeoisie locale sans fortune, le gamin est condamné à faire avec et pour des gens qui ne lui ressemblent pas.
Il polit seul dans sa chambre les mots qui doivent simultanément tenir en respect les garçons et séduire les filles. Ils ont beau ne pas l’aimer, le détester même, ils le craignent et ne peuvent s’empêcher de lui adresser des sourires auxquels ils se trouvent assujettis, jusqu’à se méprendre sur leurs propres sentiments, prêts à se glisser dans la peau de ceux qu’ils ne sont pas. Ce gamin est un serpent, il rassemble autour de lui tout son petit monde, lui le camarade providentiel en toutes circonstances, celles nées de la nécessité et du hasard.
S’il est doté d’une faible puissance de calcul, il jouit d’une belle capacité à digérer les encyclopédies et les manuels scolaires. Il médite le soir sur les deux cartes de son livre d’histoire représentant les empires coloniaux au lendemain du Traité de Vienne et à la veille de la Grande Guerre. On devine chez ce garçon la présence d’un petit caporal qui ne s’épanouira que dans une grande cause. Mais il hésite: rameuter ses troupes pour une guerre de conquête ou se glisser dans la peau du héros d’une guerre d’indépendance. Il travaille chaque soir à surmonter cette contradiction. Sans humour. Quoiqu’il en soit c’est décidé, il changera le cours de l’histoire, au moins celle de son village, de sa région peut-être. Le stratège en herbe rédige ce soir son premier article pour le journal local.
Jean Prod’hom
Il y a le passif transitoire

Il y a le passif transitoire
la natation synchronisée
les joints de culasse
il y a la dignité de l’homme
les oeufs
les barbelés
il y a les murs porteurs
l’adaptation au milieu
les saucisses de veau
Jean Prod’hom
110

Je ne suis pas superstitieux parce que ça porte malheur mais par nécessité.
Si je n’ai rien écrit plus tôt c’est parce que je n’avais rien à dire. C’est pour cette même raison que je me suis mis à écrire chaque jour.
Essaie sans y parvenir de concevoir le lien qui m’unirait, si j’avais un frère, au beau-frère de ma belle-soeur. Me perds lorsque je m’y attelle dans un immense territoire de terre sèche, à égale distance de ceux que je ne connais ni d’Adam ni d’Eve et des miens que je crois bien connaître, un territoire qui a la consistance des limbes.
Jean Prod’hom
Credo

Je crois, je crois aux vertus de l’agnosticisme qui maintient au coeur de l’homme d’aujourd’hui la foi étonnée et naïve des idiots, qui projette en tout temps la possibilité même d'un au-delà à la laïcité – dernier avatar du monothéisme. Qui ne tranche pas mais suspend, maintenant sous ses feux hésitants un avenir dont il ignore tout. Qui ne succombe pas aux tentations de l’oubli et considère avec bienveillance les idoles de nos cultes familiaux. Je crois aux vertus de l’agnosticisme, ce coeur spirituel du courage, le courage des hommes, des plantes et des bêtes qui regardent sans bien comprendre se lever et tomber, goutte à goutte, le jour et la rosée.
Jean Prod’hom
(P. F. 10) Bertram Schoch
 Bertram
BertramDes poupées de tous les pays au garde-à-vous sur les rayons d’une étagère, un morbier, des pièces de domino égarées dans les méandres d’un tapis d’orient, une carte du monde piquée d’épingles au-dessus d’une table encombrée, ne le cherchez pas, l’adolescent n’est pas dans sa chambre.
Penchez-vous par la fenêtre, vous l’apercevrez dans le jardin, assis contre un tilleul dans l’herbe et les pissenlits, perdu dans un labyrinthe de pensées sans queue ni tête. Vous le verrez branler du chef avec la régularité d’un balancier, l’adolescent souffre. Une dépression s’est levée sur le golfe de Gascogne, les circonstances le talonnent, ne le lâchent pas, ne lui laissent rien, pas même une envie ou un souvenir. Les allées et venues de la vermine dans la pelouse l’effraient, le vent siffle, le chant des oiseaux dans le cerisier l’exaspère. Le monde entier pèse contre sa poitrine, l’écrase, l’épuise.
Comment arrêter cette vague qu’une drogue sournoise a soulevée, comment parviendra-t-il à renverser les signes sans perdre l’équilibre? La chose se présente d’elle-même lorsqu’il soupire, tout près des aigrettes d’un pissenlit, les akènes portent des fruits que le vent propulse au-delà de ce qu’il peut voir, plus loin encore, en direction de l’océan. L’adolescent revit, il se sent soudain le centre des forces du monde. Il n’y avait qu’à prendre les choses par l’autre bout, le voici d’un coup à la source de ce qui est. Il suffisait d’un seul soupir, d’un geste pour infléchir l’orientation des choses. L’adolescent sent alors que le manque qui le détruisait se comble, et que ce manque ne suffit plus à contenir ce dont le monde est gros et qu’il tient dans la main.
C’est lui qui est à l’origine de la dépression sur le golfe de Gascogne, qui sera demain à l’origine de la haute pression sur les Açores, les chicanes au centre ville et les bastons au centre sportif, c’est lui. La puissance du gamin grandit.
Il laisse le tilleul, titube avant de rejoindre son bureau, écarte le désordre et note dans un cahier tous les événements qui lui parviennent, les décrit, imagine avec précision les effets qu’ils ont sur les habitants de sa ville et les gens du quartier. L’histoire qui l’a conduit là se déploie ailleurs, dans toutes les directions et atteint d’un coup les moindres recoins du monde. Il note le passé et le futur, leurs liens, découvre leur nécessité. Tant qu’à faire il va plus loin, il guérira les hommes, distribuera des médailles et des récompenses, redistribuera les richesses. Il s’attaquera aux brigands, jettera des sorts, dénoncera les hérésies, il imposera la vérité, rendra impossible les malversations, mènera une croisade dont personne ne saura rien. A moins qu’un jour quelqu’un ne découvre ses cahiers et les lise : la vague que la drogue sournoise a soulevée l’a dévasté.
Jean Prod’hom