C’est une grosse entreprise

C’est une grosse entreprise – la troisième de France –, fondée il y a quarante-trois ans, qu’une vingtaine d'employés venus des quatre coins du monde font fructifier aujourd’hui. Difficile d'évaluer le nombre d’arbres que le mistral malmène depuis ce matin, plusieurs dizaines de milliers certainement, dans une boucle du Lez, sous Colonzelle, tout jeunes encore, qui seront mis en vente l'année prochaine : abricotiers, pommiers, amandiers, pêchers, pruniers...

L’enjambeur a sarclé les allées de cet immense verger, on voit dessous la terre encore humide, nul besoin de puiser dans les basses eaux du Lez. Se détachent des interminables rangées de pruniers deux silhouettes, qui se penchent et se redressent, on fait la causette. La femme est roumaine, établie depuis dix-huit ans à Valréas. L’homme est venu avec sa femme de Corrèze, il a une trentaine d'années et le sourire des rastas ; ils rejoindront fin octobre les vignes de la Gironde. Mais aujourd’hui, il font équipe, entent des greffons d’abricotiers sur des porte-greffe de pruniers ; ils se tiennent par la barbichette, car si la Roumaine est payée à l’heure, le Corrézien est rétribué à la pièce, si bien qu’aucun des deux ne se prélassera longtemps sur la couverture qu’il ont déroulée sous les saules qui bordent la rivière, à l’abri du mistral.
Voilà comment l’équipe fonctionne : la femme tend à son collègue une tige d’abricotier piquée d'une douzaine d'yeux. Celui-ci en décapsule un avec le tranchant de son greffoir – on appelle ça un écusson – qu'il garde avec précaution entre le pouce et l’index de sa main gauche tandis que, de l’autre, il incise en T le porte-greffe, près de sa base. En usant d’une lame émoussée située à l’autre extrémité de son outil, il écarte l'écorce et y glisse le greffon, comme on glisserait une lettre dans une enveloppe. Cette opération de chirurgie aura duré une quinzaine de secondes et lui rapportera dix-sept centimes.
Il reprend ensuite le rameau d'abricotier déposé dans un seau et recommence l’opération tandis que son équipière termine ce qu’il a commencé, ligature le greffon au porte-greffe au moyen d’un plastique qu'elle enroule quatre ou cinq fois – c’est l’emballage – et dont elle ne laisse dépasser que l’oeil. Ils ont commencé ce matin à 8 heures, ils termineront ce soir à 17, avec une heure de pause à midi, pas plus, étendus sur la couverture au bord du Lez, à l’abri du mistral.
Demain et les jours suivants, le Corrézien fera équipe avec sa femme, ils toucheront alors 25 centimes ; mais ils ne manqueront pas d’échanger leur place pour durer, car emballer et greffer sont à l’origine de maux bien différents. Quant à la Roumaine elle reviendra au bord du Lez en avril prochain, taillera les jeunes arbres fruitiers juste au-dessus du greffon, si bien que vous n’y verrez que du feu lorsqu’aux branches de votre prunier flamboieront des abricots.
Jean Prod’hom
Ils avaient moins de vingt-cinq ans

Ils avaient moins de vingt-cinq ans lorsqu’ils sont arrivés dans le Vaucluse ; en bateau et en train, puis en bus une valise à la main. Ils ont travaillé plus de quarante ans dans les vignes : taille, effeuille, vendange. A la retraite aujourd'hui sur la terrasse du Pagnol, ils ont les cheveux gris, pas de château, pas de famille ; ils boivent un coup, le visage usé et brûlé par le soleil.

Ils sont trois et ne se ressemblent pas, suivent du regard sans vraiment les voir les amateurs de la brocante de Valréas. Qui ont eux la peau rose, claironnent casquette ou chapeau de carnaval sur leur crâne rond, chemise à fleurs ou Lacoste sur le dos, cadres ou bobos.
Il a fait sec à Casablanca, 40 degrés à Fez, ils ne s’y rendront donc pas cette année. Ce matin, le mistral a laissé la place au vent d’ouest qu’ils ont à la bonne, café serré et verre d'eau, on se roule une cigarette.
On a parlé à l’ombre d’un platane, oh pas beaucoup ! et sans faire de bruit, surtout ne déranger personne ; on s’est souri en un sabir nourri d'arabe et de français du Jorat, avec la curieuse impression d’être du coin – l’un d’eux a travaillé autrefois dans le Jura –, satisfaits des maigres liens qui nous ont fait tenir côte à côte, loin des coups fourrés que se jouaient vendeurs et clients autour de ce foutripi descendu des combles ou remonté des caves qui trônera bientôt sur le buffet du salon.
Jean Prod’hom
Rêve qui le restera

Le ruisseau ne cesse d’accourir à l’énigme qu’il pose.
Jean-Loup Trassard

Rêve qui le restera, celui de vivre et de mourir à quelques encablures d'un ruisseau, peu après ses sources, imprévisibles, lorsqu’il les rassemble, indécises, bien décidé à creuser son propre lit. Timide, on l'entendrait à ses vocalises, lointaines, à ses gargarises profondes. Je nettoierais ses rives en décembre. Oh ! à peine, des bouts, ici ou là, bouts des bois et du pré qui le borderaient.
Ce ruisseau existe, en-bas le Renolier, j’y étais ce matin. Un chemin le franchit sur ce qu'on n’ose appeler un pont, simple tuyau de béton d’une trentaine de centimètres de diamètre et de cinq mètres de long, recouvert de terre et d’herbe. Le ruisseau n’a pas encore de nom, il arrive d’en haut, vif et d'argent, saute, fait des caprices. Les ficaires et les primevères se penchent sur ses rives, avec le ciel sur la tête ; bientôt les hêtres et les aulnes feront leurs feuilles, les sureaux et les noisetiers déplieront les leurs, elles prendront le dessus et le couvriront d’une dentelle trouée d’ombres et de lumières.
Les eaux serrent les coudes lorsqu’elles s’approchent de la voûte de béton, deviennent tout à coup sages, se disciplinent même pour finalement baisser la tête juste avant de pénétrer dans l’obscurité ; elles en ressortent serrées les unes contre les autres, la bouche ouverte, elles ne font qu’une lorsqu’elles se lancent dans le vide, les yeux fermés, comme l'enfant du haut du plongeoir. Elles tombent dans le petit lac qui s’est creusé avec le temps, se défont en respirant profondément ; elles occupent bientôt toute l’étendue de son miroir ; elles se donnent encore un peu de temps pour retrouver leurs esprits et se rapprocher à nouveau. C’est un go aux rives amples, silencieux, qu’entourent un sapin blanc et des sorbiers nains.
Elles semblent peu décidées à reprendre leur voyage, elles paressent, rêvassent, hésitent ; en témoigne l’ivraie qui remonte à contre-courant, et qu’elles suivent, discrètement, en roulant le long des rives. En regardant bien, on s’aperçoit qu’elles reviennent sur leurs pas, de chaque côté du go, prêtes à réitérer l’expérience, le plongeon qui, après les avoir effrayées, les a ravies.
Elles s’attardent près de la cascade, mais les éclaboussures finissent par les faire renoncer, elles se tournent alors d’un coup vers l’aval, bouillonnent avant de rejoindre à la hâte celles qui ont pris les devant. Aucun reproche de celles-ci à cause de ce contre-temps ; ensemble elles reprennent la route, pas effrayées le moins du monde par l'inconnu qui se présente ; elles s’y précipitent les yeux grands ouverts, comme si elles étaient averties, en temps réel, par les eaux qui les précédaient qu’il n’y avait rien à craindre.
Ça dépendrait des jours, du temps et de mes états d’âme, je n’aurais que quelques pas à faire pour me nourrir des rires et de la lumière qui accompagnent les eaux en amont du petit pont. Ou m'asseoir en aval sur les berges du petit lac pour consolider ce désir qui nous étreint de prolonger nos vies, sans répéter ce qui nous a éblouis, jusqu’à leur delta.
Ce ruisseau existe, anonyme, en-bas le Renolier, dans le vallon qui sépare l'ancienne déchèterie et Pra Massin. A Corcelles-le-Jorat.
Jean Prod’hom
Largo dei Librari

Il fait bon à 9 heures sur la terrasse de l’Ape Bar, dans l’ombre du Largo dei Librari, un cappuccino pour les plus grands, un thé pour Lili ; on fait quelques photos. Promenade ensuite le long du Tibre, jusqu’au pont Fabricius où j’abandonne Sandra et les enfants qui le cambent pour une partie de shopping dans le Trastevere. Je me hasarde du côté du théâtre de Marcello, prend deux tickets dans un bar de la place et monte dans le bus 63 qui traverse Rome du sud au nord.

Il m’emmène bien au-delà de midi et du parc de la villa Borghese : par Buenos-Aires et Mongolia jusqu’à Ojetti et Rossellini ; des enfants en montent et en descendent, ciao ciao, c’est l’heure de manger. Il ne reste bientôt que le chauffeur et moi, je descends en bout de ligne, dans un poudingue de friches et de bitume, de mauvaises herbes et de coquelicots. Je ne m’attarde pas, l’endroit est d’autant plus inquiétant qu’il est sans danger et qu’il n’y a personne. Je marche une demi-heure dans un paysage soustrait de chez les vivants ; quelque chose pourtant remue, sans que je sache si ça pousse du côté des ruines, ou si celles-ci sont sur le point de se relever.
Au milieu de rien s’élèvent derrière un grillage un parc pour enfants, carrousels et auto-tamponneuses, balançoires et une gare routière avec un bar ; j’y bois un café.
Une demi-douzaine de contrôleurs montent dans le bus du retour, nous sommes cinq ; je tends mon billet à une dame qui fait son boulot sans trembler, mon voisin de devant montre le sien ; le pauvre vieux du fond du bus ne sait pas trop quoi répondre aux deux individus qui le cuisinent, une dame répond aux mêmes questions, du bout des lèvres, sans regarder ceux qui prennent des notes.
Je prends le métro à Conca D’oro, direction plein sud, avec l’intention d’en sortir pour jeter un coup d’oeil aux bâtiments que Mussolini fit construire pour l’Exposition Universelle de 1942, mais c’est finalement du côté de Saint-Paul que je reviens sur terre, pas le temps d’aller jusqu’à l’EUR, une autre fois. Le tombeau du vrai maître des chrétiens est d’une belle sobriété, la chaîne qui l’a contraint à rester à Rome est un beau et fin collier formé de neuf anneaux.
Le bus 23 qui me ramène au centre historique traverse Testaccio, passe sous la pyramide et la tombe de John Keats, longe le Tibre jusqu’à la place San Vicenzo Pallotti. Je fais une dernière halte sur la placette des Librari, il est un peu plus de 16 heures, le soleil plonge derrière les vieux palais décatis qui bordent la via Capo di Ferro, se glisse dans le lit de la Via dell’Arco del Monte qui se jette un peu plus bas dans le Tibre ; une brise se lève avec l’ombre, le frais revient, avec dans le dos la façade blanche de l’église dédiée à Santa Barbara, sur la pierre de laquelle le soleil s’attarde. En face le siège historique du PCI et de son allié le Parti démocratique, avec un exemplaire de l’Unità du jeudi 31 mars, Antonio Gramsci avait un peu plus de trente ans en 1924. En page une, la photographie de Gianmaria Testa, il cantautore dei dimenticati.
C’est l’heure, je retrouve Sandra et les filles, on ramasse nos valises, en route pour Fiumicino. Le chauffeur du taxi nous parle des manifestations du jour, des contrats de travail et du derby de dimanche prochain entre la Lazio et la Roma. J’obtiens confirmation, l’équipe de Rome s’entraînait avant guerre sur le terrain en friche aperçu hier à Testataccio. J’écris ces mots, il est bientôt 21 heures, l’avion a deux heures de retard.
Jean Prod’hom
Testaccio

Aussi longtemps qu’on t’arrête sur la voie publique pour te refiler, contre 5 euros, un selfie-stick, une paire de lunettes ou, s’il se met à pleuvoir, un parapluie, c’est que tu n’es pas chez toi. File ! Va plus loin ! Il y a, au sud de l’Aventin, un quartier ouvrier, de vieilles friches industrielles et un cimetière pour ceux qui n’ont pas droit de cité ; tu y parviendras en longeant le Tibre, laisse-toi couler comme les goélands qui descendent à Ostie. Arrête-toi au Ponte Sublicio, tu es à Testaccio. Antonio Gramsci y est enterré, tout près d’un jeune poète anglais. Il a voulu, le malicieux, que soient gravés dans la pierre les mots suivants : Here lies One Whose Name was writer in Water.
Jean Prod’hom
2.

Le Vatican

Salle des cartes, province par province, celle de Sicile : Catane, Milazzo et les îles éoliennes, le Vulcano crache des flammes.
Pinacothèque, siècle par siècle : dans la main du Christ une poire, ou rien, ou un pic-vert ; trois oeillets dans un vase en piteux état, peu de lumière.
Du bleu enfin, le bleu du Jugement de la Chapelle Sixtine, du bleu de haut en bas, la mer, et puis celui de l’habit de Marie et, par le grain, trois natures mortes de Morandi.
Pour finir, bâclés, deux chardonnerets surpris par l’averse, peints sur les battants de deux armoires qui se succèdent dans un interminable couloir. De l’air, de l’air. Dehors, le visage de Pasolini sur l’une des piles du Ponte Sant’Angelo et un pêcheur sur la rive droite du Tibre, il y passera la journée.
Rome n’est pas dans Rome, partout des coulées de lave et une voix qui demande le silence sans jamais l’obtenir.
Jean Prod’hom

Giorgio Morandi, Nature morte italienne,1957
Forum

Théâtre Marcello, Capitole, Colisée, Ghetto, partout des mains qui se tendent, des visages qui se tordent et des cloches qui sonnent.
Jean Prod’hom

Campo dei Fiori

Vingt ans après : Fiumicino, Vicolo del Bollo, Campo dei Fiori, Area Sacra Torre Argentina et Piazza Farnese. Le Tibre, Santa Maria in Trastevere, Piazza Navona, Eglise Saint-Louis des Français, Trevi, Piazza di Spagna.

Jean Prod’hom
Tournon

Tirer du jour
quelque chose,
quelques chose à quoi l’accrocher.

« Je t'apporte l'enfant d'une nuit d'Idumée ! », écrit Stéphane Mallarmé perché sur les épaules de Ronsard.
« Comprends pas ! », répond l’enfant aux deux poètes de Tournon.
Jean Prod’hom
Peindre le pays où fleurit l’oranger

Cher Pierre,
Du jaune, des rouges, de l’orange, avec du bleu et les premières hirondelles, le printemps s’était bel et bien installé à Grignan. Et il y avait foule vendredi dernier, pas seulement parce que le soleil avait fait son retour et que les terrasses étaient ouvertes, mais aussi parce que l’Association Jean-Claude Hesselbarth et la ville de Grignan s’étaient donné la main pour fêter le 90ème anniversaire de ce peintre majeur, en présentant dans le bel Espace d’Art François-Auguste Ducroz quelques-uns de ses dessins à l’encre de Chine et un bel ensemble de ses peintures solaires.

Photo | Danielle Marze
Il y avait, pour entourer l’artiste né à Lausanne en 1925 et installé aujourd’hui dans la Drôme provençale, sa femme, sa famille, ses proches, ses amis – et parmi eux Philippe Jaccottet l’ami de toujours. Il y avait aussi le maire de la ville, Monsieur Bruno Durieux, ancien ministre.
Il faut préciser que le vernissage de cette exposition à Grignan ne constitue que le début des festivités, puisque la fête se poursuivra à Lausanne le jeudi 23 avril à 11 heures, au Théâtre de Vidy. C’est en effet à cette occasion que sera présentée au public romand une importante monographie rétrospective : Jean Claude Hesselbarth. Peindre le pays où fleurit l’oranger. Dans cet ouvrage, les auteurs Lauren Laz et Nicolas Raboud analysent les différents aspects d’une oeuvre importante, sur laquelle Pascal Ruedin, Philippe Jaccottet, Jacques Chessex et Francine Simonin donnent leur éclairage.

Photo | Danielle Marze
Et parce que l’oeuvre de cet homme et l’homme lui-même en valent la peine, l’ouvrage repartira le 15 mai pour Grignan, il y sera présenté une seconde fois, non plus à ceux qui l’ont vu naître, mais à ceux qui l’ont accueilli à Grignan, il y a longtemps déjà.
Jean Prod’hom
Folie ce matin

Folie ce matin, le responsable s’était absenté; les nuages n’en ont fait qu’à leur tête. Chacun, pour autant qu’il était, s’est livré tout entier à la poursuite ou sur le dos de son voisin. Les plus agités ont trempé leurs mains dans d’invisibles bassines de lumière, en ont gardé un peu de jaune sur les doigts. D’autres, même père même mère, ont remué leur jupon sur les épaules de Brenleire et de Folliéran.
il y avait une hâte qu’on ne pouvait comprendre que par le retour imminent du patron. Tous pourtant ne se se sont pas livrés à cette bacchanale, vous auriez pu en effet apercevoir un nuage solitaire égaré dans le bois à l’avant du Gibloux. Plus à l’est une vingtaine de petits soldats, au coude à coude, alignés sur trois rangs, surveillaient le verrou de Saint-Maurice. Au milieu du ciel deux solitaires attardés semblaient absorbés dans des rêves très sérieux.
Les anciens se désintéressaient du spectacle de leurs cadets, le regard tourné vers le Jura, avec autre chose dans la tête, une méditation lente dans laquelle les hommes avaient les yeux fermés.
Les fumées des cheminées de la Broye avaient bien tenté sur terre de se mêler à la fête, avaient agité sans discontinuer un ruban; et des ronds de fumée sont montés en spirale, personne ne leur a fait signe, ils se sont évanouis.
On n’a pas vu l’arrivée du patron qui a soufflé un bon coup dans la partie et déroulé dans le ciel, depuis le centre, un bleu couleur de ciel. Restent de cette heure qu’on oubliera vite, là-haut, les lignes d’acier tracées dans le vide par d’anciennes caravelles.
Jean Prod’hom
L'or fin

L’or fin confond au matin les êtres qui plastronnent
les plonge dans la glaise
seconde nuit dont ils ne s’émanciperont pas
Jean Prod’hom
Septembre aux Lofoten

L’homme qui titube dans le port de Svolvær
traîne un jerrican d’aquavit
la lune ne se retourne pas et continue sans lui
Jean Prod’hom
Morvan (1980)

Il parlaient dans une langue à gros galets
d’où jaillissait un filet d’eau
corps de lierre et jambes de bois
Jean Prod’hom
Viale Ruggero di Lauria (Catane)

Des fleurs dans un pot de grès
un lot de pauvres parés d’étoiles
le jour entre les barreaux par où s’invitent une tourterelle et un air de liberté
Jean Prod’hom
San Giovanni Li Cuti (Catane) (c)

Corps et cailloux brûlants expulsés des bouches de la ville
la mer a relevé ses jupes
et les accueille entre ses cuisses
Jean Prod’hom
Via Vittorio Emanuele II (Catane) (c)

Ne pas déchirer l'enveloppe
derrière laquelle
chacun vit incognito
Jean Prod’hom
Ginostra (Stromboli)

Une vingtaine d’indiens
l'hiver sans illusion
pris entre rêveries et volcan qui se racle la gorge
Jean Prod’hom
Enfers (Stromboli)

Une baleine noire
neuf évents chauffés à blanc
personne vraiment personne
Jean Prod’hom
Cimitero di Lipari

Les habitants de l'île avaient mis leurs morts
sous perfusion
pour les maintenir en l'état
Jean Prod’hom
Vespa (Vulcano)

Vespa de Piano à Gelso
une obsidienne dans la poche
des genêts s'accrochent
Jean Prod’hom
Ce que j'avais égaré (Milazzo) (c)

Milazzo
Retrouve enfin ce que j'avais égaré
avec la soudaine conviction
que j'aurais pu m'en passer
Jean Prod’hom
Hôtel Conti (Vulcano)

Tonnerre de lave noire
la vague battue disparaît dans les sous-sols
dans la nuit Alicudi Filicudi et Salina
Jean Prod’hom
A toi l'oeil à toi le monde à moi cette carte blanche


Le soleil est revenu, l’herbe a poussé, il me faudra tondre. Je suis passé ce matin près de l'étang, les iris vont s'ouvrir bientôt et faire voir leurs délicats arcs-en-ciel. Je crains toutefois que le bouclement de l'année scolaire, la virée à Orgevaux, le voyage aux Eoliennes et les deux livres auxquels je dois mettre un point final ne me tiennent loin du jardin et me fassent manquer l’éclosion de ces fleurs qui me ravissent depuis longtemps déjà. Il nous faut trop souvent consentir à renoncer à ce qui nous entoure et que nous chérissons ; il sera soudain trop tard, il ne nous restera que quelques regrets pour nous consoler, quelques images, quelques souvenirs, et l’amitié.
Car au fond il s'agit bien de cela, prolonger ou faire revenir ces instants qui nous font signe et à côté desquels on passe, condamnés que nous sommes, pour vivre, à nous détacher de l’immédiat en taillant des marches au fil du temps, en nous promettant au dedans qu’on ne nous y reprendra pas et qu’on recomposera sur nos claviers, plus tard, ce qui était lorsqu’on n’y était pas, songeant au bonheur que ces instants auraient pu nous apporter et qu’ils nous offrent tandis que, écrivant musique et cadence, nous ne l’espérions plus.
J'ai pris quelques photos des iris dans leur étui et conduit Louise à Lucens pour la fête du cirque, Lili fait du cheval et Arthur du vélo. A la fin, je le sais, le vent nous emportera, on ne laissera à ceux qui viennent que les quelques brimborions qu'on aura cru bon ne pas jeter, une fleur qui s’incline, quelques tercets, des photographies, les peintures des amis et, mêlé à l’intraitable beauté du monde, un peu du trouble qui nous habite.

Souvenez-vous, nous étions convaincus que l’homme filait du mauvais coton et que nous avions été désignés pour le remettre sur le bon chemin. Nous étions jeunes et souhaitions changer le monde, obtenir du même coup ce qui nous manquait et que nous avaient promis nos prédécesseurs, l’obtenir immédiatement, sans que nous sachions exactement quoi. (Nous n’en savons guère plus aujourd’hui.)
Nous voulions ainsi nous donner une chance d’accéder à cet autre lieu qu’alimentaient des philosophies qu’on baragouinait avec l’autorité des gens pressés. On avait entendu, au coeur même de leur doctrine s’éveiller celui qu’on n’était pas encore, avec lequel et pour lequel on était prêts à agir, qui nous mènerait à cet ailleurs auquel on comptait bien goûter un jour. Ce désir trouble qui nous habitait, sans objet ou presque, ou satisfait par le premier venu, ne nous a jamais quittés.
Nous avons alors posé de petites mines, fait bourgeonner des mots simples, prononcé des formules incantatoires, conçu des poèmes bâtards. Bien peu lorsqu’on y songe ; mais nous avons eu la chance, ce faisant, de nous rencontrer et de marcher ensemble.
Nous avons dans le même temps appris que, même seuls, nous ne sommes pas seuls, ou que nous le sommes avec ceux qui nous accompagnent lorsque nous sommes loin d’eux. On joue toujours à l’intérieur de soi une partie à deux, l’un est soi, l’autre est foule.
Je me souviens de nos virées et de nos rires, de nos excès et de nos insouciances. Penser que nous avons un jour abandonné la partie serait se méprendre, nous avons réinvesti la force qu’on dilapidait dans le désert sur des chemins plus étroits, sans autre adjuvant que l’honnêteté de qui ose l’aventure, en accueillant aussi, à l’intérieur de celle-ci, l’obstacle contre lequel on avait buté et dont on ne voulait jusque-là rien savoir.
Vieillir évidemment change la donne, pas tellement parce qu’on n’y croit plus, mais au contraire parce qu’on y croit davantage et qu’on devine avec toujours plus d’acuité que ce qui aurait pu nous combler est précisément ce qui nous aura portés. Nous avons poursuivi chacun de notre côté, loin des groupes et des poisons qu’ils distillent, réconfortés par l’amitié et ses vertus sans lesquelles nous aurions été bien incapables de prolonger nos aventures solitaires. J’ai avancé avec vous, seul et sans béquilles.
Il ne suffit pas de mettre la main, un jour, sur une veste trop courte, des pantalons trop longs, une canne et un chapeau melon, de se laisser pousser une moustache pour devenir le héros des Temps modernes. Les légendes ignorent les échafaudages qui ont présidé à leur édification : elles ne disent rien du temps long, de la fidélité, du chemin qui, d’énigme en énigme, trouve sa direction.
Vasco et Pablo sont des amis d’enfance, dans la force de l’âge. Ils quittent Belem à bord d’une caravelle, avec dans la poche les recommandations d’Henri le Navigateur ; les deux embarcations descendent l’estuaire flanc contre flanc. Vasco jette un coup d’oeil sur la rive gauche du Tage, du côté d’Alcochete où il laisse sa famille, mais aussi les corniers et les gerboises qui le ravissent depuis qu’il est enfant. Pablo scrute de son côté la rive droite, les magasins du roi et les ateliers de construction où travaille son père. Les deux amis sont en route pour la côte ouest de l’Afrique. Mais sitôt la barre de l’océan franchie, voici que les caravelles divergent d’un rien; au large de Cascais, les amis se perdent bientôt de vue : un monde finit par les séparer.
Des nombreux voyages qu’ils feront, Vasco ramènera des portraits d’oiseaux, en particulier ceux de l’île d’Arguin ; Pablo des croquis des embarcations qu’il a observées, notamment celles de l’archipel des Bijagos. Pourquoi cet écart, nul ne le sait, un battement d’aile suffit à donner une orientation à ce qui n’en avait pas.
Chacun pilote son embarcation de l’arrière, qu’il soit dans un verre, un lac ou la mer. Certains ont le courage de la pousser là où les portulans manquent, ils en dressent alors un de fortune pour ne pas se perdre, pierres immatérielles sur lesquelles ils vont et viennent immobiles. Je vous aperçois sur vos coques de noix coupant l’horizon ; vous voir me donne du courage. Celui qui ignore l’amitié et la fidélité ne comprendra rien de la parenté de ce qui sépare et unit.
On ne sait pas à quoi tout cela rime et à quoi bon on le fait, mais on le fait jusqu’au bout. On diffère le terminus aussi longtemps que possible ; de fil en aiguille quelque chose se met en place, quelque chose qui était là bien avant qu’on s’en mêle, quelque chose qui nous ressemble.
Il y a un livre dont on ne tourne pas la page, c’est le livre qu’on écrit ; vous avez continué le vôtre, comme d’autres le leur, séparément, en des lieux qui se côtoient, se frôlent ou s’emboîtent. Et un jour, par la grâce de l'amitié, on se retrouve, avec dans la poche une ou deux choses qu'on a ramassées ou bricolées, qu’il faut bien déposer quelque part si on veut repartir les mains et l’esprit libres. On organise une fête à l’occasion de laquelle on tremble un peu, non pas tant parce qu’on douterait de la valeur de ce qu’on a réalisé, c’est trop tard, mais parce que les amis seront là. Je retrouve derrière vos visages parcheminés par les ans ce qui demeure, on évoquera nos errances et nos rencontres. Prenez bien soin de vous, je prends soin de ce que vous laissez, il contient ce que vous y avez mis, c’est tout ce que je possède.
Yves, Anne-Hélène, lorsque vous êtes venus me trouver au Riau, vous aviez déjà mis la main sur la forme que prendrait cette exposition. Il aurait été vain de vouloir combler ce gouffre que les années ont creusé entre vos deux rives. Vous aviez le sourire, heureux d’avoir trouvé le dispositif qui réunirait ce qui vous sépare, sans que jamais les images de l’un mettent celles de l’autre sous tutelle. Pas question donc d'ajouter quoi que ce soit à ce qui tient debout tout seul.
En commençant par l’autre bout, en me rappelant les fidélités que génère l’amitié, me sont apparues très clairement et très distinctement les deux directions qui se sont offertes naguère à vous, à nous, sans que nous le voulions : à toi l’oeil, à toi le monde; à moi, et je vous en remercie, une carte blanche.
Je crois au fond ne m’être jamais départi du dualisme de Descartes. La relation du sujet pensant aux objets et à l’étendue qui les contient demeure l’une des énigmes les plus profondes de notre temps. Nous n’en sommes pas sortis, invités désormais à réexaminer la relation que pourraient prendre ces deux attributs de l’être, dans les domaines qui nous sont propres – celui du langage, celui des images –, pour mieux apprivoiser cette énigme qui nous a condamnés, après nous avoir libérés, à claudiquer.
Il y a d’un côté l’oeil qui se trouble, l’esprit qui pense, doute, s’égare ; il y a de l’autre le monde dont nous sommes les hôtes et dont nous peinons à saisir l’infinie richesse. Nous avons voulu en avoir le coeur net, interminable collecte, mise bout à bout des fragments du monde, punaisés dans des boîtes sous l’empire du langage. Il a fallu déchanter, celui-ci tient en laisse ce qu’on croyait tenir dans nos mains, notre mémoire se révèle insuffisante et nous demeurons muets devant le miracle de cette coexistence. Inutile de le déplorer.
Il a fallu, Anne-Hélène, t’exiler, rejoindre d’autres continents, laver ton esprit à leurs eaux pour que, après un long détour, tu rebattes les cartes découpées dans le tissu homogène de nos récits, en conçoives d’autres, recadrées, décadrées, qui ne sont plus subordonnées aux patrons que nos routines ont mis à notre disposition. Voici nos attentes réorientées, des mondes qui auraient pu exister, les vides et les pleins redistribués; on se penche sur nos obscurités, on ouvre les yeux sur le doigt et on les ferme sur ce qu’il désigne. Combinaisons inédites qui décollent mes paupières, redonnent du jeu à ce dont je fais partie : brelans inédits et paires imprévues, qui rapatrient le trouble dans mes vues étroites, suggèrent enfin – et surtout – que la partie jouée ici relève, elle aussi, du merveilleux qu’on prête à l’ailleurs.
J’ai, sur le rebord de ma fenêtre, des images qui se chevauchent, une pierre de Patmos, un ciel, des labours, le saint Augustin de Vittore Carpaccio, un caducée, des images de vieux crépis et quelques tessons ; un moineau s’y invite parfois, sans titre, sans date, sans lieu. Ces images de la coexistence retiennent quelque chose qui déborde la raison, petits autels portatifs qui m’obligent à regarder à nouveaux frais ce qui m’entoure, me dissuadent de donner au lieu qui est le mien la forme d’un puzzle dont j’aurais à trouver la dernière pièce, mais plutôt la forme du vent dans lequel couleurs et lumière se roulent parfois en juin. Tu en témoignes, Anne-Hélène, le monde a lui aussi ses fenêtres et ses rebords, lieux de passage vers ce qui n’a pas de nom.
Il y a l’oeil qui se trouble, l’esprit qui pense, doute, s’égare, il y a mes yeux qui se ferment. Ce que nous avions cru bien établi s’est mis à trembler : nos récits font grise mine, nos représentations épousent la fumée. Le bord des choses faseye, les liens de subordination mollissent, les idées vacillent. Vertige.
Le jardin et le ruisseau qui nous enchantaient sont-ils des rêves ? Je veux y voir clair mais bute sur la dimension de mon objet. Comment éclairer ce qui ne tient aucune place, ou presque ? Quelles lentilles feront apparaître distinctement ce qui relève de mon esprit, de mon regard et du désir qu’il loge ? Quel est ce presque rien qui remue en moi, que mon corps abrite et qui fait respirer les choses ? Comment le faire voir dans sa simplicité, dans sa pureté ? 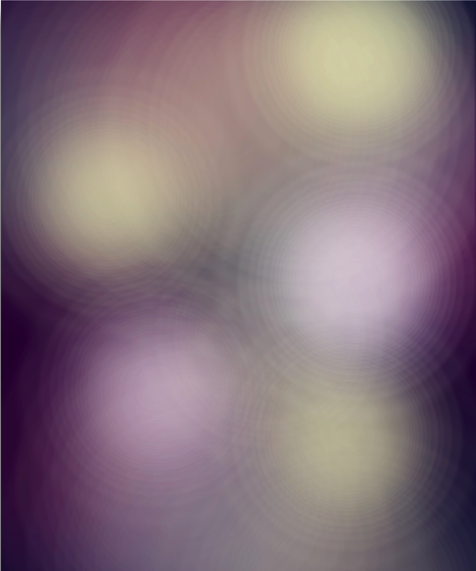
Ce rien qui tremble, respire, bouge, remue, t’a conduit, Yves, à un autre exil. Il le fallait pour donner une représentation à ce qui ne relève d’aucun lieu, pour en produire d’abord le contour, la profondeur, le relief, en examiner les variations, en figurer le jeu. Motif plongé dans un morceau de cire d’abord, organe enveloppé dans un suaire, lumière jetée dans la brouille, mots coulés dans le verre, poussière noyée dans les larmes, autant d’objets soumis au passant pour lui donner à voir son trouble. Tu lui fais voir aujourd’hui le trouble lui-même : plus de mise en scène, plus de motif, de cire ni de larme, plus de suaire, ni verre ni buée. Un seul mirage, à peine une image, celle de la lumière – qui est, disait Robert Walser, très petite –, presque rien, bientôt plus rien. Mais un rien qui tremble, étend son empire bien au-delà du domaine qui lui a été attribué, comme une poignée de galets jetés dans l’étang et dont d’immatérielles ondes répercutent la force jusqu’à l’horizon, arcs de cercle, cercles, arcs-en-ciel.
L’iris, – celui de notre oeil –, est tout à la fois l’objet et l’image de ce trouble rendu à lui-même, qui déborde de son orbite et anime sa banlieue, il outrepasse ses limites comme ces taches de lumière projetées sur l’écran noir de nos paupières et qui s’en échappent plus vite encore lorsqu’on veut les retenir. Tu as su, Yves, donner au trouble qui agite notre esprit une image, avant d’en donner – le rendez-vous est pris – une ultime figuration sans dimension. On peut espérer qu’un jour les deux attributs de l’être ne fassent qu’un, sans qu’on ait besoin de renoncer aux inestimables profits que nous a apportés ce détour : la soif et la houle.
Que nos vies relèvent du rêve ou de la réalité, je n’en sais trop rien, mais je fais le pari que la seconde recèle les propriétés du premier, et que celui-ci ne cesse de déborder de son lit pour arroser celle-là qui s’y abreuve.
Avant que ces mots ne me pèsent, je vous laisse, je rentre à la maison, comme l’enfant à la fin de l’hiver, il pousse nonchalamment du bout du pied un morceau de glace oublié sur les bords du chemin. Il n’en reste rien lorsque la porte se referme derrière lui.
Finalement je ne serai pas passé à côté du printemps. Demain, une lentille d'eau poussée par le vent fera frémir le miroir de l’étang, la brise agitera les feuilles du tremble et les lèvres des iris, et je penserai une fois encore à vous. Car nous n’en avons pas terminé. Priés de rejoindre l’arrière de l’embarcation, nous tiendrons nos promesses, nous poursuivrons notre route solitaire, ensemble, la main sur le safran dans une nuit piquée d’or.
Vous l’aurez compris, ceci n’est qu’un poème qui dit la confusion que j’éprouve lorsque les exigences de l’esprit croisent celles de la matière, et le bonheur qui me traverse lorsque les pinces du serre-joint s’écartent et que je parviens à entendre derrière le rideau de la pluie un oiseau qui chante.
Corelli/ Sonata
#1 In D - 4. Adagio | #2 In B - 1. Grave
#4 In F - 1. Adagio | #4 In F - 4. Adagio
#5 In G - 3. Adagio | #6 In A - 1. Grave
Jean Prod’hom
ANNE-HELENE DARBELLAY
YVES ZBINDEN
Jean-Claude Hesselbarth | La Rivière II

Des papiers, il y en avait de toutes les qualités. Louis de Jaucourt en dénombre plus de 50 espèces dans l’Encyclopédie dont il énumère le petit nom : Grand-Soleil, Grand-atlas ou Petit-atlas, Grand-Jésus, Petit-Jésus, Petit-royal, Royal et Grand-royal, A la cloche ou A l’écu, Grand-cornet… Plus de cinquante de ces papiers pouvaient être obtenus en cinq qualités différentes : fin, moyen, bulle, fanant, ou gros bon. Les papeteries étaient situées près d’une rivière, à la chute d’un torrent, précise Jaucourt dans l’Encyclopédie.

Les pattiers amenaient au moulin les chiffes et les nippes, les guenilles et les chiffons qu’ils avaient collectés. Triés pour ne garder que le chanvre et le lin, ils étaient entreposés un certain temps dans un pourrissoir, lacérés ensuite, battus, broyés par des maillets armés de tranchans, brassés avant qu’on ne plonge un châssis dans une cuve pour que le papier s’y fige. Qu’on dessine sur des hardes récupérées ou des vêtements de seconde main ne me déplaît pas, on n’enfile pas un complet-veston à l’atelier.
C’est d’abord le papier, ostie ou page meringuée du Félix Gaffiot, boîte à oeufs qui me remue lorsque je considère l’encre de Chine de Jean-Claude Hesselbarth que j’ai chaque matin sous les yeux. Avant que la petite plume d’acier et le bambou taillé baignés d’encre ne me fassent parvenir le couinement qui a accompagné les outils dans la creuse du lit de ce jeu d’ombres et de lumières intitulé Rivière II (1982).
Un peu moins de 34 centimètres de large sur un peu plus de 50 de haut, comment calculer précisément la largeur d’un rêve ou d’une rivière ? Un peu moins si l’on soustrait les rives qu’envahit l’eau noir de tunnel.
Rivière à la bannière frémissant au vent, lumières, ombres et frondaisons, personne ne sait très bien où commencent et finissent les choses. Blason coupé avec les dents, décousu, on appelle drapeaux les chiffons d’où l’on tire le papier à la cuve. Recommencer, par dessus et par dessous, ronciers, pointes acérées du robinier, bambous, et puis ce flottement du sens et de l’orientation. Il est 10 heures, personne dans les rues, c’est jour de rentrée, jour d’école buissonnière, René est à la rivière.
Ah ! j’oubliais, Jean-Claude Hesselbarth fêtera ses 90 ans l’an prochain.
Jean Prod’hom
Nicole Gaillard | Lucian Freud | Hotel Bedroom

Lucian Freud (1922-2011)
Hotel Bedroom, 1954, Beaverbrook Art Gallery (Canada)
« Que l’on décrive cette expérience visuelle comme l’impression d’entrer dans la fiction, ou celle, inverse, de voir un personnage en sortir et prendre passagèrement une densité quasi réelle, le rôle imposé au regardeur est toujours celui d’un témoin par principe indésirable, conduit à s’éprouver tel puisqu’il a sous les yeux l’évidence d’une relation à deux qui, en son essence même, tant à la clôture et à l’exclusion de toute tierce présence. »
Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 282
Nicole Gaillard | David Hockney | Mr and Mrs Clark and Percy

David Hockney (né en 1937)
Mr and Mrs Clark and Percy, 1970-1971, Tate Galllery (London)
« Le vase de lys agit ainsi comme le marqueur le plus patent d’un scénario présent en filigrane, celui d’un moment où s’échappent des paroles importantes – seul élément caractéristique de l’épisode religieux susceptible d’être transféré à la scène peinte par Hockney, me semble-t-il. Somme toute, le choix de réactiver chez le spectateur les habitudes réceptives liées à l’Annonciation contribue à perturber en le complexifiant, le processus de réception d’une peinture qui se présente au premier abord comme un simple portrait. »
Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 271
Nicole Gaillard | Edward Hopper | Room in New York

Edward Hopper (1882-1967)
Room in New York, 1932, Sheldon Museum of Art (Lincoln)
« Yves Bonnefoy le dit mieux que personne : « Exemplaire de ce qu’il [i.e Hopper] épie aux confins de l’âme et du silence du monde, cette femme de A Room in New York, 1932, qui, près de son mari qui lit intensément son journal, a posé, ou va poser, un doigt, rien qu’un doigt, sur le clavier du piano, pour écouter les vibrations de la note, belle métaphore d’un grand possible, celui qui manque à la vie. »
Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 246
Nicole Gaillard | Otto Dix | Mélancolie

Otto Dix (1891-1969)
Mélancolie, 1930, Kunstmuseum (Stuttgart)
« Emprisonné, réduit à l’état de pantin, acculé au seul désir de se dissoudre dans la nuit orageuse teintée de feu, l’homme endosse ici le rôle de la victime dépossédée de sa dignité originelle par une partenaire sans scrupule, à qui il suffit de se dénuder pour prendre au piège sa proie. »
Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 231
Nicole Gaillard | Max Beckmann | Man and woman

Max Beckmann (1880-1938)
Man and woman, 1932, Collection particulière (Lackner)
« Voilà donc le divorce accompli que j'évoquais plus haut. Les partenaires se sont tourné le dos, se sont réparti les deux dimensions de l'espace reçu, comme se négocie le partage des biens communs lors d'une procédure de divorce: "Je reste ici, tu vas là-bas", et, corrolairement: " Je vais là-bas, tu restes ici. » Aucune surprise dans ce partage où la femme s’attache au proche et au connu, tandis que l’homme ira découvrir le lointain, pas plus que dans l’attribution des positions contrastées, elle couchée, lui debout. »
Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 192
Nicole Gaillard | Ernst Ludwig Kirchner | Das Paar vor den Menschen

Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938)
Das Paar vor den Menschen, 1924, Kunsthalle (Hamburg)
« … d’autre part, le besoin, même pour un artiste qui s’est défini dans la rupture avec l’art du passé, de se confronter aux grands thèmes véhiculés par la tradition iconographique. Les enfants terribles sont aussi des héritiers. »
Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 186
Nicole Gaillard | Oskar Kokoschka | La fiancée du vent
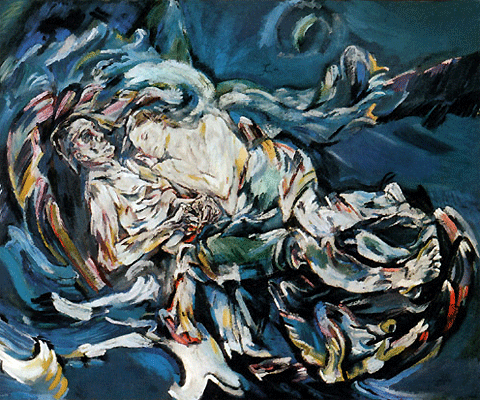
Oskar Kokoschka (1886-1980)
La fiancée du vent, 1914, Kunstmuseum (Bâle)
« Le mouvement lyrique de la composition en arabesques, la symphonie des bleus, l’allure irréelle et merveilleuse de la scène abritent en leur sein un corps étranger, cet homme qui semble ne pas pouvoir se laisser aller au repos ou à l’apaisement. »
Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 163
Nicole Gaillard | Félix Vallotton | La Chambre rouge

Félix Vallotton (1865-1925)
La Chambre rouge, 1898, Musée cantonal des Beaux-Arts (Lausanne)
« Il convient sans doute de mentionner ici les ambitions littéraires de notre peintre, dont la production écrite, peu connue, comporte cependant quelque pièces de théâtre et trois romans ; on peut voir dans cet intérêt actif pour l’écrit un facteur qui contribue à expliquer le caractère fortement narratif et dramaturgie des Intérieurs. »
Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 135
On reste à distance, mais on reste : ce qui nous perturbe dans l’oeuvre est aussi ce qui nous retient, force notre attention.
Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 139
Nicole Gaillard | Henri Matisse | Conversation

Henri Matisse (1869-1954)
Conversation, 1908-1912, Musée de l’Ermitage (Saint Petersbourg)
Bien que nous soyons beaucoup plus près des personnages …, il y a comme une vitre entre eux et nous qui donne à cette conversation une dimension à tout jamais énigmatique : on a là un effet assez analogue à la focalisation externe des narratologues, soit ce procédé qui consiste à maintenir le lecteur à distance des personnages, à filtrer l’information, à ne rien livrer de plus que ce qu’un observateur extérieur et neutre pourrait constater… Matisse fait mine de nous introduire mais nous maintien sur seuil.
Matisse fait mine de nous introduire mais nous maintient sur le seuil : le spectateur en quête de narration est tout à la fois retenu et déçu.
Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 127
Nicole Gaillard | Edward Munch | Homme et femme

Edward Munch (1863-1944)
Homme et femme, 1898, Bergen Art Museum (Bergen)
Aucune concession à l’anecdote ici.
Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 95
Nicole Gaillard | Gustave Caillebotte | Intérieur, femme à la fenêtre
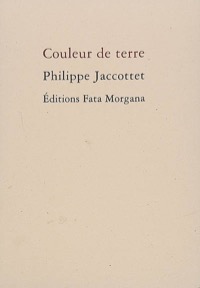
Chemins, taches rousses des sédums, lianes des clématites sauvages, chaleur du soleil couchant.
(Noté d'abord cela, pour ne pas oublier l'intensité singulière de ces instants.)
Aussitôt après :
Ces taches rousses sur les rochers - comme on parle de la lune rousse –, comme des morceaux de toison, de la toison du soleil couchant ; et puis ce lien entre chemins et chaleur, une chaleur émanée du sol…
En dépit de ma bonne volonté, je ne parviens pas à donner le moindre crédit à ce mot placé là, émanée, dont la voyelle finale, lourde et émoussée, me détourne de ce chemin d’où monte, comme une invisible vapeur, une chaleur couleur de terre. Tout s'y refuse.
Surgit pourtant dans le même temps, comme pour remplacer ce mot qui m’est refusé, une image venue de très loin, un pâturage au fond d'un vallon traversé par le Triège, atteignable par un chemin caillouteux à double ornière depuis le Trétien, ou par un sentier depuis le col de Fenestral au-dessus de Finhaut, mais qu'on rejoignait en famille de la Creuse en suivant un sentier au pied du Luisin. Vallon profond qui s’étend dans une herbe maigre, épais tapis de tourbe avec des linaigrettes et des carex, moquette mitée par le ruissellement d’innombrables petits cours d’eau qui se rejoignent et se séparent comme des coraux. Ravivée l'été passé par quelques balades, l’image de cet alpage s’impose, écarte le vilain mot, malvenu, couvert d’une épaisse couche d’étain, avant que je ne reprenne, à la sortie de ce vallon dont j’aurai parcouru les beautés, en aval, intacte, la lecture des pages de Philippe Jaccottet.
et le chemin, une sente plutôt qu'un chemin, "la sente étroite du Bout du Monde" mais justement pas du Bout du Monde : d'ici, de tout près, sous les pas. (Non dans un livre.) Tendre trace silencieuse laissée par tous ceux qui ont marché là, depuis très longtemps, traces de vies et des pensées qui sont passées là, nombreuses, diverses, traces de bergers et de chasseurs d'abord – et il n'y a pas si longtemps encore –, puis de simples promeneurs, d'enfants, de rêveurs, de botanistes, d'amoureux peut-être...
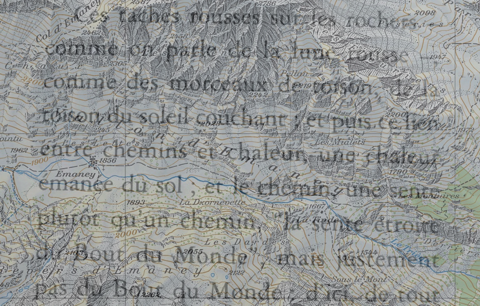
On se rendait à pied au fond de ce vallon dès l'aube pour être de retour à midi, avec le beurre et la crème que nous achetions au berger, avec les petits fruits aussi que nous cueillions en chemin, myrtilles surtout pour lesquelles notre mère vouait une véritable passion. Le sentier qui longe le Triège s’en éloignait lorsqu’on reprenait en début d’après-midi celui qui nous conduisait à la Creuse, laissant derrière nous le pâturage d’Emaney qui avait illuminé cette journée sans que personne ne le sache encore, le vallon d’Emaney vers lequel on lèverait la tête, plus tard, comme en direction d’une énigme. On croisait d'autres habitués, silencieux, qui marchaient comme nous avec mille précautions, parce qu’on se croisait à peine sur ce sentier qui se faufilait entre mélèzes et arolles, aulnes et bouleaux nains, genièvre, sariette et rhododendrons, et de lourds blocs de granit brûlant qui l’obligeaient à se contorsionner.
Si l’image de cet alpage, de ce vallon et de tout ce qui les entoure s’impose à moi aujourd’hui, c'est en raison d’un nom que je n’ai pas cessé de répéter à la place du mot que j’ai répudié, Emaney, avec à la fin, tout au fond du vallon, cette voyelle qui ouvre ses bras et son assiette, inscrivant au coeur d’un texte les lignes souples d'un autre temps, à la fois morceau du monde, ici, tout près, dans un pli de la mémoire, trace d'enfant qui n'a rien perdu de son intensité, quelque chose du dehors qui s'installe sans crier gare dedans, une poche sans fond mais aussi, comme le dit Philippe Jaccottet dans Couleur de terre, la stupeur d'avoir été simplement là, sans savoir ni comment ni pourquoi, à Emaney, avec non pas la chaleur qui montait des chemins, une chaleur émanée du sol, mais la force invisible d’un vallon, l’imperceptible émané d’un nom.
Jean Prod’hom
Nicole Gaillard | Pierre Bonnard | L'homme et la femme

Pierre Bonnard (1867-1947)
L’homme et la femme, 1900, Musée d’Orsay (Paris)
L’hypothèse d’une scène inscrite dans un miroir est d’ailleurs évoquée pat Timothy Hyman, qui relève la présence d’une sorte de cadre le long du bord gauche, finissant en arrondi dans le coin inférieur gauche… Si miroir il y a...
Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 56
Nicole Gaillard | Edouard Vuillard | Le prétendant

Edouard Vuillard (1868-1940)
Le prétendant (Intérieur à la table à ouvrage), 1893, College Museum of Art (Northampton)
La jeune femme de droite est la soeur de Vuillard, Marie, et le jeune homme, Kerr-Xavier Roussel; le couple va se marier peu après, en juillet 1893, soit la même année que celle figurant au bas du tableau, et Vuillard semble avoir activement travaillé à cette union...
Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 36
![]()
Ici, nous sommes au contraire témoins d’un instant précis, fixé au passage, dont nous reconstituons intuitivement l’avant (l’absence de l’homme), et l’après (son mouvement pour s’avancer dans la pièce, refermer la porte derrière lui, s’adresser à sa fiancée). Mais au fond, d’où tenons-nous la certitude de ce déroulement ? Ne peut-on aussi bien imaginer que le jeune homme soit en train de sortir de la pièce, jetant un dernier regard d’adieu à la jeune femme ?
Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 40
Nicole Gaillard | Edouard Manet | Dans la serre

Edouard Manet (1832-1883)
Dans la serre, 1879, Alte Nationalgalerie (Berlin)
Que nous apprend en effet la peinture spécialisée. Qu’il s’agit du « portrait d’un couple, M. et Mme Jules Guillemet, propriétaires d’un magasin de mode réputé, au 19 rue du Faubourg Saint-Honoré, et amis du peintre ». Cette indication transforme radicalement, à première vue, la compréhension de l’oeuvre : nous avons à faire avec un couple officiel, les alliances ne dissimulent aucun mystère, ni tentation d’adultère, ni mariage de convenances entre un homme mûr et une femme aux sentiments réticents.
Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 20
State | Paolo Woods et Arnaud Robert

Les photographies que Paolo Woods présente au Musée de l’Elysée pourraient faire croire qu’Haïti est un immense patchwork aux couleurs de l’Afrique faufilé par la conscience économico-religieuse de l’Occident. Il n’aurait pas tout tort. Mais il ne comprendrait pas pourquoi tout cela tient ensemble. Le texte d’Arnaud Robert qui accompagne cette belle exposition déplie avec lyrisme ce que chaque image réunit et encadre.

Paolo Woods | Musée de l’Elysée
Je devine désormais pourquoi les Haïtiens, surpris d’avoir renvoyé les colons chez eux, tutoient les dieux. Méfiants pourtant, ils attendent depuis 1804 leur retour. Dans une touffeur qui fait douter de tout. Ils les attendent la main au canon sur le parvis de la citadelle Laferrière, avec des Casques bleus sur les toits qui les encadrent. Voici le paradoxe, les colons sont dans la place, dans leur dos, et tout le monde le sait. Comment dès lors et pourquoi faire quoi que ce soit ? Quoi d’ailleurs ?
Les Haïtiens ne sont pas là où on croit, vivent dans un espace parallèle, à côté d’un président qui se promène avec une casquette de seconde main sur la tête et un portable à 10 dollars. Il y a quelque chose de mystérieux, personne n’écoute personne, chacun s’oppose à chacun, on se convertit, se reconvertit, le chef de la police lance une ligne de vêtements, le médecin importe des voitures, on échange sa place, le directeur du Bureau national d’ethnologie est aussi un prêtre du vaudou, le chansonnier devient président. Et ça tient un jour, on recommence et on renonce le lendemain, sous les yeux complices de l’ONU et des ONG qui se prennent au jeu.
Il y a si peu et tout est si vif aux Cayes qu’il n’y a rien à ajouter. La volonté de stabilisation est un voeu fou, il n’y a rien à stabiliser. Les Haïtiens vivent dans une jungle de connexions, ni légales ni illégales, qui connectent l’enfer au paradis. Les terres changent de main, les cadastres se juxtaposent sans jamais s’empiler. Haïti est le laboratoire d’une interminable transition. Au carrefour on joue au loto. Et ce qui pourrait être un cauchemar – et qui l’est – devient récréation continue. On y sent l’odeur de l’essence et de la liberté, l’odeur de la foule et de l’insouciance, des cadavres et des épices. Quel avenir quand il n’y en a plus. On ne l’imagine pas, on le fait.
Et puis il y a, lorsqu’on s’attarde sur la carte de ce bout d’île, la naissance d’un rêve : Port-de-Paix, Petite-Rivière, Mont-Organisé, Cabaret, Belle-Anse, Limonade et Marmelade, Petit-Goave et Grand-Goave, un tableau de Préfète Duffaut, le sourire de Dany Laferrière, un air de comptine qui fait oublier le sang versé pour rien.
Jean Prod’hom
Rue-Cité-Devant

Inutile de mettre le monde sens dessus dessous ou de proposer à l’autre un regard décalé sur les choses si celui pour lequel on le fait ne les saisit pas lui aussi en se décalant. C'est seulement alors que, au-delà de la performance, ce à quoi ni l’un ni l’autre ne songeaient peut-être se met à jouer le grand jeu, fait tourner les têtes en y instillant une image dans laquelle l’homme perd pied et l’ordinaire un peu de sa gravité.
Jean Prod’hom
Fous de Dieu

Le 15 septembre 1797, racontent le Père François Berbier et Cyrille Gigandet, c’était un vendredi, les représentants de la République française, après avoir copieusement bu et mangé, pénétrèrent dans les chambres des chanoines réguliers de l’ordre de Prémontré à Bellelay pour mettre la main sur tout ce qui était à leur convenance. L'arrêté d'expulsion précise que chacun des trente-huit chanoines ne put emporter que les effets à son usage. On garda huit chanoines en otages, et on fit accompagner le dimanche les trente autres par des gendarmes en zone neutre.

J'en imagine quelques-uns d’entre eux dans cet espèce d'entonnoir de pâturages qui descendent en pente douce le long de la Sorne jusqu’à la Birse, avec pour seuls bagages quelques habits et deux ou trois livres sous le bras, un gendarme à leur côté, laissant derrière eux la fine fleur de l’armée révolutionnaire – sous les ordres de Gouvion de Saint-Cyr – pillant ce qui pouvait l’être, plaçant des scellés sur ce qui ne le pouvait pas. On ne commença l'inventaire des biens des Prémontrés que lorsque le bâtiment fut vide.
Une fois les vingt-cinq pensionnaires et les huitante-neuf domestiques de l’abbaye renvoyés, un autre silence s'est installé à Bellelay qui, je crois, ne l’a jamais quitté malgré le chant des rossignols et les affectations passagères de ses bâtiments : hôpital, écurie, brasserie, verrerie. Cet étrange silence, et ce quelque chose qui est comme abandon ont été pris au piège dans la coque vide de l’église, les marécages et les tourbières qui l’entourent.
C’est en 1894, lorsque l’Etat de Berne a racheté les lieux pour en faire un asile d’incurables (plutôt qu’un pénitencier), que la solitude et le silence se sont fait entendre à nouveau à Bellelay, ramenés par des hommes et des femmes venus de nulle part, aliénés, fous de Dieu sécularisés, fils et filles sans père ni mère, sans abbé ni abbesse. Les premiers sont peut-être arrivés en longeant la Sorne, ou sont montés de Tramelan, des proches les ont accompagnés, les orphelins encadrés comme il se doit par des gendarmes.
Le silence, l’abandon, la solitude habitent aujourd’hui les couloirs déserts des trois étages du logis principal, pris au piège derrière les portes fermées des chambres, bureaux vides, salles d’animations désertes. Un bruit de clé soudain, une porte s’ouvre, unité de psychiatrie de l’âge avancé 2, une infirmière en sort, un visage sur une chaise roulante, un bruit de fond, désordonné, des remous, un regard d’une violence inouïe, désarroi. Et le silence à nouveau qui se referme sur lui-même.
Antoine Auberson, Bellelay, Repérages, 9 juillet 2013
Lui vit à Saint-Imier, fume et boit du coca sur la terrasse ensoleillée du réfectoire, il n’a pas de livre, il raconte et ne raconte pas, né à Courfaivre, il travaille dès la fin de son école dans une usine à vélos, pendant deux ans. Mais il se dispute avec son patron, bien d’accord qu’il fasse chaque jour une pause, il en a le droit, mais qui exige qu’il la fasse en travaillant, pour ne pas perdre de temps. Aide ensuite un paysan de Courfaivre histoire de s’occuper, est employé quelques mois dans une entreprise de nettoyage, chez Emmaüs enfin. Sa vie semble s’arrêter là, il se fait hospitaliser une première fois à dix-neuf ans. Cela fait trois semaines qu’il est là, il monte de Saint-Imier à Bellelay régulièrement, des séjours de trois semaines ou plus, depuis plus de vingt-cinq ans, il en aura quarante-sept ans la semaine prochaine. C’est comme s’il racontait tout cela pour ne pas s’en souvenir.



Antoine Auberson, Bellelay, Repérages, 9 juillet 2013
C’est lundi, des jardiniers râtèlent l’herbe du parc, une débroussailleuse chasse le soleil, la gardienne fait un mot fléché à l’entrée de l’église abbatiale, la porte est ouverte. S’échappe une étrange musique, longue phrase dans laquelle le silence se dédouble, l’église est vide, le silence fait tache d’huile. Comment revenir à Bellelay ? Et d’où ? Et quoi dire de nulle part, il n’entend pas, il est blessure, il est demande, demande sans fond. J’aime ce nom de Bellelay.
Jean Prod’hom
Le temps s'ouvre et se ferme comme un accordéon

L’oeuvre aboutie est voisine du suicide. Modgliani s’est tué parce qu’il ne pouvait supporter l’insuffisance de son oeuvre, comparée à la grandeur de son désir. Il existe des sages qui ajoutent lentement à leur oeuvre, il existe des Dieux qui meurent de leur impuissance. Je n’ai rien fait, je n’ai fait que rêver, imbécile. Mon Dieu je vous aime et vous supplie.
Ouvre l’oeil à 7 heures la tête pleine, retourne dans le tambour jusqu’à plus de 10 heures. Premier matin de vacances, c’est-à-dire premier matin à ne pas avoir besoin de me demander comme chaque matin de quoi les enfants ont réellement besoin, ne pas avoir à saisir les urgences devant lesquelles il est judicieux de les placer, ne rien faire, ou qu’ils s’ennuient, attendent, se taisent, placer des obstacles, prodiguer les premiers secours, écouter, dire deux mot, aller au plus court,...
Décide de descendre au marché avec Sandra et les trois petits, de m’éclipser vers l’une ou l’autre des manifestations que Lausanne propose. Plusieurs vernissages ont eu lieu hier, le XVIIIème siècle dans les collections du Musée des Beaux-Arts, Miró à l’Hermitage, mais il y a aussi l’exposition que le Mudac consacre aux sacs en plastique, Louis Rivier et Marcel Poncet au Musée historique, Amadou et Pierre Bataillard à l’Espace Arlaud. Me décide pour le Musée historique à cause d’une peinture sombre qui veillait au fond d’un couloir au Carillet à Pully et qui me revient à l’esprit.
Les amis et les petits enfants de Louis Rivier sont à l’étage, ils parlent haut et fort, comme l’autre jour, bénéficiant aujourd’hui encore de ce que leur ont laissé ces grandes familles bourgeoises et protestantes de Jouxtens-Mézery et de Mathod. Les Rivier et les de Rahm traversent notre temps en chevauchant des points d’orgue, honorant les héros de leur lignée peints sous les traits des princes toscans, amis des arts et des hommes, invisiblement généreux dans les jardins de leur château.
Au sous-sol désert un Socrate, défiguré comme de juste par l’un des fondateurs de la Société d'art religieux de Saint-Luc et Saint-Maurice, Marcel Poncet, défenseur de l'art sacré en Suisse romande, le prince Mychkine, une lettre de Louis Soutter que Marcel Poncet a mis sur les rails de la peinture, une gravure tourmentée de Jacqueline Oyex, deux autoportraits, une bouteille et un citron, assiette verte, napperon bleu, nappe rouge. J’aperçois dans une vitrine des poèmes de Jean Follain, aux éditions de La Rose des quatre vents que le catholique genevois a illustrés. Jean Follain réapparaît sur un écran de télévision dans une courte séance tournée, peut-être, dans la maison Saint-Christophe de Vich. Poncet y fait le clown entouré d’enfants.

A la fin du livre que Jaques Chessex et Valentine Reymond ont consacré au peintre et verrier, il y a une photographie réalisée à l’ouest du Bois de Chênes entre Vich et Genolier, près de la Baigne aux chevaux. On y voit Philippe Jaccottet et Marcel Poncet, mais aussi Jean-Claude Piguet tout jeune alors que j’ai assisté une année durant à l’université de Lausanne, un peu par hasard, à l’occasion d’un séminaire qu’il avait conjointement organisé au début des années quatre-vingts avec Pierre Gisel autour du requiem, et plus particulièrement du War Requiem de Benjamin Britten. Le monde se rétrécit soudain et le pavé sur lequel je pose le pied en sortant du musée se souvient. Est-ce ainsi qu'on se cherche des racines ou est-ce ainsi qu'on les trouve, parce que le temps soudain se confond avec lui-même, s’ouvre et se ferme comme un accordéon.
Jean Prod’hom
L'Europe demain

Tandis que Lili suit son cours de piano, la librairie du Midi accueille Fabrice Colin et Ta mort sera la mienne, les cyclistes du Tour de Romandie longent la Broye, deux collégiens boivent bière sur bière dans le parc de l’église, un homme ivre invective les clientes d’un tea-room, deux policiers patrouillent. Je reconnais alors très distinctement dans le fond du bassin vide de la Place de Foire à Oron une image de l’Europe vue du ciel : on distingue les terres, les mers, les vignes et la glace, l’Esèagne, des ombres, de la lumière, des îles et des détroits, la Mer Noire, Gibraltar, la Sardaigne et le Danemark. Mais quelque chose a rongé l’enduit qui avait fait tenir jusque-là les choses ensemble. Personne.
Jean Prod’hom
Assomption

Parmi tant d’autres choses je ramène de Naples un peu de son soleil, le souvenir d’une vitalité sans borne, le goût d’une ferveur, la gentilezza.
Et puis une définition du miracle qui serait, selon ce père jésuite bien peu orthodoxe rencontré via Sapienza, le produit de l’ordinaire et de la bricole, dont nous pouvons, me dit-il, reconnaître les traces miraculeuses à chacun de nos pas. Je comprends mieux les mots du saint homme lorsque j’aperçois Piazza Gaetano, peu après que nous nous soyons quittés, une Assomption qui m’était évidemment destinée.
Jean Prod’hom
Lundi à Naples

Le solde des âmes pezzentelle – abritées dans de tendres petites têtes d’os (capuzelle) – dont un décret a interdit le culte en 1969 ont été déplacées de l’église inférieure de Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco dans le cimetière de la Fontanelle. Je paie 4 euros pour en obtenir une confirmation. On n’en devine en effet plus que quelques-unes dans de rares niches, abandonnées là pour les curieux et quelques fidèles. La gardienne culturelle du temple me confirme qu’elles sont devenues rares les âmes charitables qui descendent dans l'hypogée austère pour abréger le temps de purgatoire de celles et ceux qui pourraient intercéder en leur faveur sitôt arrivés au ciel. J’apprends que, pour ne pas avoir à payer 4 euros à chacune de leur descente au purgatoire, les dernières adeptes de ce culte des âmes pezzentelle reçoivent une carte qui atteste de leur fidélité.

Passe à nouveau dans l'atelier de restauration de l’impasse débouchant sur la Via San Gregorio Armeno. Ils sont trois ce matin, les deux frères – Rosario et Antonio Ebreo – et un collaborateur.
Le San Stefano de Salerne a bien avancé, quant au collaborateur, il replâtre la Santa Marguerita d’une petite église du Lazio, ils se sont mis à l’ouvrage avec le jour. C’est ainsi depuis trois générations, ils m’informent que c’est dans cet atelier que l’autel de la Certosa di San Martino a été restauré. Ils sont confiants malgré leur santé précaire, ils travaillent tous les jours et leurs enfants reprendront l'affaire.





On mange tout près de la place San Gaetano, mal très mal. On boit un café avec du soleil sur la place San Lorenzo, c’est mieux bien mieux, on aimerait même que les choses durent ainsi.
Sandra et les enfants repartent faire un dernier tour dans les boutiques pendant que je fais un saut à la chapelle Sansevero, on est nombreux à nous demander ce qu'il y a sous le linceul de marbre du gisant que Giuseppe Sammartino a sculpté au milieu du XVIIIème siècle. Difficile de croire à de la pierre. Un corps vivant ? mort ? Ne rien toucher, pierre molle pierre liquide, le vivant serait-il mortel pour la pierre ? Une pancarte m’en avertit, le monde va décidément à l’envers, je suis tout retourné :
Si prega non toccate. Gli umori corrodono il marmo.
Jean Prod’hom
Dimanche à Naples

Le Musée archéologique national de Naples est un palais immense, tout y est grand, plus grand qu’à l’ordinaire : le bâtiment, les salles, les plafonds, la lumière, les sculptures,… Les fenêtres sont encore fermées, les gardiens sommeillent ou font des mots fléchés, ils valent autant que les sculptures de la collection Farnese ou celles qui on été extraites d’Herculanum. Alignées dans de longues salles, elles ont, comme eux, la mandorle à l’intérieur du crâne, chacune livrée à sa solitude.





Les fresques du premier siècle au second étage donnent le vertige. M'arrête devant ce qui devrait ne pas avoir changé depuis 79 : un ibis et un martin-pêcheur. Mais tout s’en va, se dérobe. Je me sens aussi éloigné des Romains que des Japonais.





Le funiculaire du centre nous emmène au Vomero, celui de la Chiaia nous ramène en bord de mer sur la via Fancesco Caracciolo. Des grappes de Napolitains et de Napolitaines se promènent, ils ont mis leurs habits du dimanche, leurs enfants sont couverts de jouets à quatre sous, c’est l’or de Naples, autrefois en noir et blanc, aujourd'hui en couleurs.
Une procession conduite par des gamins remonte la via Pizzofalcone avec la Madonna d’Arco dans leurs bras, une vieille pleure, rien n'a vraiment changé. La nuit tombe bientôt sur la baie de Naples, le Vésuve a disparu dans une des innombrables niches dont est parsemée la nuit, le Vésuve a la tête retournée, allongée contre le flanc, il est comme une grosse bête rassasiée. Ça bouronne au fond de la ville, de la périphérie au centre et le feu remonte dans toute la ville, seule la fente noire de Spaccanapoli reste dans la nuit.
Jean Prod’hom
Samedi à Naples

Deux ou trois heures en famille dans le Circumvesuviana au travers de zones sinistrées, de la gare centrale jusqu’à Pompéi, de Pompéi jusqu’à Méta di Sorrente et de Méta di Sorrente jusqu’à la gare centrale. Plus le temps continuera et moins Pompeï ne bougera pas, je sais pas mieux dire.

Seule chose d’époque à Pompéi, les chiens.
Sors de chez Ménandre, hésite à faire un saut au lupanar, remonte la via stabiana jusqu’aux thermes à la façon d'un vieux sénateur romain. A ma grande stupéfaction personne ne se retourne sur mon passage. C’est évident, dans de tels lieux on préfère les morts aux vivants.
Arthur a une vision pessimiste de l’histoire, il s’étonne en effet qu’il y eut déjà des bordels en 79 après Jésus-Christ, il conjecturait que les hommes étaient autrefois moins frustrés qu’aujourd’hui. Je pensais exactement l’inverse à son âge. O tempora o mores.
- Dis papa, quand le Vésuve a recouvert la ville, tu étais né?
Louise considère avec circonspection le plan des ruines de Pompéi, elle craint que la buvette ne soit elle aussi d'époque.

Sable de cendre, les mères ont lâché leurs petits, les glycines sont en fleurs, je joue avec une quinzaine de tessons ramassés près du port.





Jean Prod’hom
Vendredi à Naples

Ce matin encore entre Piazza Dante et Montesanto, les fripiers et les vendeurs de mozzarella côtoient les maraîchers et les tripiers, dans le même ordre que la veille, c’est à nouveau la vie avec tout son bric-à-brac, un jour encore dans les ruelles, vico, vicolo et vicoli, la nuit n’y peut rien. Arthur, Louise et Lili font des photos de tout et de rien, on traîne, on s’égare et c’est bon.
Mais c’est le métro qu’il nous faut prendre pour rejoindre la Solfatare, je demande un peu d’aide à un Napolitain qui nous accompagne jusqu’à la station la plus proche, avec le sourire, je lui souris, il ne me demande rien.
On se fait tout petits dans l’une des cages de fer de la ligne 2 dont les bruits et les tremblements nous font croire à un décollage imminent, ou à une explosion, rien de cela, on traverse les Campi Flegrei occupés par des locatifs comme on en voit dans les banlieues des grandes villes italiennes, châteaux de cartes décrépits qui ont poussé comme de gros chardons dans des pâturages gagnés par la mauvaise herbe. A quoi bon ? Ici la terre menace, tout le monde se souvient de 1980 et ne pense pas trop à l’avenir. On descend de l’avion à Pozzuoli, à un ou deux kilomètres du volcan de la Solfatare, une navette nous y conduit, j'avais imaginé le cratère plus près du niveau de la mer.
La Solfatare ressemble moins aux enfers que du temps du Voyage en Italie, il faut dire qu’aujourd’hui le ciel est bleu et des barrières interdisent d’aller où on veut. Le guide qui emmenait le personnage d’Ingrid Bergman dans le film de Rossellini est toujours là, dans ses habits gris et sales. Il fait voir à un petit groupe de touristes les secrets de la terre, un reste de mégot pend à sa lèvre inférieure, il roule les r avec un petit rire de diable édenté, gloussements de castrat qui se mêlent à la vapeur brûlante, le souffre prend les poumons. Je crois apercevoir Ingrid Bergman s’éloigner, elle porte un long manteau, un de ces manteaux couleur sépia du temps du cinéma en noir et blanc. Louise et Lili n’ont rien vu, elles ramassent quelques pierres aux teintes blafardes en rêvant de cristaux et de colliers de perles.
On descend jusqu’au port de Pozzuoli avec devant nous un bout du Cap Misène, impossible d'aller jusqu'à Procida et d'en revenir avant le soir, on se rabat sur le front de mer qui ressemble à celui de Mani sulla città, mosaïque de sacs-poubelles, baignades interdites, horizon glauque, odeurs douteuses, plages jonchées des restes de la cuisine du monde, maisons abandonnées, immense catastrophe à laquelle les habitants de Campanie semblent se faire. Il est difficile d’imaginer à quoi ressembleront Pozzuoli, Portici et la baie de Naples dans une vingtaine d’années. Une mariée pose avec son mari sur une bite d'amarrage avec pour décor la coque d'un bateau pisseux, je ne comprends pas bien leur décision.
On emprunte pour le retour la Linea Cumana jusqu’à Montesanto, puis le funiculaire qui nous dépose au pied du château sant'Elmo. On jette un coup d'oeil sur une autre mosaïque, celle des toits plats et des terrasses en nous promettant qu'on reviendra. De larges escaliers de lave nous ramènent en six ou sept larges virages jusqu'à la station intermédiaire du funiculare centrale, deux femmes s'invectivent de maison à maison.
On parvient épuisés au pied de l'imposante cage d'escaliers de notre palais où logea autrefois Gioachino Rossini, de l'ascenseur aussi qui nous emmène au sixième étage pour dix centimes d'euro.
Jean Prod’hom







Jeudi à Naples

Six étages plus bas, au pied du Palazzo di Domenico Barbaja coiffé d’innombrables petites terrasses qu'on rejoint par d’étranges labyrinthes, on aperçoit la via Toledo et la station du funiculaire centrale qui dépose ses usagers à deux pas de la place Vanvitelli. La Certosa de San Martino se dresse tout en-haut parmi les antennes de télévision et les citronniers, le ciel est bleu.
On a traversé ce matin la verrière de la Galleria Umberto, j’ai bu un café au Gambrinus, longue marche ensuite sur le damier de lave noire des quartieri spagnoli dans lesquels dominent le bruit et la ferveur. C’est le grand tambour, on distingue un peu de stupeur dans les yeux des enfants qui sortent leur appareil de photos, tout mérite qu’on s’y attarde, on s’arrête, on repart, les scooters, les têtes qui dépassent des box au rez des vicoli, les autels nichés dans le tuf, les activités secrètes, les tags, les petits commerces, bouchers, tripiers, mais aussi les conciliabules, les cris, les enfants, les vieux. Le regard flotte et rejoint de lessive en lessive les rampes d’escaliers qui montent au flanc du Vomero.
On se balade en bras de chemise, le soleil a fait halte pour la premier fois cette années, nous dit-on, on prend du bon temps dans une trattoria du vico Teatro Nuovo.
Fin d’après-midi sur l’autre rive de la via Toledo, babioles, pâtes et débrouille, autant d'églises que de locatifs, vivantes, fermées ou recyclées en galerie d'art ou en salle de théâtre. Boutique obscure au fond d'une impasse, un vieil artisan passe en rouge la robe de san Stefano, ils sont deux, même blouse, même air de famille, le second assis regarde le premier qui travaille.
On trouve un banc public libre sur la Piazza San Gaetano, à l'angle de la Via dei Tribunali et de la Via San Gregorio Armeno. Le spectacle est partout, la vie plutôt, les gamins du quartier jouent au foot au pied de l’église de San Paolo Maggiore qui s’appuie sur deux anciennes colonnes du temple des Dioscures, à Naples c’est le mélange qui fait tenir les choses ensemble, la pauvreté proverbiale de la ville emprunte pourtant les habits de l'opulence, les gamins sont dodus. Ils se déplacent comme des pigeons autour des présentoirs dressés à la va-vite par les nouveaux arrivants. Les enfants sont des rois, quant aux miséreux ils inventent des solutions, finalement une paire de cannes suffit pour deux boîteux.
Il est 8 heures, la ville clignote, les bruits s’éloignent, les trattoria ouvrent leur porte, de temps en temps une sirène. Je descends à pied les six étages du Palazzo di Domenico Barbaja que je remonte bientôt avec deux pizzas de chez Mimi.
Jean Prod’hom




Balade en Gruyère

Née en 1877 en Gruyère, Marie Thomet travaille une grande partie de sa vie à Broc chez Monsieur Cailler. Elle confectionne des confiseries à base de chocolat, gagne 8 centimes de l’heure et travaille 14 heures et demie par jour. La dame aime bien son patron. Au journaliste qui lui demande en 1964 ce qu’elle pense de Monsieur Cailler et de son entreprise, elle répond :
- On ne savait pas, à ce moment-là, que ça deviendrait une grosse boîte. Eux si ! mais ils ne se confessaient pas à nous. Si vous êtes fidèle, vous aurez une pension, qu’ils nous disaient, il était bien Monsieur Cailler, un très gentil patron, il nous avait même promis un réfectoire.

Les deux gardiennes du Musée gruyérien de Bulle ont la vie dure. Les visiteurs sont venus nombreux et de loin, d’Estavannens, de Grandvillard et de Lessoc. Descendus des quatre coins de la Gruyère, ils viennent voir une dernière fois un monde qui fout le camp, le leur. Ils font sonner les toupins qu’ils ont généreusement offerts aux gestionnaires de leur patrimoine, vérifient qu’ils ont encore la main et tranchent des tavillons, chantent le ranz des vaches, jouent, tressent, corrigent les erreurs des conservateurs du musée.
Halte ! disent les deux gardiennes du musée, pas touche ! c’est un musée. Les armaillis qui ont mis leurs habits du dimanche baissent les yeux, se découvrent comme des enfants pris en faute, c’est pourtant leur musée, mais non, ils s’en rendent soudain compte, trop tard, et rentrent dans le rang, on les a volés. Ils quittent le musée et s’en vont dans la ville déserte, il neige, c’est vendredi saint, le temps est bouché. S’ils veulent voir le Moléson ou la Dent de Brenleire, ou la Dent de Broc c’est dedans, aux cimaises du musée gruyérien.

Brève histoire de la Chapelle Notre-Dame de Compassion de Bulle
1350
Sollicité par les nobles et les bourgeois, François de Montfaucon, prince-évêque de Lausanne, fait construire une chapelle en l'honneur de la Vierge au bas de l'hôpital de la ville frappée durement par la peste.
1447
Un incendie ravage Bulle, la chapelle partiellement détruite est reconstruite, le pèlerinage survit.
1647
Dom Claude Mossu, supérieur de la maison de l’Oratoire, remet de l'ordre dans une affaire qui a de la peine à redémarrer.
1679
A la mort de Mossu, les capucins assurent la desservance de la chapelle, ils sont même établis à perpétuité.
1805
La chapelle échappe miraculeusement à un incendie qui ravage Bulle.
2005
Les capucins quittent le navire et une association des amis de la chapelle de Notre-Dame de Compassion se met en place.
2013
La chapelle est munie d’une porte automatique, l’horaire est affiché à l’entrée : Ouverture 6 heures 30 | Fermeture 20 heures.
Jean Prod’hom
Te le répète

Te le répète
reprends ton rimmel
ton dentifrice et ton fond de teint
plie ton linge de bain
et file !
on saura faire sans toi
Jean Prod’hom
Reprends tes billes

Reprends tes billes
tes cliques et tes claques
roule ton sac
et zou !
fous le camp
Jean Prod’hom
Pavé romantique et chantier romanesque

Gilles Caron s’est trouvé en juin 1967 sur les rives du canal de Suez, en novembre de la même année au Vietnam sur la colline 875, en 1968 à Paris. Il s’est rendu, également en 1968 à Mexico, juste avant les Jeux Olympiques, et trois fois au Biafra ; à Londonderry, Belfast et Prague en 1969 ; est parti pour le Tchad au début de l’année 1970, au Cambodge en avril. Trois ans au total pour ramener des images de quatre années folles : Gilles Caron disparaît le 5 avril sur la route n°1 qui relie le Cambodge au Vietnam. Le musée de l’Elysée présente à Lausanne 250 photographies de cette tête brûlée, du 30 janvier au 12 mai 2013, j’ai vu ces photographies dimanche passé.
Le hasard a voulu que je longe aujourd’hui un chantier isolé du monde par de solides grillages, deux hommes y posaient accroupis des pavés du Portugal, un troisième – le patron – râtelait un peu plus loin un lit de gravier, je me suis arrêté. C’est un travail modeste et besogneux, un ouvrier en pose entre 10 mètres et 10 mètres carrés par jour. Le patron m’a confié que le travail ne manquait pas dans la région, mais lui et sa petite équipe devaient faire face actuellement à une concurrence déloyale, des entreprises qui ne sont pas de la branche soumissionnent à des prix réduits des travaux qu’ils obtiennent sans peine et qu’ils réalisent en embauchant des temporaires à bas prix. L’homme n’est pas content, je le comprends.
On a parlé de choses et d’autres, le patron est d’ici ; celui qui parle français est l’un de ses amis, charpentier de formation qui s’est formé sur le tas ; le troisième se tait, il est espagnol et ne parle pas français. Le chantier va durer encore quelques jours avant qu’ils ne déposent le dernier pavé. Le dernier pavé, c’est le plus difficile, il doit avoir les dimensions qu’il faut, c’est lui qui fait tenir le tout, c’est la pierre d’angle. Il faut préciser que le pavement qu’ils réalisent n’est pas un pavement définitif, c’est-à-dire qu’il n’est pas posé sur du mortier, il ne sera pas jointoyé avec une chappe, il est simplement posé sur un lit de gravier, les joints seront faits de sable mêlé à du gravier. Je lui demande alors en souriant s’il met ainsi de côté et en lieu sûr les armes dont auront besoin ceux qui manifesteront demain contre l’ordre établi. Il sourit et me dit fièrement que même si le pavement n’est pas définitif, il sera très difficile de retirer la première pierre. On s’est quittés.

En montant au Riau m’est revenue à l’esprit une image aperçue dimanche au Musée de l’Elysée qui m’avait laissé un sentiment d’inquiétante étrangeté, la célèbre photographie que Gilles Caron a réalisée dans les rues de Paris le 6 mai 1968, un lanceur de pavés dont les CRS mesurent la performance à l’autre bout du stade de la rue Saint-Jacques. D’où vient le pavé que projette dans le ciel ce discobole moderne ? Pas trace de chantier ou d’excavation, le pavé qui disparaît paraboliquement dans le ciel ne vient de nulle part, il est fourni par l’histoire. Je voudrais trouver la photographie des manifestants qui s’échinent sur le premier pavé, une photographie qui donnerait à voir la vérité romanesque du chantier.
Jean Prod’hom
Une sainte Barbe à l'entrée de la nuit

Des inconnus – personne ne sait combien – ont tiré leur capuche et processionnent dans la nuit au-dessus des Paccots, lampes Led sur le front. Ces mineurs de plein air n’ont pas fait voeu de silence mais on ne les entend guère, le frottement des clous des raquettes et des peaux rêches sur la neige durcie couvrent le bruit de leur respiration.
Ce soir sainte Barbe, la patronne des mineurs, des pompiers et des égoutiers les accompagnent ; j’en fais le pari, elle deviendra sous peu la protectrice des randonneurs nocturnes, on creusera alors dans la pierre de petits autels surmontés de panneaux solaires abritant au pied des indicateurs piétonniers le corps de la martyre et une ampoule sainte, Led perpétuelle, pour donner du courage aux plus faibles et éclairer la vie de ceux qui ont broyé du noir tout au long de la semaine.
Les étoiles se sont retirées du ciel pour laisser la place ici ou ailleurs à une danse, Corbettaz-Rosalys à raz-terre et retour, les pèlerins ont creusé dans la nuit un tunnel qui les protège de ses coups de grisou.
Jean Prod’hom





Les Rasses

Les parasols du Grand Hôtel des Rasses sont baissés, personne à la réception, cheminée close, la clientèle est bruyante, dehors la neige a les dents jaunes. La publicité ne le dit pas mais le balcon du Jura fait voir depuis quelque temps déjà les pointes tordues de sa ferraille rongée par le froid et la rouille, le béton pourrit en beaucoup d’endroits, les enduits sont à refaire, maisons fermées, va-et-vient des pendulaires, châssis de guingois.
Malgré le soleil, la bande large d’une centaine de mètres entre pâturages d’en-haut et bois d’en-bas n’est pas belle à voir. Il vaut mieux l’habiter que de l’avoir sous les yeux. Les architectes et leurs commanditaires y ont mis du leur, l’argent qui manquait, la hâte, les sociétés de développement n’ont pas levé le petit doigt, ils ont tous ensemble défait la fragile avant-scène de cet arrière-pays.
Il y a eu dans la gestion de ces paysages idylliques entre ciel et terre un flottement sensible dans les dernières décennies du XIXème siècle qui a conduit leurs habitants à remettre aux Anglais la clé de certaines de leurs terres. Ils y ont élevé de grandes demeures, lourdes mais bien calibrées, ici dans le Jura, mais aussi dans tous les territoires alpins situés entre 1000 et 1500 mètres. Les autochtones flairant l’aubaine ont suivi les Britanniques en vendant lopin par lopin l’ensemble de la couronne du plateau, à la lisière des bois et des pâturages. On est passé de l’hôtellerie de luxe aux résidences pavillonnaires, du lourd collectif au léger privatif.
Les tôles se tordent, il pleut dans les granges, les balles sont trouées et parfume l’air d’herbe rance, les lambeaux de tavillons pendent dans les assiettes, on a peint quelques maisons, jaunes, vertes ou roses, ketchup suédois ou moutarde finlandaise. Pas la peine de refaire les façades et les descentes de chenaux, il y a si peu d’argent.
Je suis allé voir plus loin, mais il n’y a rien au-delà de Sainte-Croix, au-delà du col des Etroits, après l’Auberson et les Verrières, à l’arrière de l’arrière pays du pays du Haut-Doubs qui s’épuise de vallonnement en vallonnement. Quelques engins militaires vont se perdre dans leur tenue de camouflage au fond des vallons. Depuis les derniers essartages médiévaux, il ne s’est pas passé grand chose dans le coin, mis à part l’accueil de l’armée de Bourbaki
Antonietta pelle depuis son balcon la neige qui s’est amassée sur l’une des ailes de sa grande maison, elle a enveloppé sa mise en plis d’un filet rose, ses bigoudis s’agitent comme des chenilles. Elle me raconte les beaux-jours, son mari travaillait aux CFF, ils ont acheté cette maison à un notaire de Fleurier qui montait jusqu’à Sainte-Croix à pied avec sa famille, week-ends et vacances. Le mari d’Antonietta est mort en 1964, elle est restée là, jamais eu le courage de retourner à Bergame d’où elle est originaire, elle a deux filles qui travaillent en plaine, elles viennent la voir régulièrement. Et puis, me dit-elle, il y a ces écureuils qui viennent la voir chaque matin et qui la réjouissent.
Jean Prod’hom
Fenêtre de Balthus à Rohan
Personne dans ton dos, personne dans le couloir, personne dedans la pièce sur laquelle la fenêtre s’ouvre, c’est le moment. Tu te penches, passes délicatement la main sur la gorge du battant du vantail droit et sur le battant mouton du vantail gauche, effleure le fer de la gâche inférieure à l’intérieur de laquelle s’engagera, lorsque tout sera terminé, la tringle de la crémone. Tu poses tes yeux sur l’appui fenêtre et les ombres du dormant.
Puis tu mets la tête dehors, sans toucher ni au couteau ni au pichet, regardes en-dessous ce que le peintre n’a pas daigné montrer pour tordre le coup aux idées, tu aperçois alors l’ambition démesurée de ce faussaire obstiné qui témoigne, mieux que les penseurs, de ce dont le monde est fait. Le peintre est en-bas, au pied du mur, il a repris une fois encore le tout depuis le début, la lumière et l’ombre, le dedans et le dehors, le temps qui passe et les rideaux que le vent fait onduler : c’est sans fin que le le vernis s’écaille.

Balthus, La fenêtre, cour de Rohan, 1951, Troyes
Fenêtres,
de la Renaissance à nos jours. Dürer, Monet, Magritte...
DU 25 JANVIER AU 20 MAI 2013


Jean Prod’hom
Belle et noble contrée

J’écluse à petites gorgées un verre de Païen de chez Claude Clavien de Miège dans le salon du rez-de-chaussée de l’Hôtel du Parc, les fauteuils sont vides. Tandis que le jour s’enfonce dans la nuit en arrière du val Ferret, un pianiste enchaîne des standards dos au mur, je fais les comptes.

L’hôtel a certainement changé, les parquets flottants couinent à peine, les baies vitrées ont remplacé les portes-fenêtres, le béton le bois. Mais quelque chose, je le sais sans savoir exactement quoi, n'a pas quitté la butte de Montana, quelques mélèzes s’en souviennent : Louis Antille, c’est sûr, Placide et Alcide, Géo et Algé, Otto et Jacinthe, les mulets chargés. Depuis 1892 les Alpes n’ont pas bougé, le Rhône qu'on devine en bas à peine, mais ce qui s’est perdu dans l’aventure, ça je le sais aussi, c'est la déshérence, l’éclat des lacs et l’herbe des pâturages. Personne n'a rien vu venir ici, le père de Gaby a vendu un peu de terrain, acheté des appartements, des gars véreux ont promis le paradis sans donner d’adresse, les Russes viendront demain pour remettre des millions dans l’alambic et sauver ce qui ne ne l’est plus, personne n’a jamais arrêté ce qui ne s’arrête pas. Tout a passé de main en main sans que rien ne soit à personne. Et mon copain Jeff, le gros loup de Chermignon ne voit guère comment il eût pu en être autrement.
La nuit tombe sur la belle et noble contrée, de l’autre côté le vent souffle sur les braises d’Hérémence, quelques arbres me cachent le reste.
Jean Prod’hom


Architecture sanatoriale

La conception des bâtiments locatifs des grandes cités européennes de la seconde moitié du XXème siècle vient tout droit de l'architecture sanatoriale alpine de la fin du XIXème siècle et de la première moitié de celui qui suit. Longs vaisseaux symétriques, orientation sud-ouest-nord-est, parallélépipèdes sans poupe ni proue aux larges flancs et à angles droits, façades malvoyantes au nord mais ouvertes au sud sur de larges baies, balcons supportés par des colonnes qui rappellent, en plus rustique et armé, l'art de construire des renaissants florentins.

Ces bâtiments néoclassiques de Montana commandités par les cantons de Lucerne, Genève, Berne et du Valais témoignent d'un vieux rêve que les hommes ont raisonnablement fait naître, rêve de ceux qui ont sué en contribuant, souffrant, à l’augmentation des richesses de ceux qui soignent leurs dépenses, ces industriels qui ont transformé comme en écho, au même lieu, des raccards et des mayens en les recouvrant de lauzes doublées d’hermine, chalets ou palaces. Ce rêve, ils n’ont eu le temps que de le faire passer plus loin, trop de travail, des heures supplémentaires jamais payées, leur vie en gage ou en nantissement. Comment dire ça ?
Parce que la vie des tuberculeux de la fin du XIXème siècle, chaque fois que cette vie est restée à bonne distance de la mort, s’est approchée d’un rêve, vie douce loin de l’éternité, la seule qu'on peut espérer. Les malades de ce temps, patients comme nous tous, nous rappellent aujourd’hui encore notre condition de mortel, un jour encore si Dieu le veut, l’éphémère se prolonge : une nourriture satisfaisante, le repos, allongés dans les transats de l’un de ces vaisseaux pris dans la glèbe, à la cape, soleil, grand air, Dent Blanche, Mont Blanc, Tête Blanche, une pensée pour ces proches qu'on a dû quitter.
La vie au sanatorium apparaît aujourd’hui comme un rêve réalisé, celui que les Lumières avaient fait naître un peu plus d'un siècle avant la naissance de l’Hôtel du Parc de Montana, paix perpétuelle, acceptation de nos finitudes, le temps de vivre. Mais on se penchera encore sur le miracle du temps qui passe juste à nos pieds, le sud au sud, et du balcon droit devant la montagne magique.
Jean Prod’hom
Rien d’autre que le noir et blanc



Ciel boueux, temps sale, une poignée de moutons lèvent la tête au large de Bex, maigres dans l’herbe rase. Du rimmel dégouline de Morcles, ça ne rigole pas, impossible d'essorer à mesure. Des fuites de gasoil ravinent les allées des jardins ouvriers, arbres décharnés, écorce de bouleau, Rhône gris, pylônes, fantômes et squelettes dans la détrempe, cendre noire au pied des allées de peupliers. L’autoroute plonge sous des ruines, le vent tiède s'engouffre dans les tunnels des maraîchers ouverts sur des perspectives vides, ils abritent des balles de foin éventrées et des fils de fer orphelins. On a enroulé sitôt les récoltes terminées les filets noirs des vergers, les sarments grincent des dents, deux corneilles grimacent sur le rebord d’un tonneau de vidange, à côté de lourds containers dans un cimetière agricole. Rien d’autre ce matin que le noir et blanc, un peu de mauve, un cortège de véhicules processionnaires et de la tristesse.
Jean Prod’hom
La Roche-La Berra

On est une vingtaine sur le flanc oriental du bassin de la Serbache, une fin d’après-midi qui est déjà la nuit, on monte raquettes aux pieds dans le bois de La Joux en direction du Gîte d’Allières.
C’est la pleine lune ou presque, les épicéas font écran, mais ses feux pâles parviennent à se glisser jusqu’aux deux rives du ruisseau de Stoutz dont ils éclairent le tracé capricieux. On se suit à la queue leu leu sur un chemin bougrement intelligent qui se joue des ravines et des combes, un chemin qui s’éloigne parfois de la meilleure pente qu’a choisie le ruisseau, c’est une nécessité, il fait alors de longs méandres avant de se lancer dans la pente raide et rejoindre les rives de son compère, ils ne se perdent jamais de vue très longtemps, font parfois un bout ensemble, il sont comme deux attributs de la même substance, deux traductions d’une même réalité, deux caprices. Je me plais à les imaginer tous les deux dans la nuit déserte, libérés du soin de conduire et de nourrir les passants, le ruisseau qui chante et le chemin qui danse.
On fait une petite fête au Gîte d’Allières assis sur des bancs : vin rouge, thé chaud dans un long couloir que parcourt un vent froid, pain et fromage, vin blanc, un air d’accordéon à l’étage.
Il est 23 heures, brève halte sur la tête d’Allières avant de redescendre dans la plaine. On devine à nos pieds le Javro, la Valsainte et la route qui mène au Lac Noir. En face les Dents Vertes et la vallée de la Jogne, plus au sud Brenleire et Folliéran. On choisit d’emprunter les larges avenues des pistes, plus de chemin, les frontales des skieurs ont disparu dans la nuit, on est les derniers. Je prends quelques photos avec l’appareil que Sandra m’a apporté vendredi, m’attarde, suis le dernier des derniers, la lune fait le reste. J’aurais voulu au fond qu’on m’oublie, mon dos ne me fait plus mal, demeurer un instant encore dans ce pays d’une autre substance, tourner les pages de cet album de cartes postales colorisées, le froid tenu à bonne distance, à peine des couleurs.
Jean Prod’hom












Diligences

A l’endroit où le Trient déboule dans la plaine les églises ressemblent à des centrales hydrauliques, les postes électriques à des cimetières. Les langues sont en très grand nombre le dimanche dans les cafés de Vernayaz, chacun se tait. Et le Rhône bleu de sable pousse ses laves dans un lit creusé jusqu’à Marseille.
Jean Prod’hom
L'Île des morts

Au milieu des champs labourés, à l’abri des haies hautes et sombres, la maison sommeille dans une lumière blême, entourée d’un modeste jardin rempli d’ombres et de cyprès. On aperçoit d’en face un pignon réduit crépi de blanc, un drapeau pend comme un chiffon, le vent souffle à peine, on ne distingue pas la rivière qui traverse la plaine. Deux lions de marbre blanc se dressent de chaque côté du perron, plus loin des nains papotent au pied d’un peuplier, la mort a décidément mauvais goût parfois. Au bout de la courte allée tapissée de feuilles mortes, sous un platane manchot dont on voit les os, une voiture stationne, le nez dans un muret, à bout de souffle, comme si elle n’allait plus jamais repartir.
Car ceux qui sont entrés là un jour n’en sont jamais ressortis, ou ont pris la fuite jurant qu’ils ne reviendraient pas. Les habitants ont renoncé à traverser d’autres nuits et d’autres brouillards que les leurs, éloignés de tout adieu, privés de toute réalité autre que celle qui s’affaiblit dans l’obscurité, comme des fantômes sur une île.
Toutes ces villas privatives des années quatre-vingts, posées là sans raison, oubliées comme des ruines, cachées derrière des cyprès et des thuyas, habitées par des spectres m’émeuvent et me rappellent cette Île des morts – qu’a peinte cinq fois Arnold Böcklin – sur laquelle la vie persiste encore, le vert verdit en secret, parce que ce quelque chose qui doit finir ne sait comment rejoindre ce quelque choses qui malgré tout ne le veut pas.
Jean Prod’hom





Altitude 807 mètres

Le 29 septembre dernier il pleuvait des cordes sur Rossenges, il m’avait fallu écourter ma visite. J’avais eu beau ce jour-là tourner sur les hauts du hameau de l’Abbaye, le cimetière semblait bel et bien avoir disparu. Pas grand monde, une cinquantaine d’habitants pour me renseigner, je devais m’être trompé ou les cartes au 25’000 dont notre administration fédérale est si fière avaient manqué le coche ou de réaction. Que les morts ne soient morts que pour un temps, ici, au coeur de la Broye, me procurait une curieuse et nouvelle impression, j’ai quitté la colline songeur, s’il y avait un endroit où les cimetières devaient ne pas mourir, c’était bien ici.
J’ai repassé dans le coin il y a une paire de jours, il faisait beau, un vieux de la commune m’a raconté : le cimetière a été désaffecté il y a quelques années parce que les gens n’y enterraient plus leurs morts, qu’ils préféraient Moudon, son cimetière et son four crématoire, c’est moins cher. Sans compter que cette décision simplifiait le travail des paysans, pensez donc, cher Monsieur, les tracteurs devaient jusque-là tourner autour des morts, dans notre métier le temps compte, sachez-le, ce cimetière était plus embêtant qu’une verrue.

Rossenges | Google Earth, 31 octobre 2009 | élévation : 807 mètres
Je me décide aujourd’hui à jeter un coup d’oeil sur Google Earth, le satellite a rendu visite à la commune de Rossenges le 1 août 2012, il n’y a déjà plus de cimetière. Le menu Affichage | images historiques m’invite remonter le temps, le 26 mars 2012 – les ombres des toits laissent penser que c’était le matin – le cimetière n’a pas réapparu. C’est seulement à l’occasion de son passage le 1 août 2009 que le cimetière trouve sa place entre prés, pommes de terre et blé.
Rossenges a donc rempli les conditions pour la désaffectation de son cimetière qu’énumère le règlement 818.41.1 du canton de Vaud sur les inhumations, les incinérations et les interventions médicales pratiquées sur des cadavres du 5 décembre 1986. La désaffectation des cimetières est en effet du ressort des autorités communales s’il s'est écoulé moins de trente ans depuis la dernière inhumation, à moins que le département ne donne son accord. La désaffectation est portée à la connaissance du public au moins six mois à l'avance, les objets et monuments garnissant les tombes sont repris par les intéressés. Les ossements humains aussi, si les proches le demandent, mais à seule fin d'incinération. Sinon les ossements resteront en terre, ou la commune les placera dans un ossuaire, ou elle les incinèrera.
Rien ne se perd rien ne se gagne. Pas sûr cependant que la piscine creusée par l’un des habitants de Rossenges à la pointe nord-est de la commune ne remplace avantageusement le cimetière de Rossenges.

Rossenges | Google Earth, 1 août 2012 | élévation : 807 mètres
Jean Prod’hom
Les danaïdes

Des cinquante jeunes femmes que leur père, Danaos, offrit aux cinquante fils d'Egyptos, leur oncle, pour prévenir les inévitables conflits liés à leur succession, des cinquante danaïdes qui plantèrent une aiguille effilée dans le coeur de leurs cousins avant que ceux-ci ne les tuent, de leur arrivée aux Enfers et de leur jugement, la tradition n’aura retenu que la terrible punition qui s'en suivit et le désespoir dans lequel les plongea l'absurdité de leur supplice : les danaïdes noyées dans un désespoir sans fin emplissent encore aujourd’hui des tonneaux sans fond.

De la tradition, on ne retiendra ici que deux ou trois choses. L’extraordinaire sculpture d’abord que réalisa Rodin à la fin du XIXème siècle pour la Porte de l'Enfer et qu'il intitulera La Source. La chevelure de la suppliciée en pleurs coule sans discontinuer dans la poche de marbre d’où le sculpteur l’a tirée.

Mentionnons encore la représentation assez classique réalisée par John William Waterhouse en 1903 dans laquelle de belles danaïdes aux seins généreux remplissent une bassine avec une telle équanimité qu'on se demande bien pourquoi elles n’ont pas derechef quitté les lieux lorsqu’elles se sont aperçues que la bassine était trouée.
Il y a bien sûr Apollinaire qui les évoque en cette même année 1903 dans sa Chanson du Mal-Aimé :
Mon coeur et ma tête se vident | Tout le ciel s'écoule par eux | O mes tonneaux des Danaïdes | Comment faire pour être heureux | Comme un petit enfant candide


Si la fontaine que réalisa en 1907 Hugues Jean-Baptiste près de l'église Saint-Vincent-de-Paul à Marseille ne mérite pas notre attention, la plaque de marbre qui avertit le passant que l'eau n'est pas potable doit nous alerter. Le supplice des danaïdes assoiffées est plus grand encore que ne l'imaginait Eschyle.

Un mot encore sur le bronze de Brancusi, doré à la feuille, réalisé en 1913 que Christies's adjugea en 2007 pour 19,3 millions. Brancusi a-t-il voulu représenter le visage d'une danaïde désespérée ou, à ce prix, le tonneau sans fond qu'elle est condamnée à remplir ? Nul ne le sait.
Mais il faudra désormais compter avec une nouvelle interprétation iconographique du mythe des Danaïdes, une appellation qui aurait d’ailleurs avantageusement remplacé celle des Trois Danseuses attribuée aux trois nouveaux bâtiments scolaires du Mont-sur-Lausanne en référence à l'oeuvre aérienne de Degas. Pas tellement en raison du gouffre financier dans lequel de telles réalisations plongent immanquablement les communes habitées par une certaine idée du prestige, mais en raison des éviers installés dans l’un de ces nouveaux bâtiments. Que l’affaire se déroule dans les salles de sciences n’est évidemment pas anodin. Mais chaque chose en son temps, penchons-nous pour l’instant sur le renouvellement de l’interprétation du mythe.
Le supplice trouve ici son expression la plus aboutie : l’eau du robinet fixe coule directement, lorsqu’on l’ouvre, dans l'ouverture du trop plein ménagée dans la bonde qui rend le bassin étanche. La scène est nue, brutale, à son comble. Il y a du Maurits Cornelis Escher dans cette réalisation, mais on atteint ici les limites supérieures de l’art, si bien que les danaïdes, habituées pourtant au pire, n’auraient pu survivre à une telle épreuve. L’artiste en a fait l’économie, le désespoir va désormais seul, sans hésiter, dans la nuit d’une salle de sciences vide.

Jean Prod’hom
Les Alliés dans la Guerre des Nations

On peut en feuilleter un exemplaire au second étage de la maison seigneuriale de Denezy dans la vieille ville de Moudon, l’ouvrage en vaut la peine. Les Alliés dans la Guerre des Nations est un ouvrage édité par Crété en 1922, constitué d’une série de portraits de soldats de la Grande Guerre réalisés au pastel par Eugène Burnand entre 1917 et 1920, reproduits par la technique de la photogravure.
Sur le frontispice on peut lire en lettres capitales le nom du peintre, celui du Maréchal Foch – qui a bien voulu laisser une préface, très brève, quinze mots, un tweet – et celui de Louis Gillet qui a rédigé une longue introduction. En plus petits caractères, tout en bas, on peut lire encore ceci : Textes du Capit. Robert Burnand.
C’est en effet le neveu du peintre, sorti en 1908 de l’Ecole des chartes, passionné d’histoire militaire qui a écrit les notices qui accompagnent les pastels du Broyard. Lieutenant, puis capitaine d'infanterie, précise Clovis Brunel dans le tome 111 de la Bibliothèque de l'école des chartes (1953), il est blessé fin 1914. Les quatre-vingts textes qu’il livre au verso des portraits de son oncle mériteraient un tiré à part. En voici deux.

TRAVAILLEUR ANNAMITE
LÉ NAPLONG (d’Hanoï).
Une petite tête d’oiseau sur un coup démesuré, un regard étonné dans la mince ouverture des paupières ; oriental et exotique autant qu’on peut l’être. On le sent de race laborieuse et soumise par avance à toute autorité. Il n’a pas l’affinement aristocratique du Japonais, la grâce menue de certains Chinois; c’est un travailleur, un homme de la campagne, il est habitué à pousser sa jonque dans les rivières, à planter son riz, à vendre ses légumes. Un beau jour, on l’a embarqué, promené pendant des semaines et des semaines sur un bateau, en chemin de fer, en camion ; on l’a installé à l’arrière du front, dans un village mélancolique de Champagne, serré autour de quelques arbres, dans la grande plaine blanche, et il a repris son travail patient, tranquille, piochant, creusant, taillant ; il a construit des voies étroites, transporté des matériaux, organisé des tranchées. Jamais une plainte, jamais un mot. Il a, comme les autres, travaillé à la victoire ; il est retourné dans son pays doré, au bord de sa rivière, il a recommencé de planter son riz, de vendre ses légumes. A-t-il gardé le souvenir des heures passées au front de France ? Mystère ; qui pourrait lire dans ses yeux mi-clos ?

TIRAILLEUR MALGACHE (Sakhalave)
FANQUINA (de Bara, Madagascar).
J’ai vu les Malgaches en Champagne, au pied des monts. Dans ce secteur de cauchemar : boue et poussière, poussière et boue, quelques pins chétifs jalonnant l’immensité de la plaine crayeuse, ils étaient d’une propreté méticuleuse, l’uniforme brossé, le corps souple et bien lavé. Propreté morale ; nulle troupe plus disciplinée que celle-ci, où fussent moins nécessaires les rudes sanctions des unités coloniales ; des hommes très doux, un peu timides, tenant fermes sous les obus, mais avec une sorte d’étonnement craintif au fond de leurs grands yeux. Ils subissaient, sans rien dire, leur rude métier, non point avec le fatalisme oriental, mais avec une résignation chrétienne. Parmi tous les fils lointains qu’a appelés la Mère Patrie, elle n’en a pas trouvé de plus dociles.
Il faut laisser aux historiens de la Grande Guerre, de la colonisation et de la décolonisation, aux sociologues et aux historiens des mentalités le soin d’analyser la teneur de ces petits textes, il y a de quoi faire. Je voudrais de mon côté plus humblement relever la qualité littéraire de ces quatre-vingts paragraphes. Il m’en reste septante-huit à me mettre sous la dent.
Jean Prod’hom
Résidence d'écriture à Montricher

« Il y a quelque chose de magique dans cet endroit. J’ai l’impression d’avoir bâti du durable, comme s’il était impossible d’imaginer la fin d’un tel édifice. »
Si, rappelle l’architecte, l’objectif de cette maison est d’offrir les conditions idéales pour écrire : six logements individuels aux ambiances et aux personnalités différentes – appelés cabanes – suspendus sous la canopée, un auditorium, une salle d’exposition, une bibliothèque, il est impossible, ajoute-t-il, d’imaginer la fin d’un tel édifice.

Il faut entendre le mot fin en plusieurs sens. Cette construction, d’abord, ne sera jamais terminée, il en va ainsi de tous les chantiers pharaoniques. En un second sens, ce temple de l’écriture bâti sur la pierre et solide comme le roc est conçu pour l’éternité. Soit. Mais il faut entendre le mot fin en un troisième sens, à l’origine des deux premiers et plus essentiel : une telle construction n’a pas de finalité concevable. Nul ne sait ce dont a besoin un homme qui écrit.
Pas même les architectes qui meublent en désespoir de cause l’espace et le silence de ce dont ils imaginent que l’homme qui écrit a besoin pour s’attaquer à l’inimaginable : un bouquet de fleur, les Alpes, l’altitude, la campagne, le repos, un fatras dont celui qui écrit commencera par se débarrasser pour y voir clair et accueillir les manques qui le nourriront. Rien n’y fait, les architectes se sont mis aux petits soins :
Les écrivains auront un coin pour rédiger. Ils pourront se l’approprier en posant leur ordinateur. Et il y aura aussi une grande table de travail au rez-de-chaussée.
Et puis, continue l’architecte, sur les plates-formes qui relient les étages, nous installerons des fauteuils et des lampes pour lire tranquillement.
Je me réjouis, vraiment, on m’accueillera un matin de juin selon les antiques lois de l’hospitalité, j’aurai fait acte de candidature – avec le risque évident que celle-ci soit refusée mais avec un solide atout : Montricher c’est à côté de chez moi, j’y réside depuis longtemps déjà. L’écriture est une parabole, juste à côté.
Jean Prod’hom


Georges Didi-Huberman à Rumine

Jeudi 15 novembre 2012 à 20h, Aula du Palais de Rumine
Georges Didi-Huberman, «Le partage des émotions»
Précédé d’une visite de l’exposition par Esther Shalev-Gerz à 18h30

Maman est morte le vendredi 18 juillet 2003.
J’ai retrouvé une vieille photographie datée de l’été 1925 sur laquelle maman m’attend. Cette image qui m’inquiétait tant autrefois en raison du landau dans lequel on l’avait installée – enfermée ? – me fait douter de l’anisotropie du temps : je ne sais plus ce soir exactement si maman est venue au monde avant ou après moi.
Un être humain sans ombilic, c’est évidemment inconcevable ! Mais j’avoue qu’il m’est plus difficile encore d’imaginer que ma mère ait pu en posséder un avant ma naissance. Pensez donc. À moins d’admettre, évidemment, qu’elle ait donné naissance à un autre moi avant moi.
Il suffirait de modifier la fin de cette vilaine boutade : À moins d’admettre, évidemment, qu’elle ait donné naissance à un autre moi avant moi qui lui aurait donné naissance, pour qu’elle prenne une allure plus conforme à ce qui est, c’est-à-dire touche aux noces mystérieuses de la naissance et de la connaissance.
Pas de deuil, pas de chagrin, mais la beauté d’un manque qui étend son empire bien au-delà d’elle et de moi, qui nous met hors jeu en emmenant dans son sillage la terre et ses quartiers qu’il me reste à habiter, seul, avec elle et les autres.
Jean Prod’hom
Révisionnisme

Tiens il neige ! Lili met son équipement d’hiver et sort, Sandra, Arthur et Louise descendent au marché, je reviens sur les notes que j’ai prises hier au rez du Musée d’histoire des sciences de Genève à partir de l’ouvrage collectif – Villa Bartholoni – publié en 1991 et mis à la disposition des visiteurs. Je prends bien plus de temps que prévu, trop. Ce soir Arthur est invité à une boom, je l’emmène à 18 heures 30, il me faudra veiller jusqu’à près de 23 heures.
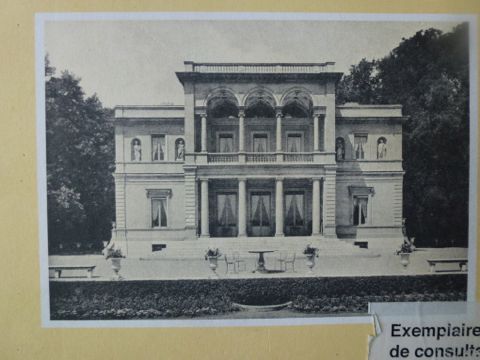
Jean-François Bartholoni est né à Genève en 1796, d’une famille d’origine toscane modeste. Il monte à Paris en 1814 et y fait ses premières armes dans la banque comme employé de bureau, il ouvrira avec son frère sa propre maison bancaire une dizaine d’années plus tard, fera rapidement fortune, il n’a pas 30 ans. Mais l’homme n’oublie pas Genève et les rives du Léman où il fait construire, sur un domaine agricole à deux pas de Chambésy, une villa et un parc de plaisance dans lequel des sculptures d’après Canova ou Fremin, Danseuse, Flore Amalthée, Artémis vont remplacer poules, chèvre et cochons. Il fait appel à un jeune loup de l’architecture et des Beaux-Arts, Félix-Emmanuel Callet, de 5 ans ans son aîné, prix de Rome à moins de 30 ans, à qui il offre la possibilité de partir étudier encore une année en Italie avant de commencer les travaux, tous frais payés. Il revient avec tout plein d’idées italiennes. Le chantier démarre en 1826, dehors on rénove le port, dedans des parqueteurs, des marbriers, des peintres et des stucateurs réalisent le décor.
Les deux compères ne se lâcheront plus. C’est Bartholoni, fort actif dans le domaine des chemins de fer – il sera l’administrateur de la compagnie Paris-Orléans et l’instigateur de la ligne Genève-Lyon – qui agira en coulisse pour que la construction des gares d’Orléans et de Corbeil soit confiée à Callet, lequel lui renverra l’ascenseur, si j’ose dire, en réalisant son tombeau au Père-Lachaise.
Les enfants et petits-enfants de Bartholoni vont se succéder, Fernand puis Jean. En 1924 un homme passe par là, chapeau de cow-boy, c’est le directeur de la Rolex Watch Co qui s’écrie : This is really the Pearl of thé Lake ! Il s’empresse d’acquérir la villa et le pré qui la jouxte. Pas longtemps puisque la maison est condamnée en 1926. La SDN a en effet l’intention d’élever son siège dans le coin. On est sur le point de rayer la Perle du lac lorsque la ville de Genève offre à la SDN le domaine de l’Ariana.
La villa aux mains de la ville se dégrade, peu ou pas d’entretien, louée à certaines périodes vides à d’autres, humidité des lieux, bombance des locataires, fuites dans le toit. Les réfections extérieures et les restaurations intérieures se succèdent, des élèves des Beaux-Arts se feront la main, on installera des salles de bains et une cuisine. En 1964 la ville de Genève remet de l’ordre dans ce marasme et donne les clés au Musée d’histoire des sciences qui ouvre ses portes au public pendant une vingtaine d’années. La villa est invivable et part en morceaux, elle est donc fermée en 1984 pour une sérieuse modernisation et une restauration minutieuse. Elle est réouverte depuis 1990, gratuite et obligatoire.
Serrée aujourd’hui de près par la circulation ininterrompue entre Chambésy et le quartier des institutions onusiennes, étranglée par la route de Lausanne avec de chaque côté des parcs publics qui sont comme des terrains vagues, à deux pas du bâtiment mussolinien de l’OMC, la villa Bartholoni semble bien petite, héroïque même d’avoir résisté, abandonnée, oubliée, visée par la foudre et par la finance. Les 12 millions engagés pour la réfection entre 1984 et 1990 n’auront pas suffi, on a découvert une nouvelle fuite d'eau dans l’un des angles du rez-de-chaussée, des vandales ont mis en miettes les montants d’une des balustres en molasse, à la masse, on finirait par la plaindre.
Chacun voit la suite, on imagine une autre histoire dans laquelle la villa Bartholoni apparaîtrait comme la petite dernière, la rescapée des attaques de la banque, de l’horlogerie de luxe, de la SDN et des vandales. Un rêve, celui d’un fils d’immigré d’origine modeste, amoureux de Palladio et de Venise, un employé de banque trahi.
Jean Prod’hom




Cyanomètre et oeil de verre

Récupère à Cointrin Sandra et les enfants enchantés de leur séjour à Berlin. On se rend à la villa Bartholoni qui abrite le Musée d’histoire des sciences. Au rez les collections permanentes, à l’étage une exposition temporaire autour du hasard Les jeux sont faits ! hasard et probabilités. De belles choses au rez, parmi celles-ci les instruments qu’Horace-Bénédict de Saussure emporta en 1787 et 1788 au sommet du Mont-Blanc et au Col du Géant, un baromètre, un hygromètre à cheveu portatif, d’autres choses encore,… et puis un cyanomètre.

De Saussure pense en effet que le bleu du ciel varie suivant l’altitude, que très haut le bleu vire au noir. Pour établir des corrélations, il bricole un instrument, simple, c’est un carton rectangulaire (format carte postale) à l’intérieur duquel 16 petits carrés évidés sont juxtaposés en alternance avec16 autres petits carrés de bleu aquarellés dont les différents tons sont numérotés du plus foncé au plus clair. La mesure se fait en dirigeant l’instrument, tenu à bout de bras, vers le ciel, puis en comparant visuellement le bleu du ciel vu par l’un des carrés évidés avec celui du carré peint dont la nuance de bleu est la plus proche (Anne Fauche). Et pendant qu’Horace-Bénédict regarde le bleu profond du ciel au sommet du Mont-Blanc, son fils regarde ce même ciel à Chamonix, bleu pâle, tandis qu’à Paris Jean Sénebier note un ciel presque blanc.
Le musée expose d’étranges boîtes, des boîtes de dépôt d’Yeux Artificiels qui étaient la propriété du Genevois Schoen, oculariste officiel des hôpitaux civils et militaires et des principales facultés et universités de médecine. Le souffleur de verre propose un grand nombre de pièces. Il faut pour passer commande spécifier si coté gauche ou droit, nuance bleue ou brune, foncée ou claire, forme petite, moyenne ou grande.

Les premières prothèses datent du XVIème siècle, d’argent ou d’or avec un iris peint en porcelaine. Les prothèses en verre leur succèdent avec une petite quantité de plomb pour mieux résister aux poussières. Mais ces prothèses résistent mal aux larmes si bien qu’on remplace le plomb par de la cryolite, minéral transparent et incolore ramené pour la première fois du Groenland au XVIIIème siècle. Les porteurs d’oeil de verre pourront désormais pleurer à chaudes larmes.
On quitte Genève à 16 heures. Brève pause à la COOP d’Epalinges pour acheter des baguettes et des saucisses de Vienne. Ce soir on mange des hot-dog.
Jean Prod’hom
Avec Esther Shalev-Gerz à Lausanne

L’évocation que la femme fait de son enfance, – de sa parentèle, de son éducation, des souvenirs qu’elle en garde, des malentendus qui l’ont construite, de ce qui s’est déposé en elle, – devient bientôt nostalgie et la passion se fissure, elle perd soudain pied et laisse entrer le doute qu’elle avait su maintenir à distance. Elle se tait usant de toutes ses forces pour rester debout avec ce doute qui vient d’en face et qui la pousse jusqu’aux limites de ce qu’elle peut endurer. Elle n’y croit plus au fond, mais elle résiste, elle tient bon jusqu’à ce que le doute se fissure lui aussi et que le vent tombe, la passion dont elle s’était distanciée un instant s’engouffre à nouveau sur son visage et l’enveloppe comme une violente averse qui l’aurait obligée à se terrer tout entière et à se taire pour sauver encore une fois sa peau.

L’une raconte la vie inconfortable dans laquelle de molles circonstances l’ont plongée, y mêle des justifications secrètes, grimace, bégaie le milieu qui l’a faite innocente victime, ajoute par-dessus des silences qui font supposer un incompréhensible labyrinthe d’éléments souterrains et sans contour, donnant à entendre ce qui rétrospectivement n’aura été que compromission.
L’autre écoute en cherchant le fil qui pourrait faire tenir debout ces lambeaux auxquels ceux qui s’y accrochent seront condamnés jusqu’à la fin. Elle a l’oeil de l’épervier et guette l’irréparable aveu sans lequel ne saurait être ni consolation ni pardon. Elle prend alors la parole et raconte sans s’arrêter la succession des événements auxquels l’enfant qu’elle fut a été mêlée, elle les fait tenir en équilibre avec un sourire étrange et lointain. Aucune circonstance, aucune justification, aucune explication, un récit au fil tranchant que l’autre ne parvient pas à émousser et qui la menace dans sa vie..
Ne serait-il pas temps qu’elles conviennent l’une et l’autre de l’irréparable et qu’elles ne laissent à personne d’autre qu’elles-mêmes le soin d’en faire quelque chose ?
Il faudrait aujourd’hui monter à plus de mille cinq cents mètres pour trouver le soleil, je resterai donc en-dessous. A Oron d’abord, une bonne heure et demie dans un magasin de sports pour choisir une paire de souliers de ski que je souhaiterais enfin confortables – les derniers j’imagine. J’attends plus d’une heure qu’un père, son fils et ses deux filles aient terminé leurs emplettes. La cadette est une passionnée du ski de randonnée, mais l’est un peu moins lorsqu’elle prend connaissance du prix de l’équipement que le vendeur lui propose. Disons d’emblée que le matériel a bien changé, des skis de randonnée pèsent aujourd’hui moins d’un kilo. L’annonce ne la décourage pas, n’a-t-elle pas travaillé dans une fromagerie tout l’été ? Ils s’en vont, la fille les mains vides, elle pense trouver moins cher ailleurs.
Descends à midi au Musée cantonal des Beaux-arts de Lausanne qui présente une exposition consacrée aux travaux d’Esther Shalev-Gerz. M’arrête devant deux plans fixes qu’elle a réalisés en 2002 à Stockholm et à Karesuando en pays Sami. L’artiste filme deux moments de la vie d’Åsa Simma qui se succèdent et se mélangent comme le doute lorsqu’il habite l’engagement et qu’il revient sur l’action.
Violents les portraits croisés des deux femmes dont Esther Shalev-Gerz filme l’interminable entretien qu’elles ont engagé à leur insu. L’une d’elles, née à Lodz, est une rescapée d'Auschwitz et de Bergen-Belsen, l’autre a vécu plus tranquillement cette même période à Hanovre, puis dans un pavillon de chasse tout près de Bergen-Belsen. Je remonte à 16 heures, sors avec Oscar, rédige cette note alors que la nuit tombe.
Jean Prod’hom




Pierre nous a lâchés

Il n'y a de place dans nos discours que pour les absents. Les orateurs de cet après-midi le savent d'autant plus que Pierre est mort. Quand ? Nul ne le sait, car personne n'est là lorsqu'il le faut, le réel prend tôt ou tard l'allure d'une parabole, Pierre est mort seul.
Les deux premiers orateurs ont donc parlé de l'absent, mais à côté comme d'habitude On écoute Pink Floyd et ça rappelle de bons souvenirs. Le troisième, c'est le pasteur, pas un mot sur Pierre, il ne l'a pas connu, alors il saisit l'occasion pour faire un peu de théologie, une théologie agressive, personne ne s'y attendait. Il lit des extraits de l'évangile de Marc où il est question de Pierre, c'était cousu de fil blanc.
Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux; ses vêtements devinrent resplendissants, et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Rabbi, il est bon que nous soyons ici; dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. Car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix: Celui-ci est mon Fils bien-aimé: écoutez-le! Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. (Marc 9, 2-8)
Par un tour de passe-passe dont je ne repère pas toutes les finesses, l'homme de couleur habillé de blanc transfigure notre Pierre en son Pierre. Personne n'y croit vraiment mais il s'obstine, avant de lâcher un peu de lest en citant un agnostique catholique, Umberto Eco. Trop tard.
On est invité à passer entre le cercueil et la famille. Difficile de rendre les honneurs aux vivants et de dire adieu au mort en même temps. Je jette un coup d'oeil à la photo de Pierre jouant de la guitare, hilare, posée sur le cercueil. Je ne parviens pas à imaginer la chose qui est dans la boîte noire, je regarde alors la photographie du gaillard qui n'en finit pas de rire depuis le début de la cérémonie et je ris moi aussi.
L'employé des pompes funèbres arrête la circulation sur l'avenue C. F. Ramuz et le corbillard s'en va, phares allumés, au crématoire de Montoie. On reste sur le pas de la porte de l'église de Chamblandes comme des cons, avec le sentiment que Pierre nous a un peu lâchés et qu'il a pris d'un coup une sérieuse avance. Pour certains d'entre nous la route est peut-être encore longue, on se retrouve donc, pour patienter et prendre un peu de force, au Restaurant du Port de Pully.
Le lac est proche mais les tessons sont rares. J'en trouve quelques-uns en mauvais état.
Dans le parc de la propriété Verte Rive où Guisan est mort en 1960, Vincent Desmeules expose une dizaine de sculptures, fers fins hagards, herbes de rouilles rongées, feux éteints figés, ruines ravalées, petits enfers perdus dans la verdure. A chaque fois la même question, comment faire tourner autour d'un objet un espace sans bord ? N'est-ce pas aussi inconcevable qu'écouter la radio au milieu de l'océan ?
M'arrête en remontant devant la forge de Ropraz où Vincent Desmeules réalise ses travaux, fais quelques photos avant de descendre au Mélèze. Arthur monte dans la voiture, la nuit tombe, les filles sont au lit.
Jean Prod’hom









Fondation Rosengart

L'un vouait une adoration sans borne pour Ulysse, l'autre préférait de beaucoup Pénélope.
Pablo Picasso et Paul Klee sont les hôtes permanents de la Pilatusstrasse 11 à Lucerne. Près de 300 travaux de l'Andalou et du Bernois ornent les murs d'une dizaine de pièces de l'ancienne Banque nationale suisse. Grands formats chez l'un, petits formats chez l'autre.
Si le premier me dissuade de peindre, le second m'y invite.





Jean Prod’hom
Allégorie

Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean, en disant :
- Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions.
Ils lui dirent :
- Où veux-tu que nous la préparions ?
Il leur répondit :
- Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau ; suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison : Le maître te dit : Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée : c'est là que vous préparerez la Pâque.
Ils partirent, mais ne trouvèrent pas les choses comme il le leur avait dit. L'heure étant venue, Jésus dit à ses disciples :
- J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, mais je ne le ferai pas dans ces conditions. Voici, j'ai amené la dispersion.
Voyant que son idée n'emballait pas les disciples, Jésus crut bon d'ajouter :
- Remettez-en une couche comme je l'ai fait moi-même.

Jean Prod’hom
Pierre Soulages
C'était, à un mètre cinquante du sol environ, une sorte d'énorme éclaboussure noire, trace laissée probablement par le balai d'un cantonnier qui avait goudronné la rue. Elle avait une partie unie, surface calme et lisse qui se liait à d'autres plus accidentées, marquées à la fois par les irrégularités de la matière et par une directivité qui dynamisait la forme ; le contour était d'un côté rebondi, et d'ailleurs présentait quelques excroissances à demi inexplicables et à demi possédant cette cohérence que la physique donne à l'aspect des taches de liquide projeté sur une surface. J'y lisais la viscosité du goudron, mais aussi la force de projection, les coulures dues à la verticalité du mur et à la pesanteur, liées aussi au grain de la pierre.
Pierre Soulages


Jean Prod’hom
Cosmogonie
Je comprends mieux, c'est à notre insu que sont nées la géométrie et les clairières.


Jean Prod’hom
Isotosi VS 102-T
outre-noir bitumineux, imputrescible sous radier, travail à froid


Jean Prod’hom
Voyage au centre de la terre

La réussite d'une expédition au centre de la terre nécessite en amont de longues et difficiles études, l'aide aussi de ceux qui en savent plus que vous, une préparation soignée, de lourds sacrifices, un peu de hasard, le dos solide et le coeur bien accroché. Axel Lidenbrock et son oncle Otto en savent quelque chose, le chemin est long de la Köningstrasse à Hambourg jusqu'aux contreforts du Sneffels près de Reykjavik. Plus d'un tiers du récit de Jules Verne – publié en 1867 – en témoigne, c'est alors seulement que la descente dans les entrailles de la terre peut commencer : entrés sur les traces d'Arne Saknussemm dans un volcan situé aux confins du monde, dans la région des neiges éternelles, les aventuriers en ressortent sous le ciel de Sicile par la cheminée d'un volcan entouré de verdure infinie : le Stromboli. Des pêcheurs les recueillent, ils ont côtoyé la préhistoire, découvert des trésors, confirmé des hypothèses et frôlé la mort. Un seul regret chez Otto Lidenbrock, celui de ce que les circonstances, plus fortes que sa volonté, ne lui ont pas permis de suivre jusqu'au centre de la terre les traces du voyageur islandais qui l'avait précédé.

Voyage au centre de la terre | Eric Brevig
Si l'adaptation cinématographique qu'Henry Levin fait du récit de Jules Verne en 1960 vaut aujourd'hui pour le vieillissement prématuré des trucages et des incrustations, celle qu'en propose Eric Brevig en 2008 constitue une illustration saisissante de la mutation de nos façons de saisir le monde et du virage épistémologique que vit notre époque : pas besoin de matériel ni de préparatifs pour descendre dans les entrailles de la terre, un petit sac à dos fait l'affaire. Se laisser tomber ensuite dans le puits, se laisser glisser dans la nuit, jouissances et vertiges. La connaissance c'est comme une fête foraine, on y accède sans y toucher, en gardant sa bonne humeur et en variant les attractions : train fantôme et grand huit, chute libre et marelle. Nous y voici, les luminaires ne manquent pas au Luna Park. Il faut le dire, la vérité c'est d'abord une émotion. Trevor, le héros du film l'avoue à plusieurs reprises, ce qu'il déteste par-dessus tout ce sont les sorties pédagogiques. Un bémol pourtant dans cette aventure, un regret, un seul, celui de Sean, le neveu et assistant du savant qui avoue soudain n'avoir jamais lu le récit de Jules Verne.
Jean Prod’hom
Rolex Learning Center






Vous pénétrez dans ces lieux avec l'étrange sentiment que, sitôt arrivé, il sera déjà temps de les quitter. Alors vous ne vous y installez pas, vous faites quelques pas qui ne vous rapprochent et ne vous éloignent de rien. Vous avez beau chercher, personne ne se dresse nulle part dans ce bâtiment à l'ancre. Les préposés au nettoyage sont vraisemblablement sur le qui vive, mais ils se font invisibles en attendant leur heure. Vous êtes bel et bien en transit, dans un espace sans loi apparente où l'on entend bruire la rumeur d'une autorité, en transit entre rien et rien, c'est ce qui fait le charme des lieux. Les individus que vous croisez sont là depuis toujours, comme des statues de sel dans un décor de papier mâché.
Le désordre et les accidents ont été éradiqués, il ne peut rien arriver, il n'est jamais rien arrivé dans ces lieux hormis quelques dépressions, des accidents cérébraux, des révolutions intellectuelles, des conversions idéologiques, bref rien de bien visible.



Aucune plaque commémorative, on les installera plus tard, lorsqu'on en aura terminé avec ce qui n'a pas commencé. Entre temps on vient prendre un rendez-vous ou un verre, faire une sieste entre deux trains, parcourir un livre. Avec le souci bien compris que tout soit comme au premier jour pour que demain se prolonge comme hier, pour de bon, à moins qu’on ne continue ainsi. Personne n'est surpris de ne pas s'étonner de l'état des choses, on s’habitue vite, sans compter qu'il n’est pas désagréable qu’on vous ignore comme si vous n'étiez pas, qu'on ne vous demande rien. Vous ne savez pas vous-mêmes ce que vous pourriez bien demander, et à qui. Vous vous asseyez pourtant, le temps se glisse à vos côtés et tout s'écarte d'un bon mètre : l'air libre circule au pas.
Les flux pourtant sont si tendus qu’il est déjà trop tard. Vous vous levez, minuit est là, ou midi. Vous constatez qu'on a fermé le bâtiment avant qu’il n’ouvre, avant même qu’il ne ferme, vous ne saisissez plus exactement le sens de ces expressions. Mais vous comprenez soudain que, si les chaises ne sont pas déjà sur les tables, c'est parce que les tables sont sens dessus dessous. Alors vous décidez de rester encore un moment, un moment dont vous n'imaginez pas la fin, mais vous y restez adossé à l'archaïque conviction qu'il vous a toujours suffi de faire un pas pour en sortir.

Jean Prod’hom
Tyrannie de la page A4

Le générateur Van-de-Graaff est naturellement l’un des clous de la visite du Technorama, il produit un courant continu de près de 500’000 volts qui dessine sous vos yeux un arc électrique – ou vous fait littéralement dresser les cheveux sur la tête. A côté de ce monstre la plus grande machine de Wimshurst au monde, avec un diamètre supérieur à deux mètres et des tensions encore de plusieurs centaines de milliers de volts. On rencontre cependant à Winterthur également des choses moins aveuglantes et plus apaisantes : un ballon rouge qui flotte sur un lac de carbone, des arrosoirs d’azote liquide qui traversent des chapeaux de feutre comme s’il s’agissait de vieilles passoires, des faux-semblants, des casse-tête, la solitude des habitants d’une bande de Moebius, les leçons du miroir, la carte de votre visage, l’histoire accélérée de la terre, le carrousel de Coriolis, l’assurance des toupies, l’huile magnétique...
Mais au Technorama de Winterthur, il y a surtout une machine, une machine diabolique qui ramène chacun d’entre nous à sa vérité et à la tyrannie d’une époque, notre apparence mesurée au nombre de pages A4 vierges qui suffisent pour que, enroulés dans ce suaire, nous ne soyons décidément plus rien.

Jean Prod’hom
Laurence Probst | Céramique

Elle participe enfant aux ateliers de poterie que Simone Mayor offre aux élèves de Moudon lorsque l’école est finie. Cette rencontre avec la terre sera décisive et ses effets ne la lâcheront pas. Mais c’est en marge de son activité professionnelle que Laurence Probst se formera, dans la vertu du compagnonnage et des ateliers où la transmission se fait de main à main, hors l’institution où la norme se raidit, dans ces marges que nos sociétés ont laissées en friche pour que le passionné indépendant puisse aller de son pas, loin des pressions, et trouver cette confiance qui croît de l’intérieur.
Laurence Probst rendra ce qu’elle a reçu aux enfants, à ceux de Lucens et de Moudon d’abord, à ceux des alentours de Vulliens ensuite où elle vit avec sa famille. C’est au geste libre et au regard appliqué des enfants que va tout particulièrement son attention, et c’est pour eux qu’elle a suivi en 1991 l’enseignement d’Arno Stern. Il lui a permis de mieux définir sa place, non plus évaluer l’adéquation des productions des enfants à des modèles, mais les accompagner autant que faire se peut dans l’exploration de ce qu’ils sont, sans que jamais leurs réalisations ne constituent la fin dernière de leur aventure. Un vent d’est souffle à Vulliens où sont mises à l’honneur des techniques qui ne tournent pas rond : modelage, colombins, plaques.



Être au service de l’enfant soit, puisqu’il en a besoin, mais être à soi-même son propre servant, explorer l’histoire, les techniques et découvrir les variations des formes primitives, bol, assiette ou plat, préparer méticuleusement la rencontre de la terre et du feu, partager avec d’autres son savoir-faire, n’est-ce pas essentiel aussi ? A cet égard le stage auquel participe Laurence Probst en 2009 à Saint-Quentin-la-Poterie est crucial. Elle s’y familiarise avec les techniques des cuissons primitives, celle du raku et de l’enfumage qui vont infléchir ses réalisations. Elle en revient pleine d’idées.
Demandez ! Elle vous racontera la chamotte et son grain, le galet pour polir avant la première cuisson, les petites inventions qui font sourire, la vieille lessiveuse, le biscuit, le lit de sciure de sapin ou de chêne mêlée à la paille et le foin, la cire d’abeille et le bas de laine avec lesquels elle lustre les pièces enfumées, la fabrication des émaux, les étonnements lorsqu’on défourne. Voyez les rejetons de cette mystérieuse cuisine conçue dans l’atelier, répétée, hautement technique, jointe au savoir-faire des anciens ! C’est l’écho d’un événement soigneusement préparé que le feu dans le four prend soudain en main, un bref instant, livrant aux circonstances et aux hasards les mauvais plis de la terre, récipients aux bords ronds, indécis, peau lisse ou craquelée, enfumés ou émaillés, grands signes de fumée noire, dentelles de l’émail qui se rétracte. On n’y est pour rien, ni les dieux ni les anciens ne sont jamais entrés dans le four, pas plus qu’ils ne sont entrés dans la tête des enfants. Pas besoin d’aller bien loin pour voyager, une roulotte prise dans les hautes herbes suffit.

Travaux actuels de Laurence Probst
Exposition du 1 octobre au 13 novembre 2011
Horaires d'ouverture
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h00
Jean Prod’hom
Edouard Monot | Opus incertum

Lorsque nous nous sommes acquittés de nos dettes et de l’inévitable, lorsque nous en avons fini avec la pile des affaires courantes, les peines, les été pourris et l’hiver qui se prolonge, les longs couloirs, les sales affaires, la file des obligations, les salons, les successions, les petits plaisirs et les jours les plus longs, bref, lorsqu’on en a fini avec ce qui assure l’équilibre de nos vies précaires et de leurs saisons, n’est-il pas heureux de disposer d’un peu de temps, hors tout, pour retourner au monde qui nous était promis – ou dont on avait rêvé – et dont nous nous sommes tenus éloignés, silencieux, en pliant l’échine parfois ?
Il est de ceux qui ont su aménager le recoin d’une cuisine pour mettre bout à bout les morceaux d’une aventure esthétique singulière, aux contours indéterminés, une de ces aventures qu’on poursuit sans trop savoir pourquoi, avec le souci de la mener à bien, la conviction qu’on n’y parviendra qu’imparfaitement et l’assurance qu’elle nous laissera au mieux les mains vides.
Pas besoin d’un palais pour cela, ni année sabbatique ni résidence d’artiste, une antichambre, l’ombre d’une arrière-boutique, un atelier d’occasion et un peu de temps arraché chaque jour lui ont suffi pour rassembler au moment voulu une trentaine d’objets qui tiennent circonscrit l’incertain, saisi à peine entre ombre et lumière, offert à ceux des passants qui veulent bien renouer un bref instant avec la construction de ces châteaux de sable qui, l’été, irriguaient leur enfance et retrouver le sérieux qui les habitait, l’hiver, devant des puzzles géants.


Des petites fenêtres, rien d’autre que des petites fenêtres en trompe-l’oeil, et dedans une durée, une durée qui dure, un temps qui ne file pas droit, c’est-à-dire du temps roulé comme de la pâte, avec dedans la possibilité que quelque chose survienne.
Mais nous avions beau faire, notre reflet se mêlait à ce que nous croyions voir. Où que nous soyons, nous apercevions le reflet d’un visage captif et le milieu dans lequel il se complaisait, la silhouette d’un inconnu qui nous tenait éloignés de ce que nous étions venus chercher. Tout se passait à notre insu, dans un dialogue organisé hors de nous par la lumière, entre le monde qui va pour son compte dans les pièges d’un miroir sans tain et l’immobilité absorbante de ce qui reste de la représentation derrière les battants d’une fenêtre.
Il y avait pourtant dans ce mariage quelque chose à saisir, les ailes de feu d’un papillon exposé dans une vitrine, derrière ou devant un visage égaré. Mais qui du papillon ou du visage était le suaire, et pour quelle histoire ? 

Le soleil déclinait lentement vers l’horizon. Au ras de l’amoncellement rocheux couronnant l’île, la grotte ouvrait sa gueule noire qui s’arrondissait comme un gros oeil étonné, braqué sur le large. Dans peu de temps la trajectoire du soleil le placerait dans l’axe exact du tunnel. le fond de la grotte se trouverait-il éclairé ? Pour combien de temps ? Robinson ne tarderait pas à le savoir, et sans pouvoir se donner aucune raison il attachait une grande importance à cette rencontre.
L’événement fut si rapide qu’il se demanda s’il n’avait pas été victime d’une illusion d’optique. Un simple phosphène avait peut-être fulguré derrière ses paupières, ou bien était-ce vraiment un éclair qui avait traversé l’obscurité sans la blesser ? Il avait attendu le lever d’un rideau, une aurore triomphante. cela n’avait été qu’un coup d’épingle de lumière dans la masse ténébreuse où il baignait. le tunnel devait être plus long ou moins rectiligne qu’il n’avait cru. Mais qu’importait ? Les deux regards s’étaient heurtés, le regard lumineux et le regard ténébreux. Une flèche solaire avait percé l’âme tellurique de Speranza.
Le lendemain le même éclair se produisit, puis douze heures passèrent de nouveau. L’obscurité tenait toujours, bien qu’elle eût tout à fait cessé de créer autour de lui ce léger vertige qui fait chanceler le marcheur privé de points de repères visuels![]() Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, 1967 (Folio 2008, 104)
Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, 1967 (Folio 2008, 104)
![]()

![]()
![]()
![]()

On ouvrit donc les fenêtres et on mit l’île autrefois sous cloche au vent. La Verzasca déboulait sous nos pieds, elle avait mis en pièces la montagne, creusait son lit dans un bruit assourdissant. L’eau insaisissable chantournait les éboulis et polissait les fragments d’un puzzle aux motifs inconnus. Elle écrivait de haut en bas un récit immobile qui se poursuivait et que rien ne pouvait arrêter. Les pierres s’arrondissaient, l’eau multipliait ses passages, modelait des réduits, creusait des poches, dessinait des avenues, dévalait la pente entre les cimes et le lac, aménageait les ruines de la montagne en d’innombrables petits chaos irrigués dessus dessous par l’eau qui tenait ensemble l’ensemble qu’elle faisait briller et chanter.![]()

![]()
![]()
![]()

Qu’avions-nous donc à faire de notre côté ? Reprendre une à une les choses mises en pièces en prenant à son compte la part laissée au hasard, reprendre une préhistoire dont on ne sait rien, dessus dessous, la recommencer comme un tavillonneur sous un ciel bleu, refaire ce dont le hasard n’aura été que la réponse paresseuse et immédiate à ce qu’on ne sait voir, reprendre pierre à pierre depuis le dedans, de proche en proche, différant le nom de ce qui commande l’aventure. Aucune appellation ne viendra donc boucler l’ouvrage, ou sans titre, une expression qui n’assure de rien. ![]()

![]()
![]()
![]()

Opus incertum, une manière de sonder latéralement l’insaisissable, de reconstruire solidement le précaire en lui offrant un fond, une coque pour autre chose. Ici pour rien ou pour elle-même, un ouvrage détaché de sa fin.
Les petits accidents jouent des coudes, la main écarte deux pièces pour rectifier l’équilibre, demi-tour, reculer ou avancer d’un plan, fort, da, les doigts reprennent des pièces, les refaçonnent, dessus dessous, établissent des ponts, creusent des galeries, collent et recollent, tout recommencer parfois.
Ça va tenir, ça va tenir sans titre, et si ça ne tient pas, on recommencera la partie. Mais sans laisser la main à celui qui n’en a nul besoin et qui fait vivre le monde comme un marionnettiste connaissant le fin mot de l’histoire, mais en prenant cette fois l’affaire sur soi et d’en-bas, comme un insomniaque qui guetterait le lever du jour, avec les mains qui retrouvent leurs fonctions ouvrières, à hauteur des pierres.
Les doigts se méfient des figures et des désignations qu’il tiennent prudemment à distance, ils exigent le silence et se taisent aussitôt que la représentation guigne avant de fondre sur leur attention et les détourner de ce qui est pour les enrôler dans ce qu’ils pourraient dire. Ça va tenir, ça va tenir donc en-deça de la représentation. Ça va tenir en équilibre, par la grâce d’une syntaxe élémentaire de formes rudimentaires, de formes concrètes tenues en un équilibre dont il faudrait faire le récit épique, du déséquilibre initial qui lui donne la chance unique d’aller au-delà de la nature morte au déséquilibre final qui en fait un tableau vivant, tiré à quatre épingles, debout et fragile, sans pierre d’angle ni clef de voûte.![]()

![]()
![]()
![]()

Mais on a beau dire au diable les maîtres signifiants, ils demeurent sur le qui vive. C’est l’eau qui sourd du chaos des rives de la Verzasca qui rend notre monde vivable, si bien que toute nature morte bien comprise n’a de sens que si elle reste vivante. La vie, je dis bien la vie, se fraie un passage dans le chaos auquel elle donne vie, l’aventure des coquelicots et de la camomille se prépare dans les interstices des pavés. C’est dire qu’une nature morte – et toute l’histoire de l’art n’est peut-être que l’histoire mouvementées de la nature morte – si elle ne raconte rien, n’en est pas moins le lieu même où se raconte la possibilité que quelque chose peut advenir.
L’un dira le berger, l’autre l’orage, un troisième la maison, bien-sûr personne n’y croit vraiment, mais chacun est assuré que quelque chose va se lever dans ce rien en équilibre précaire, quand bien même ce rien ne se lèvera pas, demeurera en retrait sur le mode de ce qui n’est pas encore.
Car au-delà du blanc sur fond blanc – ou en-deça – on est embarqué, avec le sens qui nous pousse de l’arrière et les choses qui nous attendent au contour. Papillons, coquelicots, mues de serpents ramassés au bord des routes, rouge sang, rouge pourpre, écriture enfin. Voici une macédoine, voici un banc de melons et de pastèques, voilà un jaune d’oeuf et une ribambelle de tessons usés par la mer. Malaxe, malaxe.![]()
Travaux actuels d’Edouard Monot
Exposition du 6 septembre au 5 octobre 2011
Horaires d'ouverture
Mardi au vendredi de 14h à 18h30
Samedi de 10h à 17h
Jean Prod’hom
Open space

Dix heures ce matin, vent d’ouest et ciel dégagé, c’est un temps à faire le tour du lac de Sauvabelin : pas un chat, ses poissons rouges et ses ânes, ses biches, ses chèvres, sa barque et sa terrasse. Mais il y a, à deux pas, une maison de maître qui accueille jusqu’à l’automne quelques-unes des peintures acquises par Arthur et Hedy Hahnloser pour leur villa Flora à Winterthur. Je renonce au menu fretin du lac pour le gros poisson de l’Hermitage.

Henri Matisse, Nice cahier noir, 1918, huile sur toile, 33 x 40,7
Le linge pend aux balcons et les peintures des grands maîtres sèchent, il ne faut pas les toucher. Toutes les fenêtres sont ouvertes ; les cadres imposants, souvenirs d’une autre époque, obligent le regard à se porter dedans, empêchent de déborder sur les côtés. On est soudain dehors, les rideaux frémissent ; dans le parc un ou deux visiteurs ont cédé au charmes d’août, les essences rares mêlent leur frondaison au bleu du ciel ; au-delà le haut de la cathédrale qui surplombe la ville, derrière le pigeonnier et l'orangerie, la ferme, la pelouse pour les maîtres de maison et dans leurs souvenirs une plage, c’est un matin frais d'août ou les premières chaleurs de février, la porte en bas qu'on laisse ouverte, et le bleu qui vire au turquoise. Je m’assieds sur l’un de ces bancs qu’on met à la disposition du visiteur, si inconfortable qu’il n’y reste que le temps de noter dans son carnet ce qui ne cesse de s’échapper.
Pour le reste des merveilles, les intérieurs de Bonnard qui m'ont rappelé l'univers disparu de mes grandes-tantes, Lucie et Augusta : les tapis sur le plancher encaustiqué, les passementeries, le velours des fauteuils, leurs regard sur les choses et le mien, les nappes à carreaux, les fruits et les fleurs, la lumière, les tapisseries, la lumière surtout. Elles vivaient elles aussi dans un cadre doré, à Villarzel, en un lieu où le temps ne passe pas, avec leur nécessaire de couture, un tub et de l’osier, un fourneau à pierres ollaires et des livres à dessus de cuir. Mais en voyant les jarretières rouges dune femme qui s’éveille dans une chambre en désordre, je me prends à penser que derrière leurs allures de vieilles filles accomplies se cachaient de vives envies.
Rien ne bouge dans ce sous-marin, les tableaux et les fenêtres hermétiquement closes se succèdent, le temps reste pris dans le filet des natures mortes, à l’intérieur, à l’extérieur, sur le seuil et derrière les visages. Pour les voir il faut sortir.
Accoudé sur le muret qui borde le lac j’aperçois des iris d’eau, personne.
Jean Prod’hom
Un bouquet de coquelicots

Si Claude Monet a beaucoup voyagé – l’Algérie, l’Italie, la Hollande, la Norvège... –, les peintures que Pierre Gianadda propose à Martigny du 17 juin au 20 novembre 2011 ne nous font guère aller au-delà du clos : Vétheuil, Argenteuil, Londres à peine et un peu de Provence... Elles font voir la maison du peintre, l’allée, une gare, une barque. Et dans le jardin les images premières de mon abécédaire : l’étang, les nénuphars, le peuplier et le saule, l’olivier et le palmier, la rose et l’iris, le chrysanthème, le pont et l’allée. Le peintre les explore matin et soir, été comme hiver, sans fin. Les choses bougent, l’ombre voisine avec le scintillement, les miroitements et l’irisation, et puis il y a la débâcle et l’inondation qui recouvrent tout. Impossible de mettre la main sur rien, alors Claude Monet recommence, que peut-il bien faire d’autre ?

Le Champ de coquelicots près de Vétheuil, peint en 1879 et figurant sur la première page du catalogue et les innombrables affiches de l’exposition nous offre une belle leçon d’histoire : cette peinture, volée au printemps 2008 et retrouvée quelques jours plus tard sur le siège arrière d'une voiture stationnée dans le parking de la clinique psychiatrique de Burghölzli, est invendable, aussi invendable que les improbables bouquets de coquelicots que préparent les quatre femmes près de Vétheuil, fanés sitôt faits. N’en tireront fortune que les fabricants de puzzles et les empailleurs d’éphémères, les vendeurs de sandwichs, les assureurs, les bouchers. La campagne publicitaire bat son plein à Martigny, tous les commerçants se sont donné la main.












Jean Prod’hom
Terres d'écritures

Déposer un peu de pigment noir sur le blanc mat et âpre de la porcelaine nue si mal armée, mettre du noir sur du blanc, c'est déjà écrire, n'est-ce pas ? Mais quoi ? Des lettres ou l'alphabet primitif qui les constituent, un mot ou une phrase, quelques-un des noms des anges que mentionne Umberto Eco dans son Vertige de la liste, initiale rouge coquelicot, ou ceux des démons, ceux des étoiles les plus brillantes, une poignée de titres organisant les chapitres des Notes de chevet de Sei Shonagon, ou les bienheureux qui échappent à l'appétit de l'Eisthenes du Quart livre ?
C'est selon, peu importe, car la calligraphie met à l'épreuve la relation première du tracé avec son support, de la lézarde avec le blanc cassant de la page blanche : enfance de l'écriture dans son indécise éclosion d'avant la lettre. Car la vérité est en amont, lorsque l'écriture, avant de faire système, n'était que fêlure, à la fois ruine et anticipation de la ruine, condamnée à briser la belle unité du monde pour la recomposer ensuite. La rencontre de la calligraphie et de la terre cuite était inéluctable.
Ils campent bien avant la lettre, tout prêts de l'origine mais un peu après le bing bang. Le réel et l'écriture sont contemporains et nos constructions tremblent. Pas l'ombre d'un décor, mais la vérité d'un séisme qu'un vase ou une coupe au bord ourlé et âpre contient un instant avant de se briser.
Graphic porcelaine et céramique contemporaine
Du 7 juillet au 28 août 2011
Grignan
Christine Macé
et les calligraphes
•Christine Dabadie-Fabreguettes
•Denise Lach
•Anne Gros-Balthazard
•Kitty Sabatier
Jean Prod’hom
Terres d'écritures

Déposer un peu de pigment noir sur le blanc mat et âpre de la porcelaine nue si mal armée, mettre du noir sur du blanc, c'est déjà écrire, n'est-ce pas ? Mais quoi ? Des lettres ou l'alphabet primitif qui les constituent, un mot ou une phrase, quelques-un des noms des anges que mentionne Umberto Eco dans son Vertige de la liste, initiale rouge coquelicot, ou ceux des démons, ceux des étoiles les plus brillantes, une poignée de titres organisant les chapitres des Notes de chevet de Sei Shonagon, ou les bienheureux qui échappent à l'appétit de l'Eisthenes du Quart livre ?




C'est selon, peu importe, car la calligraphie met à l'épreuve la relation première du tracé avec son support, de la lézarde avec le blanc cassant de la page blanche : enfance de l'écriture dans son indécise éclosion d'avant la lettre. Car la vérité est en amont, lorsque l'écriture, avant de faire système, n'était que fêlure, à la fois ruine et anticipation de la ruine, condamnée à briser la belle unité du monde pour la recomposer ensuite. La rencontre de la calligraphie et de la terre cuite était inéluctable.
Ils campent bien avant la lettre, tout prêts de l'origine mais un peu après le bing bang. Le réel et l'écriture sont contemporains et nos constructions tremblent. Pas l'ombre d'un décor, mais la vérité d'un séisme qu'un vase ou une coupe au bord ourlé et âpre contient un instant avant de se briser.


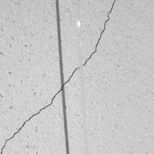

Graphic porcelaine et céramique contemporaine
Du 7 juillet au 28 août 2011
Grignan
Christine Macé
et les calligraphes
•Christine Dabadie-Fabreguettes
•Denise Lach
•Anne Gros-Balthazard
•Kitty Sabatier
Jean Prod’hom
Bédarès

Un petit maître toscan du temps des Lorenzetti conçut une peinture de petit format oubliée dans la réserve d'un musée de la province siennoise que j'eus la chance de découvrir il y a une trentaine d'années. Or un détail de cette peinture m'est apparu distinctement l'autre matin au fond d'un bassin abandonné sur les bords d'un sentier longeant le Lez près de Bédarès. Ne m'est revenu en mémoire que ce détail – l'angle inférieur droit – qu'il m'a suffi de déborder pour retrouver le bateau couché sur le flanc, le vert et l'ocre et, de proche en proche, les restes du vent, l'odeur du goudron, la filasse, le bonheur de peindre, l'arrachement, les jointures et le rivage. Personne dans cette représentation, pas même un nom à l'angle du tableau, mais une main divine.
Jean Prod’hom
Tendreté de la pierre

Il est, écrit Ovide dans sa douzième métamorphose, au milieu de l’univers, entre l’océan, la terre et les plaines célestes, sur les confins des trois mondes, un lieu d’où se voit tout ce qui se passe en tous lieux. C’est la demeure de la Renommée, mille issues, mille ouvertures nuit et jour, jamais de silence, jamais de repos. Elle répand le bruit que des vaisseaux grecs arrivent, raconte le sanglant prélude des combats, ce que peuvent les Troyens, le sang sur les rivages du Sigée, les exploits de Cycnus qu’aucun javelot ne transperce, le bouclier d’Achille fait d’airain et de dix cuirs, la cuirasse et la poitrine de Ménætès.
La Renommée raconte encore le repos d’après les premiers combats, le long entretien des chefs des Grecs et les récits que leur fait Nestor : les noces de Pirithoüs et d’Hippodamie, l’ivresse des Centaures qui, enflammés par le vin, abusent des invitée, la résistance de Thésée – l’ami de Pirithoüs – qui arrache Hippodamie des mains du centaure Eurytus, lui fait vomir sa cervelle broyée au milieu du sang et du vin, les combats qui suivirent, les os fracassés du visage de Céladon, le menton fracassé d’Amycus qui vomit ses dents brisées, les yeux de Grynée percés par les bois d’un cerf, la tempe de Charaxus frappée par un tison, l’épieu qui pénètre Rhoetus à l’endroit où le cou se joint à l’épaule, le glaive de Dryas atteignant Crénéus entre les deux yeux, à l’endroit où le nez se joint au front, le fer qui s’enfonce dans le cou d’Aphidas, la lance de Pirithoüs clouant la poitrine de Pétreus à l’arbre qu’il étreignait, cette même lance ressortant par l’oreille gauche d’Hélops, l’immense Bianor que Thésée saisit par les cheveux et dont il brise les durs os du crâne.
C’est cela qu’Ovide, la Renommée et le vieillard de Pylos racontent, les durs combats des Grecs et des Troyens, ceux des Centaures et des Lapithes

Antonio Canova, Thésée luttant contre le centaure Biénor, Kunsthistorisches Museum
Mais dans le creux de chacun de ces récits, ils nous font entendre la tendreté de la pierre, le robuste genou d’Achille qui presse la poitrine de Cycnus, Thésée qui presse du sien les flancs de Bianor et le creux de tes reins.
Jean Prod’hom
Revenants

Friedensreich Hundertwasser sur la Löwengasse.

Le duc Maximilien de Bavière et sa belle-soeur Sophie, archiduchesse d’Autriche, de retour au Prater.

Jean Prod’hom
Dimanche 17 avril 2011

La haute pression mélangée à l'inertie des dimanches soulève le ciel. Le soleil chasse les locataires des maisons encore froides et nous voilà, fenêtres ouvertes, la bride sur le cou. Balade du côté de l'étang dont j'aurai vu le cycle tout au long de l'année. Son étendue – son identité – perceptible pendant l'hiver ne l'est plus. Les aulnes et les bouleaux ont colonisé la tourbe et la bruyère ne s'y retrouve pas. Il y a quelques années, quel que soit le temps, on pouvait en faire le tour, je crains qu'il ne disparaisse et redevienne un refuge pour les lièvres et les chevreuils repoussant plus loin les canards et les grenouilles. Mais où?

Hans Steiner
Lorsque je rentre, Louise joue de la guitare, Lili se raconte des histoires, Arthur lit. Sandra dort, victime d’un virus qui a profité de sa fatigue. On la laisse tranquille et on descend au Musée de l'Elysée qui présente un ensemble de photographies réalisées par Hans Steiner.
Des photos de l'ancien temps? demande Lili. C'est exactement cela Lili, des photos de l'ancien temps. Hans Steiner est en effet né tandis que le XXème siècle venait de commencer et il est décédé alors que je n'avais que sept ans. C'est en cela que ces photographies fascinent, elles font voir ce que je n'ai pas pu voir, ou à peine, parce qu’elles nous font voir les choses comme on n'avait pas l'habitude de les voir, entre reportage et mise en scène, publicité et engagement, des images qui sont encore d'aujourd'hui mais réalisées avec les moyens d’hier, ou l’inverse, sur la crête, à bonne distance de ce qui est sous nos yeux et de ce qui a basculé dans les fosses inodores de l’histoire.
Je sens encore une fois combien le passé, qu'il soit proche ou lointain, demeure vivant à deux pas de nos existences et ne constitue en définitive qu'un des modes un peu passés du présent. Me demande au passage si Hans Steiner n'a pas été l'auteur d'une photographie que j'ai retrouvée dans un carton et qui m'a ramené bien loin en arrière, un peu avant que je cesse d’être un enfant.


Hans Steiner
Arthur, Louise et Lili se sont comportés comme des grands et, pour fêter ça, on mange la première glace de l'année. Ils s'y sont retrouvés même, je crois, parce que ces photographies de Hans Steiner constituent un bon relais, susceptible de les conduire sans heurts d'ici à là-bas, à cet ancien temps que l'on distingue sans peine et qui fait sourire, parce que ce sont d’abord des images capables de faire voir ce qu'elles ne contiennent pas en propre, ou mieux, ce qu'elles ne contiennent pas du tout mais indiquent seulement, comme ces maisons éclairées, aperçues depuis le train, qui nous rappellent au crépuscule la possibilité d’un autre pays où nous aurions pu vivre.




Jean Prod’hom
Dimanche 20 février 2011

C’est le dernier jour de la neuvième édition d’Accrochage, exposition annuelle que le Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne consacre à la fine fleur de la scène artistique vaudoise contemporaine, présentation d’œuvres récentes d’artistes de différentes générations sélectionnées sur libre présentation par un jury de professionnels. Je m’y rends avec Arthur quelques heures avant que ne retombe le rideau et qu’on place dans la nuit de quelque cave (ou les dépôts de nos généreuses banques), ce qui brilla un instant aux cimaises.
Je ne m’y retrouve pas... mais avoue que, en ce domaine, je ne connais rien, ni les sauts de loup ni les chicanes qui contraignent les artistes à se dépasser bien au-delà de ce que le Béotien que je suis est capable d’imaginer. J’admets donc volontiers que chacun des travaux présentés ici n’est que la pointe d’un iceberg dont je ne vois pas le ventre immergé. Car l’avenir est certainement radieux et Arthur met tout plein de bonne volonté.
Il me faut toutefois tenir à bonne distance l’ex falso sequitur quodlibet que me souffle un mauvais génie, prendre garde à ne pas rejoindre les grognons aigres des zones critiques qui ne se lassent pas de jeter le discrédit et les moqueries les plus triviales sur les travaux de ceux qui cherchent – sans toujours trouver – des issues à la boîte de Pandore dans laquelle ils sont enfermés, bref, tenir à bonne distance la superbe pleine de fatuité des professionnels de la critique et le gros dégoût.

Restent quelques odeurs, le bruit de vieux tram d’un vieux carrousel à dias qui projette le passé sur l’écran de l’avenir et le souvenir d’une ligne continue, noire, fixée au sol à soixante centimètres des murs sur lesquels sont exposées les merveilles. Une ligne qu’il ne faut pas franchir, scotch noir tiré à la va-vite.
Interdit de photographier le travail des artistes, précise une employée du musée lorsqu’elle me voit prendre mon appareil. Mais la ligne? la ligne noire? Interdit aussi, droits d’auteur obligent. La ligne fait-elle partie des travaux présentés? La dame n’en est pas sûre mais ne fléchit pas, moi non plus. Est-ce une représentation de l’infranchissable, une esthétisation de la clôture religieuse, un jubé de notre temps? Je ne peux m’y faire, elle réfléchit encore, cherche avec sérieux une issue. Elle me propose enfin de rejoindre l’entrée du musée, de prendre contact avec le responsable de l’exposition qui est dans le vestibule. Il m’informera et lui communiquera par téléphone sa réponse. Je pourrai alors la rejoindre et, sous sa surveillance, photographier cette ligne interdite.
Elle a tourné le dos, je n’attendrai pas. Bandit! souffle Arthur. On s’enfuit.

Jean Prod’hom
Dimanche 23 janvier 2011

L’histoire rapatrie des charniers les laissés pour compte qu’elle place délibérément en avant du chantier qu’il a bien fallu ouvrir pour chercher une raison d’être hypothétique à nos existences. L’histoire ressuscite à tour de bras, moule, habille les reliques des éradiqués, guillotinés, chassés, ensevelis, brûlés, dresse dans les cours de nos maisons leurs images pour que nous disposions de repères et puissions aller droit devant à la rencontre de l’étrange rêve du jardin promis. L’histoire pilote nos vies de l’arrière, pieds dans les ronciers, projette à l’avant les roses de l’églantier et mêle les bourreaux de salon au chasseurs de papillons, les belles victimes aux visionnaires déments, le service public aux génocides.

L’homme et le caterpillar qu’il chevauche saignent le réel, l’histoire en est le récit charmeur. Lausanne 1638, plan Buttet et sa traduction qu’en a réalisée quatre maquettistes de la Direction des Travaux de la ville de Lausanne: maisons silencieuses, tours de gala, portes dorées, moulins pour le pain, canaux de dérivation, le Flon et la Louve à ciel ouvert, arbres en fleurs, vendanges tardives, jardinets, paix perpétuelle. Imageries d’un futur à côté duquel on a passé, détenues dans le sous-sol de nos consciences, la campagne nue, des amis, marchands, bourgeois, l’évêque même. On ne voit que ce qui n’est plus et qui est sans avoir été. Un décor pour Alice, avec autour de la cathédrale le cortège des saints en habits d’Arlequin. On y croit à peine, je rêve.

Dehors la ville se dresse, sourit, poursuit sa méditation, imperturbable, avec les hommes à ses pieds, comme des gueux dans l’enceinte du Château Saint-Maire. Rien à craindre pour ces derniers venus, sinon la plus haute des craintes, celle d’être nés là, et hier, et accepter que tout cela ne mène nulle part, passer ce secret au suivant autant que faire se peut pour en être enfin.
Tu seras Elie, le Major ou l’évêque. Et sur les îlots formés des sédiments recueillis par de belles âmes, tu réhabiliteras le monde et son ombre sans leurs ombres, comme s’il t’était toujours loisible de trouver une place, en toutes circonstances. Tu seras meunier, scieur, vicaire ou sculpteur, prêt à l’idylle dans une nuit où le sang ne coule plus, la Louve et le Flon filaient vers la mer. Mais rappelle-toi, nous ne disposions ni de notre vie ni du présent. C’était le 23 janvier, jour de l’Indépendance vaudoise.

J’ai traversé comme une flèche la zone industrielle d’Ussières, déchiré par les lanières du froid, incapable de rêver. L’histoire ne fait pas de détour par l’Ecorcheboeuf, la bise noire en soulève les dessous, ramène les supplices, les terreurs, la sensation qu’on pourrait ne pas en revenir, sans qu’on sache vraiment quelle forme pourrait bien prendre cette fin, sinon celle de l’abandon.

On ne peut s’empêcher de se battre, d’abord se taire, rejoindre les bancs de l’église de Carrouge autour d’un puits d’où se font entendre des voix nues, parenthèses de bienveillance. Et personne pour siffler cette indiscipline, cet hors jeu collectif en marge de ce qui est et de ce qui aurait pu être, en marge du bruit et du silence.

Jean Prod’hom
Inscrites au Registre de la Mémoire du monde

L’Agence internationale des prisonniers de guerre créée à Genève en 1914 a eu pour tâche de rétablir les liens familiaux entre personnes que la guerre avait séparées. L’Agence a établi le fichier des disparus ordonné par régiment et par compagnie. Elle a rédigé six millions de fiches permettant de suivre le sort de deux millions de prisonniers.
Les indications au dos de certaines des 5119 boîtes de fiches exposées au sous-sol du CICR à Genève et inscrites au Registre de la Mémoire du monde de l’UNESCO ont disparu.

















































Jean Prod’hom
Desiderius Christophe Martin

Dans une niche rouge sang creusée dans le mur sud, là-bas tout au fond, se dresse sur un autel aux parois latérales de marbre une statue du Christ pauvrement vêtu, bon berger ou ressuscité, ou les deux. Il tient dans la main gauche une croix de procession à la hampe de laquelle s’enroule une bannière couleur mie de pain. Placés à ses côtés une mitre et une crosse, deux chandeliers, un encensoir.
On distingue mal derrière le rideau vert évêque les objets que contient l’autel aux parois de marbre et aux portes de bois largement ouvertes: un plat à larges anses, un paquet informe qu’un lacet semble maintenir en place... Le rideau tombe négligemment sur l’un des deux battants.
Au fond de l’oeil de l’absidiole, on distingue haut perchée l’esquisse noire d’un oiseau déployant ses ailes: un archange ou le saint Esprit. Il demeure en retrait de la statue de pierre ou de bronze du Dieu incarné. Les motifs incrustés – losanges orangés sur carrés noirs – au bas des piliers de la niche font penser à ceux du campanile de Santa Croce à Florence.
De chaque côté de l’absidiole rouge sang deux portes, dont les cadres supérieurs coiffés chacun d’un fleuron rappellent les pagodes de l’orient. L’une d’elles largement ouverte fait voir une chambre plongée dans l’obscurité dans laquelle on ne distingue qu’une table nappée de rouge sur laquelle sont déposés en vrac de nombreux objets qu’on a peine à identifier et un présentoir chargé de livres ouverts. Sur un fil tendu de part en part pendent des formes géométriques de couleur – des instruments de mesure? Une étroite fenêtre fait voir à l’est, à travers une persienne, la lumière tamisée du jour.
Pas d’ouverture en revanche sur le mur oriental de la pièce principale traversé par un long rayonnage que soutiennent des fers en esse. Il est occupé sur toute sa longueur par une bonne cinquantaines de livres dont on ne voit que les dos de cuir aux couleurs chaudes. A la verticale, à l’extrémité d’un bras de bois qui semble jaillir du mur une main tient un bougeoir sans bougie – auquel répond symétriquement, sur la paroi ouest, un bougeoir semblable. Diverses babioles, coupelles et vases, une collection de plumes, un encrier, tessons antiques, un cheval de bronze miniature, une statuette courent sur l’étroite tablette qui interrompt les boiseries recouvertes d’un velours vert pâle à mi-hauteur de la paroi. Sous le rayonnage la chaise vide et le lutrin raffinés, de bois et de cuir, fixés sur une estrade dont une moulure atténue l’épaisseur rappellent davantage d’intemporels instruments de torture que le confort exigé par la lectures prolongée de livre longs et difficiles. A côté de la petite estrade deux gros volumes ont été abandonnés contre la paroi en toute hâte.
Et puis au premier plan un homme et un chien.
L’homme immobile, vêtu d’une robe à rabats noir, blanc et rouge est assis sur un banc aux pieds torsadés finement ouvragés; il est face à une table sur laquelle, plume inclinée dans la main droite, plume levée il écrivait ou écrira. Sa main gauche a repoussé les livres qui ne servent plus, il écoute, songe, suspendu à un appel venu du dehors qui l’a détourné de ses tâches ou vers lequel celles-ci l’ont conduit. C’est un homme qu’une barbe châtaigne a assagi, il a quarante ou cinquante ans.
L’estrade sur laquelle il se trouve et dont il semble sur le point de s’échapper a la forme d’un demi-cercle, elle est recouverte d’un velours, vert évêque encore, fixé par des clous d’or qui en font le tour. Une dizaine de livres ouverts, entrouverts ou fermés gisent à ses pieds dans un savant désordre. Sur un lutrin rapproché une partition de musique.
Il n’est plus temps de lire, l’homme a laissé sa mitre et sa crosse près de l’autel, il pense mains nues, en déséquilibre.
C’est le temps des grandes découvertes. Du plafond pend une sphère armillaire conçue par les anciens Grecs pour représenter la lune, la terre, le soleil et les autres objets célestes. Mais ce n’est pas vers elle que l’homme regarde ni non plus du côté de l’Amérique, l’homme a le torse tourné vers le ciel, le visage tendu vers le soleil – a-t-il vu une fumée blanche? – la lumière qui entre par la plus rapprochée des trois fenêtres percées dans le mur ouest l’illumine, lui mais aussi le vaste cabinet dans lequel il a vécu, le mobilier raffiné qui a soulagé ou aiguisé le soir les plaies de son âme, les feuillets enluminés des missels anciens qu’il a étudiés, les livres qu’il a fallu lire pour y voir plus clair, les instruments grâce auxquels il a pu expérimenter la solidité des dires de son siècle. La lumière du dehors éclaire le dedans, non seulement les babioles patiemment récoltées, mais aussi la statue du Christ dont l’imparfaite imitation a amené le saint homme jusque-là.
A considérer la longueur des ombres et la taille des objets, la scène se déroule au milieu de l’après-midi. A moins qu’il ne s’agisse du milieu du matin et qu’il nous faille tout recommencer à reculons. Qu’importe, c’est le bureau d’un érudit.
Mais c’est aussi le bureau du premier venu, le bureau de tous ceux à qui il convient d’être à mi-chemin des livres et du ciel et qui en assurent le lien par le silence ou l’écriture. L’homme qui répond à l’appel du dehors a cessé ce jour-là de différer ce dont nous détournent l’oisive étude et les sirènes dont il a entendu l’appel trompeur en plaquant l’oreille contre le coquillage qu’on aperçoit sur le bureau, à côté de la clochette dont il usait pour appeler les domestiques. L’homme est seul et nu. Pris il y a plus de cinq-cents ans dans la glu de la représentation il l’est encore, statue de cire il prolonge un instant encore la divine expérience.
C’est le temps des réformes, on ne peut différer plus avant une tâche qui n’en finit pas. Qu’importent les livres gisants, les portes de l’autel qu’on aurait décemment dû fermer, le rideau qu’il faudrait rabattre, les piles de livres qu’il aurait fallu assurer. Le Christ lui-même, qui n’est ici au fond qu’une statue, s’est retiré dans l’ombre d’une absidiole pour laisser le champ libre au réformateur qui lui offre une seconde résurrection.
Le livre a mené l’homme, ici dedans, au seuil de l’immédiateté qui l’attend là, dehors. Et c’est un chien, un petit chien blanc, égaré dans un désert de lumière, sans autre intercesseur que son ombre, un bichon maltais gonflé de vie et de patience qui arrachera l’homme à sa sidération.
L’histoire peut véritablement commencer, Desiderius Christophe Martin Vittore et son bichon maltais vont tous deux goûter ce soir aux parfums des jardins de Rome ou de Milan. Quant à la vision de saint Augustin on n’en sait toujours rien, tout est à recommencer.
Jean Prod’hom
Échanges

Dans une séquence d'un film dont je ne me rappelle ni de l'allure ni du propos, pas même du titre, deux intellectuels de haut vol s'entretiennent en sautillant sur un court de tennis, shorts et polos blancs: leur conversation court le solide: Hegel peut-être – la dialectique? celle du maître et de l'esclave? – ou Marx, ou Lénine... quoi qu'il en soit c'est du lourd. L'échange réglé de leurs arguments, cohérent à coup sûr, épouse approximativement le rythme de leurs coups de raquette, il fait pourtant sourire. Le sens de leurs paroles ne suit pas la courbe aérienne de la balle, mais se perd dans les mailles d'un filet invisible.
Chaque chose en son temps, chaque chose en son lieu dit la sagesse populaire, que ce soit sur un court ou dans un salon feutré.
A moins que cette séquence ne démontre que les jeux de balle ne constituent qu'une piètre métaphore de l'échange spirituel: le sens ni ne va ni ne vient.
Ce que je me dis, je le dis à toi en qui je crois reconnaître celui qui pourra donner une existence plus solide à ce que nous pourrions croire ensemble.
Je suis prêt dans le même temps à entendre ce que tu te dis en me le disant, à moi en qui tu crois reconnaître celui qui pourra donner une existence plus solide à ce que nous pourrions croire ensemble.
Ce que je crois comprendre se manifeste, je le parie, dans l'idée que tu peux t'en faire, et les mots que je t'adresse en creusent rétroactivement la possibilité dans ce que tu m'as dit.
Ecrire c'est récrire, ou dire dans le discours de l'autre ce qu'il aurait pu me dire et que j'ai peine à dire.
Le père et le fils, tous deux débutants, jouent au ping-pong dans les caves d'une maison de vacances.
– Qui est le farfelu qui a inventé les indulgences?
– Qui a inventé les cartes Pokemon?
On creuse dans les sous-sols du langage, on y creuse pour faire une place aux images qui nous en viennent, les déplacer à peine pour les voir enfin.
La croyance en une circulation du sens, en sa multiplication et en sa téléologie, en un décollage sans fin, en l'idée même de progrès nous a fait beaucoup de mal en nous faisant espérer l'impossible et réaliser le pire: une immense décharge qui abrite une image, une seule image, une image pure, celle de l'Eden.
Jean Prod’hom
Réduction de l'art

S'affranchir de la morale qui fait si souvent de ceux qui bâtissent des amis des princes, ouvrir les arches aux emmurés de Lascaux aux crustacés, aux centaures, aux vertébrés, à ceux d'avant et à ceux d'après, aux domestiqués, aux chimères, aux sirènes, aux hommes, et révéler leurs secrets.
Viscères et carapaces, cartons et rebuts, débris de la vaisselle du monde, excroissances, tubulures, contenants, rien de ce dont nous sommes faits ne nous sera épargné. Le cheval, l'éléphant, l'autruche, la vache, la grenouille et les autres – en pièces – se dresseront comme au premier jour, c'est-à-dire une deuxième fois: en pièces et sur pied, locataires d'un quasi-monde qui obéit aux lois du nôtre, semblable au nôtre, semblable ou presque: la précarité, la gravitation qui règne sur les graves, le principe d'identité, le travail de l'ombre, les vertus, les dieux, l'existence des tables et des cuvettes, l'attente, la communication, la magie, le tiers exclu, l'incompréhension.
Dans la première mandorle, un éléphant avance tête baissée, bâti de mémoire, la tête dans le sac, bâti de bric, bâti de broc. Le cornac ne cesse de surveiller sa monture, la scène dure une éternité, tous les deux nous tournent le dos.
Dans la seconde Bernardo, il a beau faire face, il a beau nous regarder continûment, jour et nuit, il ne voit rien, pas plus qu'une bête ou une ombre. Bernardo est celui que nous sommes lorsque nous ne sommes rien, Bernardo est un oiseau blessé.
Pris dans ce qu'ils font et ce qu'ils sont, les hommes ignorent ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Forclos dans leur mandorle, ils s'offrent à nous, si bien que nous les voyons comme jamais nous ne nous sommes vus. Ils retrouvent un instant leur mystérieux quant-à-soi et témoignent depuis là-bas de ce que nous sommes ici et que nous ignorons.
Voici le monde et ses échafaudages, le monde qui est et le monde comme il s'est fait, le monde et sa représentation, de ce côté-ci et de ce côté-là, les choses et leur milieu, le voyageur et son ombre, la vache et l'oiseau blessé, l'autruche et le chant du coq à midi.
Les commanditaires, disons-le tout de suite, oeuvrent pour la plupart avec d'autres intentions que celles des commandités, minés par d'autres soucis, engagés dans d'autres labours, pris dans d'autres tourmentes que celles de l'esprit: dans la noble guerre de la concurrence.
Depuis plusieurs siècles, les artistes enchaînés à leur ego n'ont que rarement eu affaire avec les seconds concentrés sur leurs rapines, si bien que les uns et les autres, déliés pour le pire, après avoir choisi leurs sujets et leurs niches par exhaustion, se réfugient avec leurs emplettes, les artistes dans leur quartier, les commerciaux dans le leur.
Faire se rencontrer ceux qui s'excluent trop souvent, joindre ce qui se vend avec ce qui n'est que dépense, joindre ce dont la valeur se chiffre avec ce qui est hors de prix, serait-ce donc désormais possible? Ça l'a toujours été! ici et là aujourd'hui, autrefois à Sienne, à Pise, à Florence, dans la Toscane des beaux jours, ailleurs.
Les uns, en effet, n'auraient-ils pas tout intérêt à s'en remettre aux autres pour ne pas réduire les oeuvres des premiers à leur chiffre et celles des seconds à un numéro de catalogue? Les premiers n'auraient-ils pas quelqu'intérêt à abriter les seconds comme le corps qui abrite l'esprit, comme la grotte qui protège l'aurochs, comme le site que l'hôte explore? Quand aux seconds, en démontant et en remontant le monde qu'ils ont sous les yeux et qu'ils comprennent si mal, n'ont-ils pas la chance de toucher terre à nouveau et l'occasion de faire un peu de lumière. Fuir aussi et enfin ce qui se donne comme art, provocatoirement nul, en tant qu'il réverbère la nullité ambiante et l'entropie culturelle mondialisée (Michel Thévoz, Museums.ch, 3, 2008)?
Comment bon dieu vivrions-nous dans un monde qui n'abrite pas sa représentation et son sens?
Pour que le monde nous devienne accessible, il doit s'abymer, c'est la tâche des artistes, des parasites, des hôtes, les nobles hôtes, ceux qui ne demandent rien sinon la couche et le couvert. De leur côté les hommes qui vivent en société se doivent d'abriter ces êtres libres qui ne manqueront pas de leur révéler ce qu'ils sont en soulevant la couette sous laquelle ils se calfeutrent et s'assoupissent.
L'homme livre une image fantasmée de ce qu'il est: fondations de pierres dans des mains de fer, organisation du tonnerre de dieu, activités tous azimuts, chiffres à l'appui, santé par la croissance,... Démonter d'abord, s'installer ensuite dans ses meubles, remonter enfin des éléments de la bâtisse: les montagnes sont moins raides, moins coupantes, moins cassantes, moins solides les fondations, souples et de plumes. L'organisation du tonnerre de dieu est un bricolage d'artisans habiles.
Être d'habiles artisans, échafauder pas à pas – sans feindre un instant l'improvisation – une représentation de ce dans quoi l'homme est et qu'il ne veut ou ne peut voir, hypnotisé qu'il est par l'image délirante de ce que doit être le monde et ses actions dans le monde.
Le commanditaire accueillera le loup dans la bergerie pour que coexistent dans une seule représentation ce que les commanditaires croient voir et ce qu'ils sont incapables d'observer, Au sérieux des images lisses, solides, fantasmées répondent les échafaudages de l'édifice, la légèreté des fondations, la précarité des équilibres.
Seule une confiance aveugle du commanditaire envers le commandité peut lui amener cette plus-value spirituelle dont il a besoin pour se mettre en mouvement et disposer d'un avenir. C'est à la gloire du commanditaire que d'accepter auprès de lui, sans contrepartie, celui qui abyme le monde. Ensemble les commanditaires et les commandités, le roi et le bouffon, l'organisme et le parasite, l'hôte et son hôte, ensemble mais sans concertation, sans négociation. Les commandités n'ont pas à justifier leurs propres actes ni à illustrer et défendre les bonnes intentions des princes.
On aperçoit dans une mandorle la représentation en pièces et sur pied d'un aurochs, un mot aussi, à peine lisible, quelque chose comme un aphorisme calligraphié sur un mur délabré d'une maison à l'abandon: Qui n'a pas vu double n'a rien vu. Nulle explication nulle mention. Tant mieux!
Ni les uns ni les autres n'auront le dernier mot.
Jean Prod’hom
Histoire de l'art 6

Mode Depesche, la compagnie Elca, Sleek magazine, fanzine Sonntagsfreuden, Local Studies,... on ne saurait terminer avec Geoffrey Cottenceau et Romain Rousset sans évoquer les entreprises avec lequelles ils travaillent, sans mentionner les commanditaires auxquels ils sont liés pour le meilleur. Des commanditaires, disons-le tout de suite, qui oeuvrent pour la plupart avec d'autres intentions que celles des commandités, minés par d'autres soucis, engagés dans d'autres labours, pris dans d'autres tourmentes que celles de l'esprit: dans la noble guerre de la concurrence.
Depuis plusieurs siècles, les artistes enchaînés à leur ego n'ont que rarement eu affaire avec les seconds concentrés sur leurs rapines, si bien que les uns et les autres, déliés pour le pire, après avoir choisi leurs sujets et leurs niches par exhaustion, se réfugient avec leurs emplettes, les artistes dans leur quartier, les commerciaux dans le leur.
Faire se rencontrer ceux qui s'excluent trop souvent, joindre ce qui se vend avec ce qui n'est que dépense, joindre ce dont la valeur se chiffre avec ce qui est hors de prix, serait-ce donc désormais possible? Ça l'a toujours été! ici et là aujourd'hui, autrefois à Sienne, à Pise, à Florence, dans la Toscane des beaux jours, ailleurs.
Les uns, en effet, n'auraient-ils pas tout intérêt à s'en remettre aux autres pour ne pas réduire les oeuvres des premiers à leur chiffre et celles des seconds à un numéro de catalogue? Les premiers n'auraient-ils pas quelqu'intérêt à abriter les seconds comme le corps qui abrite l'esprit, comme la grotte qui protège l'aurochs, comme le site que l'hôte explore? Quand aux seconds, en démontant et en remontant le monde qu'ils ont sous les yeux et qu'ils comprennent si mal, n'ont-ils pas la chance de toucher terre à nouveau et l'occasion de faire un peu de lumière. Fuir aussi et enfin ce qui se donne comme art, provocatoirement nul, en tant qu'il réverbère la nullité ambiante et l'entropie culturelle mondialisée (Michel Thévoz, Museums.ch, 3, 2008)?
Comment bon dieu vivrions-nous dans un monde qui n'abrite pas sa représentation et son sens?
Pour que le monde nous devienne accessible, il doit s'abymer, c'est la tâche de ses hôtes. Et Geoffrey Cottenceau et Romain Rousset sont de cette espèce, de nobles hôtes qui ne demandent rien sinon la couche et le couvert. De leur côté les entreprises qui veulent fructifier se doivent d'abriter ces êtres libres qui ne manqueront pas de leur révéler ce qu'elles sont en soulevant la couette sous laquelle elles se calfeutrent et s'assoupissent.
La contribution de Geoffrey Cottenceau et Romain Rousset au Rapport annuel 2007 d'ELCA – une société informatique de services – applique à la lettre ce programme. Lorsque cette société leur ouvre les portes, c'est avec une image fantasmée de l'entreprise qu'ils ont affaire: fondations de pierres dans des mains de fer, organisation du tonnerre de dieu, activités tous azimuts, chiffres à l'appui, santé par la croissance,... Ils démontent d'abord, s'installent ensuite dans leurs meubles, remontent enfin des éléments de la bâtisse: les montagnes sont moins raides, moins coupantes, moins cassantes, moins solides les fondations, souples et de plumes. L'organisation du tonnerre de dieu est un bricolage d'artisans habiles.
Geoffrey Cottenceau et Romain Rousset sont eux aussi d'habiles artisans, ils échafaudent pas à pas – sans feindre un instant l'improvisation – une représentation de ce que ni les entrepreneurs ni leurs clients ne veulent ou peuvent voir, hypnotisés qu'ils sont par l'image délirante de ce que doit être le monde et leurs actions dans le monde.
C'est dire que le commanditaire accueille le loup dans la bergerie. Coexistent désormais dans une seule représentation ce que les commanditaires croient voir et ce qu'ils sont incapables d'observer, Au sérieux des images lisses, solides, fantasmées répondent les échafaudages de l'édifice, la légèreté des fondations, la précarité des équilibres.
Seule une confiance aveugle du commanditaire envers le commandité peut lui amener cette plus-value spirituelle dont il a besoin pour se mettre en mouvement et disposer d'un avenir. C'est à la gloire du commanditaire que d'accepter auprès de lui, sans contrepartie, celui qui abyme le monde. Ensemble les commanditaires et les commandités, le roi et le bouffon, l'organisme et le parasite, l'hôte et son hôte, ensemble mais sans concertation, sans négociation. Les commandités n'ont pas à justifier leurs propres actes ni à illustrer et défendre les bonnes intentions des princes.
On aperçoit dans une mandorle la représentation en pièces et sur pied d'un aurochs, un mot aussi, à peine lisible, quelque chose comme un aphorisme calligraphié sur un mur délabré d'une maison à l'abandon: Qui n'a pas vu double n'a rien vu. Nulle explication nulle mention. Tant mieux!
Ni les uns ni les autres n'auront le dernier mot.
Jean Prod’hom
Histoire de l'art 5

Affranchis de la morale qui fait si souvent de ceux qui bâtissent des amis des princes, Geoffrey Cottenceau et Romain Rousset ont ouvert leurs arches aux emmurés de Lascaux aux crustacés, aux centaures, aux vertébrés, à ceux d'avant et à ceux d'après, aux domestiqués, aux chimères, aux sirènes, aux hommes, et révélé leurs secrets.
Leur bestiaire dérange d'abord, viscères et carapaces, cartons et rebuts, débris de la vaisselle du monde, excroissances, tubulures, contenants, rien de ce dont nous sommes faits ne nous est épargné. Puis le cheval, l'éléphant, l'autruche, la vache, la grenouille et les autres – en pièces – se dressent comme au premier jour, c'est-à-dire une deuxième fois: en pièces et sur pied, locataires d'un quasi-monde qui obéit aux lois du nôtre, semblable au nôtre, semblable ou presque: la précarité, la gravitation qui règne sur les graves, le principe d'identité, le travail de l'ombre, les vertus, les dieux, l'existence des tables et des cuvettes, l'attente, la communication, la magie, le tiers exclu, l'incompréhension.
Un éléphant avance tête baissée, bâti de mémoire, la tête dans le sac, bâti de bric, bâti de broc. Le cornac ne cesse de surveiller sa monture, la scène dure, tous les deux nous tournent le dos.
Bernardo de son côté a beau faire face, il a beau nous regarder continûment, jour et nuit, il ne voit rien, pas plus qu'une bête ou une ombre. Bernardo est celui que nous sommes lorsque nous ne sommes rien, Bernardo est un oiseau blessé.
Le cornac et sa monture, le cavalier et la sienne, Bill & Co, Jeannette et Igor, tous les autres, pris dans ce qu'ils font et ce qu'ils sont, ignorent ce qu'ils font et ce qu'ils sont comme nous ignorons ce que nous sommes et ce que nous faisons. Forclos dans leur mandorle, ils s'offrent à nous, si bien que nous les voyons comme jamais nous ne nous sommes vus. Ils retrouvent un instant leur mystérieux quant-à-soi et témoignent depuis là-bas de ce que nous sommes ici et que nous ignorons.
Voici le monde et ses échafaudages, le monde qui est et le monde comme il s'est fait, le monde et sa représentation, de ce côté-ci et de ce côté-là, les choses et leur milieu, le voyageur et son ombre, Romain et le cornac, Geoffrey et Bernardo, la vache et l'oiseau blessé, l'autruche et le chant du coq à midi.
Jean Prod’hom
Histoire de l'art 4

Il fallait faire voir à nouveau les aurochs, les chevaux, les licornes et les cerfs, relégués deux fois dans la nuit de Lascaux par des hommes devenus aveugles. C'est à cette tâche que se sont attelés Geoffrey Cottenceau et Romain Rousset.
Enfant, je croyais que l'édification de la cathédrale de Lausanne n'était pas achevée et que le maître d'oeuvre des travaux en cours était un certain Monsieur Belet. Je l'ai cru jusqu'à ce qu'on m'apprenne que le nom de Belet, écrit en lettres jaunes et capitales sur de larges pancartes bleues fixées à des tubulures d'argent, désignait en réalité une entreprise d'échafaudages sur lesquels des tailleurs de pierres sciaient des blocs de molasse frais pour les substituer aux blocs de molasse mités. Les travaux ont duré plus de 20 ans. Je sais aujourd'hui que l'enfant que j'étais avait vu juste: nos cathédrales sont vivantes.
Pour exciter l'étonnement, il faut enlever les échafaudages lorsque la maison est construite conseillait Nietzsche en 1878 à ceux qui bâtissent (Le Voyageur et son ombre, §335). Il poursuit:
Le parfait est censé ne s'être pas fait. – Nous sommes habitués, en face de toute chose parfaite, à ne pas poser le problème de sa formation: mais à jouir du présent, comme s'il avait surgi du sol par un coup de magie. Vraisemblablement, nous sommes là encore sous l'influence d'un antique sentiment mythologique. Nous subissons presque encore la même impression (par exemple devant un temple grec comme celui de Paestum) que si un beau matin, un dieu avait, en se jouant, bâti sa demeure de ces blocs énormes: ou plutôt, que si une âme avait soudain pénétré par enchantement dans une pierre et voulait maintenant parler par son entreprise. L'artiste sait que son oeuvre n'aura son plein effet que si elle éveille la croyance à une improvisation, à une miraculeuse soudaineté de production, et ainsi l'aide volontiers à cette illusion et introduit dans l'art ces éléments d'inquétude enthousiaste, de désordre aux tâtonnements d'aveugle, de rêve qui cesse au commencement de la création, comme un moyen de tromper, pour disposer l'âme du spectateur ou de l'auditeur en sorte qu'elle croie au jaillissement soudain du parfait. La science de l'art doit, comme il s'entend de soi, contredire de la façon la plus expresse cette illusion, et démontrer les conclusions erronées et les mauvaises habitudes de l'intelligence, grâce auxquelles elle tombe dans les filets de l'artiste (Humain trop humain, §145).
A l'époque de la peinture pariétale, balayait-on tous les soirs à 17 heures les sols peu pratiques de Lascaux? Ravalait-on tous les dix ans ses murs? Lascaux est un chantier sans fin comme le monde une création continuée. On n'aurait jamais dû fermer Lascaux!
Nietzsche ajoute:
En outre: tout ce qui est fini, parfait excite l'étonnement, tout ce qui est en train de se faire est déprécié. Or personne ne peut voir dans l'oeuvre de l'artiste comment elle s'est faite; c'est son avantage, car partout où l'on peut assister à la formation, on est un peu refroidi. L'art achevé de l'expression écarte toute idée de devenir; il s'impose tyranniquement comme une perfection actuelle. Voilà pourquoi ce sont surtout les artistes de l'expression qui passent pour géniaux, et non les hommes de sciences. En réalité cette appréciation et cette dépréciation ne sont qu'un enfantillage de la raison (Humain trop humain, §162).
Nietzsche ouvre, avec d'autres, une autre époque de l'art.
Jean Prod’hom
Histoire de l'art 3

A qui s'adresse l'homme lorsque il lève les paupières? Je n'aperçois aucun mouvement sur ses lèvres et pourtant, je le sais et je m'en souviens, il n'est pas seul.
Personne n'a décrit à ma connaissance la nature étrange du discours que les hommes tiennent à l'aube. La nature de ce discours ne s'y prête pas, il s'interrompt et part en fumée à l'instant même où l'on tente de le passer au feu du langage, sa teneur demeure insaisissables, en deça de toute articulation linguistique. Situer sa source et sa destination est au-delà de notre raison puisque l'une et l'autre, séparées par trois fois rien – à peine une césure, moins qu'un respiration – se confondent.
Chaque matin au réveil, avant de rejoindre la communauté de ceux qui parlent, nous nous arrachons au gouffre insensé de l'immédiat pour assurer notre survie en installant dans et par un rituel fruste la matrice essentielle de nos échanges prochains. Je ne sais rien des origines de ce qui se présente comme une double voix, à peine perceptible, je la sais aux sources de ma représentation du monde.
A l'aube, l'un souffle – dedans ou dehors je ne le sais – quelque chose comme une bouffée de sens. Avant même que celle-ci ne se dépose ou se mêle à ce qui l'entoure, l'autre qui m'habite lance une seconde bouffée. Toutes deux ne tardent pas à s'enchevêtrer pour laisser place à une troisième. Les bouffées se succèdent à une cadence qui surprend. C'est ainsi que l'on s'installe aux lisières du jour.
Le sens prend au commencement l'allure du delta du Pô, mille voies d'eau issues d'une même source pour la naissance d'un lac immobile. Le monde surgit là, à peine monde, visage peut-être, creusé par le chant d'une double voix. Survient l'autre, né comme moi dans un delta, tout s'arrête, les cloches sonnent, c'est la fin des laudes, les rôles sont répartis, on distribue les tours et les gains. Nous entrons dans le temps partagé du monde, chacun son tour, toi puis moi.
Comment saisir le monde qui se lève sans lever les paupières avant lui et souffler les braises de la nuit? Demain à l'aurore, à nouveau l'un et l'autre, rappelé par le chant du coq au milieu du chemin, ils peindront les aurochs, les chevaux, les licornes et les cerfs qui ont fui Lascaux.
Jean Prod’hom
Histoire de l'art 2

Aurochs, chevaux, licornes, cerfs,... relégués deux fois dans la nuit de Lascaux.
"Que meure avec moi le mystère qui est écrit sur la peau des tigres" confie Tzinacán, le mage de la pyramide de Qaholom à José Luis Borges, après de longues années passées dans les ténèbres d'une prison à apprendre l'ordre et la disposition des taches du félin.
Et là-haut, mille oiseaux en formation qui fendent le ciel, ils ne voient ni leurs ailes ni le coin qui s'enfonce dans les nuages. Eux, le jour, la nuit c'est tout un. Il a été donné à l'homme seul de distinguer l'eau, le ciel et la terre, sans qu'il n'en récolte autre chose que des peines et le regret continu de n'être né ni oiseau ni tigre ni aurochs.
Lorsqu'il voit double, l'animal perd la faible raison qui le conduit tout au long de sa vie, sans jamais accéder à une vision d'un type supérieur, il est vraisemblablement ivre. La double fermentation du vin n'offre pas la double vue, il n'en va pas autrement pour l'homme.
Celui qui a pleuré à l'aube lorsqu'il a vu un passereau blessé au bord du talus, près du coquelicot, celui qui a levé ses yeux égarés, à midi, lorsque le chant du coq déchire la campagne déserte et rappelle l'homme à son destin, se promettent d'y voir plus clair un jour et de faire la lumière sur ce qui est. Se succèdent silencieux les matins et le bonheur tremblant de l'immédiat.
Qui n'a pas vu double n'a rien vu, mais qui est assuré d'avoir vu double? Le sens des aphorismes calligraphiés sur les murs des maisons à l'abandon reprennent vie chaque matin. On peut demeurer engoncé toute une vie dans l'immédiat avec le sentiment pourtant d'avoir vu double.
Le monde naît d'une berlüe, celle de l'avoir vu double, d'abord de ce côté-ci ensuite de ce côté-là. Deux mondes ou deux ombres. Ne le contrarie pas! S'il perd son unité, s'il perd un peu de la lumière, de la hauteur et de la profondeur que l'homme lui prête pour mieux s'en débarrasser, il retrouve le silence d'où il provient, un silence qu'il te demande non seulement d'accepter mais dont tu devras témoigner. Si tu le veux vivant, ne tente pas de réunir le monde que tu as vu double, laisse le silence faire son oeuvre, c'est à lui que revient la tâche de sertir ce qui est séparé et de lui offrir un instant l'apparence de l'unité. Sommes-nous encore dans la clairière ou déjà dans le bois? Les choses perdent leur contour, les lisières se troublent, il est temps d'à peine faufiler le bois avec la clairière. Les grands travaux peuvent commencer, le temps et les moyens nous sont comptés.
Jean Prod’hom
Histoire de l'art 1

A peine lisible, quelque chose comme un aphorisme calligraphié, il y a longtemps déjà, sur un mur délabré d'une maison à l'abandon: Qui n'a pas vu double n'a rien vu. Nulle explication nulle mention. Tant mieux!
A l'instant même où nous cessons d'être l'auteur de ce que nous avons écrit, où nous nous dégageons, à peine un instant, de ce que nous avons fait, à l'instant même où nous cessons d'en être le dépositaire, nous commençons à voir double: les choses enfouies naguère dans les plis de la conscience immédiate s'installent à mi-chemin de ce que nous étions et de ce que nous serons, au milieu.
Les choses dites, peintes, écrites, les choses représentées retrouvent un instant leur mystérieux quant-à-soi et le monde, à nouveau habité par des réalités qu'un autre nommera à son tour, s'élargit. Il y a place désormais pour un avenir de l'art.
Jean Prod’hom


