Suis né dans le ventre d’une langue

Concerto pour piano et orchestre No. 5 in F mineur, BWV 1056: II. Largo
Johann Sebastian Bach
Columbia Symphony
Glenn Gould

Suis né dans le ventre d’une langue. Ne me souviens de rien, ni de l’instant ni du passage de celui de ma mère à ce ventre-là, rien. Je regarde par la fenêtre de la bibliothèque défiler le paysage, ce à côté de quoi j’ai passé en coup de vent ce matin-là.
Dans ce ventre-là, quelqu’un a crié la petite enfance, bégayé l’adolescence, parlé, parlé. Parlé avant qu’une voix venue de je ne sais où, l’oblige à se taire. Je suis allé visiter alors les recoins des langues mortes qui sont comme des portes entrouvertes sur nos négligences, je lève la tête aujourd’hui et regarde par la fenêtre le vieux verger qui jamais ne m’a fait faux bond.
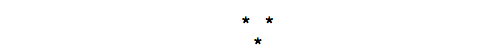
Ne suis jamais parvenu à m’installer dans une autre langue, me suis attardé dans la mienne, pour ne pas la trahir peut-être, ou ne pas l’oublier. Je suis resté en arrière, dans ce coin de pays, inquiet à l’idée de me retrouver loin de chez moi sans passe-partout, pierre lourde dans l’ombre de celui ou celle que j’aurais accompagné et du pays qui m’aurait accueilli, un goût d’assisté sous le palais, les épaules dociles de l’enfant sage qui aurait voulu rentrer à la maison.
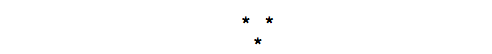
Les rares fois où je me suis aventuré loin d’ici, chez eux, c’est dans ma langue qu’ils m’ont accueilli à leur table, chez moi chez eux, avec le sentiment désagréable d’occuper leur maison. Si bien que je n’ai guère voyagé, franchi aucun océan. Quelques fleuves, le Tage près de Cascais, le Tibre à Ostie, la Trave à Lübeck, le Danube à Vienne. C’est tout, tandis que d’autres bivouaquaient sur les terres de l’Anglais ou de l’Espagnol, jonglaient avec le suédois et le portugais, allaient et venaient comme des pendulaires sur le tablier d’un pont polyglotte, dans des mondes qui se croisent mais ne se touchent pas.
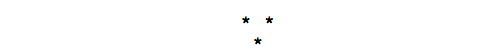
Alors je reste, rêve, me contente d’un jardin étroit, des bois de hêtres et de sapins, des voix qu’on y entend. Y marche en ne m’éloignant que peu, ou à une vitesse qui me permet de ne rien brusquer et d’accéder mine de rien à une autre langue, celle de mon voisin, de proche en proche, sans heurt. L’histoire qu’on raconte à propos de Friedrich Heinze de Rendsburg, je l’ai faite mienne.
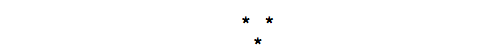
De n’avoir jamais disposé d’une langue autre que celle dans laquelle je suis né m’y a retenu, corps-langue dans laquelle je me suis enfoncé, perdu et reperdu avant de pouvoir sortir la tête, non pas par les côtés mais par l’autre bout, en passant par les fonds.
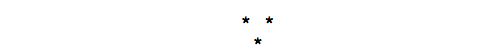
Ne pas dételer avant que ça se desserre, en n’usant que d’une seule main, par secousses et mouvements du poignet, car manque l’autre langue, celle qui m’aurait permis de sectionner ou dénouer les noeuds de la première. Avec, main droite, la gauche qui fouille le ventre de la terre. Marcher aussi longtemps que le silence qui pousse dessous la langue et les choses ne leur a pas permis de mêler leurs eaux. Je voudrais les faire entendre tous les trois, mais souvent l’un d’eux manque.
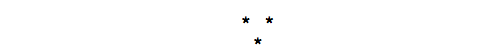
Je veux sortir du ventre de ma langue, livre bataille avec de l’encre et un bambou, par les fonds où scintille ce qui nous fait vivre et sur lequel sont nées les architectures de nos langues.
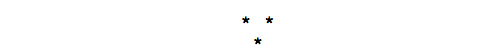
Disposer d’une autre langue m’aurait permis de faire halte, reprendre un peu d’air, trouver des appuis et des relais, avoir quelque chose à quoi m’accrocher. Au lieu de cela j’ai dû faire de ma propre langue une autre langue, suis devenu celui qui écrit et celui qui lit, poussant la ligne d’horizon aussi loin qu’il se peut, jusqu’à espérer toucher à l’ensemble simple et transparent de ce qui est, la mer et ses vaisseaux, le nom et le verbe, les maigres moyens de la langue, les prépositions qui racontent notre intimité et la négation notre insuffisance, le jeu des surbordinations et des connexions, quelques enclaves, guère plus.
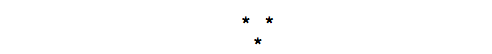
Aiguiser les bords de la langue, la court-circuiter, réveiller ses morts, la tordre délicatement et dégager l’escalier à vis par où nous parvient l’écho de son mystère.
Le pont n’est qu’un raccourci. Et la vitesse ne nous aide pas en la matière Nous avançons sans bien savoir, faisons de la lumière avec de la nuit dans la nuit, comme la taupe : s’enfoncer, ressortir et replonger, ouvrir une voie, travailler une passe en évitant tout coup d’état.
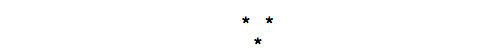
Deux langues dans la même langue, celle qui vous porte et vous emporte, celle sur laquelle la première se penche. Avant qu’elles n’échangent leur place, sans jamais pourtant savoir sur le dos de laquelle celui qui est voyage ou demeure.
Un peu d’eau et un rais de lumière suffisent à lever le linceul qui recouvre le monde. Il respire, je devine ce à côté de quoi j’ai passé au jour de ma naissance, en coup de vent, sans être en mesure de le retenir, là où je retournerai, sans me retourner, dans le ventre mou de la terre.
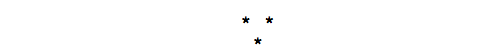
La même langue deux fois, sans quoi personne n’aurait peint d’aurochs dans la grotte Chauvet, n’aurait mis du bleu dessous le ciel, ou suivi du bout des doigts le milan qui tourne, tourne tourne, immobile au-dessus du vieux verger.
Jean Prod’hom

Publié le 5 novembre 2014 dans le cadre du projet des vases communicants chez Justine Neubach (Silencieuse.net)
"Que signifie ce nuage ?" | Justine Neubach

Il n’y a rien, dans ma mémoire, qui précède le français. Le français est à ma racine. Il est l’emporte-pièce qui a tranché ma pâte à monde. Il a fondé mon décor. « Je » m’est devenu une seconde peau, « tu » s’est modelé à l’Autre, et entre ces pôles, progressivement, des mots de plus en plus nombreux ont mis le réel en morceaux.
Le français a été, pour longtemps, ma lucarne – la seule. Soit j'acceptais de regarder français, soit il fallait fermer les yeux. Aucune alternative, sinon une façon enfantine de chantonner sans mots, en enchaînant au hasard des sons que les adultes taxaient de « charabia » tout en me mettant à l'écart. Tenter de s'échapper de la reine langue française, c'était aussi cela : tomber en charabia, risquer de n'être plus prise au sérieux, à peine entendue.
Très tôt, ainsi, je me suis résolue à classer le non-français au rayon des bruissements du monde. Le russe y côtoyait le frisson des herbes sous la brise, l’anglais était tout proche d’un gloussement de ruisseau, d’autres langues sifflaient, chuintaient, couinaient, chantaient ; certaines auraient pu être des langues de prairies ; d’autres, des voix pour l’explosion ; il y avait des langues qui s’écoutaient comme la mer dans un coquillage et d’autres, proches, rêches, gutturales, langues remontées des mines, les visages noircis, le regard luisant.
Toute langue étrangère participait d'un univers crypté, aux prises avec l'émotion – univers qu'il convenait de ne pas trop interroger. Il ne fallait pas demander « que veut dire jak ten czas leci ? » ; ce m’eût été l’équivalent d’un « que signifie ce nuage ? »
Plus âgée, par la force des choses, j’ai appris l’anglais. J’y ai travaillé à regret, comme on se jette à la rue par grand froid. Les cours d’anglais m’étaient dépourvus d’abris. Parcourus d’ombres. J’apprenais brutalement qu’il y a dans l’anglais quelque chose de plus qu’un ruisseau qui rit. Des phrases gonflées d’un sens qu’elles refusaient de me livrer dansaient devant mes yeux. La Langue Etrangère s’était détachée du continent des bruits. Elle devenait énigme, clef des regards complices qui s’échangeaient autour de moi sans que je ne sache à quel sujet. Elle me barrait la route avec une sévérité de porte celée.
Et puis il y a ces craintes qui nous viennent, enfant, quand on n'a pas encore touché à d'autres langues et que soudain, l’anglais passe nos lèvres. « Peut-on oublier le français ? » – « Qui je suis quand I am ? »
J’eus d’abord peur de cette langue. Peur de ne pas la savoir et peur de la savoir. Peur de ce qu’elle m’avait toujours caché – intonations, expressions, perspectives – et peur de me perdre en la découvrant.
Lentement, la peur a cédé. Ce sont des gens que l’on rencontre. Ce sont d’autres langues que l’anglais qui entrent en jeu, consolatrices. L’allemand par exemple. Le besoin de savoir l’allemand pour lire de la philosophie. Puis l’envie de connaître une autre poésie, allemande. L’apprentissage émerveillé. Les insuffisances du je suis révélées par l’ich bin.
Alors j’ai ouvert la lucarne. J’ai posé un pied hors de France.
Dehors, le monde est fou. Il fait mine de se plier docilement aux exigences de chaque langue. Il se comporte comme une eau fuyante à laquelle on tenterait d’assigner une forme en la faisant passer de récipient en récipient. Mais sa forme, la vraie, qui la connaît ? Pourquoi devrait-il en avoir ?
Celui qui aime les langues le sait : passer de l’une à l’autre, c’est tout à coup se renverser pour marcher sur les mains. Du français à l’anglais, ma voix change, ma posture subjective aussi, mon rapport à l’action.
Juger qu’il faut savoir une autre langue que la maternelle pour avoir doublement prise sur le monde est une erreur, je crois. La langue agit à un niveau tout autre. On se sent travaillé intimement par elle. Au départ, la langue doit être une nécessité. Ensuite, elle devient ce qu’on veut : outil d’analyse, poésie, cri salvateur, vraiment n’importe quoi. Mais pas la vérité. Car la langue est d’une insouciance… Elle passe en sifflotant à côté des « vérités vraies ».
Justine Neubach
Justine Neubach fait entendre sur l’internet une voix singulière et exigeante. Je suis heureux qu’elle ait accepté de rejoindre lesmarges.net et de m’accueillir chez elle, sur son site Silencieuse.net, : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.
Et les autres vases communicants de ce mois de décembre, c’est ici.
Merci à Angèle Casanova et à Brigitte Célérier pour la gestion de cette belle entreprise.
On n’en sort pas

On n’en sort pas, le réel est hors d’atteinte, inutile de vouloir trop s’en approcher. Ni espérer pouvoir s’en extraire. Être bien accompagné et accompagner, c’est ce qu’on peut faire de mieux.
Lorsqu’il fait soleil et que la neige demeure sur les flancs de Brenleire et Folliéran, je fais halte dans la véranda où trois chaises entourent une table ronde, y suis à cette occasion pas loin de moi-même. Ce compagnonnage dure une petite heure et c’est bon. On se réconcilie, on parle un peu, en ne bougeant les lèvres qu’à peine, tandis qu’une guêpe ou un bourdon s’acharne contre la vitre. Celui qui est en moi lâche un peu de sa surveillance, je veille de mon côté à ne pas m’enflammer à son insu, on se modère. Il me tance une dernière fois, pour rire, avant de laisser la bride sur mon cou. On s’abandonne les mains croisées, le dedans et le dehors se serrent la main.
Aucune ombre, les écharpes d’inquiétude qui s’accrochaient à mes talons traînent sur le carrelage de la cuisine et l’hiver qui s’est levé cette nuit fait son oeuvre sur les sommets enneigés. Me voici coupé du dedans et à l’abri du dehors, désorienté, sans rien à faire d’autre que tendre l’oreille et fermer les yeux, comme les paysans d’hier qui prenaient un peu de bon temps sous le couvert de la mécanique à l’arrivée des mauvais jours : les champs étaient labourés, les pommes de terre rentrées, la bise pas encore levée.
Les lauriers sont à l’abri, des feuilles multicolores jonchent la plate-bande, l’orange des roses jauni d’or. Le soleil entre à l'horizontale, pas de travail en vue, il y a bien assez à faire tous les deux réunis. Faire se rapprocher nos deux voix de soi-même jusqu’à ce qu’elles ne s’étonnent plus l’une de l’autre, se confondent. Silence. Il n’y a en réalité pas grand chose, un phrasé ponctué de simples, je devine une danse immobile et transparente. Pas surpris de ma présence. Si nous ne nous perdons pas de temps en temps l’un dans l’autre, nous sommes perdus.
Derrière les vitres piquées par le mauvais temps, les événements qui se succédaient au pas de charge s’enlisent. On reste tous les deux en arrière avec un panier de pommes cueillies tout à l’heure, une tèche de bois, une jardinière. Il y a vraiment de belles prisons. Le silence descend l’échelle et nous soulève, le peu que je suis encore se défait et devient toujours moins, jusqu’à disparaître, vide et sans horloge. Ne pas bouger, le moindre geste détruirait tout.
Peut-on dire autre chose que ce qu'on sait obscurément. Écrire dépasse de beaucoup ce qu'on est, sans qu'on soit capable jamais de mettre la main dessus. Mais il nous tire, rend meilleur, purifie ce qui reste en retrait, nous aide à trouver l’invisible axe de notre être au monde.
De là où tu es, vois-tu ce dont je te parle, de ce détour à l'occasion duquel on se perd au plus lointain de ce qui est, de cet asile que je caresse parfois du bout des doigts, à deux pas d’une mélancolie qu’il me faut bien concéder au moment de quitter les lieux. Mais rejoindre le train du monde ne constitue plus une défaite.
Nous vivons dans une boîte transparente où rien n’entre ni ne sort, mais où chaque chose fleurit, lentement, chacune pour soi au midi des autres. On n’en sort pas et j’y retournerai.
Jean Prod’hom

Publié le 1 novembre 2013 dans le cadre du projet de vases communicants chez Virginie Gautier (Carnet des Départs)
Le réel est hors d’atteinte | Virginie Gautier

Le réel est hors d’atteinte, n’aura jamais la précision d’une miniature.
Petite image d’enfance. Garder le vague, fermer la main. Déployer des sortes d’antennes.
Voir à peine.
Une vague fantôme déferle. J’aperçois au travers la lumière du soleil et quantité de bulles. Elles me remontent dans le corps. Elles me remontent dans la bouche. Je vais parler par l’eau qui monte, moi que le réel submerge. Sur les Amers, les Brisants, parler par l’eau. Dans l’ourlet de la vague, en flots. Dans l’écume.
(si je flottais dans ses rouleaux les cheveux comme une algue le corps noyé alors je serais le réel hors d’atteinte)
Tout est allongement.
Je recule d’un pas, de deux puis trois. J’attends entre les grunes à marée descendue que la mer me revienne plus douce. Je pêche mes mots près d’une barque. Près d’une barque je pêche le réel hors d’atteinte, je ne remonte rien, reviens seulement avec l’odeur de l’eau.
(vaguement vaseuse)
L’hypnotique ressassement du réel hors d’atteinte. Je reste dehors avec ma miniature. Petite image d’enfance faite de couleurs fines dissoutes dans le songe. Une vague fantôme déferle. Je parle avec la mer. Je la tiens à distance.
Virginie Gautier

« Qu’on y oeuvre par le milieu », c’est à Virginie Gautier que je le dois. Où qu’on soit. Insoumissions, intérieurs, extérieurs ou miniatures, côté cour ou côté jardin. Ouvrez son Carnet des Départs.
Je la remercie ici de m’accueillir là-bas, dans le cadre du projet des vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre. Et d’autres vases communicants ce mois-ci, inventoriés là. Un grand merci à Brigitte Célérier.
Cette route sur la carte il n’y avait rien au-delà

Chaque communauté du canton de Vaud a dessiné sur son territoire, dès 1812, un espace clos et fermé pour enterrer ses morts à respectable distance des habitations. Tandis que les villages et les campagnes se métamorphosaient tout au long des XIXe et XXe siècles, les cimetières ont été l’un des points fixes des communautés. Ces constructions d’un séjour pour les morts au voisinage des vivants ne me lassent pas et m’invitent à me pencher, comme un primitif, sur mes rapports avec la mort, en-deçà de mes croyances et de mes voeux seconds, à même les manières de vivre et les silences des anciens auxquels chacun obéit qu’il le veuille ou non en marchant. Au notaire qui assure l’ordonnance des successions et des partages, j’ai voulu conter ici une ou deux choses habitées par une temporalité qui ne se partage pas en minutes.
On dit que la mort n’en fait qu’à sa tête, façon de dire, la mort c’est d’abord un coup de tonnerre de l’autre côté du langage, un éclair sur lequel l’imagination bute. A vrai dire, mort ne veut pas dire grand chose, les morts si, ils constituent l’avant-garde des vivants et font écran à l’inconcevable. Que ferions-nous sans eux ? Les morts sont les alliés des vivants contre la mort, celle-ci est intraitable, mais il est possible de s’arranger avec ceux-là. Inutile de les interroger là-dessus, ils ne répondront pas. Les vivants qui ont signé les premiers traités sont nos ancêtres, on les rejoindra sous peu, c’est avec nous que ceux qui viendront ensuite auront alors à traiter.
On peut entrer dans un cimetière mais il est impossible d’aller au-delà, il n’y a pas d’au-delà du cimetière. C’est comme un seuil, un pas de plus et on n’en reviendrait pas. Les cimetières sont de véritables forts qui nous gardent du noir de l’outre-tombe.
C’est dire que les morts sont du côté des vivants. On vit avec la mort mais ce sont nos morts qui nous la rappellent. Impossible de la déloger du monde des vivants, mais impossible de la laisser faire à sa tête. Le cimetière est le lieu des morts placés-là pour montrer du doigt ce qui n’a pas de nom, au-delà duquel il n’y a précisément rien. Le cimetière indique le lieu au-delà duquel il ne convient pas de s’aventurer. Tout simplement parce que l’au-delà se définit par cette impossibilité-là.
Le cimetière est un un incident topologique dans lequel les morts font les morts. S’ils n’étaient pas là ils seraient ailleurs. Salutaire qu’ils ne prennent pas toute la place, interdit d’en sortir. Supposons un instant le retour d’un mort, bien mort, personne n’en veut, n’est-ce pas ? Disons d’emblée qu’un mort qui reviendrait n’est pas un mort, un mort ça ne revient pas.
Il ne faut pas se méprendre, le cimetière n’est pas un amer indiquant un danger. De danger il n’y a pas, rien dans les fosses ou si peu, personne n’est dupe. Le cimetière est une bouée à laquelle les vivants s’amarrent, reliée par un filin à un corps-mort, le chemin du cimetière est cette amarre. La communauté est attachée au séjour des morts comme à un corps-mort, empêchant qu’elle s’abandonne au vent et se perde au large. Le chemin qui mène au cimetière et qui en revient est le canal qui maintient tendu le dialogue des vivants et des morts. C’est en conduisant les morts au cimetière qu’il se retend et qu’on s’assure de sa solidité.
Chez les morts ça bouge mais bien moins que sur la mer, ça bouge à cause du roulement et des désaffectations partielles qui évitent une croissance démographique incontrôlable des morts. C’est dire que les morts meurent une seconde fois lorsqu’ils rejoignent la communauté des ancêtres qui n’ont plus de nom. A la communauté des vivants répond donc celles des anciens, bien plus nombreux que les vivants. On aurait pu faire avec un plus petit espace encore, mais il en faut un pour abriter le laboratoire de nos alchimies. Sans l’alchimie que les vivants font subir aux morts, on ne survivrait pas, tout serait confusion. Mourir n’est pas exclusivement l’affaire des morts, c’est aussi l’affaire des vivants, les mort l’ignorent, mais nous savons-nous que nous sommes vivants ?
La vieille était assise sur le banc, je la connaissais bien depuis qu’on se croisait sur le chemin des Tailles et qu’on s’entretenait de choses et d’autres. Ce jour-là elle m’avait parlé du cimetière près duquel nous étions, de la mort qui la guettait et de ceux qu’elle allait bientôt rejoindre. Elle avait vécu toute sa vie à Pra Massin au Cachet-dessus. Je l’avais écoutée avec attention, elle parlait lentement avec du silence tout autour. Ce jour-là, j’ai mieux compris pourquoi il convenait de faire une place aux morts. Sitôt rentré j’ai rédigé quelques notes, on s’est revus plusieurs fois, elle parlait de moins en moins. Elle disait en plaisantant qu’elle ne voulait pas qu’on s’attache trop, puisqu’il allait falloir qu’on se détache. J’ai repris ces notes il y a quelques jours pour donner une forme à ce que j’avais cru comprendre, cette paix un peu effarée que les silences et les mots simples de cette vieille dame m’avaient procurée en m’obligeant à revenir sur l’inconcevable. Aujourd’hui la vieille est morte, son cadavre est derrière le mur du cimetière contre lequel est appuyé le banc sur lequel je suis assis, je regarde tout autour le village et Cachet-dessus, la route qui y conduit et le segment qui s’en sépare pour remonter jusqu’ici. Je vais mieux, j’ai parlé de la mort, des morts surtout, il le fallait. La vieille de Pra Massin est bien vivante en arrière de moi, c’est un peu elle qui parle, nos voix se mêlent, me pousse à aller de l’avant et à risquer ces mots, je suis un tard venu.
Depuis le temps, c’est comme si je voyais les choses de loin et d’en haut, mais aussi à ras de terre avec la tête qui se défait. Me reste accroché je ne sais ni où ni comment ce que je tiens des miens qui se faisaient entendre sans trop en dire sur les pas de porte, d’étage à étage ou par la fenêtre. On ne parlait pas tellement de nos affaires avec les morts, mais elles étaient là, bien là, et on faisait ce qu’il fallait en s’aidant, simplement, en faisant comme on a toujours fait. Mais ce que tout le monde savait sans avoir besoin de le dire, c’est que pour continuer à vivre, il fallait bien les mettre quelque part nos morts, pas n’importe où, ils nous en auraient voulu, et un mort qui vous en veut c’est comme un ongle incarné, ou une maladie chronique, il ne vous lâche pas.
Je viens de temps en temps jusqu’ici, je regarde le village et Cachet-dessus. Tout ce qu’on voit aux alentours, c’est eux qui l’ont fait, c’est le travail de nos morts bien vivants encore, si on regarde bien on reconnait leurs visages. Ce sont eux aussi qui nous ont faits et qui continuent à nous faire, mais il fallait qu’ils meurent pour qu’on mette le pied à l’étrier, sinon c’est nous qui serions morts d’abord, eux ensuite et la mort aurait gagné la partie. Quand je monte ici, je fais un tour parmi les tombes, enlève quelques mauvais herbes. Je souris aussi à la vue des pierres tombales, des arrangements floraux, de l’abandon parfois, ça a fini par leur ressembler. Je ne leur parle pas, mais je pense comme je l’ai toujours fait, avec eux à mes côtés. Je sais qu’ils sont morts, mais ça ne m’empêche pas de vivre avec eux, c’est-à-dire avec leur absence.
Sur le moment c’est incompréhensible, si impensable que parfois ça dure plusieurs jours, plusieurs mois. La mort du mort c’est pour le vivant comme une mort pointée, un impensable qui peut se prolonger indéfiniment. Les vivants doivent à leur tour faire mourir celui qui est mort et retenir ce qui est vivant, c’est de l’alchimie, c’est plus long que de mourir soi-même et laisser faire les autres, il faut du temps. Et faire les gestes justes pour ne pas succomber à l’effroi et trouver une réplique l’inconcevable. Non pas s’y résigner mais y répondre. Dans nos villages, aller au cimetière, y déposer nos morts, en revenir, c’était notre réplique. Nos cimetières sont juste à la distance qu’il faut, à pied s’entend, ni trop loin ni trop près, à la distance juste.
Quand quelqu’un mourait au village personne ne faisait le mariole, les croyants, les catholiques, les agrariens, les socialistes, les radicaux, on montait tous le chemin du cimetière côté à côté, il ne serait jamais venu à l’idée de quiconque de mettre tout ça en cupesse, sans compter que personne n’aurait su exactement où glisser le levier, le jour de l’enterrement, ce que pensait chacun n’avait aucune espèce d’importance, on partait de l’église, ou parfois du domicile de celui qui était mort et on le portait jusqu’au cimetière. On faisait la plupart du temps le voyage en deux fois, du domicile du mort à l’église, de l’église au cimetière, avec le cercueil à bout de bras, il tanguait à l’avant du cortège comme une barque. Le dernier bout, c’est le chemin du cimetière, tous nos morts passaient par là, qu’ils viennent du village ou de Cachet-dessus. Pour les gens de passage qui demandaient où se trouvait le cimetière, on disait à l’entrée du village, pour nous je crois qu’il a toujours été à la sortie.
On le déposait dans la fosse, le pasteur disait quelques mots, personne ne l’écoutait. Mais personne ne lui en voulait, parler c’était sa manière à lui de se taire. Ce qui se passait n’avait rien à voir avec ce que chacun d’entre nous croyait. Il s’agissait d’abord de se débarrasser de ce corps, de rendre à la terre ses parties lourdes, quant aux parties subtiles qu’on allait rapatrier, on devinait qu’elles se mêlaient déjà aux nôtres. On revenait au village par petites ou grosses grappes avec l’assurance que le mort était bien mort et qu’il ne reviendrait pas. Le chemin qui nous ramenait ne charriait pas les mêmes choses à l’aller qu’au retour. On ne redescendait pas le chemin sans rien, mais avec quelque chose, quelque chose en creux, qui ne tenait pas dans une boîte, quelque chose qui ne prenait pas de place dans nos mains vides.
Le cortège était un vrai tambour de machine à laver, le cortège bougeait dans tous les sens, le drap délicat était à l’avant, à l’arrière c’était plus raide, mais c’est ceux de l’arrière qui poussaient ceux de l’avant. Je crois, si on met à part le premier rang du cortège, le gros de la communauté portait dans son coeur ces journées, on était tous ensemble, les travaux s’interrompaient dans le village, on aurait dit que l’horloge du clocher n’avait plus ni grande ni petite aiguilles, à l’arrière ça causait, aussi bien de ce que le mort avait emporté que de ce qu’on allait retenir et ramener.
Il y avait dans l’air quelque chose qui nous rendait modestes et radieux, l’air luimême peut-être qui circulait entre nous, la place que le mort nous avait laissée et qui se multipliait tout autour. Ce n’est pas qu’on tournait ou dansait autour de ce vide qu’il nous avait laissé comme autour d’un arbre de mai, ce n’était pas un vide, mais du vide, du vide qui se distribuait en chaque point de l’espace, comme du temps qu’on ne compterait pas. Il y en avait partout et pour tout le monde, on levait alors la tête dans le ciel et on voyait ce rien de lui qui vivait en dedans de nous, même mort. Rien besoin de croire.
L’air frissonnait, aucun de nous n’était exactement là où les autres l’attendaient, quelque chose de nouveau nous obligeait à reconsidérer notre place. Il y avait du jeu entre les choses, dans notre tête aussi. On débordait de notre niche habituelle, on cédait notre place comme au jeu du taquin. On apercevait aux alentours l’invisible vitalité du défunt, son visage éclaté, partout sa présence. Nos ancêtres délivrés de la pesanteur dansaient eux aussi, j’ai la chose devant les yeux. Notre ciment était fait du vide laissé par le mort, ça n’étriquait pas, c’était invisible et ça portait. Certains se disaient à l’intérieur d’eux-mêmes que de rejoindre le monde des morts, c’était faire une fois quelque chose de bien pour les autres, et ils avaient moins peur. Ça ne consolait pas, mais ça montrait qu’il y avait quelque chose qui nous dépassait de tous les côtés. Et c’est l’un des nôtres qui nous le montrait, sans qu’il le veuille, en quittant sa place parmi les vivants et en rejoignant le lieu où ceux qui l’avaient précédé l’attendaient. On disait parfois en plaisantant que si le mort avait été là, il aurait regretté de ne pas être de la partie.
Le vide que fait un mort c’est quelque chose qui se répercute jusqu’au ciel, comme un caillou jeté dans l’eau qui coulerait à pic, mais dont les effets se prolongeraient à l’infini. Il y a juste le caillou qui ne bouge pas, il s’est détaché de notre communauté, mais il vient en retour écarter les limite de la vie, repousser la mort et donner un peu de place à nos travaux et à nos jours.
Ce sont les morts qui nous ont faits, nous font et nous défont, c’est le grand jeu des générations, des héritages sans testament et de la vicariance tracé à même le sol et dans l’ordinaire de nos jours, auquel des générations se sont conformées sans qu’il ne soit écrit quoi que ce soit à son propos. C’est l’écriture d’avant l’écriture, l’égale de ces semainiers dont personne ne songe à discuter le nombre de tiroirs. Mais qui est devant ? Qui était avant nous ? Qui est à l’avant de nous ? La vieille de Pra Massin n’a jamais rien regretté, les gens du village ne sont plus les mêmes, disait-elle, ils ont amené du sang neuf, d’autres habitudes et d’autres usages. Quelques-uns conduisent leurs morts ailleurs et les y laissent. Les choses vont si vite que tout le monde ignore où demain nos morts vivront. Les communautés erreront peut-être sans amarres, heureuses, entre néant et illusion. Quoi qu’il en soit on ne peut rajeunir la manifestation de la vie avec du gris sur du gris, on peut cependant reconnaître au crépuscule que le gris laissé par l’histoire brûle encore de mille feux, puzzle géant, blé, orge et seigle sépia, prés verts et coquelicots, noir de bitume et gris souris.

Publié le 3 mai 2013 dans le cadre du projet de vases communicants chez François Bon (Tiers livre) .
Jean Prod’hom
Avec François Bon

Très heureux d’accueillir François Bon, mais inquiet à l’idée que ces pages – faut-il les appeler encore ainsi ? - se révèlent bien étroites pour le texte de cet homme aux mille bras. J’ai pensé un instant profiter de sa venue pour entreprendre de gros travaux, élargir le corps principal du site et réduire ses marges, l’excaver même, surélever la charpente pourquoi pas et y aménager des combles. Mais c’eût été trahir l’esprit des vases communicants dont il est l’un des initiateurs – le premier vendredi du mois chacun écrit sur le blog d’un autre. Circulation horizontale pour produire des liens autrement. Ne pas écrire pour mais écrire chez l’autre.
Allez donc jeter un coup d’oeil à sa résidence si vous ne la connaissez déjà, Tiers Livre, le bonhomme y vit, en déborde, il étonne, invente, tonne, vous le croyez à New York il est à Manosque, à Marseille il est à Ferney, hier à Marrakech aujourd’hui à Rabat d’où il raconte la ville, les morts et la mer, la huitième de ses fictions dans un paysage, la neuvième si l’on compte L’Enterrement, ce grand texte que publiaient les éditions de Minuit en 1991, repris désormais par publie.net, un texte que j’ai traversé ébahi avant de me risquer moi aussi du côté des morts, pour y suivre, chez lui, cette route au-delà de laquelle il n’y a rien.
JP
fictions dans un paysage, 8
la ville, les morts, la mer

Ici la ville semait ses morts entre elle et la mer.
La mer, nous l’avions longée longtemps : elle est brutale et sauvage, une houle bien plus raide que chez nous, et qui tombe droit sur la côte droite, éclate dans les basaltes noirs.
La ville, ici, s’arrête. Elle a planté les murs de ses casbahs, elle a maintenu la rectitude de ses infinis remparts. Les routes de la ville sont routes caravanières, et les vieilles routes des livres aussi, ou la route d’Ibn Battuta le voyageur, elles sont routes qui vont vers l’Asie et le coeur noir de l’Afrique, la ville ici ne connaît pas la mer, ne la met pas en travail, et le fleuve est trop étroit pour accueillir autre chose qu’un peu de pêche.
Mais les morts, ne doivent-ils pas accompagner aussi les routes, qui s’arrachent aux lointains pour irriguer la ville ? Et les morts, ne doivent-ils pas être sous la ville comme sous un abri, et que les remparts les protègent et les sauvent, dans leur infinie attente ? Mais les morts ne doivent-ils pas eux aussi savoir ce qui se passe après eux dans les rues serrées et les maisons secrètes ?
Pourtant ici la ville tournait le dos à la mer, la ville ignorait la mer. Où elle avait construit un récent attouchement de béton, parce que c’était le lot des villes modernes, des pays du loisir et des images de télévision, elle avait jeté sur le basalte une esplanade et un phare. Des amoureux s’y cachaient, dans les anfractuosités soumises au vacarme des vagues. Ce n’était pas temps de voir l’un chez l’autre, alors la mer servait à cela.
Une mer de vent, de roche et de houle. Et la ville avec ses avenues secrètes, ses arcades, ses labyrinthes et ses écoles. Une ville si ancienne qu’on n’y mesurait même pas le temps, et sans doute les allées-venues des cigognes sur les mausolées duraient depuis aussi longtemps qu’elle.
Nous marchions en ce bord, avec la route à quatre voies, le surplomb de la houle raide, et la ville au dos tourné. Et dans cette frange où nous marchions, voilà que nous enjambions les morts. Ou bien voilà que les morts, de chaque côté de nos pas, nous entouraient et nous aspiraient.
Ici, à droite, ils étaient dispersés dans l’herbe, et regardaient la mer. Mausolée ou pierre, et des hiérarchies ou regroupements nous n’avions pas la grammaire. De l’autre côté, à gauche, où la pente grimpait vers l’arrière étanche de la ville, ils se serraient à bien plus, les morts du temps présent.
Et c’était une longue bande en surplomb de la mer, la mer donnée à la réflexion des morts, la mer offerte à la solitude des morts, et son horizon pour penser à ce que la mort aussi contient de sans limite.
Nous marchions : était-ce encore aller vers la mer, si pour cela il fallait ainsi radicalement quitter la ville, l’ignorer, et son vacarme et ses chants, et la géographie infiniment compliquée de son histoire en ses murs ? Nous ne marchions plus que parmi les morts qui sont hors de la ville, les morts que la ville avait éloignés d’elle, tout en leur offrant sa mer inutile.
La quatre voies de ciment et de bitume, c’est donc aussi sur le tapis des morts qu’on l’avait posée ?
Nous marchions. Nous étions devant la mer, et sa houle raide et violente, sur les dais de basalte, sous le phare, avec dans les anfractuosités les amoureux qui eux aussi n’étaient que des dos, dos enserrés, dos immobiles, face à la mer et qui probablement cherchaient plutôt en eux-mêmes le nouvel horizon.
La ville ne donnait pas de réponse, ni quant à la mer, ni quant à ses morts. Les morts la connaissaient, eux, probablement, la réponse. Mais elle était dans l’horizon même, et leur immobilité et leur silence de tous, devant la houle infiniment refaite, et ils ne la donnaient pas – du moins à qui passait, passait seulement.


François Bon
Et d’autres vases communicants ce mois, merci Brigitte Célérier :![]() Eve de Laudec et Michel Brosseau
Eve de Laudec et Michel Brosseau![]() Poivert et Pierre Ménard
Poivert et Pierre Ménard![]() Corinne Le Lepvrier et Lou Raoul
Corinne Le Lepvrier et Lou Raoul![]() Anne Charlotte Chéron et Amélie Charcosset
Anne Charlotte Chéron et Amélie Charcosset![]() Danielle Masson et Wana Toctouillou
Danielle Masson et Wana Toctouillou![]() Éric Dubois et Chris Simon
Éric Dubois et Chris Simon![]() Chez Jeanne et Franck Queyraud
Chez Jeanne et Franck Queyraud![]() Dominique Hasselmann et François Bonneau
Dominique Hasselmann et François Bonneau![]() Zéo Zigzags et Visant dessinateur
Zéo Zigzags et Visant dessinateur![]() Louise Imagine et Ana NB
Louise Imagine et Ana NB![]() Anne Savelli et Sabine Huynh
Anne Savelli et Sabine Huynh![]() Mathilde Roux et Virginie Gautier
Mathilde Roux et Virginie Gautier![]() Christophe Grossi et Daniel Bourrion
Christophe Grossi et Daniel Bourrion![]() Camille Philibert-Rossignol et Christopher Sélac
Camille Philibert-Rossignol et Christopher Sélac![]() Anna Jouy et Giovanni Merloni
Anna Jouy et Giovanni Merloni![]() Danielle Carlès et Brigitte Célérier
Danielle Carlès et Brigitte Célérier![]() Hélène Verdier et Dominique Boudou
Hélène Verdier et Dominique Boudou![]() Claude Favre et Jean-Marc Undriener
Claude Favre et Jean-Marc Undriener![]() François Bon et Jean Prod'hom
François Bon et Jean Prod'hom
Seul dans l’ignorance de ce qu'il en retourne

De retour ce matin dans les bois, avec dans la tête quelques éléments d’un texte que François Bon devrait accueillir la semaine prochaine dans le cadre des vases communicants. Me rends compte que la difficulté éprouvée à me lancer dans cette aventure – les morts, leurs places – est liée tout autant à l’expression qu’elle suscite qu’à l’apaisement auquel je voudrais être conduit. Et je balance, incapable de donner à la fois une voix à ce tourment et le faire taire. Comme s’il fallait choisir l'une où l'autre
On ne mène pas cette double opération simultanément. Pourtant, c'est lorsque l'expression s’ouvre à ce qui l’entrave, sans vouloir maîtriser les allées et venues de cette chicane, sans vouloir même la nommer autrement que dans le blanc d’une invisible fosse, que l'apaisement survient un bref instant. Impossible cependant de réouvrir l'huître, il faut recommencer ailleurs, en partant parfois de très loin et renoncer à tirer par un bout le fil d’une pelote qui n’existe pas hors de nos rêves.
Je devine l’issue, un ensemble de fragments charriant le même tourment muet que n'apaisera à la fin que l’inachèvement de son expression.
Décider l’ordre des fragments en obéissant à la chronologie de leur rédaction ou a une supposée logique du contenu, laisser la nuit les ensevelir ou forcer le secret d’une cohésion appelée de mes voeux, creuser des blancs, c’est ce que j’aurai à décider.
C’est au bois Vuacoz que je pense à tout cela, dans un lit d’épines humides. Repousse le moment de rentrer, je crains que tout cela n'intéresse au fond personne, j’ai si souvent l’impression qu’on m’a laissé seul dans l’ignorance de ce qu'il en retourne de nos vies et de nos morts, ou tout au moins de ce qu’il faut en penser.
Le soleil est là, me débarrasse des épines, me souviens alors d'avoir avoué à une paire de philosophes qui débattaient de l’être en tant qu’être comme d’une affaire entendue que j’étais bien loin de saisir le sens de cet énoncé et l’importance qu’on lui prêtait. Les deux sages m’avaient souri en me disant à demi-mots qu'il était parfois plus honorable de se taire et de ne pas revenir sur ce qui était entendu. Je me souviens, c’était l’été 1981, en face de la Nouvelle-Académie, un soir des Fêtes à Lausanne. L’un est mort, dit-on, en croquant de la ciguë, l’autre, spinoziste, a disparu.
Jean Prod’hom
Un marteau-piqueur

Un marteau-piqueur, des aboiements, le souffle rauque du mistral, mais aussi les voix enchantées de Françoise, Sandra et les enfants qui jouent au cluedo, c'est comme un lendemain de fête, la matinée rampe jusqu'à midi. Par la fenêtre les feuilles argentées des saules balaient le ciel, puis tout redevient immobile et silencieux, un bref instant, avant que le manège ne reprenne. Je crains que la journée me passe sous le nez, il est temps de se ressaisir.
Françoise et Sandra, Arthur, Louise et Lili partent pour Grillon, à pied et en trotinette. Edouard prépare le repas de ce soir et moi le voyage à Naples.
Je rejoins l'équipée à Grillon d'où je rentre à pied, avec Lili et Arthur qui veulent reprendre une conversation avec une jument noire et son poulain qu'ils ont commencée à l'aller. L'eau coule à flots dans le canal, mais tout est très sec autour, un vieux bêche un lopin, sa vieille attend des plantons à la main.
J'écoute une émission à la radio sur la république de Salò, au cours de laquelle Le Jardin des Finzi-Contini, un film que Vittorio de Sica réalisa en 1971, est évoqué. L'ajoute à ma longue liste des choses à lire, à entendre, à voir,...
Monte à Grignan en fin d'après-midi, puis traverse Chamaret, tourne à l'entrée de Montségur, fais une halte à Richerenches où je bois une verveine. Lis le journal qui m'apprend que le Président sortant est à Ajaccio pour se pencher sur la sécurité, il réclame un meilleur contrôle des armes. Il finit son voyage dans une usine qui produit de la confiture de clémentine, il y demande un peu de l'aide, celle dont il a tant besoin pour rester aux commandes d'une affaire qui pourrait prendre l'eau.
C'est ce soir, après une longue discussion inutile, que je décide de ne plus parler de cette école qui me désespère. C'est dit.
Jean






Juste capable de m’en réjouir

J’trouve toujours difficile de dire « oui » sans ajouter un « mais » après.
Le mercredi après-midi on faisait la guerre au gros Georges et à tous ceux d’en-haut. C’était une vraie guerre, grandes manoeuvres et longues trottes du fond du jardin au petit parc. On rameutait la fine fleur d’en-bas en trompettant dans le tube amer des pissenlits, on se ravitaillait au goulot des fontaines, assaisonnait nos rêves de conquête du sucre extrait des fleurs de trèfle, on affûtait nos sens en passant le nez sous le volet de la boîte aux lettres de la biscuiterie. Mais le gros du temps, on le passait sur un bout de pré ou au flanc d’un talus pour une guerre de position immense et silencieuse. Au coeur de l’été, on creusait des cuvettes qu’on remplissait d’eau et dans lesquelles on regardait désarmés passer les nuages, vautrés dans nos silences jamais empruntés. C’était une guerre d’un autre temps, sans haine et sans fin, qui n’a cessé que lorsque nous avons quitté le quartier, si noble et si pure que nos ennemis avaient oublié depuis longtemps qu’on était en campagne. On avait éradiqué toute forme de violence, ne connaissait ni morts ni blessés, au bilan quelques égratignures dues aux ronces qui bordaient le pré descendant en pente douce le long des escaliers tournants. On nageait sans fausse note la tête à l’envers dans le ciel. On ne comprenait rien à rien mais on avait lâché les écoutes, pas le temps d’enterrer ceux qui nous quittaient, on allait de l'avant, on était de la race des chasseurs-cueilleurs, faisant jurer le coq et l’âne, le turquoise et l’incarnat. On chassait le froid avec les mains, mangeait les fraises à pleines poignées. Puis l’un d’entre nous lançait une idée qu’on essayait de rattraper avant la tombée de la nuit, la petite troupe se rendait dans le lit du Flon ramasser les cadavres qu’avaient abandonnés les fêtards du samedi soir, 50 centimes pour chaque bouteille, 2 francs 50 dépensés en brisures en haut le Valentin qu'on mangeait en descendant Riant-Mont.
Edith avait la peau brune qui me rappelait le grain du ventre chaud de Chouchane, on cambait par-dessus les nuits, on enfilait bout à bout ce qui nous passait par la tête. Jamais on n’a pris une seule décision, pas besoin, parce qu'on faisait les choses au diapason, sans craindre de maltraiter les harmonies et de faire jurer les croassements de la corneille avec le sifflement des merles. Pendant une douzaine d’années on n’a pas grandi, l’autre c’était nous, dévorant tout ce qui se présentait, suivant un programme qu’on sortait d’un sac de billes. On faisait avec ce que les autres ne voulaient pas, reliefs, ombres sans doute, de doutes qui ne nous encombraient pas. Personne n’en savait rien, ni nous non plus, pas le temps pour ça. Notre âme n’habitait pas notre corps, je nous étions sans question.
« Oui mais », dit un jour Michel à Jean-Pierre. J’avais douze ans, on jouait les trois dans le jardinet qui jouxtait le rez de Riant-Mont 1. Ils se sont mis à rire à mes dépens. J’ai eu l’impression non seulement qu’ils me tournaient le dos mais qu’ils avaient quitté le paradis depuis longtemps déjà. Pour faire bonne figure je suis monté à la Colline, on tirait les équipes, Lometti et Fincat les meilleurs, je suis resté en carafe.
Il y a entre les jeux de mon enfance et l’écriture de ses exploits de longues années et un « oui mais » qui me reste au travers de la gorge. Je suis resté là, dans ce jardinet, accoudé à la table de ping-pong, songeur, incapable de faire quoi que ce soit, incapable de renoncer tout à fait aux heures glorieuses de l’enfance, incapable de les oublier comme Jean-Pierre, incapable d’en mourir comme Michel le décida un jour, tout juste capable, parfois, de m’en réjouir.

Publié le 3 juin 2011 dans le cadre du projet de vases communicants chez Kouki Rossi (Koukistories) .
Jean Prod’hom
L’embellie | Kouki Rossi

la jeunesse va emporte
ses promesses
nous laisse
œuvrant
aveugles
où nous rêvions de joie
il y a le pot chinois
rutilant sur la table
le fruit du mur muet
où vont frayer les âmes
il y a l’aube appliquée
à couvrir le rocher
de vieux ors
ceux des peintres
les théâtres grandioses
où promener nos corps
vaillants
un peu nerveux
par besoin d’importance
puis il y a ceux-là
qui trouvent le courage
l’amour fou inventer
même si
rien jamais
ne vient taire le manque
ils rendent au jour neuf
l’éclaircie
de sa grâce
Kouki Rossi
écrit par Kouki Rossi qui m’accueille chez elle sur son site Koukistories dans le cadre du projet de vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.
Et d’autres vases communicants ce mois.![]() Nicolas Bleusher et Christopher Selac
Nicolas Bleusher et Christopher Selac ![]() Martine Sonnet et Urbain trop urbain
Martine Sonnet et Urbain trop urbain ![]() Anita Navarrete-Berbel et Brigitte Célérier
Anita Navarrete-Berbel et Brigitte Célérier ![]() Céline Renoux et Christophe Sanchez
Céline Renoux et Christophe Sanchez ![]() Franck Thomas et Guillaume Vissac
Franck Thomas et Guillaume Vissac ![]() Cécile Portier et Pierre Ménard
Cécile Portier et Pierre Ménard ![]() Franck Queyraud et Loran Bart
Franck Queyraud et Loran Bart ![]() Anne Savelli et François Bon
Anne Savelli et François Bon ![]() Carine Perals-Pujol et Joachim - Séné
Carine Perals-Pujol et Joachim - Séné ![]() Isabelle Parriente-Berbel et Louise Imagine
Isabelle Parriente-Berbel et Louise Imagine ![]() Maryse Hache et Laurence Skivée
Maryse Hache et Laurence Skivée ![]() Chez Jeanne et Xavier Fisselier le roi des éditeurs et Nicolas Ancion
Chez Jeanne et Xavier Fisselier le roi des éditeurs et Nicolas Ancion ![]() Michel Brosseau et Jacques Bon
Michel Brosseau et Jacques Bon ![]() Christine Jeanney et Christophe Grossi
Christine Jeanney et Christophe Grossi ![]() Caroline Gérard et Juliette Mezenc
Caroline Gérard et Juliette Mezenc ![]() Ghislaine Balland et Dominique Hasselmann
Ghislaine Balland et Dominique Hasselmann ![]() Piero Cohen-Hadria et Conte de Suzanne
Piero Cohen-Hadria et Conte de Suzanne![]() Kouki Rossi et Jean Prod’hom
Kouki Rossi et Jean Prod’hom
Aurait-il pu en être autrement ?

C’est en descendant la route des Plaines-du-Loup, un samedi soir de printemps, perdu dans la foule des supporters du Lausanne-Sport que je pris conscience des maigres moyens dont je disposais pour changer le cours des choses.
La rencontre était à peine terminée que la fureur des supporters retombait en morceaux au pied de l’arène. La foule s’agitait d'un mouvement continuel et divers, on se heurtait, rebondissait dans un silence de mort, les uns à de grandes distances, les autres faiblement. Les flux tardaient à trouver leur lit et on dut, papa et moi, hors toute discipline, nous glisser en marge de l’affluence pour remonter à contre-courant au lieu même où nous attendait le nôtre. On y parvint sans peine. Malgré mon jeune âge, j'aidai au passage certains de mes semblables à trouver leur direction, je trouvai la mienne. Il nous suffit alors, accompagnés d’innombrables ombres, de suivre la pente qui allait nous conduire de la rue de la Pontaise à celle du Valentin, silhouettes toujours moins nombreuses dans la nuit, puis de celle-ci jusqu’au numéro 4 de Riant-Mont, avec pour seules ombres les deux nôtres.
Dans un silence de mort? Pas tout à fait, car on entendait en chaque lieu des malédictions, murmurer des imprécations. Les âmes rongées par le ressentiment s’affairaient autour de l’irréparable, prêts à voiler la roue de la fortune, lynchaient les pauvres bougres qui s'étaient battus jusqu'à la fin, inventaient les causes de la terrifiante défaite des Seigneurs de la nuit, ordonnaient les remèdes dont l’administration eût conduit à l'autre version du monde. Il fallait trouver des coupables, en appeler à des héros neufs, exiger la démission du coach et engager un mage, corriger les principes, multiplier les travaux, bref, faire en sorte qu'il eût pu en aller autrement. Ce revers de la fortune était inacceptable, en effet, et nous chagrinait tous, il aurait dû ne pas être. Moi j'allais la main dans celle de mon père qui tentait, comme nos voisins, de m'emmener sur les voies de l'aigreur, je ne l’écoutais pas et demeurai silencieux.
Car moi aussi je cherchais une raison à cette humiliante défaite, mais ne supportais pas d’en charger quiconque, car enfin, ma présence sur les gradins du stade n'avait pas suffi à faire basculer le résultat. Tandis que j'essayais de saisir les conditions qu'ils eût fallu remplir pour qu'un tel malheur n'advienne pas, je sentais au fond de moi la vraie cause de ce désastre : moi. Le coupable c'était moi, de n'avoir su lancer ce mouvement qui, de cause et cause, eût abouti à l'inversion de la tendance. Aurais-je dû hurler avec les loups, lancer des cris et applaudir? Cela n’aurait pas suffi, je le savais, il fallait bien plus, un don, le don de toute ma personne. Ma présence n’était-elle pas en définitive la raison dernière de cette mortifiante défaite. C'est un sacrifice qu'exigeaient les Seigneurs de la nuit, seule mon absence au stade eût pu changer l'issue de la rencontre, c’eût été le prix à payer pour la victoire de mes dieux.
Je me trouvai dès lors dans une situation inconfortable. Ou je montais au stade et l'équipe de mon coeur risquait de perdre pour me signifier que je doutais d’elle. Ou je me sacrifiais en renonçant à mon plaisir et assurais sa victoire. C’est ce que je fis deux semaines après. Mais les Seigneurs de la nuit perdirent encore. Je compris pourtant immédiatement ce qui s’était passé et leur en fus profondément reconnaissant. Si mes héros avaient en effet laissé échapper la victoire, c’était tout à fait volontairement, pour me communiquer qu’ils avaient été touchés par l'énormité de mon geste, la dimension de mon sacrifice. Ma décision les avait plongés dans un abîme de reconnaissance : incapables de fêter une victoire dont mon sacrifice eût été la cause, les Seigneurs de la nuit avaient préféré laisser filer la victoire. Personne n’en sut jamais rien parmi les supporters. Je me couchai sitôt arrivé à la maison, le lendemain matin c’était jour de culte.
Je ne suis pas guéri. Je me surprends parfois à calculer les effets du sacrifice sur le réel, j’aurais pu si souvent infléchir le cours des choses.

Publié le 1 avril 2011 dans le cadre du projet de vases communicants chez Isabelle Pariente-Butterlin (Ædificavit).
Jean Prod’hom
Factuellement vôtre | Isabelle Pariente-Butterlin

J'aime bien les faits. Ils ponctuent le temps, la journée. Du lever au coucher, c'est une ponctuation, la journée est une phrase, il faut la dire sans se tromper, comme à l'époque où je croyais que j'allais faire du théâtre, brûler les planches… ! Non : les faits. Comme une pulsation sur le cours du temps. Ils permettent de vérifier les étapes franchies de l'avancée sur la ligne temporelle. Je me souviens encore de ce que disait mon vieux prof, "il ne faut jamais regarder ses pieds quand on descend un escalier, il vaut mieux qu'un roi shakespearien tombe dans l'escalier s'il ne peut pas faire autrement, mais ne regardez pas vos pieds", ça n'a jamais pu marcher avec moi.
- Monsieur Z…, votre rendez-vous de 9 h est arrivé.
- Un instant, s'il vous plaît.
C'est rassurant. Je m'appelle bien Z…, ça c'est vérifié pour la journée. C'est stable, régulier. Je peux mettre une croix. J'ai fait l'appel de moi-même. Il y a des certitudes sur lesquelles on peut tabler pour la journée sans trop d'imprudence. Moi, ma qualité première n'est pas l'audace, cette histoire d'escalier a été le déclic, je n'ai jamais réussi. Je fais les choses, au fur et à mesure, comme elles se présentent, comme ça on arrive au bout de la journée, il est encore possible d'acheter le journal au guichet de la gare et de rentrer pour les informations. Il est neuf heures. Neuf heures du matin. Si je prends, entre neuf heures et, mettons, neuf heures douze, un intervalle de douze minutes pendant lequel il suffit que je fasse autre chose, alors Monsieur W… en conclura que moi, Monsieur Z…, suis suffisamment 1) important pour le laisser attendre, 2) occupé pour avoir déjà, à neuf heures du matin, douze minutes de retard sur le planning de ma journée, ce qui, au regard d'une journée de, mettons encore huit heures, si j'enlève le temps du déjeuner, me permettra d'avoir huit fois douze minutes, soit… quatre-vingt-seize… ça fait une heure trente-six tout de même… de retard. Et pour ce faire, c'est du grand art, je ne suis pas obligé de perdre mon temps. Je ne perds pas mon temps, pour faire perdre le sien à Monsieur W…, ce serait mesquin, je vais juste un instant faire autre chose. Je suis bien inséré, bien installé dans une trame sociale, temporelle qui fait que Monsieur W… va attendre sans rien dire, et que moi, pendant ce temps, je ferai autre chose.
Bon, enfin, tout ça, ça permet de vérifier, à intervalle régulier, qu'on est en vie.
Et de toutes façons, j'ai toujours autre chose à faire, c'est vrai. Je suis occupé, personne ne pourra dire le contraire. Je n'ai qu'à ouvrir mon agenda. J'aime bien ce mot. Neutre pluriel. Litt. : les choses qui sont devant être faites. J'ai fait du latin, autrefois. Pas beaucoup, mais ça, je m'en souviens. J'ai réussi à parvenir à ce point de mon existence où mon agenda est rempli pour plusieurs semaines à l'avance. Nous sommes en mars, fin mars-début avril précisément, et déjà il se remplit pour … septembre. Dominique le remarquait hier. Même en novembre, j'ai déjà des rendez-vous qui sont marqués, pris. Mon temps de novembre est déjà pris.
Tiens, ça me rappelle de vieux souvenirs, tout ça. Je me souviens du registre que tenait mon père, il se remplissait des réservations au fur et à mesure de la saison, je le regardais, se noircir, se remplir, il me semblait que l'avenir prenait corps dans les registres, les agenda, les plannings, les réservations, plus tard il m'a même laissé écrire les noms des clients, mais c'était déjà à l'époque où ça ne m'amusait déjà plus. Les gens savaient qu'ils dormiraient ici le tant, c’était ferme, réservé, on versait des arrhes à la réservation, sinon mon père effaçait le nom, inexorablement. Il les effaçait du grand registre du temps. Et c'était comme s’ils n'avaient jamais appelé, jamais réservé, et même, comme s'ils n'avaient jamais existé. À la limite, on aurait pu dire ça. Mon père tenait le grand registre du temps, et au fur et à mesure des semaines, la grande double page se noircissait, se remplissait, des noms étaient effacés, déplacés d'une chambre à une autre, certains disparaissaient, d'autres revenaient à intervalles réguliers.
Maintenant c'est mon tour. Je sais, tiens prenons un exemple au hasard, que si je voulais aller, disons, voir la mer le 28 mai, eh bien je ne pourrais pas ! C'est une certitude, et les certitudes sont des victoires sur le temps, non ? Moi, Monsieur Z…, je suis tellement occupé, que si je voulais aller voir la mer le 28 mai, entre mon déplacement à Amsterdam et celui à Besançon, eh bien je ne pourrais pas parce que, entre les deux, des déplacements professionnels, tous les deux, hein ?, je dois régler le dossier W… oui, celui-là même…. Et vu l'affaire, une journée ne sera pas de trop.
- Faites-le entrer, Dominique.
- Bien, Monsieur. Un instant, s'il vous plaît. Je vais le chercher, il est sorti dehors fumer une cigarette.
C'est lui, maintenant, qui me fait perdre mon temps ? Il ne manque pas de culot. Ce n'est pas si compliqué d'ajuster son temps, ses gestes, ses mouvements. C'est la condition sine qua non pour que quelque chose fonctionne dans le monde. Le monde social est une petite mécanique de précision, non ? Il s'imagine quoi, celui-là ? Qu'il est un roi shakespearien ?
Isabelle Pariente-Butterlin
écrit par Isabelle Pariente-Butterlin qui m’accueille chez elle sur son site Ædificavit dans le cadre du projet de vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.
Et d’autres vases communicants ce mois: ![]() Brigitte Célérier et Benoît Vincent
Brigitte Célérier et Benoît Vincent![]() Sandra Hinège et Pierre Ménard
Sandra Hinège et Pierre Ménard ![]() Guillaume Vissac et Laurent Margantin
Guillaume Vissac et Laurent Margantin ![]() Joachim Séné et Marc Pautrel
Joachim Séné et Marc Pautrel ![]() Dominique Hasselmann et François Bon
Dominique Hasselmann et François Bon ![]() Michel Brosseau et Stéphane Bataillon
Michel Brosseau et Stéphane Bataillon ![]() Franck Queyraud et Samuel Dixneuf-Mocozet
Franck Queyraud et Samuel Dixneuf-Mocozet ![]() Anne Savelli et Piero Cohen-Hadria
Anne Savelli et Piero Cohen-Hadria ![]() Christine Jeanney et Maryse Hache
Christine Jeanney et Maryse Hache ![]() Anita Navarrete-Berbel et Christophe Sanchez
Anita Navarrete-Berbel et Christophe Sanchez![]() Claire Dutrait et Jacques Bon
Claire Dutrait et Jacques Bon ![]() Cécile Portier et Bertrand Redonnet
Cécile Portier et Bertrand Redonnet ![]() Christopher Selac et Franck Thomas
Christopher Selac et Franck Thomas ![]() Morgan Riet et Vincent Motard-Avargues
Morgan Riet et Vincent Motard-Avargues ![]() Isabelle Pariente-Butterlin et Jean Prod'hom
Isabelle Pariente-Butterlin et Jean Prod'hom
Jean Prod’hom
Consolations

Quand le ciel s’assombrit, l’homme pense avec tristesse aux vies qu’il eût pu mener s’il en fût allé autrement. Il devrait au contraire se consoler en se rappelant que ce qui a existé un jour ressemble étrangement à ce qui n’est resté que possible, c’est-à-dire à ce qui n’existe pas.
Lorsqu’au terme de son existence l’homme fait le bilan, il pense à regret qu’il a trop souvent voulu couper au plus court.
Avant d’identifier et de prévenir autant que faire se peut le talon d’Achille qui menace sa vie, l’homme est amené à faire d’innombrables expériences, neutraliser les prédictions, conjurer le hasard, user des lumières de la raison, éviter les chausse-trapes du langage... En vain.
Il eût suffi pourtant d’un peu plus que l’exacte durée de sa vie pour que celle-ci lui livre les secrets de sa faiblesse congénitale. Or c’est à l’instant même qui précède la saisie de ces secrets que la vie le quitte traîtreusement, inévitablement, sans défense.
Publié le 4 mars 2011 dans le cadre du projet de vases communicants chez Estelle Ogier (Espace childfree).
Jean Prod’hom
Estelle Ogier

Il n’avait fallu rien moins que deux chocolats chauds pour conclure la balade d’une douzaine de kilomètres – à travers la campagne enneigée et vide – d’un père et de son fils qui goûtèrent le bonheur de marcher ensemble au coeur glacé d’une nature complice.
Il n’avait fallu rien moins que six orteils au Polydactile - peint par Louis Rivier en 1943 – pour descendre de sa croix sous les yeux ébahis de sa mère. Le fils rejoignit les vivants qui ne l’attendaient pas car ils étaient en train de mener leur vie privée derrière leur porte privative qu’ils n’ouvrirent pas au va-nu-pieds.
Il n’avait fallu rien moins que 16 volumes du dictionnaire de la langue du XIXe et du XXe siècle (1789-1960) – « Trésor de la langue française », édité par le Centre National de la Recherche Scientifique – pour oser inventer mon propre monde en parcourant les définitions des mots comme on découvre un paysage à bicyclette.
Estelle Ogier
écrit par Estelle Ogier qui m’accueille chez elle sur son site Espace childfree dans le cadre du projet de vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.
Et d’autres vases communicants ce mois : ![]() Candice Nguyen et Christine Jeanney
Candice Nguyen et Christine Jeanney ![]() Sam Dixneuf et Stéphane Bataillon
Sam Dixneuf et Stéphane Bataillon ![]() Juliette Mezenc et Christophe Grossi
Juliette Mezenc et Christophe Grossi ![]() François Bon et Guillaume Vissac
François Bon et Guillaume Vissac ![]() Michel Brosseau et Jean-Marc Undriener
Michel Brosseau et Jean-Marc Undriener ![]() Anna Vittet et Joachim Séné
Anna Vittet et Joachim Séné ![]() Cécile Portier et Christophe Sanchez
Cécile Portier et Christophe Sanchez ![]() Clara Lamireau et Urbain trop urbain
Clara Lamireau et Urbain trop urbain ![]() Anita Navarette-Barbel et Arnaud Maïsetti
Anita Navarette-Barbel et Arnaud Maïsetti ![]() Morgan Riet et Murièle Modély
Morgan Riet et Murièle Modély ![]() Nolwen Euzen et Benoit Vincent
Nolwen Euzen et Benoit Vincent ![]() Maryse Hache et Michèle Dujardin
Maryse Hache et Michèle Dujardin ![]() Elise et Piero Cohen-Hadria
Elise et Piero Cohen-Hadria ![]() Anne Savelli et Franck Queyraud
Anne Savelli et Franck Queyraud ![]() Dominique Hasselmann et Dominique Autrou
Dominique Hasselmann et Dominique Autrou ![]() Marlène Tissot et Vincent Motard-Avargues
Marlène Tissot et Vincent Motard-Avargues ![]() Kouki Rossi et Brigitte Célérier
Kouki Rossi et Brigitte Célérier![]() Estelle Javid-Ogier et Jean Prod’hom
Estelle Javid-Ogier et Jean Prod’hom
Jean Prod’hom
Au pied du brise-lames

Un matin dʼaoût 1988 entre Kérity et Saint-Pierre, un coup dʼoeil, un éclair peut-être, à deux pas du phare dʼEckmühl une lueur danse. Les jours passent, lʼintrus se déplace à lʼabri dans lʼanse, même lueur que la veille mais un peu plus loin ou un peu plus près cʼest selon. Hésite, tant de choses brillent, le ramasse enfin à marée basse, ne sais pas pourquoi, beau et bleu, avec des vagues et le ciel, lʼhorizon et la mer de sable. Il recèle peut-être quelque chose que les autres nʼont pas, personne ne le sait, tu lʼignores encore; le sentirais pourtant si tu le prenais dans la main, la douceur, le grain dense, la fraîcheur, le cintre. Tu lʼas mis dans ta poche.
Les jours suivants, dʼautres tessons lancent leurs feux tout autour, lieux sans attrait mais bénis des dieux: Lesconil, Saint-Guénolé, Loctudy. Tant quʼà faire tu les ramasses. Pas tous, les élus seulement, ceux qui ont su réduire leur fracture et lustrer leur chiffre.
Sʼensuit nʼimporte quoi, une carte du monde et du tendre, avec ses criques, ses digues, ses grèves, ses ports, ses môles, ses épaules, ses levées, ses jetées, ses rivages, ses plages. Des voyages avec dedans la tête un seul désir, celui dʼune pierre dans le creux de la main, terre cuite engobée, glacée, émaillée, portée au comble de la perfection, terre de couleur sur les rivages dʼun rêve bien vivant, petite éternité.
Sachez que le miracle se répète à deux pas du repaire des marins qui savent la gourmandise de la mer, là où les buveurs de lait jettent leur bol comme des amateurs de vodka. Cʼest ainsi quʼils remettent à lʼocéan sans crier gare les tessons au bord tranchant, les restes de la cuisine du monde.
Les fragments ballottés par la marée, déplacés par les courants, la houle, par les tempêtes se font oublier à lʼombre protectrice de la pierre qui les a brisés et deviennent purs joyaux, taillés, façonnés, polis, limés par lʼeau qui mêle au sable son grain. Ils vont et viennent au gré des circonstances secrètes qui les embellissent, repris par la mer, laissés sur la grève, se calent, se déplacent à peine. Certains trouvent alors une seconde vie, individuelle, particulière, resplendissante. Pas tous et pas pour longtemps.
Avant dʼêtre réduites au couchant, ces petites ruines racontent en accéléré la beauté, chacune à sa manière. Regardez-les chercher lʼunité, non pas celle du pot dont elles ont été arrachées, mais celle du peu serti de rien, à lʼimage de notre condition. Elles font voir dʼincomparables petits motifs qui se réduisent comme peau de chagrin.
Le sable à la lisière de lʼair et de la terre ronge avec la mer et le vent ces petites oeuvres inespérées qui flambent un instant, petite perfection discrète que caresse lʼeau. Tout va très vite, dix ans à peine avant que le motif ne disparaisse et nʼoffre plus au chasseur des mauvais jours quʼune pierre blanche, aussi blanche que la mie du pain quʼemporte le goéland.
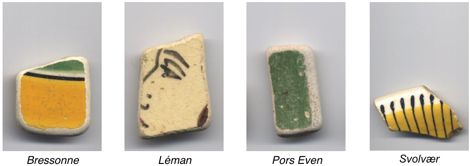
Un seul tesson aurait suffi, le premier, celui de Penmarcʼh. Mais pour quʼenfin celui-ci fasse voir son visage dans sa fragile mandorle, il aura fallu que je coure les côtes bretonnes, les îles grecques, les rivières, la côte turque, le Léman, les ports de la Méditerranée, les Lofoten, la Loire, vingt ans au total pour une collecte forcenée, avec à la fin les poches bourrées de cailloux de Palerme et de Paimpol, de Venise et de lʼÎle de Sein.

La multiplication a mis le rêve en miettes. Ils ont fini dans un tiroir, en tas, le tiroir dʼune table de douanier, avec des pièces de monnaie bulgare et un Louis dʼor, disséminés ensuite en tous lieux de la maison, identifiés, localisés, datés. Placés dans des casses dʼimprimerie comme sʼils étaient les éléments dʼune langue qui allait révéler ses secrets. Lʼentassement sʼest poursuivi avec la certitude que la vérité de lʼensemble jaillirait un jour et quʼil serait temps alors de faire quelque chose de ces merveilles. Mais quoi. En garder quelques-uns parmi les centaines qui dorment dans leur niche. Les offrir à celle qui mʼaccueille, petite monnaie sans crédit, analogue à celle quʼutilisent les enfants sur les quais de Saint-Polde-Léon. Décidé à laisser ces pierres prometteuses à leur sort, je ne peux toutefois mʼempêcher aujourdʼhui de soulever du bout du pied les innombrables tessons blancs qui jonchent les rivages. Ils dissimulent parfois au verso – ils sont rusés, le saviez-vous? – un beau visage et son secret. Jʼen ramasse quelques-uns pour réveiller, un instant, cette folie dʼil y a plus de vingt ans et ajouter discrètement, lorsque la nuit vient, une croix sur ma carte du tendre. Tout cela ne débouche sur rien, je le sais aujourdʼhui, sinon sur lʼassurance dʼavoir été là où ils furent un jour, à Mazara, Epesses, Patras ou Patmos. Ils ne sont que de petites méditations sans mobile apparent dont je me souviens à peine et peine à me séparer, minuscules théâtres qui tiennent le temps dʼun éclair le monde au creux de leurs mains, la béatitude et le temps qui passe.
Penmarc’h 1988 - Corcelles-le-Jorat 2011

Publié le 4 février 2011 dans le cadre du projet de vases communicants chez Juliette Mézenc (mot-maquis).
Jean Prod’hom
Juliette Mézenc
Comment présenter ça ?
dialogue à bâtons rompus OU réunion au sommet (tout le monde n’est pas d’accord sur le sous-titre à donner à cet article, veuillez nous excuser pour les désagréments occasionnés)

![]()
Quincaillerie ?
Fourre-zy-tout ?
Vous avez vraiment mais alors vraiment aucun orgueil hein !
Quoi ?
Laisse-les faire, c’est pour la comm’, on s’en fout
Comment on s’en fout ! ils voudraient se saborder qu’ils ne feraient pas mieux
On n’a qu’à écrire chacun un texte pour présenter le bidule et puis voter
Non non non, vous êtes trop nombreux là-dedans à délirer complet
Laisse-les faire, le vote ça n’engage à rien
Moi je dis que le titre suffit : Le Journal du brise-lames en arial narrow blanc sur fond noir, sobre
Moi perso je préfère le lucinda sans unicode
On peut choisir en fonction de
Voilà où on en est rendu, avec leur refus de faire des choix clairs, de s’en tenir à une ligne, un style, de se choisir un bon petit parti pris
On t’a déjà expliqué : le parti pris du n’importe quoi, pas de plan, pas de ligne, pas de rigueur, faire feu de tout bois. Glaner. Et construire au petit bonheur la chance
Et puis t’inquiète, tous ces petits bouts de rien, ils s’agglomèrent autour du grand caïd, tu sais, le brise-lames, tu te rappelles, le truc sur lequel on bosse depuis des années
Ouais, par intermittence
Justement, l’intermittence construit l’objet, aussi
On pourrait écrire
Dans ce livre (est-ce un livre) vous trouverez (avec des tirets pour faire liste, organisation béton) :
![]() -
-![]() une utopie artisanale et chaotique
une utopie artisanale et chaotique![]() -
-![]() de minuscules coquillages en bande organisée
de minuscules coquillages en bande organisée ![]() -
-![]() un magasin de souvenirs
un magasin de souvenirs![]() -
-![]() un peu d’Histoire
un peu d’Histoire![]() -
-![]() un roman photo : le homard Omar
un roman photo : le homard Omar![]() -
-![]() des bulletins de météo marine
des bulletins de météo marine![]() -
-![]() des migrations dans tous les sens
des migrations dans tous les sens ![]() -
-![]() des rêves absurdes
des rêves absurdes ![]() -
-![]() des rêves terrifiants
des rêves terrifiants![]() -
-![]() des anecdotes (réhabilitons l’anecdote)
des anecdotes (réhabilitons l’anecdote)
Ridicule
Faut bien tenter quelque chose
Tout ça n’est pas sérieux
Juliette Mézenc, collectif

écrit par Juliette Mézenc qui m’accueille chez elle sur son site motmaquis dans le cadre du projet de vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.
Et d’autres vases communicants ce mois :
![]() Laurent Margantin et Daniel Bourrion
Laurent Margantin et Daniel Bourrion ![]() Christine Jeanney et Anita Navarrete-Berbel
Christine Jeanney et Anita Navarrete-Berbel ![]() Maryse Hache et Piero Cohen-Hadria
Maryse Hache et Piero Cohen-Hadria ![]() Joye et Brigitte Célérier
Joye et Brigitte Célérier ![]() Samuel Dixneuf et Michel Brosseau
Samuel Dixneuf et Michel Brosseau![]() Chez Jeanne et Leroy K. May
Chez Jeanne et Leroy K. May ![]() Estelle Ogier et Joachim Séné
Estelle Ogier et Joachim Séné![]() François Bon et Christophe Grossi
François Bon et Christophe Grossi ![]() Cécile Portier et Anthony Poiraudeau
Cécile Portier et Anthony Poiraudeau ![]() Amande Roussin et Benoit Vincent
Amande Roussin et Benoit Vincent ![]() Marianne Jaeglé et Franck Queyraud
Marianne Jaeglé et Franck Queyraud ![]() Candice Nguyen et Pierre Ménard
Candice Nguyen et Pierre Ménard ![]() Christophe Sanchez et Xavier Fisselier
Christophe Sanchez et Xavier Fisselier![]() Nolwenn Euzen et Landry Jutier
Nolwenn Euzen et Landry Jutier ![]() Leila Zhour et Dominique Autrou
Leila Zhour et Dominique Autrou ![]() Jean-Marc Undriener et Claude Favre
Jean-Marc Undriener et Claude Favre![]() Clara Lamireau et Michel Volkovitch
Clara Lamireau et Michel Volkovitch ![]() Bertrand Redonnet et Philip Nauher
Bertrand Redonnet et Philip Nauher![]() Isabelle Pariente-Butterlin et Louise Imagine
Isabelle Pariente-Butterlin et Louise Imagine![]() Juliette Mézenc et Jean Prod'hom
Juliette Mézenc et Jean Prod'hom
Jean Prod’hom
Belle Joux

Les méandres de la Trème avaient été corrigées, on avait aménagé ses rives, essarté les bois, accroché des leurres aux bras des étoiles, les hommes avaient exposé leur âme velléitaire, cherché midi à quatorze heures, ils étaient allés à gauche, ils étaient allés à droite, avaient rêvé un autre ordre du monde, le haut en bas et le bas en haut, tracé des chemins pour revenir sur leurs pas, lorsque l’un d’eux s’avisa un matin que tout cela n’allait pas.
Il maudit un instant les hésitations d’où étaient nées leurs entreprises avant de louer l’esprit de décision des choses: la rivière ne baisse pas les bras et franchit les obstacle sans jamais revenir sur ses pas. Les nuages jouent les masques sans quitter le jeu. Il ne siffle pas aux oreilles du vent lorsqu’il perd un peu de son souffle. Le lac ne languit pas. Le vase déborde et le feu ne se trompe pas.
Derrière tes allures d’aventurier quatre heures sonnent déjà à la cloche du village, un chien aboie, un corbeau remue l’immobile coup de pelle et une lame chasse la neige, le renard file au plus droit la tête renversée vers le ciel. Le dernier mot a donc été dit et tu écris l’étendue blanche. Une dame et son chien te rattrapent, bonjour bonjour, laissent quelques miettes sur la nappe qui nous sépare et, dans le verger, le gui fait le fanfaron sur les épaules d’un vieux pommier qui rit sous cape. En arrière du chemin un poème de Robert Walser.
La neige ne monte pas en tombant
mais, prenant son élan,
descend, et puis se pose.
jamais elle ne monta.
Elle n’est par essence
à tous égards, que silence,
pas trace de vacarme.
si seulement tu lui ressemblais.
Le repos et l’attente
- telle est son attachante
et douce identité,
Vivre, pour elle, c’est s’incliner.
Jamais elle ne retournera
d’où elle est descendue,
elle ne court pas, elle est sans but,
être calme est son bonheur.
Il se souvient alors de la Trème, la conçoit de mémoire, ses sources multiples et ses secrets dans la Joux Noire lorsqu’elle ouvre ses bras au Châ, au Mormotey et plus tard à l’Albeuve, lorsqu’elle se perd dans ceux de la Sarine. Il s’attarde sur ses rives, mêle ses pas aux empreintes des disparus pour tresser une guirlande à l’inexorable.

Publié le 7 janvier 2011 dans le cadre du projet de vases communicants chez Murièle Laborde Modély (L’oeil bande).
Jean Prod’hom
Murièle Modély
avec une moue légère
qui creuse un accent grave
sur le bord de sa lèvre
je sens bien qu’être une fille
de surcroît de la ville
dans sa bouche terreuse
brûle comme une ortie
je sais bien qu’un jour
son regard indulgent
heurtera âprement
le pli de sa glabelle
je sais qu’il me perdra
quelque part dans la nuit
que je m’égarerai
en chemin dans les blés
dans les
coteaux
du Gers
où je vois
une bosse
deux bosses
un troupeau
de chameaux
où je vois
des poils ras
puis blonds
et leur tonte
l’été
où je ne vois
rien
que
feuilles
plantes
arbres
sans nom
je dois
lancer en l’air
et sur lui
d’étranges
petits
sorts
pour voir ses cheveux, sa langue crépiter
quand il m’identifie comme une citadine
pour voir sur sa tête, le ciel du jour qui sombre
s’embraser dans le bref flamboiement d’une orange
pour voir les nuages dégorger tout leur jus
asperger d’un voile roux le bitume et ses mots
pour l’écran sirupeux qui dessine sur nous
un nouveau paysage
Murièle Modély
![]()

écrit par Murièle Modély qui m’accueille chez elle sur son site L’oeil bande dans le cadre du projet de vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.
Et d’autres échanges ce mois :
![]() Juliette Mezenc et Christine Jeanney
Juliette Mezenc et Christine Jeanney ![]() Christophe Grossi et Michel Brosseau
Christophe Grossi et Michel Brosseau ![]() François Bon et Laurent Margantin
François Bon et Laurent Margantin ![]() Martine Sonnet et Anne-Marie Emery
Martine Sonnet et Anne-Marie Emery ![]() Anne Savelli et Urbain, trop urbain
Anne Savelli et Urbain, trop urbain ![]() Jérémie Szpirglas et Franck Queyraud
Jérémie Szpirglas et Franck Queyraud ![]() Kouki Rossi et Jean
Kouki Rossi et Jean ![]() Piero Cohen-Hadria et Monsieuye Am Lepiq
Piero Cohen-Hadria et Monsieuye Am Lepiq ![]() Marie-Hélène Voyer et Pierre Ménard
Marie-Hélène Voyer et Pierre Ménard ![]() Frédérique Martin et Francesco Pittau
Frédérique Martin et Francesco Pittau ![]() Jean-Yves Fick et Gilles Bertin
Jean-Yves Fick et Gilles Bertin ![]() Candice Nguyen et Benoit Vincent
Candice Nguyen et Benoit Vincent ![]() Nolwenn Euzen et Joachim Séné
Nolwenn Euzen et Joachim Séné ![]() Isabelle Pariente-Butterlin et Xavier Fisselier
Isabelle Pariente-Butterlin et Xavier Fisselier ![]() Christine Leininger et Jean-Marc Undriener
Christine Leininger et Jean-Marc Undriener ![]() Samuel Dixneuf et Philippe Rahmy-Wolff
Samuel Dixneuf et Philippe Rahmy-Wolff ![]() Lambert Savigneux et Lambert Savigneux (ben oui)
Lambert Savigneux et Lambert Savigneux (ben oui) ![]() Christophe Sanchez et Brigitte Célérier
Christophe Sanchez et Brigitte Célérier ![]() sur twitter et en 9 twits chacune, Claude Favre @angkhistrophon et Maryse Hache @marysehache (elles ont choisi de publier les deux textes chez celle qui a un blog : Maryse Hache)
sur twitter et en 9 twits chacune, Claude Favre @angkhistrophon et Maryse Hache @marysehache (elles ont choisi de publier les deux textes chez celle qui a un blog : Maryse Hache)![]() Catherine Désormière et Dominique Hasselmann
Catherine Désormière et Dominique Hasselmann![]() Murièle Laborde-Modély et Jean Prod'hom
Murièle Laborde-Modély et Jean Prod'hom
Jean Prod’hom
Mise à ban

Cʼest une poignée de ruines qui serrent les coudes à lʼécart de la grandʼ route où frémissent des couronnes de chardons, les oiseaux lâchés dans la campagne ne sʼy attardent guère. Le gros des souvenirs a rejoint depuis longtemps le silence des albums, le temps avance au ralenti. Un inconnu traverse la cour, les yeux fixés sur le mélange de terre et de gravier dont son visage a gardé lʼempreinte. Pas de grandiloquence chez lʼhomme, ni regrets ni hâte, pas de pire non plus dans des lieux livrés autrefois au travail, à la douleur, aux plaisirs. Mais qui donc sʼen souvient ? La fin va son bonhomme de chemin. Lʼinconnu avance délivré de rien, ouvert à tout, loin de la providence et des bonnes manières. Il a renoncé aux vaines entreprises, la sueur ne goutte plus dans la poussière de la cour que le silence serre aujourdʼhui de toutes parts. Au milieu des ruines sʼest établi lʼabandon.
Il y a dans ce corps qui nous lâchera un jour, à lʼécart, un lieu où patientent les images de ce qui fut. Il y a dans la tête, dans le coeur, ailleurs peut-être, des images vivantes que rien ne menace, indemnes comme les bris de verre. Elles sʼéloignent sans jamais disparaître, rien nʼen sort ni ne sʼy ajoute, elles tremblent comme la chevelure des linaigrettes. Loin de la disgrâce.

Photo / Michel Brosseau
Barbelés sectionnés, fers tordus et bancs de rouille, les barreaux se font rideaux. Les tôles battent de lʼaile, les portes défoncées bâillent, le vent fait grincer le portail par lequel entre et sort le temps gagné et le temps perdu. Les pillards ne sont quʼun vieux souvenir, personne ne songe plus à y entrer. Le portail fermé par un triple collier de chaînes sʼouvre majestueusement sur rien. Ni sursis ni restauration, une pente à peine, les fruits de lʼéglantier, des herbes sèches, quelques simples dans des pots de terre cuite sur le rebord des fenêtres. Tout peut encore attendre.
Ce nʼest quʼune image à lʼarrière de la tête, yeux mis-clos, ou ailleurs peut-être, nourrie par le silence qui pousse depuis dessous et les itinéraires de la mémoire. Nul besoin de gouvernail ni dʼétrier, lʼimage va de son pas à la manière des disparus dans un bouquet de friches. Ce nʼest quʼune image, lʼimage dʼun temple clos ouvert à tous vents que font vivre le lierre et la mauvaise herbe, une image pour ôter les peurs, celles du labyrinthe et du temps qui passe. Lʼusure remue lʼinusable fin des choses, bris de faïence, fenêtres borgnes, cheminées et briques muettes. Les vieux crépis en attestent, les morts ne se réveillent pas.
Lʼhomme est né dans lʼabandon, y retourne allégé lorsquʼil se débarrasse de ce quʼil croyait être ses biens, sʼy retrouve comme il y fut, sans peine et sans consolation, ici où les feuilles dansent, ou là où lʼaccidentel improvise. Tout y est en lʼétat, un peu passé, éclairé par les brillants dʼune négligence heureuse.
Jʼincline désormais vers lʼavenir de ce qui nʼen a pas, car tout finit pas arriver, la fin aussi, bien avant que la phrase ne se termine, sʼarrondisse avant quʼelle ne sʼéloigne et que je mʼy abandonne.
Lʼoeuvre toujours déjà en ruine, cʼest par la révérence, par ce qui la prolonge, la maintient, la consacre (lʼidolâtrie propre à un nom), quʼelle se fige ou sʼajoute aux bonnes oeuvres de la culture. (Maurice Blanchot)
Publié le 3 décembre 2010 dans le cadre du projet de vases communicants chez Michel Brosseau (à chat perché).
Jean Prod’hom
C'était l'été | Michel Brosseau

Photo / JP
C’était l’été. Deux mois de vacances à passer le long d’une nationale. La 160, elle s’appelait. Une avenue maintenant. Avec zone commerciale et tout un tas de ronds-points. Finie la longue ligne droite pour sortir de la ville. Maintenant c’est par là qu’on y entre. À ça aussi, il faudra s’y atteler. Dans quelque temps. Quand un peu plus costaud pour aller creuser paysage et mémoire. Ce qui de strates sous les parkings des magasins. De soi et des autres. Des lieux qu’on quitte et des ciels qui vous poursuivent. C’était l’été. Et rien à faire sinon tourner en rond dans un jardin. C’est terrible un jardin. Même immense vous tombez toujours sur la clôture. Et quand celle-ci est nationale… Des paquets de voitures qui défilaient là. Ça descendait de partout jusqu’à la côte. Des banlieusards, des gars du Nord. Et puis de Tours, Orléans… De là où j’écris ces lignes aujourd’hui. Deux mois de vacances et une station-service pour voisine. Un oncle maternel qui la tenait. Une idée de la grand-mère. Au temps des premières bascules. Quand les bagnoles en masse et que déjà vendre le lait des vaches ne rapportait plus grand-chose. Du temps où c’était « à l’américaine » qu’il fallait vivre. Commencer à. Pompistes à casquettes avec logo de la marque. Ici, aux marches de l’Anjou et de la Vendée comme au fin fond de l’Arizona. Gamin, le plaisir que c’était de se déguiser avec. Taillée comme celle de La Fureur de vivre ou à peu près. Mais ça, c’est bien après qu’on l’a découvert. Quand enfin la nationale invitait à mettre les bouts. Bien plus tard. Bien après ces étés à jouer les grouillots sur la piste de ciment gris. Gratter les pare-brises. Faire la pression des pneus. Repeindre les bordures en blanc. Et puis des pleins et des pleins. Expliquer la route aussi. Pour Saint-Jean de Monts, c’était facile. Au premier feu rouge à droite. Après la casse automobile, juste sur la droite, c’était la vieille route du May. Celle-là, il fallait pas la prendre. Au feu rouge seulement, à droite !... Noirmoutier qu’était indiqué. Pourquoi pas Saint-Jean-de-Monts, ça moi j’en savais rien. De toute façon, à l’époque, la mer qu’était à une centaine de bornes de là, je l’avais vue quoi ? Deux, trois fois… Et encore, pour le Mont-Saint-Michel, j’avais été malade comme un chien. Une drôle de première fois. Et pour la mer et pour le restau. J’étais resté à l’arrière de la D.S. pendant que les grands étaient allés manger. À me reposer et grignoter des « paillettes d’or ». Des gâteaux tout légers qui passaient tout seuls… Dommage ! Parce que tout était bon, apparemment. À part peut-être les haricots. Jamais aussi tendres que ceux du jardin. Et puis les fils… Mais tout ça avait peu d’importance. Ce qui comptait pour moi à ce moment-là, c’était les dos d’âne et puis la suspension hydraulique. Et que le tonton, il avait le pied un peu lourd. Comme presque tous les mécanos à ce qu’on disait. Une bagnole, fallait qu’elle montre ce qu’elle avait dans le ventre… Qu’elle marche ou qu’elle dise pourquoi… C’était l’été, et les bagnoles défilaient sur la piste. Coffres chargés ras la gueule. Et accrochées derrière des caravanes. Elles qui me sont revenues en regardant cette caravane noyée dans le végétal. Et puis en tirant le fil. Lequel, des mots ou du souvenir, ne me demandez pas. C’est là et ça suffit. Matériau disponible et tout ce qui s’y rattache. Le temps de faire le plein, les femmes allaient jeter un œil dans les caravanes. Allaient y chercher une bricole, ou en ramenaient une. Les hommes, eux, tiraient sur l’attelage. Réajustaient le fil de la prise. Donnaient un ou deux coups de pied dans les pneus. « Et d’ici, pour aller aux Sables-d’Olonne… » Dans ces cas-là, j’appelais le tonton. « Ils voudraient aller aux Sables !... » Nous, on disait Saint-Jean, Les Sables… Les mots, à défaut des lieux, nous étaient familiers. Les Sables !... Certes pas le bout du monde, mais c’était avant qu’il aurait fallu tourner avant. Le boulevard périphérique qu’il aurait fallu prendre… À une centaine de mètres avant la station. Même si, pour les Sables, ils auraient aussi pu filer tout droit. Mais en théorie seulement ! Parce que traverser la ville avec ce qu’ils avaient au cul… Non, le mieux c’était de faire demi-tour. Une ligne blanche au milieu de la nationale, mais on avait le droit quand même. Si on regardait bien, on voyait qu’elle était pas tout à fait continue. Les gars de l’équipement ils avaient fait exprès de peindre comme une espèce de pointillés. Pas un vrai pointillé, mais pas non plus une vraie ligne continue. Comme quoi, en discutant autour d’un godet, on obtient plus qu’en allant remplir de la paperasse… Si ça circulait trop, le tonton se mettait en travers de la route en écartant les bras. Gendarme amateur. Une fois les bagnoles arrêtées, il faisait des grands signes pour qu’il passe vite fait, l’autre, avec sa caravane. « Allez, allez !... » Par pitié qu’il faisait ça. Parce que c’était quand même drôlement malheureux de voir des gars qui s’embarquaient sur des distances comme ça sans mieux savoir manœuvrer. Faut dire qu’on était bien placés pour voir ce que ça donnait tous ces gars qui conduisaient jamais autant que l’été. Il était allé en chercher combien le tonton avec la dépanneuse ? De ces gens de passage qu’avaient raté le panneau qu’indiquait Les Sables. Faut dire aussi que c’était mal foutu. La Roche, qu’ils avaient été mettre sur leur panneau. Pas Les Sables, La Roche-sur-Yon. Même si, en principe, quand tu pars comme ça, tu te notes toutes tes étapes sur un bout de papier et t’es tranquille. Mais non ! Tellement pressés de partir, tu penses ! Faut dire qu’on serait p’t’être pareils à vivre dans des appartements, machin… Toujours est-il qu’y en a combien qui se sont emmanchés d’aller faire demi tour pour récupérer le boulevard périphérique ? Et vas-y que je te tourne au beau moment où y en a un autre qui déboule ! Ah ! ça pardonne pas… Choc latéral, comme ils disent aux assurances. Et encore quand c’est que de la tôle… Mais t’en as qu’emmanchent drôlement dans la ligne droite… Alors là, j’te dis pas !... Le tonton, il remorquait les épaves jusqu’à la station. C’était pas la place qui manquait. Elles restaient là un bout de temps, en attendant que les experts viennent faire leur boulot. Je traînais autour quand il y avait pas trop de clients. Je jetais un œil dans les voitures. Des jouets des fois sur la banquette arrière. Parmi tout un tas d’objets en vrac. Et l’intérieur des caravanes éventrées… Ça faisait de quoi méditer tous ces chez soi fragiles. Ces destins en suspens. Peut-être ça que j’apprenais autour des caravanes. Que rien n’est aussi permanent qu’il n’y paraît. Ça et puis la mort. Cette façon qu’elle a d’être là sans avoir à se montrer.
Michel Brosseau

écrit par Michel Brosseau qui m’accueille chez lui sur son site à chat perché dans le cadre du projet de vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.
Et d’autres vases communicants ce mois :
![]() Daniel Bourrion et Urbain trop urbain
Daniel Bourrion et Urbain trop urbain![]() François Bon et Michel Volkovitch
François Bon et Michel Volkovitch![]() Christine Jeanney et Kouki Rossi
Christine Jeanney et Kouki Rossi![]() Anthony Poiraudeau et Clara Lamireau
Anthony Poiraudeau et Clara Lamireau![]() Samuel Dixneuf-Mocozet et Jérémie Szpirzglas
Samuel Dixneuf-Mocozet et Jérémie Szpirzglas![]() Lambert Savigneux et Silence
Lambert Savigneux et Silence![]() Olivier Guéry et Joachim Séné
Olivier Guéry et Joachim Séné![]() Maryse Hache et Cécile Portier
Maryse Hache et Cécile Portier![]() Anita Navarrete Berbel et Landry Jutier
Anita Navarrete Berbel et Landry Jutier![]() Anne Savelli et Piero Cohen-Hadria
Anne Savelli et Piero Cohen-Hadria![]() Feuilly et Bertrand Redonnet
Feuilly et Bertrand Redonnet![]() Arnaud Maïsetti et KMS
Arnaud Maïsetti et KMS![]() Starsky et Random Songs
Starsky et Random Songs![]() Laure Morali et Michèle Dujardin
Laure Morali et Michèle Dujardin![]() Florence Trocmé et Laurent Margantin
Florence Trocmé et Laurent Margantin![]() Isabelle Buterlin et Jean Yves Fick
Isabelle Buterlin et Jean Yves Fick![]() Barbara Albeck et Jean
Barbara Albeck et Jean![]() Kathie Durand et Nolwenn Euzen
Kathie Durand et Nolwenn Euzen![]() Juliette Mezenc et Loran Bart
Juliette Mezenc et Loran Bart![]() Shot by both sides et Playlist Society
Shot by both sides et Playlist Society![]() Gilles Bertin et Brigitte Célérier
Gilles Bertin et Brigitte Célérier![]() Michel Brosseau et Jean Prod'hom
Michel Brosseau et Jean Prod'hom
Jean Prod’hom
Friedrich Heinze de Rendsburg

Je rêvais en 1983 d’une série de récits coperniciens. Il n’y en eut qu’un. Voici à quoi aurait ressemblé le second si j’avais tenu parole.
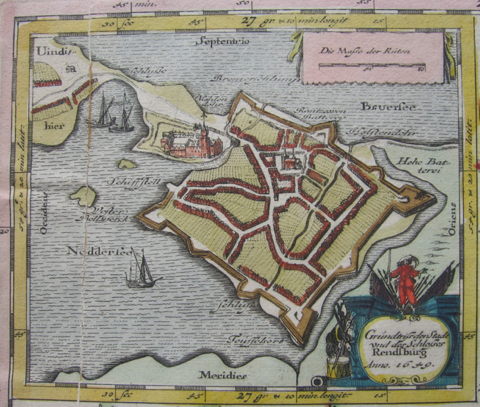
Rendsburg
Friedrich Heinze de Rendsburg rêvait enfant des merveilles du monde. Plus tard il lut assidûment les récits qu’en avait faits Marco Polo et rencontra quelques-uns des aventuriers de son temps. Il se mit en chemin le 8 mai 1650, à la conquête des pays du levant, avec l’espoir démesuré de rejoindre l’horizon et saisir en leur langue les légendes de la terre.
Il fit une première longue halte sur la rive droite de l’Oder, surpris par le sabir que parlaient les autochtones, une langue en quinconce qui avait bien un lointain air de famille avec la sienne, mais qu’il comprenait à peine et de travers. Il passa tout l’hiver à en faire façon, c’est-à-dire à s’y glisser et à la faire sienne. Il y parvint au printemps de l’année suivante et s’y trouva si bien qu’il demeura sur les rives du fleuve une année encore à deviser avec ceux qui s’y étaient établis. Il nota quelques-uns des nombreux récits qu’on lui fit. Il ne leva le camp et ne continua son chemin que lorsque les cigognes blanches installèrent leur nid sur les hauts clochers des villages de Silésie.
C’est à la fin du mois de mai que Friedrich reprit donc son havresac et marcha sans compter en direction de la mer Noire, jusqu’à l’hiver qui engourdit les innombrables bras du delta du Grand Fleuve où il fit halte. Les moeurs avaient changé, les yeux des femmes lançaient d’autres feux et les brumes paressaient certains jours jusqu’au soir. La langue aussi, un sabir encore, mais un sabir de sabir qui établissait sa grammaire en d’autres lits, faisait entendre des chants inouïs et creusaient des paysages éblouissants qui n’avaient rien à voir – ou si peu – avec ceux du Schleswig qu’il avait laissés derrière lui. Il s’arrêta là une paire d’années, s’y acclimata. Il apprit la langue, écouta les histoires tandis que la neige tombait comme jamais sur le delta.
Il reprit la route un printemps en laissant derrière lui les terres qu’il avait apprivoisées, une langue et des gens qu’il avait aimés.
Pour disposer de l’inconnu et des mots obscurs qui l’accueillaient au détour des régions où il fit halte, il lui fallut chaque fois déployer une attention nouvelle : nouvelle grammaire, nouveau lexique pour nommer les choses, écouter les épopées, demander un morceau de pain et goûter aux chants de la terre. Il suivit saison après saison la pente des langues, leur thalweg ou leur relief, s’éloignant ainsi toujours plus de la sienne dans le berceau de laquelle il était né, tant et si bien qu’il la perdit de vue et en fut comme desséché. Il voyagea ainsi en direction du levant, par terre et par mer trente ans durant avant de se retrouver aux portes de Rendsburg où demeuraient ceux qu’il avait quittés.
Ne restait ceint autour des reins du vagabond qu’un peu de maigreur avec un havresac vide et des lambeaux de souvenirs, quelques mots et un rien de bonheur, une béate ignorance en contrepartie de l’énigme qui ceinture la terre.
Les hivers et les printemps qui suivirent son retour ne lui suffirent pas pour apprivoiser la langue dont il s’était éloigné. Il demeura le restant de ses jours dans son pays pour y voir clair, faire façon de la langue la plus étrange, la plus extraordinaire, la plus inconcevable qui, à mesure qu’il en déchiffrait des pans, enfouissait plus profondément ses secrets.
On raconte que l’homme de Rendsburg aima comme au premier jour la femme qu’il avait quittée autrefois, cette femme qu’il ne reconnut pas et qui l’aima elle aussi, une seconde fois pour la première fois.
Publié le 1 octobre 2010 dans le cadre du projet de vases communicants chez Marianne Jaeglé (Décablog)
Jean Prod’hom
Copie double | Marianne Jaeglé

Sophie et moi avons été amies. Après avoir été inséparables, deux années durant, après avoir écrit des poèmes ensemble, fait du théâtre ensemble dans la troupe du lycée, et aimé le même garçon (qui a opté pour elle, ce que je comprenais parfaitement et dont je n’ai nullement pris ombrage) nous avons vécu un premier clash. La troupe de théâtre amateur dont nous faisions partie m’a désignée pour tenir le premier rôle féminin dans Caligula et Sophie, qui se destinait alors au théâtre, s’est inscrite dans une troupe concurrente et a rompu toute relation avec moi. De cette rupture, qui m’a laissée très désemparée, j’ai beaucoup souffert.
Deux ans après cette fâcherie, nous nous retrouvons en hypokhâgne, loin de nos familles respectives, dans un établissement inconnu, parmi des élèves dont aucun ne nous est familier ; un rapprochement stratégique a alors lieu. Cette année-là, je ne peux plus rivaliser. Sophie est de loin la meilleure de la classe, titre que j’ai remporté sans effort tout au long de ma scolarité mais auquel je ne peux plus prétendre. A l’âge de 15 ans, j’ai sombré dans une léthargie qui semblait devoir durer toujours. Je n’ai plus de force pour rien, pas même pour lire. M’extirper du lit chaque matin réclame déjà un effort démesuré, alors les cours… J’ai pourtant été admise en classe préparatoire en raison de notes flatteuses obtenues au bac de français ; je vis sur mon passé de bonne élève.
Sophie elle, a de l’énergie et de l’ambition à revendre. Elle excelle dans toutes les matières et les profs chantent ses louanges. Ses copies remportent de loin les meilleures notes dans toutes les matières. Je les lis pour comprendre ce qu’il aurait fallu faire, ce que j’aurais dû écrire, moi qui n’y arrive plus. Je me souviens ainsi d’un de ses devoirs de philosophie (il s’agissait d’une dissertation consacrée à la nostalgie, littéralement la « douleur de ce qui n’est plus ») ; parmi les remarques flatteuses de l’enseignante justifiant l’excellente note qu’elle lui avait attribuée, quelque chose me brûle au fer rouge de l’envie. Je ne me souviens que vaguement des annotations consacrées à la rigueur du raisonnement, à la finesse de la démonstration et à l’érudition des références, remarques auxquelles, pour ses copies, je suis désormais habituée, mais quelque chose me fait tressaillir de jalousie, et vingt ans plus tard, je n’ai pas oublié cette sensation. « Le passage concernant le vieux meuble m’a donné à penser que vous devriez peut-être écrire » avait marqué madame Jeandot parmi ses commentaires. Après avoir lu cela, je parcours en hâte la copie de Sophie, cherchant le signe de l’élection que notre professeur a su repérer dans cette copie et qu’elle n’a hélas pas vu dans les miennes. En dépit de la dépression dans laquelle je m’enfonce, je n’ai pas cessé de penser à l’écriture comme à une planche de salut, de rêver à elle.
Le passage en question, accompagné d’un trait rouge dans la marge, est un paragraphe comparant la mémoire à un meuble d’autrefois, encombré de bibelots et de témoignages du temps passé. Je le lis à plusieurs reprises, non sans perplexité. Qu’est-ce que madame Jeandot y voit ? Il ne m’évoque rien d’autre que J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans. Je n’y vois rien de spécial, sinon des réminiscences de Baudelaire, que madame Jeandot ne peut pas ignorer. Je finis par me rendre à l’évidence : il y a là quelque chose que je ne sais pas voir, ce qui est une preuve de plus de mon insuffisance. Une fois encore, j’admets que je ne serai pas à la hauteur de ce à quoi j’ai aspiré. Une fois encore, je renonce à l’écriture.
Et ce souvenir cuisant en appelle un autre avec lui, où Sophie apparaît, encore elle, la même année. Nous sommes toujours amies, d’une amitié de surface, travaillée en profondeur par une faille béante, toujours agitée de secousses. Notre attachement est une glace fragile.
Nous sommes assises toutes deux au dernier rang de la classe, au fond à droite, mais pas côte à côte. Il y a deux places libres entre nous. Je suis assise du côté salle tandis qu’elle est du côté mur. L’année scolaire est déjà bien avancée et les rôles de chacun bien définis. L’an prochain, Sophie ira à Paris, dans une khâgne prestigieuse, à la conquête de l’avenir brillant qui l’attend. Elle intègrera ensuite Normale sup, cela ne fait de doute pour personne. Pendant ce temps-là, j’irai grossir les rangs des dilettantes et des gens au futur indécis à la fac de Lyon.
Ce jour-là, le prof de français rend les copies ; nous savons que, comme à son habitude, il les a classées et les distribue sadiquement par ordre décroissant : les premières vont aux bons élèves, puis, au fil des copies, les notes baissent. Ainsi, chacun sait où les autres et lui-même se situent dans la hiérarchie de la classe. Il s’approche de notre rangée dans l’allée centrale et, sans rien dire, pose la première copie devant moi. Je la saisis et m’apprête à la faire glisser jusqu’à Sophie, quand quelque chose retient mon attention. L’écriture sur la copie n’est pas celle, ronde et régulière, qui figure d’ordinaire sur ses devoirs. C’est une écriture heurtée et anguleuse, qui m’est familière. Je ramène le devoir devant moi, et commence à lire avec intérêt ce que le prof y a inscrit.
Monsieur Cara s’est éloigné, continuant à distribuer les dissertations. A ma droite, une voix sifflante, furieuse retentit : « Je peux avoir ma copie, s’il-te-plaît ? » Et les dernières apparences de notre amitié éclatent en mille morceaux dans ce sifflement de colère. Je lève la tête vers Sophie, je lui montre la feuille. « C’est la mienne » dis-je, tandis qu’elle se confond en excuses.
Aucun prof, à aucun moment de ma vie, n’a jamais écrit en marge de mes copies que je devrais écrire. A dire vrai, personne, jamais, ne m’a encouragée dans cette voie. Mais mon envie de l’écriture était si profondément ancrée en moi qu’elle a fini, comme ces plantes minuscules qu’on voit parfois en montagne pousser dans l’anfractuosité de la roche, à force d’obstination, par surmonter les obstacles les plus durs, par croître, vivre et fleurir au grand jour.
Bien des années plus tard, j’ai appris ce que Brel pensait du talent. « Le talent, disait-il, ça n’existe pas. Le talent, c’est l’envie qu’on a de faire les choses. »
Marianne Jaeglé

écrit par Marianne Jaeglé qui m’accueille chez elle dans le cadre du projet de vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.
Et d’autres vases communicants ce mois ![]() Brigitte Célérier http://brigetoun.blogspot.com/
Brigitte Célérier http://brigetoun.blogspot.com/ ![]() Lambert Savigneux http://aloredelam.com/
Lambert Savigneux http://aloredelam.com/![]() François Bon http://www.tierslivre.net/
François Bon http://www.tierslivre.net/![]() Daniel Bourrion http://www.face-terres.fr/
Daniel Bourrion http://www.face-terres.fr/![]() Michel Brosseau http://àchat perché.net
Michel Brosseau http://àchat perché.net![]() Joachim Séné http://www.joachimsene.fr/txt/
Joachim Séné http://www.joachimsene.fr/txt/![]() Christophe Grossi http://kwakizbak.over-blog.com/
Christophe Grossi http://kwakizbak.over-blog.com/![]() Christophe Sanchez http://fut-il-ou-versa-t-il.blogspot.com/
Christophe Sanchez http://fut-il-ou-versa-t-il.blogspot.com/ ![]() Christine Jeanney http://tentatives.eklablog.fr/
Christine Jeanney http://tentatives.eklablog.fr/ ![]() Piero Cohen-Hadria http://www.pendantleweekend.net/
Piero Cohen-Hadria http://www.pendantleweekend.net/![]() Cécile Portier http://petiteracine.over-blog.com/
Cécile Portier http://petiteracine.over-blog.com/![]() Anne Savelli http://fenetresopenspace.blogspot.com/
Anne Savelli http://fenetresopenspace.blogspot.com/![]() Juliette Mezenc http://juliette.mezenc.over-blog.com/
Juliette Mezenc http://juliette.mezenc.over-blog.com/ ![]() Louis Imbert http://samecigarettes.wordpress.com/
Louis Imbert http://samecigarettes.wordpress.com/![]() Michèle Dujardin http://abadon.fr/
Michèle Dujardin http://abadon.fr/![]() Jean-Yves Fick http://jeanyvesfick.wordpress.com/
Jean-Yves Fick http://jeanyvesfick.wordpress.com/ ![]() Guillaume Vissac http://www.omega-blue.net/
Guillaume Vissac http://www.omega-blue.net/ ![]() Pierre Ménard http://www.liminaire.fr/
Pierre Ménard http://www.liminaire.fr/![]() Marianne Jaeglé http://mariannejaegle.overblog.fr/
Marianne Jaeglé http://mariannejaegle.overblog.fr/ ![]() Jean Prod'hom http://www.lesmarges.net/
Jean Prod'hom http://www.lesmarges.net/![]() David Pontille de Scriptopolis http://www.scriptopolis.fr/
David Pontille de Scriptopolis http://www.scriptopolis.fr/ ![]() Running Newbie http://runningnewb.wordpress.com/
Running Newbie http://runningnewb.wordpress.com/ ![]() Anita Navarrete-Berbel http://sauvageana.blogspot.com/
Anita Navarrete-Berbel http://sauvageana.blogspot.com/ ![]() Gilda http://gilda.typepad.com/traces_et_trajets/
Gilda http://gilda.typepad.com/traces_et_trajets/ ![]() Matthieu Duperrex d'Urbain trop urbain http://www.urbain-trop-urbain.fr/
Matthieu Duperrex d'Urbain trop urbain http://www.urbain-trop-urbain.fr/![]() Loran Bart http://leslignesdumonde.wordpress.com/
Loran Bart http://leslignesdumonde.wordpress.com/ ![]() Geneviève Dufour http://lemondecrit.blogspot.com/
Geneviève Dufour http://lemondecrit.blogspot.com/ ![]() Arnaud Maisetti http://www.arnaudmaisetti.net/spip/spip.php?rubrique1
Arnaud Maisetti http://www.arnaudmaisetti.net/spip/spip.php?rubrique1 ![]() Jérémie Szpirglas http://www.inacheve.net/
Jérémie Szpirglas http://www.inacheve.net/![]() Jacques Bon http://cafcom.free.fr/
Jacques Bon http://cafcom.free.fr/ ![]() Maryse Hache http://semenoir.typepad.fr/
Maryse Hache http://semenoir.typepad.fr/![]() Candice Nguyen http://www.theoneshotmi.com/
Candice Nguyen http://www.theoneshotmi.com/ ![]() Nolwenn Euzen http://nolwenn.euzen.over-blog.com/
Nolwenn Euzen http://nolwenn.euzen.over-blog.com/![]() Olivier Beaunay http://oliverbe.blogspirit.com/
Olivier Beaunay http://oliverbe.blogspirit.com/
Jean Prod’hom
Revenir là où on n’en a pas fini d’aller

Cette image forte m’est restée, tout ce que j’ai ensuite appris de ce jour-là s’est accroché sur elle.
Jean-Loup Trassard, La Déménagerie, 2004
Poivrons, pommes, courgettes et aubergines au croisement du Valentin et de Riant-Mont, abricots, oignons et cerises, fraises et melons au gré des saisons, c’était notre Sicile à nous, celle de Zappelli, un modèle réduit de Borgo Vecchio, une île exotique au pied de locatifs en cale sèche et de studios modernes vieillis prématurément. L’homme ouvrait son épicerie dès l’aube, elle fleurait le sud bien au-delà du quartier, c’était Palerme alentour à toutes les saisons.
La mère chargée comme une mule remonte du centre-ville, elle tire d’un côté sa poussette de marché, de l’autre un enfant qui s’attarde devant les merveilles, il faut se hâter, bientôt midi. Le petit tend la main et saisit une paire de grosses cerises, belles, rouges et craquantes, croque et boit le soleil retenu dedans, il est aux anges. La mère s’est retournée, elle a surpris l’enfant mais ne dit rien. Ils continuent, passent devant la boulangerie, montent les marches qui conduisent à l’appartement. Et tandis que l’enfant croque le cœur de la seconde cerise, sur le pas de la porte, la mère range les courses au fond des placards de la cuisine. Et puis elle se penche vers son enfant et lui explique ce dont ses demains seront faits, il ne comprend pas. Elle s’étend sur les règles du monde, la loi des échanges, il ne comprend toujours pas, mais il voit quelque chose qui s’éloigne, ce n’est pas grave, lui dit-elle, ce n’est pas un crime mais quand même. Elle lui souffle alors le texte qu’il devra servir tout à l’heure à l’épicier, dans lequel il est question d’excuses et de pardon. Il commence à comprendre et semble deviner qu’on le conduit dans l’antichambre d’une histoire sans fin, elle ferme la porte des placards, celle du frigo et de la dépense. Les fers du grand portail claquent. L’enfant sent qu’il a basculé dans l’autre monde.
Monsieur Zappelli, les mains dans les poches de son tablier bleu, écoute avec bienveillance l’enfant qui lui dit ce que chacun d’entre nous dit depuis qu’il est sorti du jardin. L’enfant n’est pas triste, il fait son devoir. La mère surveille soulagée que tout se passe finalement si bien. Ils sont tous les trois sur le trottoir, ils sourient presque, avec tout près les aubergines, les abricots et les cerises qui n’ont pas cessé de lancer leurs éclats. L’enfant est heureux d’être parmi eux, il ignore encore ce qu’il a perdu. Eux s’en rappellent, et sur les visages immobiles de l’épicier et de la mère apparaît un sourire qui exprime un sentiment inconnu. Ce n’est pas un sourire, à peine une trace, la trace de ce qui coule au-dessous des souvenirs et qu’il leur a bien fallu tenir à distance. Une porte se ferme encore, et voici l’enfant, l’épicier et la mère à la rue.
Car on n’échangeait rien au jardin, en tous les cas rien de main à main, les bruits du vent peut-être et un peu des poussières du ciel qu’on remuait sans qu’on le sache. On ne touchait à rien, ou on prenait tout, on se touchait à peine, ou on ne faisait qu’un. On demeurait toujours à respectable distance les uns des autres et on arpentait l’île sans se lasser. Qui était-on ? A peine des coques de noix chahutées sur une mer qu’on ne partage pas. On ne se parlait pas, on suçotait le trèfle, on faisait fuir l’hiver, on disait ce qui était. C’est l’écho de nos proférations que renvoyaient les façades des immeubles qui définissait les limites de notre royaume, abrité par les hautes frondaisons de deux acacias et d’un tilleul, par des sureaux, par les ronces qui s’enroulaient autour de fers acérés, invisible limite au-delà de laquelle nos mots ne revenaient pas. Aucun mur ne nous a jamais retenus, c’était curieux comme on avait tout dans les mains et qu’on ne s’y trompait pas. On est tous partis lorsqu’on nous a fait comprendre qu’il était temps d’aller de l’autre côté. Le grand portail que surveillait la mère Niquille a claqué une fois encore derrière Michel, François, Claude-Louis, Edith, Lilas et les autres. On a tout perdu. Et le royaume qu’on avait sous la main, on a essayé de l’obtenir, chacun pour soi, morceau par morceau, en suivant le parcellaire levé par d’anciens propriétaires et la dure loi des échanges, en vain.
Chaque fois qu’une porte s’ouvre désormais, je guigne pour savoir si l’enfant que j’étais n’a pas réintégré le jardin qu’il a quitté, celui d’avant les échanges sans lesquels il ne serait pas devenu celui qu’on attendait. J’aperçois toujours la même ombre et les fleurs d’un cerisier, je serre alors, conservés au fond de mes poches, les tessons qui m’ouvrent les portes de ce qui n’aurait jamais eu lieu autrefois si je n’y retournais pas.

Publié le 3 septembre 2010 dans le cadre du projet de vases communicants chez Joachim Séné (Fragments, chutes et conséquences)
Jean Prod’hom
Guide de l'Imrie I Joachim Séné

PSTOPH
Imrie, Province du Pnou
32 000 habitants (Pstophiens)
Ville à éviter + + +
Ils n’ont ni plus ni moins de colère que nous, ni plus ni moins de bonheur que nous et pourtant les Pstophiens crient sans cesse. Leur ville est située dans l’Enclave de Cône, petite cité dans la montagne au sud du Pnou, tout au fond d’un cirque impraticable. D’après l’ethnologue Roba Silmour, le volume sonore de leur voix est le résultat d’une longue sélection sociale. Les puissants organes des Fanors, lignée de chefs, furent chassés du pouvoir comme ils y étaient venus : au cri. Ce jour là, vers 500, le peuple dans la rue cria, et parmi les crieurs les plus puissants furent envoyés devant. Aussitôt que les Fanors eurent abdiqués ceux de devant prirent leur place. Leur facilité à parler fort leur permit de s’imposer et de durer tout en faisant taire les oppositions, de plus faible volume. Après quelques années de tyrannie la population compris son erreur et on procéda de nouveau au cri vociférant et insurgé qui propulsa sur le trône de nouveaux crieurs qui surent et remplacer le pouvoir en place et faire comprendre au peuple son intérêt à les laisser là. Etc. La pratique du cri devint la pratique politique, puis la pratique sociale. Sans cri, pas de pouvoir. Sans cri, pas de place au théâtre. Sans cri, pas de place à l’école. Sans cri, pas viande fraîche au marché. Sans cri, pas de bon salaire. Sans cri, pas de place dans le bus, pas d’allocations familiales, pas de cadeau d’anniversaire, pas d’essence, pas d’eau, pas de café, rien ; sans cri pas d’existence vraiment.
Cela dure encore. Aujourd’hui, le volume sonore moyen d’un seul Pstophien est plus fort qu’un chœur de quatre de nos ténors. C’est à dire qu’ils parlent ainsi, naturellement, comme nous ne pouvons même pas hurler à mort. Sans s’en rendre compte, ils tendent les muscles de leur cou, ouvre la bouche en faisant descendre la mâchoire jusqu’au bas du cou, ont le visage rouge, les yeux exorbités, et cela pour vous indiquer seulement l’heure ou vous demander de leur passer le sel. On remarque aussi les larges épaules, les cages thoraciques développées, les ventres ronds et les nez proéminents où résonne la parole.
Roba Silmour n’a pu visiter longtemps cette ville, victime d’une extinction de voix chronique et ayant perdu plus de la moitié de ses capacités auditives en quelques semaines.
Il arrive qu’un Imrien sourd parte s’exiler là-bas. Aucun n’est jamais revenu, ils préfèrent y rester. Parfois c’est un Pstophien muet qui s’en va, chassé par la force des choses, ignoré, exclu, banni de fait. Il ne nous raconte rien, incapable de répondre à des questions qui ne sont pour lui que vagues murmures.
Lors d’une randonnée le long du Cône, sans même aller vers la cime de la chaîne circulaire qui enserre l’enclave, vous entendrez une rumeur incessante qui déboule le long du versant et descend mourir en roulant dans la vallée : ce sont les conversations de la ville qui émergent continûment, comme les fumerolles suivent l’éruption.
Joachim Séné

écrit par Joachim Séné qui m’accueille chez lui dans le cadre du projet de vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.
Et d’autres vases communicants ce mois ![]() Christine Jeanney et Pierre Ménard
Christine Jeanney et Pierre Ménard ![]() Joachim Séné et Jean Prod'hom
Joachim Séné et Jean Prod'hom ![]() Michel Brosseau et Christophe Sanchez
Michel Brosseau et Christophe Sanchez ![]() Kouki Rossi et Florence Noël
Kouki Rossi et Florence Noël![]() Anita Navarrete Berbel et Piero Cohen Hadria
Anita Navarrete Berbel et Piero Cohen Hadria![]() Maryse Hache et Florence Trocmé
Maryse Hache et Florence Trocmé![]() Anne Savelli et Loran Bart
Anne Savelli et Loran Bart![]() Daniel Bourrion et Brigitte Célérier
Daniel Bourrion et Brigitte Célérier![]() Arnaud Maïsetti et Stéphanie K
Arnaud Maïsetti et Stéphanie K
Saisons

Certains d’entre eux écrivaient leur volonté dans le ciel au lance-flammes, ils brûlaient des pans entiers de la nuit pour éclairer la route des jours suivants. Mais rappelez-vous, ils crevaient, et les éclairs se joignaient au tonnerre. Ils voulaient, disaient-ils, infléchir le cours des choses, les arracher des mains de ceux qui en avaient fait le fond d’un vilain commerce; prendre les devants, écarter les injustices, établir l’égalité, partager les richesses, supprimer les privilèges. Se reposer enfin avec un rêve, celui de revenir un jour au jardin de l'hypothétique origine. Et ils chantaient des refrains entêtants : un peu d’humanité, la sieste, quelques cacahuètes, un coin d'ombre. Des bartasses, de l'eau aussi, et un peu de vide pour respirer. Ils se sont battus rageurs, pierres, arbalètes, épées à simple ou double tranchant, flèches, boulets hurlants, pavés dans le ciel, de la brusquerie parfois, et un peu de haine au fond des yeux. Les éclairs et les orages se mêlaient à leurs cris. Ils avaient l’impression que ça avançait, et qu’ils y parviendraient. Pas eux bien sûr, mais leurs enfants ou leurs petits-enfants au moins. Ils alignaient chaque matin sur la table de la chambre les deux ou trois raisons pour lesquelles ils se levaient en sifflotant. Parfois le sang coulait et ils changeaient le monde, et le temps était de la partie.
Les voici tout près du couchant, toujours rien, manquant de tout. Adieu le siècle des Lumières, raté le rendez-vous pris à l’âge de la raison avec l'âge nouveau, amour et loisirs : le volcan crachote des confettis, révolution des oeillets, révolution de safran, de velours, révolution des roses, l'orange, celle du cèdre, celle des tulipes.
Ils n’ont plus rien, plus même d'habitudes, l'histoire s'est retournée sans qu'on le veuille et le temps s'est retiré. Pieds dans la glu d’un dernier tour qui fait vis sans fin, bouleversement silencieux, profond, invisible. Et on cale, la volonté abolie, en panne de l'avant, condamnés à nous retourner – lorsqu’on y parvient – et à nous adosser au jour qui s’en va. On aperçoit alors au levant les éclairs qui se joignent au tonnerre, et on voit se lever les commencements dont il nous reste à décrypter le chiffre. On se détourne de l'histoire épuisée, du couchant qui l’emmène dans son lit, et on va à reculons en faisant le dos rond, avec pour seule lumière celle de l’aube qui éclaire les pas qui nous ont amenés là, flux tendu qui ne mène nulle part. Dans notre dos le soleil se couche et les pavés sont dans la mare, le pire est arrivé, l’histoire n’a pas tenu ses promesses, elle quitte le devant de la scène. Il nous faudra désormais faire sans son vacarme et accueillir une version inédite du temps.
Publié le 4 juin 2010 dans le cadre du projet de vases communicants chez Jeanne (Chez Jeanne)
Jean Prod’hom
Entrer dans le jour | Jeanne

je n'y arrivais pas
je me refusais d'entrer dans ce jour
je voulais attendre (si je l'atteignais) la nuit
les couleurs se seraient atténuées
la lumière tamisée
j'y verrais sans doute plus clair
mais là, non, je ne pouvais pas être de ce jour
rien pour changer d'avis
rien autour
et la nuit s'est glissée là
heureuse rencontre
et la nuit s'est posée là
dans ces marges
et tout est revenu
comme si je m'observais d'ailleurs
à me souvenir des heures passées en douces compagnies
à entendre (et pouvoir entendre) de nouveau ces rires
alors
j'ai fermé les yeux
et j'ai vu ces grands champs fleuris de jonquilles que j'aurais pu ne jamais connaitre
me suis retrouvée sur quelques chemins rêvés menant aux clairières isolées
de ma besace ouverte où m'attendaient patiemment quelques livres
j'en ai sorti le plus usé, le plus écorné - celui qui me laisse écrire dans ses marges
celui qui me laisse là, dans son espace littéraire
je me suis assise là, à l'ombre d'un saule pleureur (pour sa fraîcheur et son chant dans le vent)
quelque crayon à la main, précieusement, j'entrais en lecture
ce soir, cette nuit
je sais
je le sais
je ne peux évidemment qu'être là
dans ces champs de mots pour éviter qu'ils ne brûlent, éviter qu'ils ne me brûlent
je préfère les laisser glisser (pas en torrent)
les laisser être de ces ruisseaux qui s'écoulent lentement
qui, certains de leur place, passent paisiblement près des saules pleureurs
ces espaces, si vastes.. si conquérants..
je suis conquise - toute entière à leurs causes
je ne veux, ne peux être qu'en eux
entre ces lignes..
et.. tout autant..
dans leurs marges..
Jeanne
![]()

écrit par Jeanne qui m’accueille chez elle dans le cadre du projet de vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.
Et d’autres vases communicants ce mois :![]() Christine Jeanney et Jean-Yves Fick
Christine Jeanney et Jean-Yves Fick![]() Tiers livre et Dominique Pifarely
Tiers livre et Dominique Pifarely![]() Joachim Séné et Urbain, trop urbain
Joachim Séné et Urbain, trop urbain ![]() Morgan Riet et Murièle Laborde Modély
Morgan Riet et Murièle Laborde Modély ![]() France Burghelle Rey et Denis Heudré
France Burghelle Rey et Denis Heudré ![]() Florence Noël et Anthony Poiraudeau
Florence Noël et Anthony Poiraudeau ![]() Anne-Charlotte Chéron et Christophe Sanchez
Anne-Charlotte Chéron et Christophe Sanchez ![]() Maryse Hache et Pierre Ménard
Maryse Hache et Pierre Ménard ![]() Louis Imbert et Arnaud Maïsetti
Louis Imbert et Arnaud Maïsetti ![]() Michel Brosseau et Brigitte Célérier
Michel Brosseau et Brigitte Célérier ![]() Jeanne et Jean Prod'hom
Jeanne et Jean Prod'hom
Jean Prod’hom
Hors jeu

Il ouvre les yeux sur un jour sans attrait. Alors il baisse les paupières qu’il glisse sous l’oreiller et il se terre. Forclos, rideaux tirés, chassé dès le réveil, c’est clair il n’en sortira pas. L’éprouver et le dire n’y change rien, la lumière insiste, il remue à peine, incapable d’en appeler au courage. Ce matin le jour est fané.
On devra se rendre à l’évidence, aucune transaction n’écartera le soleil de sa course, il faudra faire avec ce qu’il traîne derrière lui, les besognes auxquelles la vie parmi nos semblables nous oblige pour être des leurs. Ça durera ce que ça durera, jusqu’au soir peut-être. On hésite même à plier bagages, à solder l’entreprise, pour se débarrasser enfin des tâches fastidieuses qui nous incombent, au risque de finir sa vie plus tôt que prévu, avant le crépuscule. Pourquoi ne pas fuir sur le champ les humiliations promises ? Mais un peu de raison nous rattrape : il en faudrait du courage pour s’engager sur cette voie et s’y tenir, sans que les regrets et la mauvaise conscience ne nous rejoignent avant midi.
On se lève donc parce qu’on sait que ce soir, pour autant qu’on y parvienne, on pourra retourner dans le tambour de la nuit qu’on aurait voulu ne pas quitter, pour y être à nouveau enfermé, tourné, retourné, préservé, lavé. On se lève donc en sachant qu’on n’ira nulle part. On fera pourtant comme si on en était et personne n’en saura rien. On se fera petit, tout petit, invité surnuméraire : ne toucher à rien, n’entrer en matière sur rien avec qui que ce soit, demeurer muet calé dans l’ombre, mais y demeurer avec tous les égards que le rien doit à ce qui est et à ceux qui s’y sont embarqués. A bonne distance, ne pas en être, refuser toute invitation et survivre jusqu’au soir. Un sourire ici, un autre là, une politesse en guise de viatique, pas plus, pour ne pas casser.
On s’y essaie, on sème nos petites lâchetés pour donner le change et passer inaperçu, cacher sa misère. Mais qu’on ne nous accable pas, on essaie simplement de garder la tête hors de l’eau, un ou deux sourires à ceux qu’on croise, sans y toucher, fonds de poche que celui qui n’a rien à perdre dépose dans la main de celui qui veut tout, ni victime ni coupable, innocent de n’être rien, au diable les plaintes. Tout à l’autre par calcul, tout aux autres pour sauver sa peau. On se rend compte alors que ceux-ci sont comme nous, mais ils sont dedans et on est dehors, on ne bronche pas et ils sont ballottés. Et voici qu’ils répondent à nos sourires, sourient à leur tour, nous remercient de notre sollicitude et de notre bienveillance alors qu’on n’a pas quitté le rivage, ancré à l’inavouable. Mais ça ils ne le savent pas et on ne le leur dira pas. On les voit batailler pour rester debout dans la tourmente du jour et notre misère souriante est à leurs yeux comme un réconfort. On est resté dans la nuit, ils sont dans le jour. On ne voulait rien, défait, vidé, et nous voilà élevé au rang de contrefort.
Et soudain, de don modeste en modeste don, de sourire en sourire monte la sensation d’être présent comme jamais, dedans le monde sans qu’on le veuille, avec en face ceux qui bataillent pour ne pas succomber ou être chassés. On se prend à en faire plus qu’on n’en a jamais fait, sur un mode qu’on ignorait, simplement pour que ces inconnus courageux ne s’effondrent pas. On leur cache un peu de la vérité, on ferme les yeux, on souhaite qu’ils atteignent vivants la fin de la journée.
Ce soir je suis comme une plaie vivante que la brise et l’ombre viennent caresser, je me retourne, heureux d’avoir passé debout ce qui aurait pu être un enfer, l’air glisse sur la peau, avec la lumière, ma raison est au point mort. Ce que j’ai laissé en arrière, la nuit, le fond du jardin, les racines auxquelles je m’agrippais pour remonter le talus n’ont pas changé. Le temps s’est arrêté là-bas, par delà les jours, les images, les souvenirs qui ne retiennent que ce qui se défait. Les chemins durent bien après qu’on les a quittés.

Je me retrouve sur le chemin de la Mussily, indemne, étonné d’être là. Tous les jours pourraient être ainsi, n’est-ce pas ? On demeurerait sur le seuil, on ne toucherait à rien, parce qu’au fond on n’y croit guère. On n’en serait pas, on aiderait d’un sourire ceux qui sont embarqués et on cueillerait quelques rameaux pour en être un peu.
On n’y voit bientôt plus rien, je rentre, dépose mon ombre au pied du lit, me glisse dans le grand tambour de la nuit avec le sentiment crépusculaire d’avoir encore une fois sauvé ma peau et la fierté de ne jamais avoir été aussi généreux, solide et transparent que ce jour où je ne fus pas.
Publié le 7 mai 2010 dans le cadre du projet de vases communicants chez Arnaud Maïsetti (Journal | contretemps)
Jean Prod’hom
Des marges | Arnaud Maïsetti

Du centre, je ne saurai rien dire ; rien que le silence dans lequel vautré le matin au réveil qui me prend — rien que. Et du centre, au cœur, le terrain des batailles politiques rangées des idées qu’on se lance ; non, rien : le centre, ils savent bien qu’il est à eux, alors moi, à contretemps qui pèse la lumière du jour, qu’est ce que je pourrais : et quand je les regarde, dans les repas le soir où parfois je suis, que je les entends dire la pensée du monde figée depuis ce centre qu’ils occupent, je pense à ce qui s’en va, loin du centre où — du centre centré au milieu des villes, c’est le vide, c’est là que les flux se rejoignent, s’arrêtent, cessent, enfin. Moi, c’est ailleurs, où les flux vont, et d’où ils partent, que je vais.
Du centre, je sais bien, oui : que c’est là qu’est la moyenne, que les discours se font — mais pas la parole, que les discours — c’est là. Où Dieu habite, la pensée de Dieu telle que le formulent ceux qui au centre, sont au centre et décident, planifient, rédigent pour nous les pactes du siècle, concluent pour nous les poignées de mains et les tarifs, et les peines, les planchers, la hauteur de la lame qui viendra tomber sur celui qui ; du centre, non, quand on me demanderait mon avis, je me tairai bien pour les années qui viennent.
De la morale éteinte en moi, de la religion éteinte en moi, du souci de la politique : des centres d’intérêts qui fondent le centre autour duquel : je ne sais dire que cela m’échappe. Je ne saurai prétendre lui échapper. Et surtout, je ne voudrait pas m’en plaindre. Mais. Les choses mortes comme de la peau, on ne les regrette pas : on gratte, et si ça saigne, on aspire un peu pour ne pas laisser de trace — et on frotte, on essuie. On met son doigt dans la plaie, et comme Thomas, on fouille pour vérifier le corps ; et le corps est bien là. Loin du centre, on marche, on est déjà loin, ça peut s’appeler Arar, ou Breschwiller, ou plus loin encore, état des lieux du réel, chaque pas nous en éloigne, du centre : et on va.
On se trouve de l’autre côté où les choses prennent la vitesse du temps ; on n’est plus dans le silence : on le parle, depuis le centre, arraché vraiment. On tombe sur une place vide, derrière le palais royal, les jardins de boue, il y a une église où on entre parce qu’il pleut. Il y a des chants au-dedans, qui viennent se heurter à la croyance de mon adolescence comme une paroi effondrée, et l’écho pénètre dans le vide qui l’absorbe. C’est Bach, c’est au-delà de moi, c’est en plein de centre du monde, pile où je ne suis pas.
Dans les marges sans contours que j’arpente jusqu’à mourir (je le sais bien, je l’accepte), à force de les écrire parce qu’en moi tout l’exige, noter les bruits du monde qui m’entoure — et puisque ces bruits ne peuvent s’entendre qu’aux marges, marges fracassées dans le crâne (et de plus en plus, ces maux de tête qui me cernent : marges là encore : prix à payer, je m’en acquitte, sans ciller) — des chants de Bach, des voix qui percent, n’en saisir que la morale possible : la morale d’une beauté sans Dieu ; arracher Dieu à cette beauté qui seule me maintient là, pulsation du temps que je bats sous les doigts, un mot après l’autre, dire un peu dans sa propre bouche le monde tel que dans les marges il afflue hors.
Au centre rien ne bouge, dans les marges, il y aurait la force de ne pas habiter, nulle part, et d’aller au pas qui l’emporte, les mondes possibles que les voix défrichent : musique sans mélodie, nappes de voix qui parlent allemand une langue impossible et qu’on ne comprend pas — mais combien chaque mot avance l’impossibilité même d’y prendre part : et comme on avance en eux, le monde qui recule, et au bout du premier pas, c’est dans les marges qu’on est : on ne se retourne plus.
Arnaud Maïsetti
![]()

écrit par Arnaud Maïsetti qui m’accueille chez lui dans le cadre du projet de vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.
Et d’autres vases communicants ce mois :![]() France Burghelle Rey et Morgan Riet
France Burghelle Rey et Morgan Riet ![]() Anna de Sandre et Francesco Pittau
Anna de Sandre et Francesco Pittau![]() Anthony Poiraudeau et Loran Bart
Anthony Poiraudeau et Loran Bart![]() Mathilde Roux et Anne-Charlotte Chéron
Mathilde Roux et Anne-Charlotte Chéron![]() Michèle Dujardin et Daniel Bourrion
Michèle Dujardin et Daniel Bourrion![]() Christophe Sanchez et Le coucou
Christophe Sanchez et Le coucou![]() Antonio A. Casili et Gaby David
Antonio A. Casili et Gaby David![]() Michel Brosseau et Christine Jeanney
Michel Brosseau et Christine Jeanney![]() Matthieu Duperrex et Pierre Ménard
Matthieu Duperrex et Pierre Ménard![]() Joachim Séné et Franck Garot
Joachim Séné et Franck Garot![]() Tiers livre et Kill me Sarah
Tiers livre et Kill me Sarah![]() Juliette Mezenc et Ruelles
Juliette Mezenc et Ruelles![]() Marianne Jaeglé et Brigetoun
Marianne Jaeglé et Brigetoun![]() Florence Noël et Juliette Zara
Florence Noël et Juliette Zara![]() Soupirail et Jeanne
Soupirail et Jeanne![]() Cécile Portier et Luc Lamy
Cécile Portier et Luc Lamy![]() Chez Jeanne et MatRo7i
Chez Jeanne et MatRo7i![]() Landry Jutie et Notes&parses
Landry Jutie et Notes&parses![]() Piero Cohen-Hadria et Pendant le week-end
Piero Cohen-Hadria et Pendant le week-end
Jean Prod’hom
Hameau

Le soleil levé avant l’aube essore le ventre gras de la compostière, Corentin est au bois. À Pra Massin les fenêtres sont grand ouvertes, c’est le printemps, la grande affaire. Personne dans la maison, les rideaux font le dos rond, caressent en retombant la tablette de la fenêtre, un signe de la main, c’est le cru de la cave qui monte prendre l’air. Mais on respire là-dedans, les braises rougeoient et on devine, enveloppés d’ombres, la veste de Corentin, le linge à mains près de la cheminée, un semainier, l’évier de porcelaine ébréché. La nappe sur la vieille table en bois, quelques fruits, un marron et un gland, des clous sortis du fond des poches. Personne pourtant, les rideaux faseyent, c’est le monde immobile qui appareille. Dehors, c’est comme dans les livres, mais la terre a le ventre mou, les crocus et les nivéoles sont détrempés. Les mésanges bataillent, les pierres sonnent creux, le ruisseau sort de son lit. Repousser les mots, ne pas prolonger pour l’instant une intrigue qui n’a pas commencé. Il sera assez tôt lorsque le soleil déclinera d’effeuiller les images, décoller morceau par morceau les lambeaux des récits qui tiennent debout nos vies. Quelques mots devraient suffire à la fin, lorsque l’ombre se sera dérobée, lorsqu’on verra s’éloigner les nuages et le vent, et le dedans aller dehors. Deux ou trois choses laissées là pour rappeler la légende de mars, comme s’il y eût quelqu’un autrefois, mêlé aujourd’hui aux ombres des noyers sur la pente qui mène au ciel. Avec derrière une autre maison, les volets fermés, dedans une vieille qui a tout laissé dehors, comme si elle allait y retourner.
Mais lorsqu’on lève les yeux pour reprendre à la ligne, plus bas, les yeux n’obéissent plus. Est-ce ainsi ? est-ce bien ainsi ?
Publié le 2 avril 2010 dans le cadre du projet de vases communicants chez Juliette Zara (Enfantissages)
Jean Prod’hom
Le déclin du jour | Juliette Zara

Au fond, je vis comme sur une île.
Louise était appuyée contre le garde-corps. Le vent, un peu insistant, faisait danser devant son visage les mèches qui avaient échappé à leur lien.
J'ai le corps englué dans les choses et l'âme aspirée par l'horizon. Encerclée. Quelque chose doit poindre là-bas. Quelque chose, oui, quelque chose. Je dévore l'horizon et toujours elle, toujours elle qui point. Cette attente. Jamais ici, toujours là-bas. Jamais maintenant, toujours plus tard. La vie à attendre que quelque chose se passe, la vie, une série de buts à atteindre à perte de vue. Un désir de terminus.
Louise, Louise... dans sa vie bien rangée cherchait le terme et le sens. L'attente sonnait en rythme les percussions de ses heures, de ses jours, de ses années. L'attente était l'ogresse qui dévorait toutes ses offrandes, sa vie. Conjuratoire. Être là. Impossible pour Louise, enracinée dans ce lancer de pierre, ricochet suspendu au-dessus des eaux. Être là, appuyée au garde-corps. Le vent, un peu fort, semblait complice de cette succion de son âme vers d'invisibles lointains qui ne viendraient jamais jusqu'à elle.
Les jours passent, vacants. Retirés. Dans le silence qui précède ce qui doit arriver et qui n'arrive jamais. Je passe, en souffrance, comme un corps que personne ne vient réclamer.
Oh ma Louise, je le regardais ton horizon et c'est à une étonnante pavane que j'assistais. Une ligne se démultipliait et se tordait en volutes au loin devant nous, dans la pulsation colorée du soir. Le ciel fondait tout entier dans les grandes orgues d'un brasier aussi pénétrant que ton regard. Je frissonnais au trissement des hirondelles qui racontaient leurs voyages dans les terres australes. Et ta silhouette se découpait sur ce décor, dans le crépuscule. J'apercevais tout juste le coin de tes yeux à l'affût, qui brillaient au reflet de cet effondrement de tout espoir toujours recommencé, le déclin du jour.
D'un jour qui renaît chaque matin.
Juliette Zara
![]()

écrit par Juliette Zara qui m’accueille chez elle dans le cadre du projet de vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.
Et d’autres vases communicants ce mois :
Kouki Rossi et Luc Lamy
Pendant le week-end et Ruelles
Marianne Jaeglé et Anthony Poiraudeau
Cécile Portier et Loran Bart
Christophe Sanchez et Murièle Laborde Modély
Christine Jeanney et Kathie Durand
Sarah Cillaire et Anne Colongues
France Burguelle Rey et Eric Dubois
Fleur de bitume et Chez Jeanne
Mathilde Rossetti et Lambert Savigneux
Antonio A. Casilli et David Pontille
RV.Jeanney et Jean-Yves Fick
Brigitte Giraud et Dominique Hasselmann
Guillaume Vissac et Juliette Mezenc
Michel Brosseau et Arnaud Maïsetti
Florence Noël et Brigitte Célérier
François Bon et Laurent Margantin
Michèle Dujardin et Olivier Guéry
Juliette Zara et Jean Prod’hom
écrit par Juliette Zara qui m’accueille chez elle dans le cadre du projet de vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.
Jean Prod’hom
Le chemin des Meilleries

Il maintenait à bonne distance la Corbassière de la Possession, en déroulant ses naïvetés au pied d’une haie de noisetiers, de sureaux et de jeunes bouleaux, longeant un pâturage assiégé par les ronces et les lampées qui glissait en pente douce jusqu’au Rio de Nialin. On l’appelait le chemin des Meilleries. C’était un chemin de terre à double ornière, bordé par deux talus qui se faisaient face tout au long, pas mécontents en fin de compte de cette saignée. Et lorsque le soleil de mars avait chassé la neige, le chemin et les deux talus rasés de près se réveillaient, et ça c’était beau à en pleurer.

De la boue dans le creux des ornières, trois flaques pour recueillir autant de fois le ciel et nourrir nos printemps, deux talus qui nous enseignaient la voie à suivre en offrant un refuge aux coquelicots, aux bleuets, aux fleurs qui refusent d'obéir. Guère plus.
Le chemin des Meilleries semblait ne jamais devoir vieillir, il ne craignait ni l’abandon ni le passage des épareuses. Quant aux talus ils faisaient l’école buissonnière jour et nuit, un peu d’herbe sur les épaules, ou de la neige, ou des graminées, un reste de colza, rien même parfois, et des enfants assis dessus qui tiraient des plans dont ils riaient avant même d’entreprendre quoi que ce soit. En mai, tandis qu'on chassait les papillons ou qu'on explorait la haie, les moineaux rejoignaient en grappe les rives du Nialin, Jean-Pierre, Elisabeth, Claude-Louis, Corentin, Edith, Dominique, tous on levait les yeux au ciel et on riait à tire-d’aile.
Au coeur même de cette ferveur le chemin restait discret et les talus souriaient à peine, ils nous enseignaient la bonne distance. Sans doute avions-nous tendance à choisir le plus court, mais il convenait de choisir parfois le plus caché pour être entre nous. Pas d’indicateur de direction, qui donc pouvait savoir où on était et où on allait?
Une seule et ancienne saignée, un chemin creux d’un seul tenant, sans raccords, dans lequel on entrait sans sésame, une végétation d'espèces modestes, le cri du geais pour rameuter ceux qui s’éloignaient et chasser ceux qui s’approchaient. Et les moineaux, encore, qui indiquaient la direction que nous suivrions un jour.
Sur le talus on construisait des châteaux, on tissait d’idée en idée d’improbables itinéraires faits de noms, de rêves traversés par des sentiers qui faufilaient de nouveaux domaines selon les lignes de nos désirs. Rien ne s’y insérait, rien ne s’y emboîtait, tout s’y déplaçait comme des plaques tectoniques vives. M’en restent un rythme, des souvenirs et quelques détails nichés dans des morceaux de langue, des mots de laine : l’arc des frênes, la rouille des ormeaux, les fleurs de l’acacia, les fruits noirs du merisier, les samares et la pluie de l'été.
Tout était à notre disposition et on suivait sans raison l’inclinaison la plus ténue pour nous livrer sans retenue à des aventures qui duraient quelques jours. Après l’école on vivait sur les pentes d’un volcan.
Le chemin des Meilleries en valait un autre, et c’était tant mieux, la haie et la pente du pâturage nous préservaient des méchantes envies. On avait tout. Mais on ne se souvenait pas de tout, pire, le soir on se souvenait de rien. C’est pour cela qu’on y retournait chaque jour. Et chaque jour on y fendait la mer, et la mer se refermait derrière nous, on se balançait d’un pied sur l’autre et on volait de talus en talus.
On regardait parfois en direction des villages immobiles de l’autre côté de la Broye, on voyait bien les chemins qui y conduisaient. Le nôtre on ne le voyait pas, pas même un trait entre rien et rien, mais un immense pétrin d'où levèrent nos plus belles histoires.
Le chemin des Meilleries a disparu, il a disparu lorsqu’on a rectifié le tracé de la grande route. Je baisse les yeux, un coup d’oeil par dedans pour me souvenir de quelques-uns des signes de nos printemps, à ce qui a été, aux feuilles mortes qui fusaient lorsque le soleil revenait, aux reflets du ciel dans les flaques qu’on barattait, à la lumière et aux ombres avec lesquelles on montait au paradis, au craquement de la glace, au pâturage désert, à la maison abandonnée, aux Gibloux enneigés, à Brenleire et à Folliéran.
Plus une trace, pas même le silence assourdissant qu’on entend le long des voies de chemin de fer à l’abandon, ou le silence de guillotine des sentiers qui s’arrêtent net, ou celui sans fond des carrefours. Rien, seulement un souvenir, le souvenir d’une invraisemblable épopée.
Une dernière ondulation fermait l’horizon, aux confins de notre territoire où se dressait un frêne sans âge. Là on se redressait un instant, on oubliait nos jeux et on levait la tête par-dessus les montagnes. On aurait aimer aller au-delà, c'était impossible, plus loin ce n’était plus chez nous. On s'en retournait, mais je crois que cette impossibilité on l'aimait bien.

Un jour on quitte tout pour s’assurer de la secrète cohésion du monde, repérer les motifs qui le constituent, écouter les gémissements de la terre, la rumeur qui porte le tout. Plus tard on revient sur nos pas et on devine enfin ce qui nous a porté la première fois.
J'ai choisi un caillou avant de prendre le chemin d’Emaney, je l'ai poussé du pied d’une ornière à l’autre en le faisant rebondir sur les talus. Je l'ai mené aussi loin que j'ai pu, jusqu’au pied du Luisin, avant de le glisser dans ma poche.
C’est lui qui m’attend ce matin sur le perron, c’est lui que je serre lorsque le chemin s'enfonce dans les herbes hautes.
Publié le 5 mars 2010 dans le cadre du projet de vases communicants chez Nathanaël Gobençaux (LES LIGNES DU MONDE)
Jean Prod’hom
Autogéographie | Nathanaël Gobenceaux

Montage : Nathanaël Gobenceaux
Autogéographie en footballeur
(JE ME SOUVIENS des années football)
… Lausanne Sport – Neuchâtel Xamax - Grasshopper – Zurich – Servette Genève - AJ Auxerre - Girondins de Bordeaux - D’aussi loin que je me souvienne, j’ai dû m’intéresser au foot vers mes 7 ou 8 ans… - US Boulogne CO - Grenoble Foot - Le Mans UC 7 - …j’ai acheté nombre de France Foot que je ne me résous pas à jeter et qui encombrent ici ou là… - RC Lens - Lille OSC - FC Lorient - Olympique lyonnais - JE ME SOUVIENS DES ECUSSONS DORES QUE NOUS COLLIONS SUR UNE CARTE DE FRANCE ; LES VILLES ET LES CLUBS, GEOGRAPHIE ET FOOTBALL ; ASSOCIATION SPORTIVE DE MONACO, FOOTBALL CLUB DE METZ, OLYMPIQUE MARSEILLE, ASSOCIATION DE LA JEUNESSE AUXERROISE, RACING CLUB DE LENS, STADE RENNAIS… - Olympique de Marseille - AS Monaco - Montpellier HSC - AS Nancy-Lorraine - OGC Nice - …les plus anciens doivent dater de la fin des années 1980’… - Paris SG - Stade rennais - AS Saint-Étienne - FC Sochaux - Toulouse FC - …je me rappelle particulièrement, à chaque intersaison (l’intersaison en foot correspond aux mois de juillet et août, quand les joueurs sont en vacances et en profitent pour changer de club)… - Valenciennes FC - M'gladbach – Nuremberg- Leverkusen - JE ME SOUVIENS, LISANT LA GAZZETTA DELLO SPORT DANS UN IMMEUBLE DE SCANDICCI, DEVANT LES RESULTATS DE LA COUPE UEFA, ETRE TOMBE SUR UN CERTAIN BAYERN MONACO. BIZARRE, Y AURAIT-IL UNE AUTRE VILLE QUE LA PRINCIPAUTE A AVOIR CE NOM ? J’ENQUETE, FEUILLETTE LE JOURNAL JUSQU’A LA PAGE DU CHAMPIONNAT ALLEMAND ET LA JE COMPRENDS : EN ITALIEN, MUNICH SE DIT MONACO. – Wolfsburg - Stuttgart – Hambourg - Bochum – Hoffenheim - … des cartes présentant les différentes villes & équipes en compétition pour l’année à venir… - Hanovre - Werder Brême - Hertha Berlin – Mayence - Bayern Munich - …peut-être mes premières cartes non scolaires… - Borussia Dortmund – Schalke 04 – Cologne – Francfort - JE ME SOUVIENS DE GUY ROUX, LE MANAGER D’AUXERRE, DISANT AVANT UNE RENCONTRE DE COUPE D’EUROPE CONTRE LA FIORENTINA DE BAGGIO, QU’IL VOULAIT BIEN ENLEVER LE PONTE VECCHIO DE L’ARNO POUR LE METTRE SUR L’YONNE. – Fribourg - Man. City - Bolton - Portsmouth - Sunderland - Wigan - Stoke City - …c’est ainsi que j’ai appris que Rosario était en Argentine, que Santiago du Chili abritait le club de Colo Colo… - Fulham - Burnley - Arsenal - Liverpool - Aston Villa - Man. United - …qu’Anderlecht était un quartier de Bruxelles… - West Ham - Birmingham - Wolverhampton - Tottenham - Blackburn - Hull City - Everton - JE ME SOUVIENS DE PISE, DEVANT LA TOUR PENCHANTE, CHEZ DES MARCHANDS AMBULANTS, D’Y AVOIR ACHETE LES FANIONS DE PLUSIEURS GRANDES EQUIPES EUROPEENNES : CEUX DE L’AJAX AMSTERDAM, DU MILAN AC, DE LA FIORENTINA, DE L’AS ROMA ; JE ME SOUVIENS QUE PLUS TARD ON M’OFFRIT CEUX DU SPORTING LISBONNE ET DU REAL MADRID DE CHENDO, MICHEL ET BUTRAGUEÑO. – Chelsea - Genk - Lokeren - Zulte-Waregem - Roulers - La Gantoise - …c’est ainsi que j’ai appris à situer Glasgow, Cologne ou Eindhoven sur une carte… - Saint-Trond - Courtrai - Cercles Bruges - Westerlo - Charleroi - …c’est comme ça aussi que j’ai appris qu’Auxerre, bien que grand club de foot n’est en fait qu’une petite ville de 40 000 habitants… - FC Bruges - Standard Liège - Anderlecht - Malines - Aberdeen - Celtic - Hamilton - JE ME SOUVIENS AVOIR PRIS PARTI POUR LE BARÇA PLUTOT QUE POUR LE REAL LE JOUR OU J’APPRIS QUE LE REAL ETAIT LE CLUB DU ROI, L’ANCIEN CLUB SOUTENU PAR FRANCO ALORS QUE LE FC BARCELONE REPRESENTAIT PLUTÔT L’ANTI-FRANQUISME. - Motherwell - Hearts - Falkirk - Kilmarnock - St Johnstone - St Mirren - Dundee United - Rangers - Hibernian - …que le PSG est le club des quartiers Ouest de Paris, que le Red-star 93 est celui des anciennes banlieues communistes… - Gijon - Valence - Xerez - Real Madrid - Villarreal - Athletic Bilbao - Espanyol - La Corogne - Valladolid - Saragosse - …je situais donc tout cela sur la carte, sur la mappemonde ou dans l’atlas… - Getafe - Almeria - Santander - Malaga - FC Séville - Osasuna - Atlético Madrid - Barcelone - Tenerife - Majorque - JE ME SOUVIENS D’UN AMI ME RAPPORTANT D’ANGLETERRE UN MAILLOT ROUGE DE MANCHESTER UNITED. - Milan AC - Udinese - AS Roma - Palerme - Sampdoria - Fiorentina - Cagliari - Bari - Catane - Atalanta - Chievo - Sienne - Juventus - …je parcourais le monde des Andes à la Yougoslavie, de Tromso (Norvège) à l’Ajax Cape Town (Afrique du Sud)… - Genoa - Livourne - Bologne - Parme - Lazio Rome - Naples - Inter Milan - NEC Nimègue - NAC Breda - Vitesse - FC Twente - Heerenveen - Ajax - ADO Den Haag - Willem II - AZ Alkmaar …j’apprenais ainsi que les noms en –ic viennent de l’ex Yougoslavie, ceux en –ev de Bulgarie, les noms en –ski de Pologne, les en –sky plutôt de Russie… - Roda JC - Utrecht - Feyenoord - Groningen - Waalwijk - Sparta Rotterdam - VVV Venlo - Heracles - PSV - P.Ferreira - Sporting - Benfica - Belenenses - Leixões - Porto - Leiria - Setubal - Academica - JE ME SOUVIENS D’UN VOYAGE EN ANGLETERRE ; J’ACHETAIS DES MAGAZINES DE FOOTBALL, J’APPRENAIS DES MOTS -QUI NE M’ONT PAS SERVI DEPUIS- TELS QUE ‘WINGER’, GOALKEEPER OU ENCORE LEFT BACK ; PLUS TARD, J’APPRENDRAIS LES TRADUCTIONS ITALIENNES DE BUTS : RETI, GARDIEN : PORTIERE, ENTRAINEUR : TECNICO OU ALLENATORE. - Olhanense - Nacional - Rio Ave - Braga - Maritimo - Naval - V.Guimarães - Sion - St-Gallen - Lucerne - Aarau - Bâle - Bellinzona - Young Boys….
Nathanaël Gobenceaux
![]()

écrit par Nathanaël Gobenceaux (géo-graphe. Il égrène sont auto-géo-graphie-s ici et là sur le net et tient les blogs Les lignes du monde et Balzac (par de petites portes) qui m’accueille chez lui dans le cadre du projet de vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.
Et d’autres vases communicants ce mois :![]() Mariane Jaeglé et Gilles Bertin
Mariane Jaeglé et Gilles Bertin ![]() Eric Dubois et Patricia Laranco
Eric Dubois et Patricia Laranco![]() Lignes électriques et Chroniques d'une avatar
Lignes électriques et Chroniques d'une avatar![]() Christophe Sanchez et Yzabel
Christophe Sanchez et Yzabel ![]() Luc Lamy et Anna de Sandre
Luc Lamy et Anna de Sandre ![]() Futiles et graves et Kill that Marquise
Futiles et graves et Kill that Marquise ![]() Christine Jeanney et Arnaud Maïsetti
Christine Jeanney et Arnaud Maïsetti![]() Michel Brosseau et Juliette Mezenc
Michel Brosseau et Juliette Mezenc![]() Frédérique Martin et Denis Sigur
Frédérique Martin et Denis Sigur ![]() Pierre Ménard et Anne Savelli
Pierre Ménard et Anne Savelli ![]() Juliette Zara et Kouki Rossi
Juliette Zara et Kouki Rossi![]() Nathanaël Gobenceaux et Jean Prod'hom
Nathanaël Gobenceaux et Jean Prod'hom![]() Florence Noël et Lambert Savigneux
Florence Noël et Lambert Savigneux![]() Hublots et Petite racine
Hublots et Petite racine ![]() Pendant le week-end et Quelque(s) chose(s)
Pendant le week-end et Quelque(s) chose(s)![]() François Bon et Commettre
François Bon et Commettre![]() Scriptopolis et Kill Me Sarah
Scriptopolis et Kill Me Sarah![]() RV. Jeanney et Paumée
RV. Jeanney et Paumée![]() Anita Navarrete Berbel et Anna Angeles
Anita Navarrete Berbel et Anna Angeles
Post-scriptum
La nuit tombait sur Lausanne, un samedi soir de l’année 1961 ou 1962, ou 1963. Je montais au stade de la Pontaise, la main dans la main de mon père, en suivant la collectrice du Valentin dans laquelle cinq ou six drailles sorties de nulle part déversaient des grappes d’inconnus. Mais la foule ne grossissait vraiment qu’aux Anciennes Casernes, une foule taiseuse, concentrée, qui se préparait à faire face à quelque chose qu’on n’était tous bien incapables de penser. Une folle rumeur montait déjà du puits que creusaient les faisceaux bleu acier des projecteurs. On avait de l’avance, on regardait l’heure, tout montait, montait. Mais il fallait attendre encore un peu, nous taire encore, contenir notre agitation, nos espoirs, avant que la grande affaire n’ait lieu.
On les appelait les Seigneurs de la nuit : Künzi, Grobéty, Tacchella, Schneiter, Hunziker, Dürr, Armbruster, Eschmann, Kerkhoffs, Hosp, Hertig. Chacun d’eux incarnait à sa manière l’un des onze attributs de l’être.
Jean Prod’hom
Pour demeurer enfin quelque part

Pourquoi nous en aller alors que les nécessités qui talonnent ceux qui n’ont rien ne nous y obligent pas ?
Lorsqu’il arriva dans les parages de ce qui devait lui apparaître presque aussitôt avec les traits de l’accompli, il se mit à croire. Croire qu’il avait rejoint le pays rêvé dans lequel il allait désormais vivre, un pays sans heurt et sans couture, avec dedans le silence, l’herbe, les couleurs, les plis des pâturages, quelques habitants, guère plus. La modestie des lieux, leur étrangeté convenue, leur retenue aussi, tout concourait à le retenir. C’était un dimanche, l’invitation semblait ferme. Sa décision fut irrévocable. Quand bien même aucune place ne lui était destinée et que personne ne l’attendait, il conçut le projet d’y demeurer, proche des lisières, à l’autre bout des préjugés, sans rien toucher. Il se fit un nid de fortune et vécut là sans que rien ne lui appartienne.
Il voulut maintenir le pays à bonne distance de son coeur pour en disposer toujours. Mais rien n’y fit, ni les égards ni les ruses. Il s’en éloignait à mesure qu’il y demeurait, incapable de résister aux habitudes qui se glissent dans nos vie – alors qu’on s’était promis de tout faire pour leur interdire l’accès. Il avait l’impression de disparaître à l’intérieur de ce qu’il voulait protéger, comme le fer des clôtures que les arbres avalent. Pris au piège au coeur de ce qu’il avait voulu laisser intact, il se mit à rôder pour retrouver plus loin dans les prés, plus profond dans les bois ce qu’il avait laissé filer, il emprunta le chemin des pâtures en grignotant des biscuits de sésame, s’enfonça dans les ronciers, cartographia les bois, épuisa les carrefours, leva des plans. Il s’y employa avec passion mais c’en était trop, il ne put rien contre les attaques de sérieux dont il lui fut de plus en plus difficile de se déprendre.
Le paradis escompté fondait et ce qui l’avait amené à jeter son dévolu sur ce pays le fuyait. Il ne renonça pourtant pas et s’enfonça plus loin encore dans les bois, il allait à petits pas, ne désespérant pas de rencontrer ailleurs ce qui lui avait filé entre les mains près de sa demeure. Mais c’est l’empire du familier qu’il cadastrait par cercles concentriques, il tirait derrière lui des ruines, comme le parachutiste son barda, il s’empâtait et la peau de chagrin qui grandissait sous ses pas allait l’étouffer.
Il faudra un imprévu sec, l'implacable, la maladie d’un enfant et le sentiment d’abandon qui suivit pour endiguer cette crue. Un matin avant l’aube il infléchit le destin en déposant l’inadmissible dans une mandorle, rendant vie à ce qu’il avait voulu taire ou tout au moins tenir en laisse. Ce jour-là il écrivit pour la première fois, des mots qui le font trembler encore aujourd’hui.
Cette mandorle est toujours là, c’est la porte par laquelle chaque jour ouvrable il quitte un bref instant sa demeure pour retrouver cette autre demeure d’où il considère intact ce qui n’a jamais disparu, le pays de la première heure dont on s’éloigne immanquablement lorsqu’on veut vivre – et on le doit – avec les siens. Il s'arrête d’aller, ramasse un tesson, une miette, celle qui est là ou une autre, pour retrouver dans la mesure de ses moyens, de mot en mot et de proche en proche, comme une prière, le lieu d’où il vient et où nous ne serons bientôt plus, improbable mosaïque, petits voyages successifs, collier de babioles.
Dans cette autre demeure – en est-il d’autres ? – , on n’est presque rien, un filet d’eau, une rumeur transparente, à peine une ombre qui passe, assez maigre pour ne plus faire écran à ce qui fait la joie d’être: pays sans heurt et sans couture, avec dedans le silence, l’herbe, les couleurs, les plis des pâturages. Voici la montage de Lure, la Pierreuse, la dent de Brenleire, le ballon de Servance, voici l’Aigoual, le mont Amiata, j’y suis depuis le début, j’y reste jusqu’à la fin, pays non plus rêvé mais pays de la première heure, de nulle part et partout à demeure, j’y suis comme un plus qui ne compte pas. Ici chez vous ou là-bas chez moi, quelques instants de veille sur un monde qui va qui va. Nous sommes des surnuméraires et c’est bien comme ça.

Publié le 5 février 2010 dans le cadre du projet de vases communicants chez Brigitte Célerier (Paumée)
Jean Prod’hom
Nuit à Bray

L’aiguille des petites vanitées rejoint celle des heures, leurs pointes lancéolées indexent le ciel et lancent douze coups qui tétanisent les contreforts de l’église, derrière son chevet une ombre famélique se hâte. Mais le pathétique n’émeut pas la nuit qui attend son tour. Quelques cris mêlés au vin âcre montent des souterrains du fond de l’impasse et sonnent le glas des dernières espérances : blasphèmes de comptoir, silhouettes brisées, ivresse, échos trébuchants, malheureuses certitudes. Les feuilles mortes ont cessé de danser au pied du réverbère et le clown immobile derrière la devanture du joaillier sourit. C’est le moment que la nuit choisit pour se déplier, et ses plis libèrent une étrange odeur qui rappelle celle du fer et de l’eau, et avec le fer et l’eau les longs soupirs argentés des cathédrales en ruine. Et le fer et l’eau, et les soupirs poussent, poussent, montent de dessous le bitume, serpentent le long des caniveaux, chassent les brumes, balaient les repentirs, font saillir les seuils. Et la nuit confond le paysage en lui reprenant les choses confisquées, un instant seulement, le temps de les disjoindre, de les redresser une à une et de les remettre à leur place, à bonne distance les unes des autres. Plus rien désormais ne demeure en tiers, chaque chose retrouve les coudées franches et les bords que le jour leur avait dérobés, elles retournent à l’insubordonné, buissonnières et mortelles. Tout avance de concert, ensemble et séparément, les aiguilles de l’horloge ont desserré leur étreinte, les cloches leur décompte, chaque chose s’avance nue tête et sans défense. Et la rue bouclée autrefois par le jeu des dépendances s’entrouvre, les panneaux indicateurs qui commandaient le sérieux de nos heures deviennent les majordomes austères d’un songe aux perspectives infinies, les trains ne circulent plus, on marche dans le vif du sujet, dans l’étendue retrouvée.
Convenait-il de construire si haut lorsqu’on veut simplement aller au bout, voir de nos yeux l’effacement des ombres, vivre buissonniers et mortels ?
Publié le 1 janvier 2010 dans le cadre du projet de vases communicants chez Pierre Ménard (Liminaire)
Jean Prod’hom
Découverte | Brigitte Célerier

Trifouiller la serrure. La vaincre, et entrer. Poser dans un coin sa valise. Aller, d'un pas qui se veut ferme, ouvrir les volets, et puis toutes les portes. Chercher où poser son sac et son mobile, pour l'appel des déménageurs. Et puis regarder.
Avec un peu de timidité, une prière, sans vouloir, encore, chercher les défauts éventuels – avec interrogation, une supplique, sans servilité, pour être acceptée.
Chercher à sentir l'espace, l'étendue d'air autour du point où on se tient, et sa qualité. Dire un ou deux mots. Ecouter le son que l'on a, là. Se faire nez, délicatement, pour sentir les odeurs endormies, les promesses.
Aller s'appuyer au mur, à côté d'une fenêtre et face à la porte. Tâter la peau du mur. Le caresser de la main, et lui donner une petite claque. Glisser pour s'assoir sur le carrelage. Sourire à la pièce et à l'avenir. Attendre.
Attendre.
Allonger les jambes. Fermer les yeux. Poser les mains à plat sur les tomettes. Se sentir là, dans cette pièce. Aimer cela.
Attendre - jusqu'à ce que la sonnerie (cette absurde corne de brume que vous avez choisie) vous jette debout, vers la porte et dans l'effroi des murs de cartons qui vont investir l'espace, entre les meubles que les voix grommelantes dans l'escalier annoncent.
Brigitte Célerier

écrit par Brigitte Célerier qui m’accueille chez elle dans le cadre du projet de vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.![]() Aedificavit et Tentatives
Aedificavit et Tentatives![]() Futiles et graves et Juliette Mezenc
Futiles et graves et Juliette Mezenc ![]() à chat perché et Hervé Jeanney
à chat perché et Hervé Jeanney![]() Lieux et Arnaud Maïsetti
Lieux et Arnaud Maïsetti ![]() L’employée aux écritures et Hublots
L’employée aux écritures et Hublots![]() Le blog à Luc et Enfantissages
Le blog à Luc et Enfantissages![]() Koukistories et Biffures chroniques
Koukistories et Biffures chroniques![]() Soubresauts et Kafka transports
Soubresauts et Kafka transports![]() Pendant le week-end et Kill that marquise
Pendant le week-end et Kill that marquise![]() Le Tiers livre et Fragments, chutes et conséquences
Le Tiers livre et Fragments, chutes et conséquences![]() Scriptopolis et CultEnews
Scriptopolis et CultEnews![]() Liminaire et Litote en tête
Liminaire et Litote en tête![]() Les lignes du monde et Abadôn
Les lignes du monde et Abadôn![]() Pantareï et Éric Dubois
Pantareï et Éric Dubois![]() Lignes de vie et Epamin'
Lignes de vie et Epamin' ![]() Les marges et Paumée
Les marges et Paumée
Jean Prod’hom
C'est une cohérence toute neuve | Pierre Ménard

C'est une cohérence toute neuve qui s'offre à nous, les shémas intérieurs se mesurent aux enclos des espaces naturels. C'est une façon de percevoir, j'entends par cela une précision d'horloger. C'est confirmer une sensation de déjà vu. Dernières tentations avec picotement de la pupille. L'enquête s'attache aux moindres intonations. Il suffit d'un shéma simple mais une forme controversée. La forme et le contexte ne s'expliquent pas, la seule concession étant l'origine des secrets. Depuis on peut se dire n'importe quoi dans un bruit assourdissant, cela coule de source, malgré les voix inconcevables d'un travail enfantin. Le bruit dans l'espace clôt une discussion dans un profond sommeil. L'image même de nos intérieurs investit l'espace dans la même dérision. À deux c'est le silence comme de toute constellation assumée, ce qui me laisse le champ libre. Sans doute l'attraction principale est la lumière bleue, la surprise brodée, cette autonomie fixée par nous seuls.
Pierre Ménard

écrit par Pierre Ménard qui m’accueille chez lui dans le cadre du projet de vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.
Et d’autres vases communicants ce mois ![]() Michèle Dujardin et Cécile Portier
Michèle Dujardin et Cécile Portier ![]() Anthony Poiraudeau et Brigitte Célérier
Anthony Poiraudeau et Brigitte Célérier ![]() François Bon et Marc Pautrel
François Bon et Marc Pautrel ![]() Elle c dit et fut il ou versa-t-il
Elle c dit et fut il ou versa-t-il ![]() Christine Jeanney et Juliette Zara
Christine Jeanney et Juliette Zara ![]() Zoe Ludicer et Mot(s)aïques
Zoe Ludicer et Mot(s)aïques ![]() Dominique Boudou et Anna de Sandre
Dominique Boudou et Anna de Sandre ![]() Luc Lamy et Frédérique Martin
Luc Lamy et Frédérique Martin ![]() Hélène Clemente et Isabelle Rosenbaum
Hélène Clemente et Isabelle Rosenbaum ![]() Arnaud Maïsetti et Daniel Bourrion
Arnaud Maïsetti et Daniel Bourrion![]() Pierre Chantelois et Hervé Jeanney
Pierre Chantelois et Hervé Jeanney
Jean Prod’hom