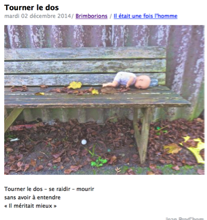Il y a du Jan Vermeer dans ces fins d’après-midi

Cher Pierre,
En échange des heures passées à Grignan, je surveille cet après-midi les arrêts, dans le silence : les têtes de linotte liquident leurs arriérés ; les droits communs ont déposé les armes et se reposent : tenir le haut du pavé à journée faite les oblige à puiser dans leurs réserves, pas mécontents de vivre un instant loin des feux de la rampe, le temps de se refaire une santé. Ils rament léger, un stylo et une feuille, des listes et des trous qu’ils remplissent du bout du doigt, sans réfléchir. Ils vont bientôt aux toilettes, à tour de rôle, en traînant les pieds, s’étonnant d’une tranquillité dont ils ne sont pas familiers. Ils ont déposé en entrant leur fierté sur une chaise vide, nichent leur tête dans leurs bras, pas loin de s’endormir ; se redressent bientôt, inquiets à l’idée que ce bien-être ne les amène à changer quelque chose dans leur vie ; ils ne sont pas prêts, restent sur le qui-vive, personne n’est là pour les accompagner dans cette transition ; ceux qui leur ont promis un soutien ont une vie ailleurs. Alors ils se reprennent, l’état de grâce s’effrite, l’un d’eux couine, un autre grogne ; ils n’ont plus une minute à perdre, plient leurs rêveries, se réinstallent dans leur égo défaillant, si bien qu’ils sont prêts en sortant à rependre la galère, là où ils l’ont amarrée en entrant.

Aujourd'hui ressemble à hier, même hauteur du ciel, même pression atmosphérique, même régime de vent. Je parque derrière le garage, les filles sont dans le jardin, Nicole et Sandra assises sur le granit rose de la fontaine ; je dépose mon barda ; Arthur, qui héberge comme nous tous un être de raison et un indéfectible rêveur, hésite au coin de son lit.
Je monte jusqu'au triage, Oscar rayonne, nous longeons le repaire des bouvreuils, barré par les ronces, traversons la sapinaie jusqu'au refuge de Ropraz, empruntons le sentier qui rejoint le chemin aux copeaux, redescendons sur la route de terre qui mène à Froideville. Oscar me colle aux basques lorsque le sentier se fait sente, prend les devants lorsqu’il s’élargit.
Le grand marais sous la Montagne du Château a perdu la partie, les bouleaux et les aulnes, les saules et les peupliers ont jeté l'ancre. On ne reverra plus ni les canards ni le ciel ; je crains pour la bruyère et les myrtilliers.
Nous n'avons pas de fleuve au Riau, ce fleuve qui nous aurait permis d’organiser le monde en un en-deçà et un au-delà. Cet étang était notre Greenwich, on le voyait où qu’on soit et on dessinait tout autour, lex yeux bandés, des cercles concentriques toujours plus larges qui nous donnaient une exacte représentation du monde. Il nous reste la clairière de la Moille Baudin.
Il y a du Jan Vermeer dans ces fins d’après-midis ensoleillés d'automne, dedans comme dehors, lumière froide et or blanc derrière les carreaux des fenêtres entrouvertes, dentelles d’ombre et coulées de lumière dans les sous-bois.
Jean Prod’hom
Chaque région a son ciel

Cher Pierre,
Chaque région a son ciel et la hauteur de celui-ci varie ; elle résulte de celle de l'horizon, laquelle découle des lignes de la terre, de leur longueur et de leur écartement, de leur enchevêtrement ; mais aussi des bois, de la pente des collines, des cultures, des chemins, de la profondeur des vallons. Ou l’inverse. Mais qu’importe, qu’elle soit première ou seconde, la hauteur du ciel joue un rôle prépondérant dans nos manières d’aller et de penser, de nous lier et de nous séparer, de manger, de nous mettre en colère, de nous égarer : le Jorat n’y échappe pas.

C’est pour cette raison que l’invitation qui m’a été faite de participer à la fête de la paroisse de Mézières, samedi prochain, me réjouit. Parce que l’occasion m’aura été donnée de placer sous le même ciel les deux livres que j’ai écrits et les fruits qui ont mûri, les légumes qui ont poussé et les fleurs qui ont fleuri, les bijoux et les colifichets que des femmes ont polis et cousus à Peney, le pain et les tresses que d’autres ont façonnés à Ropraz ou Corcelles. L’agnostique que je suis se réjouit du culte des récoltes, dimanche, auquel participera le Choeur mixte de Carrouge ; on mangera ensuite du gratin, du jambon et des légumes.
Car si ma vie d’enfant s’est déroulée tout entière à Lausanne, et si mes origines par mon père me lient à Bursins et la Côte lémanique, c’est dans le Jorat que j'ai installé mon campement, il y a longtemps, fondé une famille.
Mon grand-père maternel, né Rossier dans la Broye, s’y est établi à son retour du Pays-d’Enhaut ; ma tante et son mari ont habité Epalinges, ils ont été des familiers de Vucherens ; mes cousines n’ont jamais quitté les environs de Savigny ; mes parents y sont retournés lorsqu’ils en ont eu terminé avec nous.
Je suis né à Lausanne mais n’y suis pas resté, suis remonté dans le Jorat, à cause de la hauteur du ciel.
Jean Prod’hom
Le ciel s'est vidé

Cher Pierre,
La bise a forci, l'air fraîchi, le ciel s'est vidé. Le soleil fait désormais chambre à part, les feux qu’il lancera ne réchaufferont plus ce qu'on a laissé derrière soi. Service minimum jusqu'au printemps.

Minimum dont on goûte l’extrême douceur derrière les baies vitrées de la véranda. Personne n'est pourtant dupe de l'artifice, pas plus de la résistance des verres anciens et des armatures de fer blanc qui bleuiront sitôt que le soleil aura disparu derrière le bois Vuacoz. Il faudra alors entrer plus plus avant dans la maison, se glisser dans une de ses poches, s’y serrer et nous réchauffer dans l'épaisseur de la nuit.
Jean Prod’hom
Daniel de Roulet | Tous les lointains sont bleus

Cher Pierre,
La nature des outils numériques qui m’ont permis de construire ce site, son architecture, le parti pris initial – il n'a guère changé depuis le temps – et l'archivage mensuel m’amènent aujourd’hui à prendre les devants avant que la bâtisse ne s’effondre ; je crains en effet que le logiciel dont je me sers (rapidweaver) refuse bientôt d’obéir à mes instructions et que le fichier index.html ne soit plus en mesure de tenir du bout du doigt les 11278 éléments qui en dépendent, comme un essaim qui se détacherait de la branche d’un cerisier.

J'ai pris la décision aujourd’hui d'archiver l'ensemble des fichiers produits depuis 8 ans, ou quasi, dans un dossier archives et d’alléger ainsi les tâches de rapidweaver ; bien des choses vont bouger, mais je n’en pèse pas les conséquences. L’opération aura lieu le 28 octobre 2015 – un peu de pathétique ne nuit pas –, 8 ans exactement après la mise en route de ce site. Je prépare ce transfert dès l’aube et un bout de l’après-midi.
Le travail ne manque pas ailleurs, Sandra m’aide à choisir les cartes-postales qui accompagneront Marges et Tessons à l’occasion de la Vente de la paroisse du Jorat qui se tiendra le samedi 3 octobre à Mézières ; je choisis un brimborion et trois textes extraits de Marges que je mets en page. Je prépare enfin la semaine prochaine à la mine.
Petit bonheur, Lucie m’envoie deux photos prises sur le Parcours céramique carougeois. On aperçoit dans les vitrines de deux librairies Tessons, en très bonne compagnie, notamment avec les Jeux d’écriture de Denise Lach dont Christine Macé a exposé le travail cet été.
Tous les lointains sont bleus, écrivait Léonard de Vinci ; c’est le titre que Daniel de Roulet a donné au recueil des chroniques qu’il a écrites entre 1955 et 2011. L’homme a beaucoup voyagé, à pied ou en avion, j’ai lu autrefois L’envol du marcheur et on s’est vus il y a deux ans au Salon du livre de Genève. Je l’ai rencontré hier après-midi à la FNAC, assis derrière les piles de ses livres, on s’est mis à babiller, moi accroupi ; à cause de mes genoux, j’ai demandé une chaise à une employée, on a babillé encore une grosse heure ; je serais bien resté à parler encore avec lui sur cette île, au milieu de la librairie ; comme lui à Maschapa, sur la plage, au milieu des gamins moqueurs.
Je monte me coucher : Abidjan, Auschwitz, Paris, Vancouver, Berlin, n’importe où...
Jean Prod’hom


Pour Justine Neubach

Cher Pierre,
En allant me balader sur Silencieuse.net, le beau site de Justine, je me suis réjoui du généreux accueil qu’elle y fait du mien. Nous ne nous sommes jamais vus, j’aime son écriture, c’est ainsi que nous nous connaissons. Nous nous sommes offert un jour, en guise de reconnaissance, l’hospitalité, c’était le vendredi 5 novembre 2014, jour des vases communicants. Justine a écrit et lu, à cette occasion, un texte qu’elle a intitulé : Que signifie ce nuage. J’ai de mon côté écrit et lu Suis né dans le ventre d’une langue. Gould et Bach avait été invités à la fête.

J’ai rapatrié ce matin ma lecture de chez Justine, que j’ai placée tout à côté de la sienne, dans les marges. Est monté alors un chant que je n’espérais pas, de sous-bois, un appariement étrange de deux voix qui tout à la fois vont de leur pas et se mêlent intimement, donnant un corps imprévu, modeste et imparfait, à l’idée d’harmonie préétablie. C’était aussi, près d’une année après, une manière à l’emporte-pièce de la remercier de cet échange-là.
Jean Prod’hom
Nous oublions vite les joies larges et muettes

Cher Pierre,
Nous oublions vite les joies larges et muettes, qui nous saisissent parfois un instant, une minute, un matin ; nous perdons de vue, aussitôt qu’elles nous ont désertés, les sensations qui les ont annoncées, les événements qui les ont précédées, convaincus qu’il serait tout à fait vain de vouloir en dégager les raisons, en isoler les causes, ou en éclairer les rampes d'accès. On n'en sait ma foi rien ; elles nous laissent les mains vides, précisément parce que cet état – la joie – l'est de s’en être dégagé, à la manière du sommeil lorsqu’il se coupe de la veille.

La joie, ça pourrait ressembler à une clairière, autour de laquelle les haies vives se refermeraient après notre passage. Pourtant la joie n'est pas un rêve ; celui-ci obéit à des ressorts dont se passe celle-là. En s’écartant de la raison – dans la raison –, le rêve lui reconnaît son dû et offre au rêveur, sous forme d’énigme, le récit codé d’un manque à dire.
La joie, elle, déborde la raison, lui laisse prendre les devants sans céder à la déraison. Elle demeure en-deçà, aux voisinages de l’origine ; elle nous met, muette, au plus près des bêtes sauvages, à deux pas de l’état de panique dont les chevreuils ne se sont jamais départis. La joie est étendue, sans orientation, panique mais panique heureuse.
Sommeil, veille, joie, mais aussi désir, rancoeur, amour gagneraient à être distingués comme autant de territoires autonomes, à la réalité dense et formelle. Ce parti pris atténuerait en le circonscrivant l’état de panique généralisé dans lequel nous plonge notre propension à orienter dans le temps tous nos états de conscience, libèrerait des territoires colonisés jusque-là par une conception imprudente du temps, affranchirait nos vies de l’histoire, qui pèse de tout son poids non seulement sur des pans entier de la réalité mais aussi sur l'avenir, son rejeton, qu’elle nourrit sans compter, aux dépens de ce qui s’en passerait bien. Le sommeil, le rêve, la joie sont des territoires, ils coexistent ; ce n'est que secondairement et injustement qu’ils se succèdent.
Jean Prod’hom


Marges
Dans le fond d’une cuvette

Cher Pierre,
La surcharge obligée, ou consentie, resserre les lignes de fuite qui me faisaient rêver ; elle obscurcit l’horizon que traçaient leurs extrémités. Me voici chaussé de fer et placé dans un véhicule glissant sur une paire de rails. Au bout le mur, avec ce que je n’aurai pas fait, pas réglé, pas pensé. D’autres désagréments se mettent au diapason. De l’aube à midi.

C’est pourtant l’inverse qui se produit après midi. Sans savoir ni comment ni pourquoi. Ce qui m’arrive se désolidarise de mes sombres prévisions, quelque chose se retourne, mes poches se retroussent, ma tête à l’envers. Je ne me retrouve pas au pied d’un monticule, bien au contraire, mais dans le creux d’une cuvette à l’abri du vent ; tout glisse de l’autre coté du talus, en pente douce, me laissant seul avec le ciel et sa profondeur bombée. Je monte faire une sieste sous les toits, on se réjouit parfois d’être sans avenir.
J’ai passé une belle soirée à Peney avec le club de lecture dont ma mère faisait partie. Ce que j’ai à dire, je ne le sais pas exactement, je le garde, pour moi, en l’état.
Jean Prod’hom
Ma mère est morte en été 2003

Cher Pierre,
Quelques pierres semées à Grignan ont pris racine. La grand-maman de Rose, avec laquelle nous avons passé une très belle soirée, m’a envoyé un message, elle nous remercie tous, Sandra, Lucie, Arthur, Louise et Lili. Elle m’apprend que les trois pierres que je lui ai offertes, elles les a déposées dans son jardin près d'un petit chat en céramique qui veille sur elles. C’est nous qui la remercions d’avoir pu faire sa connaissance. Elle s’appelle Anne-Marie, son visage rayonne même si elle n’a pas eu une vie de tout repos. On est tous à l’image de ces pierres cassées ; à nous de nous refaire, on a une vie pour cela, ce n’est pas toujours facile.

J’en est donc fini avec cette aventure, même si j’arpenterai encore les grèves, remuerai les laisses ; je me pencherai encore et ramasserai de nouveaux tessons. Mais je ne retournerai probablement plus sur les rives du lac de Bracciano. A l’inverse, je me baladerai sur celles du Léman, à Kérity, à Porz Even, sur les rives de la Bressonne et des Gaudines. Mais autrement, libéré de la dette que je n’ai cessé de contracter en m’appropriant ces objets.
Je m’étais promis, il y a très longtemps, de faire quelque chose avec ces petits paradis portatifs, ça aura été un livre, je n’y songeais pas. Je sais aujourd’hui que ce livre a voyagé ; ici tout près, à Corcelles, à Ropraz et à Peney ; mais aussi plus loin, sur les rives du Tage et de l’Atlantique, des deux côtés de la Bretagne, à Berlin, en Lorraine, au bord de la Méditerranée. Que vouloir de plus !
J’ai fait de belles rencontres, ce livre a réveillé des souvenirs, j’ai reçu des cadeaux – parfois un tesson, parfois une boîte qui débordait –, le livre d’une artiste qui en a fait des choses extraordinaires, des témoignages de reconnaissance.
Je rencontre demain quelques personnes qui font partie d’un groupe de lecture, à Peney. L’une d’elle me demande de ne pas oublier quelques tessons à montrer, je me réjouis. Ma mère est morte en été 2003, elle faisait partie de ce groupe de lecture, activement, elle aimait lire. Elle ne se doutait pas que je rejoindrai ses amies un jour, pour parler d’un livre que ni elle ni moi n’imaginions, je crois qu’elle l’aurait aimé. Si les belles histoires n’ont pas de fin, elles n’ont pas non plus vraiment commencé.
Jean Prod’hom
Rien ne serait sans le soleil ni la beauté ni ton corps

Cher Pierre,
Le temps maussade, la correction plus qu’approximative des noms propres dans Marges, les sifflements suspects de l’aspirateur, les travaux que les patrons tardent à mener jusqu’au bout dans la maison me pèsent.

Je préférerais tout laisser, ne plus toucher à rien et attendre ; convalescence plutôt que retraite, à l’occasion de laquelle j’aurais tout loisir d’offrir au vent les miettes que ma main droite aurait rabattues puis lentement fait tomber dans le creux de ma main gauche.
J’ai de bonnes raisons de me plaindre : les trois bâtiments scolaires qui accueillent les élèves dont j’ai la charge mettent à notre disposition des ordinateurs fixes aux qualités indéniables. Mais chacun d’eux propose des systèmes et des versions de logiciels différents, si bien qu’un document enregistré sur un même compte dans le bâtiment B ne s’ouvrira ni dans le bâtiment C ni dans le bâtiment D ; qu’un document enregistré dans le C s’ouvrira dans le B mais pas dans le D. On conclut qu’il est prudent de travailler dans le bâtiment D, puisque les documents enregistrés en B et C s’y ouvrent. Mais si on se décide à travailler par la suite dans le B ou le C, on révise nos préférences, si bien qu’à la fin nous préférons, bon an mal an, garder simultanément trois versions du même document.
C’est parce que j’ai oublié cette précaution que j’ai passé aujourd’hui du bâtiment B au bâtiment D, suis revenu au B avant de passer au C, puis successivement au D, au C, au D et enfin au B. J’aurais tort de me plaindre, me dit un plaisantin, les bâtiments sont proches.
J’ai appris à cette occasion deux choses qui en réalité n’en font qu’une : lorsque le monde se fait marchand et n’a d’autres valeurs que le profit, l’ancien règne ; on le maintient compatible avec le nouveau aussi longtemps que les clients ne sont pas ferrés puis captifs ; et lorsqu’ils le sont, les marchands coupent l’outil et son usager du passé.
On nous promettait, où qu’on soit, de pouvoir vivre la bohème et marcher les mains vides, partout, avec des ordinateurs fixes disséminés sur la terre qui devaient nous permettre de nous connecter chez soi où qu’on soit. On allait parvenir enfin à conjuguer le meilleur de la vie des chasseurs-cueilleurs et des patachons. On nous condamne en réalité à l’inverse : les pendulaires portent leur maison sur le dos où qu’ils se rendent. Ce qui devait faire de nous des oiseaux connectés nous contraint aujourd’hui à rejoindre la famille des gastéropodes à coquille, les escargots, à ne jamais quitter nos ordinateurs portables.
Journée sombre donc, sans soleil. Je me console à l’idée que celui-ci, en s’imposant aujourd’hui, aurait bien donné un peu de clarté aux choses qui m’entourent, mais ne les aurait pas rendues plus claires. Rien ne serait évidemment sans le soleil, ni la beauté ni ton corps, il n’est cependant pas suffisant ; nous avons à compléter le jeu de ses lumières et de ses ombres en usant de celles qui habitent le langage. C’est cette double action qui nous éclaire en retour, atténue nos peurs, circonscrit nos égarements et réchauffe notre confiance si souvent mise à mal.
Jean Prod’hom
Quelque chose en nous de Tennessee

Cher Pierre,
Renée – qui m’a fait le plaisir d’être avec nous samedi passé à Terres d’écritures – descend la ruelle des Commerçants ; je l’arrête, elle me reconnaît avec peine. Elle a nonante et un ans et passe la belle saison à Colonzelle. Une tache noire au milieu de chacun de ses yeux l’empêche de lire, mais une association lui envoie, en format audio, les textes qu’elle souhaite entendre ; elle fait aussi un peu de piano, se promène beaucoup, heureuse de vivre dans ce village, parmi des gens qui n’hésitent pas à l’aider. Elle me propose de visiter la maison que son neveu – architecte – a tiré des ruines qu’elle s’est offertes, il y a une trentaine d’années.
Un grand loft à l’étage, avec un lit, un coin cuisine, un salon et un piano devant lequel elle s’assied, une aquarelle d’une amie en guise de partition ; elle m’offre le début d’un prélude de Chopin, elle tâtonne, s’énerve des encoubles que sa cécité lui tend.
Elle me conduit sur une petite terrasse ouverte sur l’orient ; elle y passe une grande partie de son temps à regarder la Lance et le Ventoux, à se souvenir aussi des années passées en Indochine comme infirmière, qu’elle quitte pour Paris à la fin des années quarante. Elle s’y reconvertit au secrétariat et aux relations publiques dans de grands groupes français. On promet de se revoir.
Lucie me parle avant le déjeuner d’une jeune amie que la malignité de la vie n’a pas épargnée. Ils sont nombreux ces jeunes gens que la poisse accompagne et qui s’acharne. On ne remarque pas, lorsqu’on les croise, qu’ils sont tenus, avant de vouloir changer le monde, de se tirer du mauvais pas dans lequel le sort les a jetés, ou de faire avec. Et lorsqu’ils y parviennent, c’est souvent si fatigués qu’ils souhaitent d’abord que rien n’ait trop changé, pour que ne s’ajoute pas au combat qu’ils ont dû mener, la difficile tâche de remonter dans un train qui ne les aurait pas attendus.

Ma tournée dans la Drôme se termine, je remballe et charge mon barda rue Saint-Louis. Sandra, Lucie, les enfants et Oscar sont partis de leur côté. J'écoute Johnny dans la voiture qui me traîne sur la route de Taulignan : on a tous quelque chose en nous de Tennessee.
Jean Prod’hom
Upcycling

Cher Pierre,
Le moteur de la soufflerie gronde, les cerveaux se recroquevillent ; longue plainte dans la boulangerie et au café de la Bourgade. Ils sont nombreux à jouer au tiercé ou à l’euro-million, à rêver d’un pays sans mistral ni meltem ; les roseaux penchent, les platanes secouent la tête. Une vieille femme portugaise, établie en France depuis plus de trente ans, m’assure qu’il n’existe pas de mot dans sa langue pour traduire l’écorne-boeuf qu’on appelle mistral ici.

Christine discute avec un poète de Chantemerle et ses amis lorsque j’entre dans la galerie. Nicolas et sa femme font une halte, ils remontent d’Avignon.
C’est au tour d’une vieille dame à l’ensemble bordeaux, béret blanc, de nous rendre visite ; une Parisienne alerte et souriante que l’âge a cassée, établie à Grignan depuis trente ans déjà ; visiblement une habituée de la galerie, courbée et penchée sur les casses. Elle me raconte un épisode de ses douze ans ; son père, un peintre, excellent paysagiste et portraitiste, caricaturiste aussi, l’avait emmenée avec une de ses camarades dans les Vosges. Les deux petites s’étaient mises à racler la terre et gratter les sous-bois au sommet du Hohneck à la recherche d’un trésor. Et comme leur quête tendait à s’éterniser, le peintre les avait sévèrement grondées, excédé de ne pas les voir lever les yeux vers le ciel, les Vosges et s’émerveiller en contrebas du lac de Gerardmer. Elle le remercie, aujourd’hui encore, d’une réprimande qui lui a ouvert les yeux.
Mais les pierres sur lesquelles elle se penche à l’instant lui font douter de la vérité des mots de son père, la convainquent qu’il a été bien trop sévère autrefois. A la voir qui s’éloigne à petits pas serrés, les yeux rivés aux beaux pavés de la rue Saint-Louis, je ne peux m’empêcher de penser que ces pierres semi-pécieuses ont été façonnées par la mer pour les enfants et les vieux.
Christine m’envoie un message, elle a besoin de se reposer et me confie sa galerie. Lily passe à 15 heures avec milord son chien, on bavasse, comme disait Hessel, de rien mais aussi de tout, pendant deux bonnes heures, de ses réalisations à la RTS, des longues marches qu’ils faisaient tous les deux avec leurs amis, de nos connaissances communes.
Fin de journée et soirée à Colonzelle, on a bouclé les comptes, le rouge ne nous fait pas peur. Il nous reste des boîtes en pagaille, on fait la fête, Lucie et Sandra voient là l’occasion de se lancer dans l’upcycling. Rendez-vous à Mézières début octobre.
Jean Prod’hom

Une histoire de la compassion

Cher Pierre,
Sandra, Lucie et les enfants ont débarqué hier soir, tard. Ils dorment lorsque je les quitte ce matin pour la boulangerie de Grillon et le copyquick de Valréas, où je fais imprimer cinquante copies de cinq d’extraits de Tessons qui seront placées à l’entrée. Je dépose le pain sur la table du déjeuner à Colonzelle avant de filer à Grignan.

Lucie Monot
Le soleil entre de tous les côtés, le mistral aussi ; les textes fixés au mur ne résistent pas, tournoient comme des feuilles mortes. Je m’installe dans la salle aux casses, d’où j’entends les voix de Christine et des visiteurs ; ces petites pierres provoquent des souvenirs tout proches d’innocentes confidences. On bavarde, on se quitte à 13 heures. Je m’arrête au retour dans le pré fauché qu’il faut traverser pour entrer dans la chapelle de Saint-Pierre, la porte est ouverte, c’est la journée du patrimoine, j’y entre et fais quelques photographies de Dieu.
Sandra, Lucie et les enfant reviennent chargés de chez Leclerc, on pique-nique sur la terrasse.
Christine que je rejoins a réouvert la galerie à 15 heures, on dresse deux tables sur la petite place qui fait communiquer la librairie Colophon à Terres d’écritures, une placette où s’épanouissent des mauvaises herbes, mauvaises parce que les noms manquent ; je m’assieds sur le versant nord du double banc mitoyen, face à une boîte à bouquins où le livre se vend au kilo, 60 centimes les 100 grammes.
Les gens ont répondu au rendez-vous. Bonheur de rencontrer Sylvie, en vrai, une voix que j’avais imaginée en fa, elle est en do. Lectures ensuite, j’apprends ; je devine le plaisir qu’on peut éprouver à lire ce qu’on a écrit et donner à l’entendre. Plaisir encore de boire un coup avec Brigitte, Eléonore, les deux Bretons, Philippe et les autres, plus tard de manger en famille, Sandra, Arthur, Lili et Louise, Lucie et la grand-mère de Rose.
J’imagine encore, avant de m’endormir, le tesson qui me restera, lorsque j’aurai remis tous les autres aux enfants de ceux qui s’en sont débarrassés, le tesson que je n’aurai pas donné, l’oublié des oubliés : une nouvelle histoire peut-être, celle de la compassion.
Jean Prod’hom



Lucie Monot
Lucie Monot
Le bonheur d’être là s’acharne

Cher Pierre,
J’ouvre les volets et bois un café. François Maurel évoque sur France Inter la vie de Guy Béart, mort en allant chez le coiffeur mercredi passé. Et je comprends mieux le sentiment qui m’habite dans cette maison vide, vide comme une chanson lorsque celui qui la chantait meurt.

Une bande claire au-dessus de Chamaret, fine à l’aube, repousse les nuages ; large et bleue à 9 heures, il n’y a qu’elle en fin de matinée, le soleil coule alors sur les calcaires secs de la rue des Commerçants. Il faudra curieusement que je sorte de la maison pour que celle-ci soit à nouveau habitée, c’est-à-dire que j’y fasse entrer le dehors d’ici.
La cave des Rosier se situe sous le cimetière de Chantemerle, une apprentie m’accueille dans le caveau ; elle complète l’équipe des trois ouvriers qui travaillent sur ce domaine, il appartient à une vieille famille dont on voit les noms gravés dans la pierre du cimetière de Chantemerle.
Les pluies de ces ces derniers jours et un ou deux ennuis mécaniques ont retardé la fin des vendanges, mais la récolte sera exceptionnelle. Je repars avec une fontaine de 3 litres de vin rouge. La cour de la maison d’habitation, les flots généreux de la fontaine qui trône au milieu, quelques oies tapies dans l’ombre donnent à voir l’image d’une ancienne opulence. Mais ils sont nombreux les carreaux brisés et les locaux inoccupés, un coq chante dans les vignes, des canards barbotent dans la petite marre que longe un chemin caillouteux.
Il n’y a pas grand monde à Grignan, Christine est absente et je m’improvise galeriste pendant deux bonnes heures. Je n’aurai la visite que d’une seule personne, une dame toute en bleue, une voisine, c’est elle en effet qui assure la permanence dans la boutique de vêtements située en face de Terres d’écritures.
Le bonheur d’être là s’acharne, la porte de la galerie est grand ouverte, il est midi, avec le bruit du vent dans les branches, le soleil, et celui des feuilles qui roulent sur les pavés. Et pas loin le bruit d’un moteur, une casserole et son couvercle, les grincements de deux fers rouillés, une cuillère dans une assiette. Je ne vois pas bien pourquoi et comment je pourrais résister.
L’écrire ne le diminue pas mais le soulève, l’élargit en le maintenant en-dehors de soi. Il n’y plus d’après dans la cuisine, sous le tilleul, sur la terrasse de la Bourgade, au bord du Lez. C’est en écrivant qu’on s’y abandonne le mieux, en s’en détachant qu’on y est le plus mêlé. Et même impossible, on aimerait qu’il se prolonge.
Jean Prod’hom
La Drôme charrie de grosses eaux terreuses

Cher Pierre,
Les autorités communales ont donc fait tronçonner l’immense tilleul du carrefour, on ne voit ce matin, de partout, qu’un étrange vide qui s’étend bien au-delà de son point de disparition. Nécessaire ? Les avis étaient partagés hier soir, les enfants exceptés qui ont joué dans ses dépouilles.

Il a plu toute la nuit et c’est sous une pluie serrée que je quitte le Riau à 7 et le Mont à 14. Je fais une halte à Aubonne pour retourner les six tablettes qu’Yves et Anne-Hélène n’ont pas utilisées à Grignan ; impossible de toucher la somme en liquide, l’employée d’Ikea me délivre un bon.
Le Salève est sous le soleil, je file d’une traite jusqu’aux Abrets, emprunte le chemin des écoliers jusqu’à Voiron, reprends l’autoroute jusqu’à Valence. France Inter et le soleil m’accompagnent.
Sous le pont de Crest, la Drôme charrie de grosses eaux terreuses au-dessus desquelles des pigeons – en est-ce ? – font un drôle de ballet. Je bois un coca sur la terrasse du café de Paris, mange un croissant en feuilletant le Dauphiné ; l’opticien descend bientôt les stores de sa boutique, le patron du bistrot le suit de près. Je reste seul, regarde par la fenêtre la nuit qui tombe.
Je n’imaginais pas que mes billets puissent amener un jour l’un ou l’autre des quelques lecteurs qui me font le plaisir de lire ce que j’écris, à réagir de la sorte. C’est fait ! Et même plutôt deux fois qu’une, en seulement deux jours. Le premier m’enjoint de quitter ma lune et de revenir parmi les hommes le plus rapidement possible, et même, si j’ai bien compris, de quitter le hameau que j’habite, bien trop à l’écart, bien trop à l’abri du monde des hommes et de ses tempêtes. Je doute que j’y parvienne, et que ce soit même souhaitable.
Quand au second, qui est une lectrice, elle pose un certain nombre de questions auxquelles mon billet me semblait répondre, mais j’aurais été bien impoli de l’inviter à le relire, j’ai donc paré au plus pressé en raccourcissant mes réponses si bien que je suis arrivé bien plus tôt à Colonzelle que je ne le pensais.
Jean Prod’hom

Les acteurs du milieu littéraire romand s’agitent

Cher Pierre,
L’école a ménagé pour les oublieux et les indisciplinés des niches dans lesquelles ils sont convoqués pour payer d’arrêts leurs petits ou gros forfaits. Les têtes brûlées prennent immanquablement le pas sur les têtes en l’air et profitent du repaire qui leur est offert pour leur apprendre l’art de la dispute et certains de leurs secrets. J’ai passé une heure et demie cet après-midi à faire le maton avec une dizaine de ces gamins. Quatre d’entre eux, très forts, très très forts, très très indisciplinés, m’ont obligé à revenir sur la vieille promesse que je m’étais faite de ne jamais accabler les enfants qui en sont arrivés à ses extrémités-là ; le fait est bien établi, avant d’être des indisciplinés, ces enfants-là sont des oubliés.

Le prix que nous aurons à payer, les idées que nous aurons à développer puis à déployer pour redonner à ces oubliés-indisciplinés-révoltés le goût de vivre en société, croît chaque jour davantage. Les nantis ne parviendront pas, sans rien céder, à se protéger des mines qu’ils préparent pour disposer d’un bout de terre sur un territoire dont ils sont les natifs et dont ils n’ont jamais été chassés. Le temps presse et la réponse nécessite que nous renoncions à d’imbéciles privilèges, mais surtout que nous fassions autre chose avec ce qui est à notre portée, pour obtenir les mêmes bénéfices mais à moindre prix, sans en exclure personne : se taire, marcher, écrire, aimer.
La littérature est essentielle à cet égard-là, parce que lire et écrire ne coûte rien, n’en appelle qu’au temps qui passe et au livre, quel que soit sa forme. Le monde n’a guère changé, le ciel, la mère et la ville ressemblent à ceux dont le saint Augustin de Carpaccio a été témoin à Venise. La souplesse de notre rétine ouvre nos vies à des mondes improbables, sans bouger, dans nos jardins ou nos chambres. Il y a toujours du revenir en arrière quand on va de l’avant.
Le soleil revient à la Marjolatte (Marjolattaz), puis glisse derrière les sapins du bois Vuacoz. J’écris ces mots à la bibliothèque et trouve le temps de renouer avec ma vieille promesse. Les bûcherons ont tronçonné l’immense tilleul du Riau, on s’agite au carrefour. Non, je n’accablerai ni les autorités communales ni les enfants, mais je ne baisserai pas non plus les yeux devant la facture que nous aurons à honorer pour bifurquer. Il faut nous réjouir de cette autre route qui, comme la première, ne mène nulle part, mais autrement et sans reliques.
De leurs côtés, les acteurs du milieu littéraire romand s’agitent sur les réseaux sociaux. On dit, amende et corrige ; on asserte, rectifie et précise ; on écarte, adoube et caresse. On ne sait pas très bien ni pourquoi mais ça écume. Ceux qui sont supposés savoir sont condamnés à se réconcilier, parlent d’une même voix et faufilent des accords. On parle d’art, de lenteur et d’oeuvre grandiose, tous savent au dedans que l’essentiel est ailleurs : les innombrables romans pèsent trop lourd sur la vie littéraire. Par chance la nuit vient.
Jean Prod’hom
Vous êtes bien mignon Jean

Cher Pierre,
Romain, à qui le responsable de l’inauguration des nouveaux bâtiments de l’école où je travaille, a prié de réaliser le programme des manifestations, m’a demandé de rédiger le texte introductif. Je m’y colle ce matin en essayant de faire voir, au passage, le visage de Janus de cette noble institution qui, simultanément, abrite des activités qui n’ont guère changé depuis Jules Ferry et digère tant bien que mal des mutations profondes que tous les acteurs de l’école sont invités à honorer aujourd’hui, qu’ils le veuillent ou non, et qui les obligent à réorienter leurs efforts en usant des outil si nouveaux qu’ils les laissent souvent pantois.

Je tais l’autre idée, iconoclaste, selon laquelle les embarcations construites par nos architectes pour apprendre à nos enfants à naviguer sur terre, sont obsolètes avant d’être mises à l’eau. Les moyens de communication, mais aussi de stockage de l’information dont nous disposons ne nécessitent plus de grands locaux fixes, pouvant accueillir 20 ou 30 élèves – et le matériel supposé nécessaire –, mais au contraire des espaces réduits, modulables, capables d’accueillir jusqu’à cinq ou six personnes – pas plus – ; un local permettant à une centaine de personnes de travailler individuellement et en silence ; un autre enfin, de même dimension, à l’acoustique irréprochable, qui permettrait à un orateur de se faire entendre de tous, ou à un film d’être projeté dans de bonnes conditions. Inutile de parler de cela, personne n’est prêt à le concéder, pas même à entrer en matière.
A la suite de sa lecture de mon billet de hier, un lecteur écrit ceci : Vous êtes bien mignon Jean, mais les réfugiés politiques qui déferlent sur l'Europe n'effleurent même pas votre village ? S'il vous plait, revenez un peu parmi nous. L'homme, qui se déclare humble disciple de Montaigne, de Spinoza, de Rousseau et de quelques autres s'étonne que ma prose élégante rebondisse sur l'orbe du monde réel comme si elle ne l'effleurait même pas.
Dois-je rester dans le village que j'habite et m'en excuser, ou rejoindre ce disciple de Montaigne et aller à la rencontre des réfugiés politiques qui déferlent ? Que cet homme prenne en otages des auteurs qui ne lui appartiennent pas et qu'il m'arrive de lire parfois, en se proclamant leur disciple, ajoute un peu de colère à mon désarroi. Ce monsieur veut-il étendre la guerre partout, même dans mon village ? Il doit comprendre que je défendrai mes enfants où que nous soyons, dans sa ville ou ici au cul du monde.
L’intervention de cet homme, quoi qu'il en soit, laisse entrevoir l'incurie des épargnés. À moins qu’il ne soit en danger et que derrière ses allures de révolté, il soit un réfugié qui fuit et demande un asile ? J’aurais aimé qu’il me demande comment va le monde, je lui aurais répondu : Pas bien ! Mais faut-il mal tourner pour en être solidaire ? C'est un miracle que nous soyons encore vivants.
Belle soirée dans l’ancien cinéma du Bourg en hommage d’Hessel, avec ses amis, mais je ne prolonge pas la fête. Sale journée ! Une amie de Montreuil m’envoie un gentil mot ; ce que j’écris, dit-elle, l’apaise. Elle ajoute pour mon bonheur qu’elle a trouvé dans ses rêves un petit tesson avec une main dessinée dessus.
Jean Prod’hom
Un peu de philosophie phénoménologico-pratine

Cher Pierre,
Il a plu toute la nuit et je me lève reposé de Grignan ; je traverse la journée d’assez belle humeur mais les yeux fermés ; je la termine au Chalet des Enfants, devant un thé et la pluie qui s’est remise à tomber. J’en profite pour me perdre dans la clairière que j’aperçois derrière la porte vitrée et m’embarquer dans un peu de cette philosophie phénoménologico-pratine qui m’amène à penser parfois, lorsque la fatigue me rend transparent, que mon corps et ma tête sont assez poreux pour laisser entrer morceau par morceau l’ensemble des choses qui m’entourent, mais aussi l’inverse, laisser filer et se mêler à l’étendue mon souffle et ma peau.

Notre corps est en effet un puits assez profond pour recueillir et traiter l’ensemble des sensations qui lui parviennent de partout et en tous sens, sans qu’elles n’en ressortent jamais, laissant à la nuit le soin d’en interrompre le flux, à nos désirs de l’accélérer, à notre conscience d’en détourner le flot, au langage de le doubler et d’en atténuer les effets.
Mais le corps est aussi insignifiant qu’une seule maille d’une toile d’araignée, si bien que ce que l’homme a cru comprendre s’échappe en le trainant derrière lui.
Je remonte au Riau, le garagiste a changé mes essuie-glaces. Les anniversaires des deux grands approchent : Louise recevra une nouvelle guitare, Arthur un ordinateur. Lili trouve toute cette affaire injuste, c’est toujours elle qui a son anniversaire en dernier.
Jean Prod’hom
Celles dont on ne dispose que du profil facebook

Cher Pierre,
Il y a celles et ceux que l’on connaît depuis peu ou depuis toujours, celles et ceux que l’on ne verra qu’une seule fois, d’autres que l’on ne verra jamais.

Il y a, depuis peu, celles et ceux dont on connaît le profil Facebook, et dont on tire, sans le vouloir vraiment, une image complète et vraisemblable. Parmi celles-ci, celles dont l’image composite que l’on s’était faite s’évanouit, sans faire aucun bruit, lorsqu’on les voit pour la première fois. Je les avais conçues sans voix, jamais imaginé la lenteur de leurs gestes, la manière qu’elles ont de vous regarder ou de baisser les paupières, penser, parler, sourire, de vous quitter enfin.
Grand bonheur donc, hier, de faire la connaissance d’Hélène Sturm et d’Isabelle Damotte, en vrai, petite satisfaction aujourd’hui de prendre acte trivial de ceci : les images ne montrent rien de ce qui est, elles n’en sont qu’une partie volatile, infime, à la consistance et aux pouvoirs étranges : la consistance des nuages et la faculté de se déposer sur tout, comme la poussière, de s’infiltrer partout, comme le plus dangereux des poisons.
Edouard et Françoise ne repartiront que demain, on s’embrasse. Je fais un saut à Terres d’Ecritures pour embarquer les tables que nous n’avons pas utilisées, regarde dans la salle vide la belle installation qu’Yves et Anne-Hélène ont réalisée, la coexistence simple et pacifique des bris de vaisselle et des photographies, la fixité des secondes et la mobilité des premiers ; neuf îles autour desquelles le curieux peut aller, se pencher, toucher, prendre, retourner, table d’enfant dont les photographies définissent le territoire et les tessons le jeu. Je les laisse, bien certain que je les retrouverai plus tard, comme les enfants de Port-Béni, inutile de mettre ces pierres sous clé.
Je passe dans l’autre salle, presque vide, vide de l’absence de ceux qui m’ont fait l’amitié de venir écouter mes sornettes et de boire un coup. Dans un coin le quarteron de vingt litres et les cinq casses bourrées jusqu’à la gueule.
Un climatologue parle sur France-Inter de dimensions qui m’échappent, j’ai peine à le croire malgré son assurance, ou précisément à cause d’elle. Je m’arrête à Crest pour rédiger ces notes, une poche du ciel lâche à nouveau, aucun bistrot en vue ; je pique une chaise dur la terrasse du café de Paris – fermé le dimanche – que je dépose sur le pas de porte abrité de l’opticien. Des gens entrent se réfugier dans l’église, trois scugnizzi de Crest, trempés jusqu’à l’os rient et crient, entrent et sortent, assez vieux pour tirer sur des mégots mais trop jeunes encore pour préparer des mauvais coups.
Il est 22 heures 30 lorsque j’arrive au Riau, Oscar aboie une fois, aucun bruit ailleurs, les portes des chambres des enfants sont fermées, Sandra s’endort.
Jean Prod’hom










Un gros sou, un iota et puis plus rien

Cher Pierre,
Une drôle de bête appelle au milieu de la nuit, fauve ou serpent, l’autre se tait. C’est mon sommeil ou le sien, à la fin, plus de bruit. Long silence qu’un couteau crève ; grosse poche lâche, pleine à raz-bord, il est six heures, le ciel perd ses eaux qui claquent sur le bitume.
Ce matin, le ciel se mire deux fois dans une flaque double ; je lève la tête, c’est le soleil qui sèche et repasse les dentelles des génoises. Je bois un coup, sirop de fraise d’Eyguebelle, sur la terrasse du Sévigné. Y reviens, le temps est passé, Pascal et Jasmine sont des gamins qui ne demandent rien.
Tout se précipite, au pas, bonheur de rencontrer Isabelle, Hélène et les autres, de lire ainsi, et d’entendre, l’écho de ce qu’ils me renvoient et que je leur dois : un gros sou, un iota et puis plus rien ; écrire et lire, écouter et dire, on y prend goût.
Jean Prod’hom

Allons à Quimper danser breton

Cher Pierre,
La journée a passé en coup de vent, on a effeuillé les lauriers. Beau travail. Les gens de métier entament mes dernières convictions autour d’un feu de camp, je brûle ce qui brûle, prends congé de ceux qui restent, de ceux qui s’en vont, j’excuse, remercie et pardonne. J’écris à ma belle : Ne touche à rien, princesse, n’ajoute rien, ne retranche rien, tout est bien trop fragile. Ecoute la mer remuer les galets. Ce soir, princesse, faisons un pas de côté, allons vendanger ; ce soir, princesse, allons à Quimper danser breton.
Jean Prod’hom

Minuit passé

Cher Pierre,
Yves et Anne-Hélène m’avertissent, minuit passé, que la cinquième photo du neuvième gruppetto a été glissée dans la quarante-cinquième enveloppe pergamine et la centième boîte fermée. Fini ? Pas tout à fait ! Ils me proposent encore d’ajouter un tesson par boîte ; j’accepte sans me rendre compte des conséquences.

Je descends à six heures à la cave, Edouard et Françoise dorment encore. J’extrais avec peine cinq ou six pierres du quarteron de vingt litres que j’ai descendu en août; je me rends compte aussitôt que la tâche sera difficile. Je me retrouve en effet devant un dilemme prévisible mais dont j’ai différé l’examen : faut-il que je me sépare des tessons qui ont, pour moi, une valeur particulière ? ou de ceux qui occupent une place seconde ? Autrement dit, est-il fondamentalement possible que j’abandonne ces merdouilles, quelles que soient les mains qui les recueillent, amies ou inconnues ? Je ne peux en effet m’empêcher de craindre que les gens qui en deviendraient les propriétaires manquent à leur égard du regard qu’elles méritent. Je rationalise : elles ont vécu un premier abandon, il n’est pas concevable que celui qui les en a arrachées les y plongent lui-même une seconde fois.
Mais quand je ne serai plus là, que deviendront ces pierres que je proclamais sans valeur – et qui en ont pris une à mon insu ? Ne vaut-il pas mieux que je m’en débarrasse aujourd’hui même puisqu’il faudra bien m’y résoudre un jour ; cet événement à Grignan n’en est-il pas l’occasion rêvée ?
Le chasseur cueilleur que j’héberge opine du chef et se réjouit de pouvoir enfin se débarrasser de cette caillasse, qui charge les poches d’une existence qu’il partage avec un autre qui est à demeure chez moi. Celui-ci s’y refuse, il craint que notre maison se vide, que nous soyons soudain nus, et que nous prenions froid. Il va falloir donc nous entendre et nous y parvenons ; nous prenons le parti de ne pas nous séparer des pierres que Geoffrey et Romain ont photographiées, mais de céder les autres, même si elles me sont chères. Cet arrangement m’apaise et je retire des casses, avant 7 heures, vingt tessons.
Edouard et Françoise sont au marché de Nyons, ils font quelques courses ; c’est sur la terrasse de la Bourgade à Grillon que je rédige ces notes, avec la sensation que je suis sur la bonne voie, bonheur mêlé, comparable à celui du chasseur-cueilleur sur une aire de repos. Je rentre pourtant à Colonzelle, me remets à la tâche et choisis 10 nouvelles pierres. Serais-je donc bientôt guéri ?
Christine ouvre la galerie, il est 14 heures 30, on décharge les casses. C’est la première fois qu’elle voit ces morceaux de terre, les considère en spécialiste, étonnée de la disparition de leur couverte, intriguée par leurs motifs, leurs couleurs, leurs formes. On va fêter ça au Sévigné, Françoise nous rejoint, on parle de l’apéro de samedi. Il est temps de songer à la vitrine qui donne sur la rue Saint-Louis : quelques livres, une casse et deux douzaines de tessons feront l’affaire.
Le soleil baisse, il me reste beaucoup à faire ; un message sautillant de Sandra repousse les menaces de l’à-quoi-bon auquel je cède parfois.
Jean Prod’hom


Le camp de base est installé

Cher Pierre,
La nervosité est palpable. Le surplus de travail lié à l’inauguration des nouveaux bâtiments, le spectacle des petits, les jeux de pouvoir des grands, la rétention des informations d’un côté, leur dispersion de l’autre y ont chacun et chacune leur part. Ce qui ne m’empêche pas de boucler les affaires courantes, de négocier très précisément avec les élèves ce qu’ils auront à faire pendant mon absence ; ils ne semblent pas mécontents de me voir tourner les talons, assez satisfaits, je crois, de montrer ce qu’ils sont capables de faire seuls.

Je fais un tirage des papiers pour Grignan – mon vieil ipad pourrait lâcher – et remonte au Riau ; les portes sont grandes ouvertes, Oscar entre et sort à sa guise. Oh! les beaux jours.
Sandra est d’accord de rédiger l’article sur les championnats du monde de trial que Jean-Daniel m’a demandé d’écrire. Cette femme est une perle, elle sait tout faire, efficacement, sans jamais se départir de son sourire – ou presque –, si pleine d’attentions que je me demande si je la mérite.
France Inter m’accompagne une partie du voyage et double mes songeries, qui s’échappent dans la campagne que l’autouroute traverse comme une fermeture-éclair, vieille, usagée, une fermeture-éclair qui ne fermerait plus. Pas le droit de m’arrêter sur la bande d’urgence, pas le temps de faire halte sur une aire de repos, alors je les laisse filer. Elles ne sont pas perdues, je les retrouverai peut-être. Mais à considérer la célérité avec laquelle elles disparaissent, je prends conscience qu’elles sont toujours plus brèves, toujours plus volatiles, comme si leur grain s’amenuisait davantage, si bien que les grosses mailles du filet que je leur tends ne parviennent plus à les retenir assez longtemps. Impossible de les saisir.
Je fais une halte à Crest, sur un banc devant l’église, place Général de Gaulle ; les cloches sonnent curieusement 19 heures : trois fois trois coups, puis à la volée. La place est vide, 23 degrés s’affichent à l’enseigne du pharmacien. Je dévore une quiche lorraine et une tartelette aux myrtilles, trois morses pour la première, deux pour la seconde. Je bois un coca au café de Paris, anciennement café Peyrot dont on voit une ancienne photo au-dessus du bar.
Sandra m’a envoyé un message, elle me raconte qu’il y a le feu au Riau, la mère d’une camarade de Lili l’a avertie en effet que des poux dansent sur la tête de sa fille. Il faut choisir les armes, chimiques ou naturelles. Sandra a décidé que la guerre sera chimique. Elle m’écrit en préparant une pizza et en faisant une lessive, en résolvant quelques équations et en rédigeant l’article qu’a demandé Jean-Daniel ; elle n’a pas de temps à perdre, Arthur l’attend à l’arrêt de bus. Et moi qui suis là, au café, un café que je vais devoir quitter, le patron ferme. Je lui envoie des lauriers, elle m’envoie un baiser.
Le jour baisse et je rate la croisée de la Bégude-de-Mazenc. Je parviens enfin à rejoindre Espeluche, monte un col sans nom avant de redescendre à Salles-sous-Bois. Edouard et Françoise m’invitent à leur table qu’ils ont dressée sur la terrasse. Le camp de base est installé, les grandes manoeuvres peuvent commencer.
Jean Prod’hom
Jamais aussi bon que lorsque on n’y est pour rien

Cher Pierre,
Le journaliste de la feuille locale, qui souhaitait l’autre jour me poser deux ou trois questions par téléphone, vient boire un café à 9 heures. On s’installe dans la véranda et on babille pendant une heure et demie. C’est son dernier article, il reprend ses études de sociologie à la fin de la semaine, il songe plus tard entrer dans une carrière diplomatique.

Je prépare ensuite ce que je vais dire à Grignan, saute le repas de midi, me retrouve avec les élèves de 9P pendant deux périodes, poursuis dans une salle de dégagement ce que j’ai commencé, au soleil et fenêtre ouverte ; je termine à 18 heures.
Tessons aurait pu s’intituler Terres d’écritures, au pluriel. Nous lui avons préféré, Pascal Rebetez, Jasmine et moi Tessons, un mot lourd, coupant aussi, qui rappelle les origines industrielles de ces rebuts.
Mais ceux qui ont eu l’occasion de feuilleter ce livre ont certainement constaté que ces morceaux de terre cuite, malgré tout, dévoilent des motifs, souvent simples, parfois rustiques ou sommaires, mais des motifs tout de même, qui en font les cousins lointains, très lointains des terres calligraphiées que Christine Macé expose dans sa galerie depuis des années.
Mais que les habitués de cette galerie ne se méprennent pas, ces tessons n’ont aucune prétention, ils ne sont pas des oeuvres d’art et je ne suis ni potier ni calligraphe.
Ces merdouilles, comme les appelle si gentiment David Cuendet, se satisfont de n’être rien, moins que rien. Et leur collecte n’est en réalité qu’une lubie sans conséquence, le fait d’un indéfectible paresseux qui s’est toujours promis qu’il ferait un jour quelque chose de ces morceaux de vaisselle ramassés sur les rives de deux ou trois mers, de quelques lacs, de quelques rivières.
Au bout du compte, je n’en aurai rien fait. Le gros du travail, c’est la mer, le sable, le vent et les circonstances qui s’en sont chargé, je n’ai été là que pour les cueillir au moment de leur floraison. Deux photographes, des vrais, ont eu la difficile tâche de faire passer une cinquantaine de ces tessons de la plage à la page, de métamorphoser ces objets de peu de valeur en pierres précieuses, ou semi-précieuses. Je leur ai collé aux basques une poignée de textes disparates, petites coques de noix qui m’ont permis de revisiter quelques-uns des enseignements et des plaisirs qu’ils m’ont procurés. C’est tout.
Mais il a fallu encore, pour que tout cela ait lieu, des gens de courage, ceux qui m’ont mis le pied à l’étrier il y une année exactement, Pascal Rebetez et Jasmine qui savent faire des livres et des miracles.
Christine Macé, curieuse de tout, ouverte à tout, passionnée de terre et d’écriture, n’est pas restée insensible à ces objets oubliés et à ce livre ; elle leur a ouvert sa galerie, merci.
Ma paresse ne s’arrête pas là, je crains qu’elle ne soit sans borne, si bien que je ne pourrai jamais m’acquitter de toutes mes dettes. J’en ai contracté une immense auprès d’Anne-Hélène Darbellay et Yves Zbinden, qui m'ont fait l'amitié de s’occuper de tout, ils ont conçu le dispositif, donné une allure aux morceaux de terre cuite, aux textes, aux photographies qu’ils ont choisies, à leur support, aux boîtes qui les réunissent. Tout paraît si simple, il y aurait tant à dire sur leur travail. Et sur celui de Françoise, Edouard et Lucie, de Sandra, Lili, Louise, Arthur qui ont soutenu et soufflé sur les braises d’une aventure qui doit tout à la bienveillance des gens qui m’entourent. Je leur suis redevable de tout et je vérifie chaque jour davantage l’adage suivant lequel on n’est jamais aussi bon que lorsqu’on y est pour rien.
Qu’un musée archéologique ait accueilli ces merdouilles dans ses vitrines – et celui de Lausanne l’a fait pendant 6 mois –, on pouvait encore le concevoir. Il l'était moins qu’elles se retrouvent dans une galerie d’art.
Mais à y regarder de plus près, il faut se demander si le silence dans lequel ces tessons se tiennent alors qu'ils auraient tant à dire de leurs aventures, des conditions de leur apparition, des circonstances de leur rédemption, des incidents sans lesquels ils ne seraient jamais devenus ce qu’ils sont, ne fait pas d’eux je l’ai dit, les cousins éloignés des oeuvres d'art, des cousins orphelins, dépositaires, si cela se pouvait, d’un art anonyme.
A moins que Christine Macé, en les accueillant à l’intérieur même de sa maison, n’ait voulu conjurer le sort, en faisant une place à ce à quoi sont condamnées les merveilles qu’elle expose, et s’allier ainsi les bonnes grâces de saint Bonnet, de sainte Catherine ou de l’un ou l’autre des saints patrons des potiers.
Ce ne sont à la fin que des pierres, des photographies et quelques textes, qui constituent tout à la fois les traces du temps qui passe, et le gué que j’emprunte pour continuer et me risquer sur des rives que je ne connais pas.
Au Riau, Louise m’appelle avant que j’aie eu le temps de retirer mes chaussures, elle a fait une bonne note à cette dictée dont elle craignait le pire. Arthur fait des math et Sandra écrit son second livre. Il me revient de faire à manger et d’aller chercher Lili. Ni une ni deux, je glisse les restes du gratin au four et jette dans une marmite les rudiments d’une ratatouille.
Jean Prod’hom
Il y a des réveils que l’imprévu égaie

Cher Pierre,
Il y a des réveils que l’imprévu égaie et maintient accrochés aux rêves ; un ami m’avertit en effet que Michel Audétat a écrit hier un billet sur Marges, dans le Mag du Matin Dimanche. Un beau billet, de ceux qui témoignent qu’un autre au moins a été sensible à la lumière qui fait trembler l’ordinaire et nous fait aimer celui-ci plus que tout au monde. Oui, les jours méritent qu’on s’y attarde ; oui, il est de belles joies nonchalantes ; oui, il existe des asiles et des heures dans le creux desquelles baigne ce quelque chose dont j’ai cru percevoir la mélodie et que j’ai souhaité faire entendre aux inconnus qui auraient pu être mes amis, et je l’entends miraculeusement animer l’écriture d’un autre. Non, nous ne sommes pas seuls au monde.

Il me faut pourtant cesser de faire des phrases et rejoindre la mine, je m’y enfonce sans interruption jusqu’à midi. Je dévore ensuite une pizza au Central avec deux collègues.
Le site pour l’inauguration du complexe scolaire fonctionne, les dix élèves qui auront pour tâche d’éditer sur le web les textes et les photos que leur enverront par Ipad les élèves des autres classes sont prêts, Evernote et RapidWeaver n’ont plus de secret pour eux. Raul a protégé le domaine des marges.net en réalisant une partition qui interdira aux élèves l’accès à la racine du site.
Yves m’envoie deux images des tirages des 9 x 5 photographies, il descendra avec Anne-Hélène jeudi. Comment les remercier ? Je prépare un gratin dauphinois et lave une salade ; Sandra et Louise rentrent un peu avant 20 heures d’Oron, sans Lili qui a préféré renoncer à ses cours de piano, Arthur qui fait du parkour à Lausanne rentre à plus de 21 heures. Je me couche avant minuit, cela faisait longtemps.
Jean Prod’hom


Allez au jardin de la vie

Cher Pierre,
Romain m’envoie une photographie prise dans une librairie de la région. On y aperçoit Marges au premier plan, à côté de L’homme qui jouait de l’orgue, Listen to this, Musicophilia, Les Danseurs mythiques, Danse avec l’espoir, « Piaf », La voie de la voix, Les 101 grand opéras. Une erreur d’aiguillage ?

Pourquoi pas, c’est peut-être sa place ; je constate en effet, pas internet, que La librairie du Baobab à Martigny l’a indexé sous Lettres et linguistique ; les livres comme les hommes peinent à trouver la place qui est la leur, jusqu’à ce qu’ils comprennent que d’autres places peuvent leur convenir.
Olivier me téléphone, nous descendons au bord du lac, marchons jusqu’à Lutry où un boit un café. Trois mois qu’on ne s’était pas revus. On cause de tout, enfants, job, retraite, projets tout en remuant les galets ; il trouve un beau tesson qu’il accepte de me laisser. Bonne nouvelle ! il est possible qu’il descende à Grignan avec Patrick, je m’en réjouis. On s’arrête au retour au bord du terrain de foot, les joueurs de Lutry affrontent ceux du Team Gruyère, ; lorsqu’on les quitte, les seconds mènent 2 à 1.
Sandra n’a pas eu une minute à elle de la journée : Ziggy et Sahita, les paiements, les leçons des enfants. Demain c’est visite de chantier, on passe en revue les travaux qui restent à faire dans la maison. Et puis, je mets enfin sous pli les pièces justificatives supplémentaires que l’office des impôts a exigées, Sandra a mis la main sur l’annexe 06 que je ne retrouvais pas. Je fixe les échéances de la semaine prochaine, prépare le remplacement de jeudi avant de finir ma journée à la cuisine.
Je crains qu’on ne puisse disparaître autrement que deux fois, sous la terre d’abord ; sous les mots des inconsolables qui recouvrent ceux du vivant : allez au jardin de la vie.
Jean Prod’hom

Oiseaux des îles et oiseaux-lyres

Cher Pierre,
C’est jour de fête à Pépinet ; à la foule des lecteurs se joint dans les travées celle des ombres, des noms scandés qui sont à eux seuls des livres : Enard, Ernaux et Dicker. Christine Angot ? on est en rupture de stock ; Annie Ernaux ? avec H je crois ; Le Ruffin ? pas mal, surtout la fin ; le Meizoz ? je n’ai pas lu ; Un Amour de jeunesse, c’est d’abord un film, n’est-ce pas ?

Un vieux beau commente les nouvelles parutions, soupire, compare, distribue les lauriers, il fait entendre, avec son chapeau, qu’il a aimé Mort à Venise. Un autre, moins beau, carnet et cabas à la main, fait ses emplettes : Hamel, Maggetti, Brügger. Je remonte au Riau les mains vides.
Nous partons, Sandra et moi, nous balader du côté du Bois Vuacoz ; K, au volant d’un gros tracteur, tire une bossette sous le Chauderonnet ; il nous raconte un peu de sa vie dans un français monosyllabique : la Macédoine, sa femme restée à la maison, ses enfants ; ses cousins et cousines qui sont à Belfaux, Echallens, Lausanne. Il nous dit, sans s’appesantir, la solitude dans laquelle il vit, seul dans sa chambre. Il aura son anniversaire dans quelques jours, son sourire ressemble à ses mains. L’année passée, ses patrons l’avaient invité au restaurant, ils avaient terminé le repas avec une tourte, il leur en est reconnaissant. A la maison, Arthur tond le gazon, Louise dessine et Lili lave à grandes eaux sa boîte de peinture.
Le spectacle de clowns commence à 19 heures sous le chapiteau de Bercher, on a donc une heure à tuer ; on la passe au bord de la Menthue, dans le parc animalier du Clos Bercher, un établissement médico-social qui accueille une vingtaine de patients. Cette belle maison de maître accueillait autrefois la direction d’une succursale de Nestlé, on y a fabriqué de 1880 et 1921 des farines lactées et du lait condensé. L’usine, démolie à la fin du XXème siècle, a laissé la place à une dizaine de volières, à des parcs aussi : biches, chèvres, oies, chevaux, moutons,...
Une auxiliaire de santé fouille le parc et les rives de la Menthue pour retrouver, avant le renard, la pintade qui s’est échappée : sans succès. La malheureuse a d’autres soucis, elle nous raconte en effet qu’une pensionnaire qui l’aide à soigner les oiseaux, avec ses petits moyens, a oublié de refermer la porte de la grande volière ; c’est une nuée d’oiseaux des îles et d’oiseaux-lyres qui volètent dans les saules et les pins du parc, sautillent sur les fils de fer des clôtures, sur les grillages et les treillis, picorent dans le pré vert : ils chantent c’est bon signe. La porte restera ouverte toute la nuit, restez ici, faites comme chez vous. L’auxiliaire de santé en rit.
Lis au retour un mot de Christine qui m’attend jeudi prochain, Yves et Anne-Hélène descendront à Grignan vendredi ; Pascal, Jasmine et son fils samedi. Elle dit se réjouir de voir les casses et le travail d’Yves et Anne-Hélène. Elle me dit aussi avoir croisé Philippe Jaccottet à la boulangerie, ils ont parlé de Marges.
Jean Prod’hom







La terre est un seuil et nos vies sont des veilles

Cher Pierre,
Nous serions donc des tard venus ; ce que nous faisons ne serait que le prolongement de ce qu’ont entrepris nos aïeux et notre histoire qu’une question sur le trajet d’anciennes réponses à d’anciennes questions sans formulation. Cette idée me ravit ; elle nous met à l’abri de l’injonction qui nous est faite continûment de ne rien entreprendre qui ne soit radicalement neuf. Elle nous autorise à de ne pas être original, ou en un autre sens. « Nous ne sommes pas d’aujourd’hui ni d’hier ; nous sommes d’un âge immense. »

Les interrogations naissent de notre proximité avec la nuit, elles ne s’en départissent pas ; s’en dégagent pour devenir raisons ; s’en nourrissent, c’est leur milieu ; y transitent, c’est leur canal ; elles y retournent lorsque nous leur faisons faux bond.
Nous sommes invités dans ce délai à déplier ce qui s’est noué dans notre gorge et les chicanes du langage, à libérer son chant, à faciliter les passages, ponts et cols, sans rien aplanir ; à réconcilier le promis avec le révolu sans quoi il n’y aurait pas de paix.
Notre présent étoile en tous sens, il enveloppe le passé et l’avenir ; la terre est un seuil et nos vies sont des veilles.
Jean Prod’hom
La photographie d’un enfant mort

Cher Pierre,
La photographie d’un enfant mort échoué sur une plage a jeté l’effroi. Son visage caresse le sable, son corps est tourné vers la mer au moment même où celle-ci est sur le point de le reprendre ; bientôt dans les bras d’un employé qui l’emportera. Sa terre d’asile aura été, sans délai, sa terre de sépulture.

Qu’on nous présente cette photographie ou qu’on nous la cache, qu’on ajoute un mot à ceux qui ont été prononcés, qu’on les condamne tous, que notre colère gronde, que ceux dont le métier est de parler fassent le procès de ceux qui se taisent et de ceux qui parlent trop n’y change rien, chacun tire la couverture à soi parce que nous avons froid, nous sommes en danger de ne savoir que faire ; il y avait bien la compassion mais l’enfant est seul.
Les cris et les prières montent les murs d’un silence gorgé de culpabilité, nous hurlons et pleurons sur la margelle d’un puits sans fond. Comment diable tout cela pourrait-il s’arrêter ? J’aurais tant voulu peindre des ex-votos.
J’en ai trop dit, je n’ai rien dit, quelque chose remonte les jambes de la sagesse qui avait su mettre un couvercle sur la terreur et la violence qui nous menacent ; nous habitons au fond d’une caldeira géante à l’abri des vents. Mais qu’on ne se méprenne pas, les dieux et les démons se sont réveillés, il faudra les nourrir.
Ce que j’ai à dire, je l’ai dit avant de le savoir, je suis un ignorant.
Jean Prod’hom
Synesthésie

Cher Pierre,
En dehors du tunnel ou du chemin que nous empruntons pour les traverser en compagnie de ceux de notre espèce, nos journées ne sont qu’entrelacs d’innombrables sensations, d’origine diverse, issues du milieu qui nous accueille et qu’elles rejoignent s’y fondant presque immédiatement.

Nos journées ainsi se répètent, et il nous semble même parfois que nous ne vivons, malgré nos nuits, qu’un seul et même long jour dans lequel surgissent et disparaissent à leur tour le lilas, ton corps, une nuée de moineaux, la fontaine, un mirage, une sirène, des iris, un cri.
Restent pourtant chaque soir, au fond du tamis qu’on agite, deux ou trois choses légères, aussi indépendantes les unes des autres que les îles d’un archipel, qui dessinent un être hybride, sans corps ni tête, une constellation si singulière que leur combinaison ne ressemble à aucune autre, une combinaison qui ne reviendra pas, cryptée et verrouillée du dedans.
Je voudrais donner à chacune d’elles le nombre qui l’identifierait, un nombre unique qui envelopperait sa teneur, sa texture et ses couleurs, morceau de marbre noir de Saint-Triphon, terre cuite ou praliné.
Jean Prod’hom
Le jaune des potentilles et des rudbeckias

Cher Pierre,
Ce matin, le vent d’ouest a fait reculer la bise, il a poussé des lambeaux de laine feutrée au-dessus du jardin ; si le jaune des pissenlits, des boutons d’or et des fleurs de colza a fait l’ouverture de la saison en juin, c’est aussi lui qui la ferme en septembre, avec les potentilles de la plate-bande et les rudbeckias du terre-plein.

Le ciel est descendu d’un cran, et le soleil qui s’est levé au-dessus des Aiguilles Vertes s’est glissé pendant une demi-heure sous la couverture nuageuse, il a ouvert comme au premier jour des cols et creusé des vallées qui s’étagent jusqu’aux Alpes, on se serait cru dans les Cévennes ; mais l’huître s’est refermée à huit heures et le manteau de neige sale est venu nouer ses franges à l’arête des Vanils.
Un journaliste de la région me téléphone, il se propose de faire paraître dans son journal quelque chose à propos de Marges, dans l’édition de jeudi prochain. Il me demande si j’ai une minute, si je peux répondre à quelques questions, par téléphone, il a feuilleté le bouquin. Monsieur, ne serait-il pas préférable qu’on diffère tout cela à la semaine prochaine ? Venez boire un café à la maison, mardi à neuf heures, c’est entendu.
Les jours qui viennent m’inquiètent un peu, les rencontres à la va-vite, les malentendus qu’elles vont provoquer, les approximations dont il faudra se satisfaire,... c’est le jeu. Ne pas vouloir convaincre son interlocuteur de quoi que ce soit, aller aux faits, raconter une ou deux choses, de celles qui tombent à nos pieds ou sous le sens.
Il a plu tout le matin. Le menuisier a posé les plinthes dans les toilettes d’en-bas et les stores dans les combles, je mange les restes de l’omelette de hier avant que les filles rentrent de l’école, Sandra leur a préparé des crêpes ; je file au Mont pour deux périodes, remonte. Je rattrape Arthur qui rentre du gymnase sur son vélo, sous la pluie mais enchanté, je fais une dictée à Louise qui me l’a demandé.
Les adolescents et les pré-adolescents ont l’art de jouer avec les garde-fous dont on a cru bon devoir les entourer aussi longtemps qu’ils ne se sont pas bricolé les leurs ; mon dieu que c’est difficile ! Il plu toute l’après-midi, il a plu tout le soir.
Jean Prod’hom
Histoire merveilleuse de Pierre Schlémihl

Cher Pierre,
Je ressors de ces premières journées de l’année dans la mine avec du gravier et du sable plein la tête, qui étouffent les voix du dedans et interdisent l’accès à celles du dehors. Je ne suis plus qu’une tête ronde, étanche, à peine un je serré dans un pudding qui tapisse ma voûte crânienne, embarrassé par un corps dont j’aurais bien pu me passer.

C’est lui pourtant qui trouve à 17 heures une issue, perméable à la bise qui se lève, légère, et au soleil qui a baissé ses feux. Le gravier et le sable glissent derrière les yeux, libèrent la nuque ; les pores de la peau s’ouvrent tout grand – ce sont des phénomènes que Lucrèce a décrits avec précision – , et le petit matériau de remplissage s’écoule comme dans une chéneau, cherche le chemin le plus court ; le corps retrouve ses marques, les bouchons lâchent, la circulation reprend son écoulement dans une tête à moitié vide ; seuls les plus petits atomes restent dans la boîte, ceux qui commandent les pensées les plus fines, ils se mettent à danser dans le vide retrouvé avec les poussières du dehors, les images, les simulacres.
Je lis en rentrant l’Histoire merveilleuse de Pierre Schlémihl dont S m’a parlé hier. J’imaginais que l’épaisseur conférée au corps par le jeu de la lumière et de l’ombre aurait été le pivot du récit d’Adelbert von Chamisso. Il n’en est rien, le botaniste allemand du début du XVIIIème siècle explore d’abord l’exception sociale de l’homme qui a cédé son ombre pour une fortune, et l’exclusion dont il est la victime. Le marché que le diable propose à Pierre pour la récupérer – lui remettre son âme à sa mort – n’y change rien. Les dernières lignes du récit le confirment :
Quant à toi, mon ami, si tu veux vivre parmi les hommes, apprends à révérer, d’abord l’ombre, ensuite l’argent. Mais si tu ne veux vivre que pour toi et ne satisfaire qu’à la noblesse de ton être, tu n’as besoin d’aucun conseil.

En 2004, le beau film d’animation que réalise Georges Schwizgebel à partir de ce livre va dans le même sens : une ombre se libère de son point d’attache et danse ; elle devient un quasi-objet qui réunit les danseurs du monde entier autour de celui qui en est dépourvu. Hymne formel, mais rien ou peu sur le désarroi, la transparence et l’opacité de l’homme sans ombre.
Jean Prod’hom
Rendez-vous à Grignan

Qu’un musée archéologique accueille des morceaux de terre cuite dans ses vitrines, on pouvait encore le concevoir, il l'était moins qu’ils se retrouvent dans une galerie d’art à Grignan.
Mais à y regarder de près, il faut se demander si le silence dans lequel ces tessons se tiennent alors qu'ils auraient tant à dire de leurs aventures, l'escamotage des conditions, des circonstances, des incidents sans lesquels ils ne seraient jamais devenus ce qu’ils sont, les rendent cousins éloignés des oeuvres d'art, dépositaires, si cela se pouvait, d’un art anonyme, orphelin.

Vous voulez en savoir plus ? Alors voici :
un lien vers Terres d’écritures,
l’affichette de l’événement, en grand,
la réception critique de *Tessons »,
l’histoire de cet événement,
... et même un dossier de presse.
Jean Prod’hom
Tessons

Dominique Aussenac
Le Matricule des Anges 161 (mars 2015)
Lisbeth Koutchoumoff :
Le Temps Samedi Culturel ici et là (15 novembre 2014)
Critiques littéraires du « Temps » (23 décembre 2014)
Palmarès ici ou là
Michel Audétat (30 novembre 2014)
Le Matin Dimanche
ch REIHE | ch COLLECTION | ch COLLANA (chstiftung)
Jean PROD’HOM | tessons
Jean-Louis Kuffer (5 et 12 novembre 2014)
Mémoire vive (51)
Ceux qui ramassent des éclats de beauté
Philippe Dubath et Odile Meylan (29 novembre 2014)
24heures 1
24heures 2
Jean-Blaise Besençon
L’Illustré (7 janvier 2015)
Tête-à-tête
Littérature romande (6 avril 2015)
Entretien
Tessons
Dominique de Rivaz (8 mai 2015)
Le Nouvelliste
Pierre Bergounioux (12 février 2015)
Cher Jean
Nicolas Verdan (27 novembre 2014)
Terre et Nature
Etienne Dumont (11 décembre 2014)
Bilan
Alinda Dufey (5 décembre 2014)
Vigousse
Thierry Raboud (6 décembre 2014)
La Liberté (Fribourg)
Carine Delfini sur La 1ère (12 novembre 2014)
RTS
Geneviève Bridel
Le Journal du samedi (27 décembre 2014)
Quartier livres
3.35 - 5.30
La Puce à l’oreille (27 novembre 2011)
Elsa Duperray
La Puce à l’oreille (27 novembre 2011)
Denis Montebello (2 décembre 2014)
Le blog de Denis Montebello
Karim Karkeni (17 décembre 2014)
Sur Katchdabratch
Alain Bagnoud (21 novembre 2014)
Blog
Danielle Marze
La Tribune Nyons-Vaison-Valreas (17 septembre 2015)
Thomas Vinau (8 décembre 2014)
Éclats de rien qui bout à bout forment le temps. Récolte insignifiante des petits morceaux de couleur dont plus personne ne veut. On ne répare pas les pots cassés mais on peut en faire des bouquets, des enfants, des questions.
Sylvie Durbec (22 novembre 2014)
Lire Tessons de Jean Prod'hom, c'est marcher d'un pays à l'autre, d'une plage à l'autre, d'un Portugal aimé à une Bretagne retrouvée. Et les tessons s'entassent un peu partout dans la mémoire. Et ravivent le désir de poursuivre.
Claire Krähenbühl (17 novembre 2014)
Tesson(s) s'ouvre comme une huître et la chair s'annonce savoureuse: "les belles histoires n'ont pas de fin". Pour vérifier, je cours à la dernière page et ça finit bien mais par une promesse. Ouverte. Rien ne finit jamais. On se penche, on ramasse, on touche, on écrit. "Les restes de la vaisselles du monde!" Reliefs. Bris qu'on empoche comme un marron. Brisures qu'on achetait gamines, les morceaux cassés des pièces à quinze (qui se souvient?) un cornet pour 10 centimes. Chutes de tissus, échantillons, lambeaux, brindilles, restes de restes, mots. Motifs.
Dany Schaer (20 novembre 2014)
Journal de Moudon
Echo du Gros de Vaud
Agathe Gumy
Aux 4 coins du Mont (février 2015)
Tête-à-tête
Alain Schafer (6 novembre 2014)
La Broye
PS
Mon rêve, moins ambitieux: que ce petit livre parvienne aux rivages bretons: Douarnenez, Paimpol, Saint-Guénolé, Roscoff,... Si vous en apercevez un dans une vitrine, avec la mer et le sable pour décor, faites une photo et envoyez-la-moi.
Jean Prod’hom
Malheur à celui qui n’a pas trouvé son ombre

Cher Pierre,
Ce sont des bois qui bordent le pays de Vaud au-dessus de Vulliens ; dessous des prés, des haies et c’est déjà celui de Fribourg. On devine, en se penchant, la Broye que dominent Rue et son château ; tout autour le vieux bourg auquel on a accroché il y a vingt ans une zone villas. Je termine Bel-Ami, assis à la lisière, avant l’arrivée des premiers pilotes. Georges Duroy s’est encanaillé en quelques années, à l’école de La Vie Française et des Forestier, il semble même avoir rajeuni et disposer à la fin de tout l’avenir devant lui.

On sonne la messe à Ursy dont on aperçoit l’église ; sa haute flèche ne lève pas le doigt vers le ciel pour rien, les fidèles sont plus nombreux là-bas qu’ici en pays protestant ; son corps, démesuré, rivalise avec les plus gros hangars à tabac de la Glâne. Quinze belles minutes de sonnailles, relief d’une époque révolue qui déroule sa vague, se propage et ondule, réveille les prés, les haies et les restes de la forêt primitive.
Ensuite plus rien : nous sommes en effet chargés, Arthur et moi, de seconder les commissaires des zones 10 et 11 de la course de trial des Vestiges. Un peu plus de six heures à poinçonner les cartes de pointage des cent quarante motards qui ont participé à cette épreuve bon enfant. Bruits de moteur à deux ou à quatre temps et odeurs d’essence.
Le soleil – qui a, aujourd’hui encore, tiré son arc d’est en ouest – a mis le feu. Malheur à celui qui n’a pas trouvé son ombre.
Jean Prod’hom

Deux belles heures assis sur un banc

Cher Pierre,
J’ai relu aujourd’hui tandis que Lili dormait et que Sandra et les deux grands étaient au marché le gros de Bel-Ami, publié sous forme de feuilleton. Je serais assez curieux de savoir comment Maupassant l’a écrit.

Autre chose encore, je suis incapable de me faire à l’idée que Georges Duroy est un jeune homme de moins de trente ans au début de ce récit, tout simplement parce que le narrateur, en indiquant dans le second paragraphe qu’il porte beau par pose d’ancien sous-officier, m’oblige à le vieillir illico d’une vingtaine d’années. Je n’imagine pas en effet un ancien sous-officier de moins de cinquante ans. Rien dans les pages qui suivent ne parviendra à le rajeunir – la réception a décidément toujours le pas sur la production.
On mange dans la véranda, Lili a préparé la sauce à salade, je réchauffe les restes de riz de la veille et passe à la poêle les filets de poulet que j’ai dégelés hier.
On monte en début d’après-midi dans un chalet d’alpage au dessus des Paccots, le chalet des Pueys où une collègue et son mari ont organisé une grande fête ; je passe deux belles heures assis sur un banc, songeries à la longe et tête à l’ombre. Un accordéoniste joue des airs qu’on devait entendre au XIXème siècle dans les gargotes de Bougival, d’Argenteuil, de Maisons ou de Poissy, les airs se succèdent et s’aboutent les uns aux autres, donnant à la fin l’impression que c’est une seule et même mélodie.. Mais nous sommes ici à plus de mille mètres d’altitude, non pas dans l’une des boucles de la Seine mais au pied de Teysachaux, pas de coquettes ou de bourgeois, de parvenus ou d’amazones, mais des familles nombreuses, des collègues et des amis.
Nous rentrons à 18 heures, je laisse Sandra et Louise au bout du chemin, file à Epalinges ramasser Lucie qui mange avec nous les pizzas que Lili a préparées. Il n’a y a pas une minute à perdre, ce soir Françoise chante à Boulens.
Jean Prod’hom
Les vérités naissent en captivité

Cher Pierre,
Premier vendredi matin de congé au triage, je goûte avec Oscar au chaud-froid des matinées de fin d’été ; les entre-saisons, lorsque le soleil est de la partie, c’est peut-être ce que la météo fait de mieux dans nos régions tempérées : grains secs dedans et l’air liquide qui coule sur la peau.

Je songe sous un épicéa, amusé, curieux, aux grandes et petites manoeuvres qui tout à la fois annoncent et constituent la rentrée littéraire, aux bricolages romanesques que les auteurs exhibent sur les plateaux après les avoir escamotés dans leur livre.
Le roman se confronte, à sa manière, plus peut-être que tout autre manifestation littéraire, aux discours ambiants qui établissent ce qui est, le réel, qu’il s'en affranchisse radicalement – sans pourtant désobéir aux principes d’identité et de non-contradiction –, ou qu’il cherche à l’épouser en en suivant les courbes supposées – sans manquer de le tromper, souvent : c’est un roman mais ça ressemble étrangement à ce qui se passe réellement, disait l’un d’eux l’autre jour à la radio. Le roman se donne ainsi le droit de dire ce qui est ou n’est pas, sans être accusé de mensonge, cela donne lui donne des ailes. Mais si l’une de ses missions est d’écrire le vraisemblable, lui revient aussi la tâche d’écrire ce que personne n’a encore vu ailleurs que dans ce qui est en train de s’écrire, le vrai qui se fait.
Le lecteur attend à la fois que le romancier le captive et lui fasse entendre quelque chose de vrai. Cette double contrainte met le second en porte-à-faux : ou il ouvre au premier sa cuisine et la vérité est marquée du sceau du doute, ou il l’escamote et la vérité ne sort pas de l’orbite des représentations lisses.
Les vérités naissent en captivité, au roman de les détourner de ce qui leur a donné naissance et des lieux qui les ont hébergées, en recourant à des dispositifs, à des techniques compatibles avec nos habitudes. Faire entendre la vérité est un métier ; la vérité est un savoir faire, elle se taille, se polit, s’organise.
Quoi qu’il en soit, en temps de guerre comme en temps de paix, ceux qui écrivent et lisent des romans n’ont jamais fait de mal. Et parfois un romancier passe outre, il refuse à la fois de séduire et de convaincre.
Jean Prod’hom
Recommencer même s’il est tard

Cher Pierre,
Tout est joué, je n’y puis rien ; chacun est emmêlé dans la combinaison que lui ont laissée ceux qui l’ont précédé. Un mot dit de travers ou mal entendu ne s’efface pas, pas plus qu’une croyance partagée par le grand nombre, ou une rumeur, ou un mirage acoustique, c’est la donne. Cartes orphelines, maigre paire ou quinte floche, qu’importe, personne n’en sait rien, tous perdus dans l’étendue et en équilibre sur une pointe plus acérée que celle d’une épingle, avec l’assurance que le rien qu’on tient dans la main déborde, lorsqu’on l’ouvre, bien au-delà de la Crimée.

La Maison de l’Ecriture depuis le deuxième étage du Mottier C
On tâtonne somnambule, on se saisit yeux fermés de ce qui semble à notre portée et on le déplace derrière nous, ou dans une boîte, dans sa mémoire ou une poche. Parfois ça n’y entre pas ; on s’avise alors que les propriétés de l’étendue interdisent que nous continuions à faire comme on l’a fait jusque-là, entravent notre marche, nous amènent à surcharger notre existence, ou l’autorisent, mais à des conditions trop coûteuses. Quelque chose cloche, coup de sac, l’avenir décidément ne suit pas le passé.
Les fidèles s’empressent de nier le tout en bloc, les puristes refont des calculs, les opiniâtres se lamentent au pied de l’impasse. Les joueurs, eux, recommencent, à côté ou à l’envers, très sérieusement, sans se préoccuper de leur isolement, sans s’inquiéter des voisins. J’ignore s’il faut du courage, s’il faut être champion des causes perdues, enfant ou idiot pour lever à nouveau le voile, en se décalant, en prenant du retard, en marchant à contre-temps ou à contre-sens, et tout recommencer même s’il est tard.
Jean Prod’hom
C’est une bande étroite
Cher Pierre,
Il existe, tout près de l’école où je travaille, un sentier qui traverse l’un des derniers domaines agricoles à l’intérieur du Grand-Lausanne ; il est entouré d’immeubles locatifs et de villas mitoyennes, on en aperçoit des bouts de la fenêtre de la classe 207 ; c’est une bande étroite, large de deux pieds, sur les bords de laquelle poussent en août des courges et des choux. Il disparaît au passage du Rio de la Croix, avant de réapparaître au Ferrajoz ; il zigzague dans la pente après la Longeraie, ralentit dans le verger, jusqu’à la lisière du Bois de Vernand qu’il traverse au frais ; et puis il bascule dans les prés.

Kurt von Ballmoos | Gymnase du Bugnon
La route de Cheseaux le coupe net à Romanel, mais il reprend vie à Camarès, péniblement ; il franchit au sec le Taulard, fait une épingle pour emprunter le pont de la Mèbre. Il éclate dans les bois de la Chamberonne, y dessine une curieuse arborescence. Mais ses excès le perdent, incapable de se ressaisir, personne ne s’en souvient plus au treillis de l’autoroute.
Lui-même désespère, il s’agit donc d’un réel miracle lorsqu’on en aperçoit une section, très bien conservée, entre Mex et Vufflens-la-Ville. Court répit : malgré la Venoge dont il aurait pu se faire une alliée, le sentier disparaît sous le bitume jusqu’à Penthalaz.
Il se remet à espérer au Moulin de Lussery, on le devine en effet qui pousse sous le chemin de terre, insiste pour surgir enfin, comme une eau vive, un peu après la Sarraz, libre de toute entrave, il se joue des pentes du côté de Ferreyres. Monter lui donne des forces si bien qu’il parvient sans efforts jusqu’à L’Isle, folâtre un instant le long du Chemin vert, avant de grimper seul jusqu’au Mollendruz. Il allonge le pas dans les pâturages du Petra Felix et plonge sur les rives du lac de Joux. C’est un peu avant Le Pont que j’ai eu l’assurance qu’il s’agissait bel et bien du chemin qui passe tout près de l’école où je travaille : même largeur, mêmes fleurs, mêmes choux, mêmes courges, même ciel.
Il y a un train toutes les heures, changement à Vallorbe et bus de Lausanne jusqu’au Mont ; le sentier, lui, revient par le même chemin.
Jean Prod’hom


Rose Envy

Cher Pierre,
Grosse agitation ce matin dernière la porte de la salle de bains, à laquelle je ne me mêle pas puisque j’ai la maison pour moi jusqu’à midi. A l’origine, la reprise scolaire et la coexistence depuis peu, dans un même lieu, de l’évier, du miroir et de la douche.

Chacun tourne les talons pour s’engager dans son tunnel et s’éloigne ; je fais le petit tour avec Oscar, un chevreuil lève la tête, on s’arrête, il replonge son museau dans le pré.
Je m’embarque, au retour, dans le Rose Envy, que Dominique de Rivaz a fait paraître en 2012, texte fait main, court et tendu, précédé d’une remarque de Jean Roudaut, qui me ramène à mes réflexions de la veille sur le saint Augustin de Carpaccio et sur le devenir-taupe de notre espèce.
« Lire est se nourrir d’un livre. Pour que cette nourriture se fasse consubstantielle, il faut la broyer, se l’assimiler : c’est le rôle de cette forme de manducation qu’est la réflexion rêveuse quand le regard quitte le texte... »
Ni miracle, ni cri ni claque, mais glissement progressif auquel nous convient une écriture et un enfant qui, plutôt que de se ronger les ongles ou de se mordiller les lèvres, grignote l’intérieur de sa joue et de sa vie jusqu’à faire disparaître, à la fin, à la fois son corps et celui des autres. Il ne reste des morts que des cendres et des souvenirs sur lesquels les vivants soufflent pour les garder en vie, la tête levée en direction de cet ailleurs où conduit l’écriture et d’où nous parvient l’appel de ceux qui ont quitté la partie.
Cendres ou terreau qu’importe, ne pas s’offusquer quelle que soit la sépulture ; Styx et obole sont l’affaire des vivants. Saint Augustin l’a établi. « Le devenir du corps n’engage en rien le salut de l’âme », celui-ci ne dépend que de la bienveillance des vivants.
Un récit en tu que le narrateur précède, le récit d’une gamine soucieuse en diable qui traverse les âges dans un glissando musical, se détourne de l’opprobre qui la menace ; le narrateur dit tout, tout haut et avec grâce, sans s’appesantir, jusqu’à une espèce de vide d’où la vie refait surface, légère, les cendres se mélangent aux fragrances du lilas et le souvenir devient respiration.
Guillaume amène la table et les chaises, on boit un café. Je quitte le Riau lorsqu’Elsa, Lil et Louise rentrent, il est midi passé. Je fais quelques photocopies et retrouve les élèves auxquels je demande de tirer sur le fil que je leur ai tendu hier. Ils tirent sans que je sache encore exactement où ce fil va nous conduire.
Je fais une photo de la Yaris que je vais laisser au garage demain. Arthur revient satisfait de sa première journée complète au Bugnon, Louise de la sienne à Mézières. On n’entend pas Lili qui se prépare à l’étage, c’est la reprise de l’entraînement. J’irai la rechercher tout à l’heure sous le soleil, je me réjouis.
Jean Prod’hom
Eclats de Méditerranée

Cher Pierre,
Le vaste mouvement de laïcisation des institutions scolaires aurait pu ouvrir les yeux de nos enfants, les ouvrir à d’autres ciels que celui qu’indiquent, urbi et orbi, l’index de l’église romaine et, mystérieusement, le petit doigt des consciences réformées.
Mais les précautions prises par les hommes chargés de cette sécularisation les ont conduits à se taire et se faire tout petits jusqu’à disparaître sous terre, pour éviter le soupçon de privilégier tel ou tel ciel. Avec pour conséquence le rejet de l’idée essentielle que les signes pourraient venir d’ailleurs, laissant nos enfants seuls avec eux-mêmes. Nouvelle traque, nouvelle ère du soupçon, autrement plus dangereuse que celle dont certains philosophes avaient rendu responsables, au milieu du siècle passé, Marx, Freud et Nietzsche. Voici nos enfants plongés dans une nuit où le ciel est par prudence banni.

Voilà ce que j’ai pensé au terme de cette première longue journée à la mine, longue traversée à quai, grandes baies vitrées à travers lesquelles il est interdit de regarder, tableau étrange qui éloigne nos enfants du saint Augustin de Vittore Carpaccio et les rapproche de la taupe. D’une taupe qui s’ignore, disposant de barres à mine, de lanternes, de cliquets et de roues dentées, tunnels étroits et galeries d’aération qui permettent à l’espèce de ne plus avoir besoin de sortir la tête de l’eau et de se détourner du ciel.
Cette obscurité dans laquelle m’ont plongé ces réflexions s’est dissipée en écoutant Vassilis Alexakis et Nicolas Verdan, visages au vent, parler à Sonia Zoran de la Grèce – au-delà du roman de ses turpitudes –, de la mer qui l’a découpée, qui l’a préservée, et de ses rives sur lesquelles vient s’échouer les échos d’un ailleurs qui demeure entier.
Jean Prod’hom
Il y a des jours qui distillent un poison

Cher Pierre,
Il pleuvine ce matin, et il pleuvinera jusqu’au soir, si bien que je n’ai pas quitté la bibliothèque, vissé devant l’ordinateur à choisir les textes que je me propose de lire à Grignan, et à les disposer bord à bord comme un parquet flottant.

Autrement dit rien, ou presque rien : trois ou quatre cafés, un passage à la laiterie, un autre au Mélèze où je dépose une facture, deux au compost ; j’ai guetté sous le chêne le pic épeiche et scié un pavatex pour bloquer la chatière.
Tout le monde ce soir s’affaire, sauf moi : Sandra prépare une salade et fait cuire des pommes de terre, Louise met la table, Arthur coupe des tranches de fromage, Lili jette des oeufs dans la poêle. On se retrouve dans la véranda et on se régale.
C’est tout, non pas que le monde se soit subitement appauvri, mais parce qu’il y a des jours qui distillent un poison qui paralyse les mâchoires, engourdit la vue et alourdit l’esprit, devenu soudain incapable de prendre de la hauteur, de se glisser dans un pli de la terre ou une trouée du ciel.
Je le sais d’expérience, il n’y a rien de mieux à faire qu’à attendre la nuit qui rétablit l’équilibre des humeurs en vidant la boîte crânienne de ce qui l’encombrait.
Jean Prod’hom
Corcelles-le-Jorat | 22 août 2015

Cher Pierre,
Au risque d’en étonner plus d’un, moi-même en premier lieu, je suis étrangement calme avant cette rentrée scolaire, bien décidé à mener les élèves à l’essentiel, à ne pas les noyer dans une cascade de distinctions ou à les égarer dans les labyrinthes de la scolastique.

Les jours rétrécissent, certes, mais le soleil, radieux, nous rappelle que l’été n’a pas renoncé. Et si le temps des cerises est bel et bien passé, celui des pommes du verger nous promet de belles récoltes. Sandra et les enfants sont descendus en ville, c’est là-bas que se trouve leur avenir ; je monte au triage avec Oscar, – le sien est plutôt dans les bois.
Avec dans la poche La Vallée de la Jeunesse d’Eugène ; c’est un livre publié en 2007, qu’une collègue nous a proposé de lire avec nos élèves, dans l’idée qu’ils puissent, au moment voulu, rencontrer son auteur et s’entretenir avec lui du métier d’écrivain ou, s’il ne s’agit pas d’un métier, de l’écriture lorsqu’elle n’est pas exercice scolaire.
J’ai lu le récit d’Eugène il y a quelques années. Des vingt (ou vingt-deux objets ?) qui ont marqué sa vie, à Bucarest et à Lausanne surtout, je me souvenais assez précisément de l’aiguille à ponction et du Rubik’s Cube 4 x 4. L’idée de lire ce livre avec des élèves m’emballe, le principe est efficace. Et puis, à travers le rappel des dix objets qui lui ont fait du bien et des dix qui lui ont fait du mal, il sera aisé d’évoquer plusieurs aspects du monde dans lequel nous vivons ; on abordera en outre la belle et épineuse question de l’écriture des souvenirs.
Et même si tout est faux, quelle importance ? Je me souviens de la réponse de Blaise Cendrars quand on l’a sommé d’avouer s’il avait réellement pris le Transsibérien, pour écrire un de ses plus fameux textes : « Qu’importe si je l’ai pris, puisque je vous l’ai fait pendre ». (La Vallée de la Jeunesse, page 178)
J’ai lu, Pierre, votre mot à mon retour du triage, là où j’ai suivi ce printemps les amours de deux bouvreuils et la naissance de leurs petits ; là où je lis aussi, parfois, loin de tout, et somnole.
Vos envois me réjouissent tout autant parce qu’ils m’obligent à demeurer attentif aux mésaventures et aux petites misères des autres, si semblables aux miennes, mais aussi aux beautés qui persistent et qui permettent à l’inquiet que je suis de trouver des arrangements avec le monde, ne serait-ce que pour en sortir vivant lorsque le jour tombe.
Sandra s’est rendue à Servion, la table et les chaises sont prêtes ; on en disposera la semaine prochaine. Promenade encore avec Sandra et Oscar, avant que le soleil disparaisse derrière le bois Vuacoz. J’ai entendu à nouveau, au-dessus du poulailler, les petits coups secs et francs du pic épeiche que j’ai aperçu ce matin.
Jean Prod’hom
Gif | 22 août 2015

Cher Jean,
Nous sommes deux inquiets, l'un du Jorat, en Suisse, l'autre, français, d'origine limousine, aux portes de Paris, à croire devoir garder trace du temps qui passe et à échanger quelques observations, à ce sujet, par dessus la frontière. Je n'ai pas vu que ce que vous notez, de votre côté, ni nos petits courriers attentent à aucun principe, éthique, esthétique, théorique, politique... J'ai noté, dès l'enfance, la rigueur morale des quelques copains protestants que j'avais, dans le Sud-Ouest. Ils n'étaient pas drôles, riaient difficilement, se tenaient sur leur réserve mais on pouvait compter sur eux, ce qui n'était pas toujours le cas avec les papistes. La totalité de l'histoire, du passé demeure présente dans les agissements des vivants.
Frappé de l'attention que vous donnez, entre mille autres choses, aux bouvreuils. De vivantes merveilles, auxquelles on peut toutefois reprocher de manger les bourgeons floraux et de nous priver de fruits. Les petits appareils numériques ont tout changé. On peut aussi extorquer des images précises, en couleur, au flux temporel, fixer l'atmosphère sonore. Où ai-je vu qu'une thèse avait été consacrée à celle des rames de RER, avec le bruit croissant et décroissant du moteur électrique, l'annonce de la station par une voix préenregistrée, d'homme ou de femme, les sonneries des portables, les conversations, à haute et intelligible voix des téléphoneurs, la détente de l'air comprimé à l'ouverture des portes, la sonnerie précédant le départ... L'écriture a donné aux mortels que nous sommes la possibilité d'étendre indéfiniment leur mémoire, donc leur conscience. Rien peut-il échapper à la révolution numérique?
Ne vous tourmentez pas. On a déjà bien assez de soucis comme ça. Bonne journée. Amitiés.
Pierre

Photo | Pierre Bergounioux
Corcelles-le-Jorat | 21 août 2015

Cher Pierre,
Merci de votre mot. Comment en effet échapper de nos prisons tout en restant vivants ? Là-bas des ponts, ici des cols ; les Joratois ont puisé, je ne sais où, le courage et la curiosité de se risquer hors d’un massif forestier inextricable – qui culmine modestement à 900 mètres –, rejoindre le chemin de Sainte-Catherine infesté de brigands, faire sauter le verrou au Chalet-à-Gobet qui tenait éloignés ceux des hommes qui pouvaient se passer de leur tête de ceux qui pouvaient se passer de leurs mains. C’est seulement dans les années 60 du siècle passé que la grande bourgeoisie détenant le capital économique, culturel, et symbolique a entrouvert ses portes et laissé venir à elle, au compte-goutte, les enfants du Jorat dont elle avait besoin.

Nous n'avions plus entendu la sonnerie du réveil depuis cinquante jours. Debout donc au clairon pour une conférence des maîtres à l'occasion de laquelle, probablement, nous nous rendrons compte à nouveau que les précautions prennent le pas, chaque année davantage, sur ce qui relevait du bon sens et de la conscience de chacun.
J’ai la confirmation, en partant à la mine, que le sifflement dont je ne parvenais pas à identifier la source il y a quelques jours, provient d’une boîte, pas plus grosse qu'une grosse boîte d'allumettes, déposée sur le rebord d'une fenêtre à plus de cent mètres de la maison. J’en conclus, pour ne rien dire de la pollution sonore, que j’ai l’ouïe aussi fine qu’une fouine.
Je m'arrête au garage et jette un coup d'œil sur la Suzuki Swift, candidate au remplacement de la Yaris que je regrette déjà, avant de descendre les six marches de l'aula. Rien n'a beaucoup changé pendant l'été, les vraies questions demeurent à l'abri, recouvertes par d'anciennes et de nouvelles directives qui flamberont vite. N'en vouloir a personne. On parle de tout, soigneusement, sans rien laisser au hasard : retenues, parking, bus, surveillance, légalité,... de tout ce qui entoure ce dont on ne parle pas.
Je repasse au garage dans l’après-midi, signe finalement pour une Nissan Micra. Je me hâte de terminer ce que j’ai à faire au collège, le soleil claire fort. Je fais une brève halte au Riau avant de récupérer les filles à Thierrens, enchantées de leur camp, moins de l’école, pour des raisons différentes des miennes. Etaie le pommier qui penche dangereusement.
Me sens encore le devoir, là où nous en sommes de cette correspondance fictive, semi-fictive, réelle, de vous demander si vous pensez qu’elle a sa raison d’être. Si elle vous embarrasse, faites le moi savoir. C’est le devoir de chacun de laisser à l'autre le pouvoir de s’échapper. Je suis né au pays de Viret, de Farrel et de Calvin ; et je ne voudrais nourrir ni votre mécontentement ni ma culpabilité. Amitiés.
Jean Prod’hom
Gif | 21 août 2015

Cher Jean,
Trois semaines et plus qu'on a retrouvé la grande banlieue, laquelle tire un charme étrange, en août, d'être à peu près vidée de ses habitants. Pas une âme, des places partout, pour se garer, un silence sidéral. On se croirait sur la lune ou bien sur terre mais après la disparition de l'homme. Il va refaire son apparition dans quelques jours.
A quoi bon les cartes routières quand on a le GPS? Qu'elles servent, une dernière fois, à éclairer les montagnards du Jorat sur les hauteurs, plus modestes, du massif Central.
Bonne fin de vacances. Amitiés.
Pierre

Un aperçu du pont de fer, désaffecté, sur les gorges du Doustre. Il a été lancé en 1911.
On pouvait échapper, enfin. (Photo | Pierre Bergounioux)
Corcelles-le-Jorat | 20 août 2015

Cher Pierre,
Merci pour votre mot, il m’a fait plaisir. Que vous m’assuriez qu’il existe des Jean-Rémy du côté de Gif-sur-Yvette n’atténue nullement ma peine, au contraire ; me voici pourtant d’un coup moins seul. Tout porte à croire, malgré tout, qu’on n’en a pas fini avec la bêtise.

Le garagiste est absent à 8 heures, je déposerai la Yaris demain matin. Le directeur a accepté ma demande de congé pour le jeudi 10 septembre, bonne chose de faite ; je passe à l’économat commander ce que j’ai oublié. Pour le reste, mieux vaut attendre lundi et se tenir prêt à tout. Je passe dans la salle Paul Klee, paie à Romain ce que je lui dois, il me raconte ses vacances en Espagne. Je remonte au Riau.
Vincent propose une simple tôle à glisser sous le poêle, avec un rebord de trois à quatre millimètres ; il prend les mesures, viendra avec son diable la poser, et l’ajuster s’il le faut.
Arthur tond l’herbe du jardin, je prépare une ratatouille, des filets de brochet et un beurre persillé, il est temps de préparer la rentrée d’Arthur au gymnase. Dans la soirée, Valérie vient donner un coup de main à Sandra pour choisir et mettre en page les photos de nos vacances à l’île d’Yeu.
PS
L’enveloppe – ou le pliage – dans laquelle vous avez glissé votre mot, le plateau de Millevaches, en êtes-vous l’artisan ?
Jean Prod’hom


Gif | 13 août 2015

Cher Jean,
Difficile d’épiloguer après que François Bon l’a fait. Si, pourtant, l’écho soulevé par la marche des vivants confondus sur le chemin du cimetière, l’intrusion de Jean-Rémy. Il existe des hommes de cette nature. J’en témoigne.
La preuve que nous habitons des pays distincts, ce sont les expressions « jouer à clicli mouchette » et « mettre en cupesse », c’est la première fois que je les vois et je ne les comprends pas.
Merci de votre envoi. Bon mois d’août et beaux tessons. Amitiés.
Pierre

Pierres, couleurs et lumières

Cher Pierre,
Le peintre recouvre de béton ciré les rebords des fenêtres de la salle de bain, Sandra et Arthur sont descendus en ville, j’aurais pu naturellement profiter de cette matinée pour préparer la rentrée. Pas envie ! Je lis le petit livre que Monika Langhans m’a fait gentiment parvenir hier par la poste : Pierres, couleurs et lumières.

Un petit livre rempli de proses brèves, de galets, d’encres et de nom de villages ramassés tout autour du Lubéron. Elle n’y vit pas mais y retourne régulièrement, sûrement parce qu’elle y a laissé quelque choses autrefois. On y croise ses amis : un potier à Roussillon, un vieux couple qui résiste au vent et à la pluie sur les hauts de Saignon, une chineuse de fers rouillés dans la garrigue autour de Murs, des pèlerins à Cucuron, un chien, un papillon, une guêpe. Un indien autrichien aussi, près de Fontvieille, Yvonne Printemps et Bacon sur la route de Tarascon. Et puis il y a Roussillon qui revient comme le mistral, les carrières d’ocre lorsqu’elles étaient ouvertes au public, la place Camille-Mathieu à la Saint-Jean, les vignes de Bonnelly que Samuel Beckett a vendangés.
Monika écrit, peint, ramasse tôles et pierres dans les veines desquelles elle lit ou dessine l’avenir, elle aime les souvenirs, les salades provençales et les ciels étoilés. Je me souviens tout à coup de la tristesse de Céreste, des flancs du Lubéron, d’une semaine de travail à Lourmarin autour de Thomas Kuhn, d’un petit matin à Saint-Saturnin-lès-Apt après m’être perdu dans les neiges du Ventoux.
Je ne crois pas que je retournerai à Gordes, je ne me souviens pas de Lacoste, ni de Menerbes et d’Oppède-le-Vieux. Mais ce petit livre a été comme un pont, il m’a permis de rejoindre sur l’autre rive le tracé d’anciennes promenades et les jours oubliés ; il m’a tendu quelques fils pour rejoindre chambres, silhouettes et chemins qu’il m’a suffi de tirer pour tout recommencer.
Je retrouve un peu par hasard, dans un carnet de notes, la photo que Lily m’a donnée l’autre jour ; on la voit avec Nicolas, sa femme et Philippe. Bien des choses ont changé depuis. Un ouvrier de l’entreprise qui nous a vendu la chaudière la contrôle en début d’après-midi, il me conseille de baisser la courbe de chauffe à 15 et de monter la température à 22 ; me détaille les opérations que j’aurai à répéter au début de l’hiver pour régler convenablement la température dans la maison. Arthur se rend à vélo à Froideville chez ses grands-parents, on va manger au café du Jorat en amoureux.
Jean Prod’hom

De chaque côté de la route

Cher Pierre,
De chaque côté de la route qui va de Chapelle à Thierrens, on ramasse les pommes-de-terre et les becs verseurs crachent le maïs d’ensilage. A l’arrière de la Yaris, Louise et Lil sont pressées d’arriver, rêvent leur semaine ; elles nomment les chevaux qu’elles aimeraient monter pour la voltige, ceux qu’elles voudraient travailler à la longe, sur lesquels elles feraient volontiers une balade,... Je les dépose avec leurs rêves et dix bonnes minutes d’avance ; ciel maussade, elles s’éloignent dans l’allée, sans se retourner, balançant en tous sens leur sac de couchage.

Je lis dans les combles les premières pages de Tom petit Tom tout petit homme Tom de Barbara Constantine, brûle les déchets qu’Arthur a entassés près du hangar, restes de ses travaux de jardin de la semaine passée, je découpe une section du treillis du poulailler qui devrait nous permettre d’y ranger les tuiles que les panneaux photovoltaïques ont remplacées sur le toit.
Arthur se propose de nettoyer l’étang, de l’agrandir même en profitant de la petite tractopelle que Marc-André amènera pour assainir le bas de la façade orientale de la maison. Bonne idée. Je monte au triage avec Oscar, où je lis les dernières pages de Tom petit Tom, passe à la forge de Ropraz, Vincent n’est pas là.
A Servion, Guillaume a refait la table en noyer Louis-Philippe et les sept chaises, il nous fait voir comment il se propose de l’enduire. Apéritif sur la terrasse et spaghettis à l’intérieur. On rentre à 23 heures passées.
Jean Prod’hom
Inavouable désir

Cher Pierre,
La Yaris est bien mal en point, il va falloir prendre une décision avant qu’elle nous lâche. Je m’arrête à Coppoz, dépose ma roue crevée ; la garagiste me fait voir une Suzuki 4X4, je repasserai jeudi pour faire le point.

Il est légitime de se demander si les travaux du troisième bâtiment scolaire seront terminés lundi prochain ; les ouvriers s’affairent en tous sens, dans la salle de gymnastique, la cage des escaliers, celle de l’ascenseur, dans les classes, le hall. Je les regarde avec intérêt mais aussi avec un curieux désir, inavouable, le désir que tout se complique, que rien ne marche et que la rentrée ait lieu dans des conditions inhabituelles, imprévues, difficiles, condamnés que nous serions à faire autrement, aller à l’essentiel, bricoler, inventer,...
Peu d’enseignants encore dans l’Etablissement, les doyens vont et viennent, assurent le fléchage, dégagent les sorties de secours. Je remonte au Riau au milieu de l’après-midi, les mains vides, sans avoir fait grand chose.
Les filles s’affairent autour de la console qu’un ami d’Arthur leur a vendue, ils se sont constitués en coopérative, pourvu que ça dure. Nous faisons le petit tour, la bronchite de Sandra nous oblige à marcher à petits pas, Oscar court, un chevreuil nous regarde en-haut la Mussilly, un autre en-bas.
Arthur est descendu à Lausanne, à 17 heures, rejoindre ses amis de Parkour Lausanne. Il nous téléphone à un peu plus de 20 heures, il m’attend aux Croisettes. La nuit tombe, un chevreuil disparaît sous la Moille-Baudin.
Arthur n’a pas une minute, se douche et part à vélo, dans la nuit et à travers les bois, rejoindre des amies et des amis au refuge de Corcelles. Il rentrera, lui-même ne sait pas quand. J’ignore toujours davantage l’emploi de son temps, il ne peut en être autrement. Je vais consulter le site de Parkour Lausanne, une jeune association qui met en avant la dimension non compétitive de cette activité, plutôt un art et une philosophie.
Les filles partent demain matin pour quatre jours à Thierrens : balade, éthologie, voltige, longe,... Elles préparent leur sac, excitées comme des puces, devenues soudain inséparables, les meilleures amies, les meilleures soeurs du monde. Elles se couchent tard, trop tard, à 11 heures. Mais comment leur en vouloir ?
Jean Prod’hom


Cellule de lieu et cellule de temps

Journée donc de transition, comme on dit au Tour de France, au Riau, avec une pluie fine et le podcast d’une émission écoutée d’une oreille, hier entre Crest et Voiron, animée par Jean Claude Ameisen sur France Inter, intitulée La mémoire des jours qui furent les tiens.

L’hippocampe et ses zones périphériques auraient donc un rôle important dans l’exercice de la mémoire, en laquelle persiste ce qui a disparu, là tout proche ou il y a longtemps. Ce que nous avons vécu en état de veille repasse en boucle la nuit, migre dans le cortex cérébral, se synchronise avec ce que nous avons déjà vécu avant de s’y intégrer. Nouvelle pièce d’une mosaïque mouvante, morceau indépendant, mais susceptible de se recombiner avec d’autres. Fidélité des souvenirs donc, inscrits dans le jeu des cellules nerveuses, mais aussi de l’espace dans lequel nous nous déplaçons et que nous nous représentons.
Les cellules nerveuses dessineraient et conserveraient les trajets que nous effectuons sous la forme de cartes dynamiques de l’environnement, qui s’empilent à mesure que nous avançons. Ce sont ces cartes que nous convoquons pour identifier où nous sommes quand on y est, pour retrouver le chemin que nous avons emprunté la veille ou il y a un mois, et qui nous conduira à l’endroit où nous souhaitons nous rendre, en déterminant notre position actuelle dans l’environnement, celles qui l’ont précédée et celles par où nous souhaitons passer. Avec parfois des bugs.
Nous disposerions donc d’un système de navigation constitué de cellules nerveuses de deux espèces. Les cellules de lieu d’abord, dans l’hippocampe, qui s’activent pour tout à la fois identifier le lieu que nous traversons et construire la carte de son environnement, cellules susceptibles d’être réactivées dans des circonstances analogues, ou pour nous aider à revenir sur nos pas.
Et, dans une région voisine de l’hippocampe, le cortex entorhinal, des cellules de grille, constituant un système de coordonnées sans lequel la navigation dans l’espace s’avèrerait impossible, une partition hexagonale de l’espace préexistant dans notre cerveau, recouvrant n’importe quel lieu sans laisser de surfaces libres et grâce à laquelle sont déduites distances et frontières.
Les cellules de lieu – réparties sur un fond de cellules silencieuses – recomposent les cartes sans jamais les effacer. Leur nombre pourrait être important sachant que toute cellule de lieu peut devenir cellule silencieuse dans un autre environnement. Il semblerait que les cartes ainsi générées soient de résolutions différentes, certaines étant activées dans certains contextes tous les mètres, dans d’autres tous les dix mètres. Sur des cartes saturées d’hexagones de différentes dimensions.
Dans l’hippocampe et le cortex entorhinal coexisteraient donc l’activité des cellules de lieu, de grille, et silencieuses sans lesquelles nous serions perdus, mais aussi les traces de notre mémoire émotive et déclarative (ou sémantique), et les cellules de temps qui auraient pour tâche de fournir un ordre aux événements que nous avons vécus, de chiffrer leur durée et la durée des intervalles qui les séparent. Certains chercheurs ont avancé que ce sont les mêmes cellules qui président à la construction de l’espace et du temps.
La question du substrat biologique auquel ces recherches se réfèrent, la méthodologie qu’elles honorent, les observations et les interprétations qu’elles développent me dépassent naturellement. Mais le traitement de la question de la mémoire, celle du lieu, des émotions, celle du temps, du langage ont pris un virage qui ne peut me laisser indifférents. Et cette idée que les cellules de temps fassent partie des cellules de lieu ravit le sauvage que je suis, convaincu que notre seule chance, c’est que le temps se réduise au lieu.
Arthur me téléphone, je vais le rechercher, lui et ses camarades, à Cossonay ; puis Françoise et Lucie au Chalet-à-Gobet, elles mangent ce soir avec nous.
Jean Prod’hom

Marché de la vente de paroisse du Jorat

Cher Pierre,
Ce matin, j’ai mangé un croissant que les larmes d’une jeune boulangère ont arrosé. Si j’avais su, je n’aurais pas repris le commerce, me dit-elle, neuf ans de galère, que vont devenir mes enfants ? J’ajoute à mes emplettes un pain au chocolat, un peu de honte aussi lorsque je lui dis courage et que je m’en vais.

Au café de la Bourgade, le vieux René, loquace en diable, me raconte le livre qu’il est en train d’écrire sur la paysannerie locale. Il y évoque surtout, précise-t-il, ce qui a disparu, ce qui rendait les gens plus sociables. La pauvreté, les chevaux, les veillées, les coups de main, les échanges main à main, la belote. Mais aussi la guerre, le silence, les cachotteries. Les vignes, les olives, la betterave, le seigle, la garance cultivée autrefois dans le Vaucluse. C’est loin d’être gagné : sa petite fille dactylographie le texte ; des amies à lui, qui ont travaillé dans l’administration, s’occupent des photos et de la mise en page. Pas sûr que ça suffise. J’aime bien René.
Je laisse Isabelle Huppert et Claude Chabrol à Crest, ils m’on accompagné sur France Inter depuis La Bégude. La petit ville des rives de la Drôme est bondée, c’est jour de marché, sourires d’apparat de chaque côté des stands. J’ai la nette impression, assis sur les escaliers de l’église Saint-Sauveur, de voir défiler les sosies de gens que je connais depuis toujours, mais avec le sentiment qu’ils font à nouveau transparaître ce que je ne voyais plus : leur insouciance, leur innocence. Jean-Claude Ameisen présente, entre Crest et Voiron, une extraordinaire émission sur la mémoire, que je me promets de réécouter demain. René Char récite ensuite des poèmes qui me conduisent, en passant par Céreste et Lourmarin, jusqu’aux portes de Genève.
Je fais halte à Bursins, il y a un mariage à l’église, la porte est ouverte, j’entends sur le seuil un extrait du chapitre 5 de l’Epître de saint Paul aux Galates : Or les oeuvres de la chair sont manifestes : ce sont l'impudicité, l'impureté, le libertinage, l'idolâtrie, les maléfices, les inimitiés, les contentions, les jalousies, les emportements, les disputes, les dissensions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et autres choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Les invités rient, je les laisse.
Le village a bien changé, les deux cafés sont fermés ; de la boutique de Frida ne reste que l’enseigne. L’atelier de mon grand-père aussi ; je passe la fin de l’après-midi avec son petit-fils, sa femme et son arrière-petit-fils dans le jardin.
Lili et Louise sont allées chez le coiffeur, elles me racontent aussi leurs journées passées à Thierrens. Arthur participe ce week-end à une fête de jeunesse à Cossonay, Sandra tousse, je la gronde, elle m’assure qu’elle guérira de sa bronchite sans antibiotiques, Ça prendra, m’assure-t-elle, un peu plus de temps, c’est tout.
Je reçois encore un mail d’une responsable du marché de la vente de paroisse du Jorat qui se tiendra le 3 octobre à Mézières ; elle recherche des exposants divers afin de rendre ce marché attrayant. Elle se demandait si cela m’intéresserait de tenir un stand avec Tessons et Marges ; elle précise que la place est gratuite, que les stands mesurent trois mètres chacun et que l’installation se fait dès 7 heures, le démontage à 13 heures. Je réponds favorablement.
Jean Prod’hom





La maison est vide

Cher Pierre,
La maison est vide. Edouard et Françoise sont partis à 11 heures. La journée est classée orange, celle de samedi annoncée rouge. Je remonterai demain comme je suis venu, par La-Bégude-de-Mazenc et Crest, Voiron et Cruseilles.

Je reçois un mot de Sandra qui me réjouit, même si elle ne dit rien de l’état de sa bronchite. Hier soir, écrit-elle, l’orage a été violent dans le Jorat, une petite tornade qui a emporté trois pans de la serre. Les tomates regardaient par la fenêtre, j’ai remis tout le monde à l’abri. Les delphinium ivres de pluie sont tombés en coma aquatique, je leur ai mis un tuteur. Ce matin au réveil, petite pluie fine. Lili est restée à la maison. Arthur qui a rendez-vous en ville à 17 heures dort. Quant à Louise, elle est très contente de se rendre à Thierrens. Gwenaëlle n’y est pas, mais a laissé une liste des choses à faire. Louise se réjouit de la découvrir, seule à bord de l’arche aux trente-deux chevaux.
Je reprends une avant-dernière fois les 9 textes pour Grignan que j’envoie à Yves et Anne-Hélène. Il est 14 heures lorsque je quitte Colonzelle pour Chamaret. Christine est souriante, je lui explique l’état des travaux : les tables basses, les 9 x 5 photos, les 9 textes, les casses,... Elle fait confiance, comme moi, à la cuisine des deux artistes. Elle propose toutefois de mettre en vente non seulement les 45 photos et les 9 textes, mais encore chacun des grupetto. A voir !
Lily reçoit ce soir amis et famille, elle prépare un poulet qu’elle recouvre d’un bouillon 10 bonnes minutes, nourri d’une farce dont j’ai oublié la composition, rôti ensuite. Elle a retrouvé des photos de la fête d’après le vernissage de l’expo d’Hessel, je lui lis le texte écrit avant-hier, pas sûr que j’aie bien fait. Je la quitte vacillante, elle se retient aux deux pilons du poulet qu’elle farcit. On se reverra bientôt, le 5 septembre à Lausanne, la semaine suivante à Grignan.
Anne est de garde, contente de son engagement comme surveillante dans un internat à Nyons, du temps dont elle disposera pour travailler terre et calligraphie, sans échéance. Je quitte la galerie pour le Grenier à sel où je bois une bière.
Halte plus tard sous le château de Madame de Sévigné, la nuit est tombée. Un peu après la piscine, un peu après le camping. Mêmes projecteurs, autres gens : l’équipe de Roussas affronte celle de Grignan. J’ignore le résultat, c’était un match amical, mais si vous saviez, Pierre, le bien que ça m’a fait. Je rentre à Colonzelle, nuit noire, remballe mes affaires.
Jean Prod’hom




Il pleut rue des Commerçants

Cher Pierre,
Edouard et Françoise font quelques achats à Nyons, je les lâche place Joseph Buffaven ; j’apprends qu’il s’agit d’un coiffeur de Nyons, déporté le 22 mars 1944 de Compiègne, arrivé le 25 mars à Mauthausen et mort le 6 septembre 1944 dans le centre d’extermination du château de Hartheim.

Je m’installe sur la terrasse du Miss Maple devant le marché aux légumes. Tous les touristes de la région se sont donné rendez-vous, le soleil tatoue des feuilles d’érables sur leur visage, leurs bras, leur dos nus ; ils tiennent tous leur rôle à la perfection, sans effort, des amateurs formés à l’école de la rue et des illustrés, princes, acteurs et politiques en vacances dont ils offrent des variantes criantes de vérité ; la costumière n’a pas eu, pour les habiller, à puiser ailleurs qu’aux étals de la place de la Libération, plus bas, là où trône l’office de tourisme.
Un vrai théâtre, épopée et dialogue d’aujourd’hui, prix des légumes et des fruits, rendez-vous pour le soir, recette du pâté, oeufs cassés. Monsieur Hulot est entouré de ses amis, pipe au bec, ravi d’être enfin écouté ; un grand cow-boy dégingandé, visage pâle au-dessus de la foule, recherche paniqué le cheval qui l’a désarçonné ; foule, figurants à casquette, marchands de bétail, joueurs de base-ball, candidats recalés, chapeaux neufs, chapeaux vieux, tous dansent un ballet selon un scénario que personne n’aurait osé imaginer ; Charles Trénet donne la main à une Juliette Greco fanée, les suit une paire de boiteux, Richard Gere achète des oignons à un repris de justice, John Frazer fend la foule.
Je reçois un mot de Sandra :
Les filles sont à Thierrens, Arthur chez Yohan, D. fait mille aller-retours à moto sur le chemin pour apprendre à conduire, N. m'a amené son baume du tigre contre le mal de tête, il fait chaud, Oscar gobe les mouches qui nous agacent. Ce soir on mangera la moussaka que Marinette m'a amenée tout à l'heure, on arrosera s'il ne pleut toujours pas et on regardera « L’homme qui murmure à l'oreille des chevaux », enfin Arthur peut-être pas. Le jardin et le silence sont magnifiques.
On rentre par Vinsobres et Valréas, le ciel se couvre, le ciel gronde, très loin. Colonzelle se laisse faire, il pleut, il pleut large, très large, on aimerait que ça dure. Le bruit de la trotteuse d’une montre-bracelet se mêle à celui de l’averse, sur les tuiles du toit et les feuilles du tilleul, sur le bitume du haut des génoises sans chéneau.
Jean Prod’hom






Ils nous laissent le grain sans l’ivraie

Cher Pierre,
A cette saison, ici dans la Drôme, les heures avant neuf sont les meilleures ; celles du soir et de la nuit ne sont pas mal non plus. Situation impossible dans laquelle nous plongent les étés torrides, tout particulièrement lorsque le mistral est tombé, qui nous obligent à raccourcir nos nuits et à reporter après midi les heures de sommeil nécessaires à notre santé. Mais comme le feu réduit en cendres les heures de sieste, il nous est permis de ne pas les reporter au bilan et de disposer ainsi de deux jours au prix d’un.

Je passe donc à 8 heures à la boulangerie de Grillon, emporte deux croissants et une fougasse, cherche le garage dont m’a parlé T, il est fermé. Je sonne à la porte de Lily.
Il y a au fond du jardin un bassin dans lequel Hessel trempait ses pinceaux ; les poissons rouges et l’orange y voisinent le vert, le jaune, le blanc des nénuphars, roses vermeilles sous le bleu du ciel, fruits des laurels, arrosoir sur le flanc, grillons et l’eau au goulot. La source n’est pas tarie à l’ombre du micocoulier. L’homme était gourmand, je l’ai vu – c’était la dernière fois – dans une cuisine rustique couper des quartiers de pommes et de poires gonflées de jus pour Lily et lui.
Nous buvons un café et mangeons un croissant sous la vigne vierge. Les bignones et le bougainvillier mouraient cet hiver, corsetés dans de la jute remplie de feuilles mortes. Hessel m’a demandé ce printemps de les arroser, je n’y croyais pas. Ils ont mis des feuilles, même que le bougainvillier est en fleurs ; pour les bignones, il faudra attendre.
C’est en deux fois que la vie reprend, il y a celle qui se dépose après avoir englouti la coque du vaisseau, il y a celle que n’ébranle aucun naufrage et qui continue : le fauteuil vide et les citrons qui tiennent à pleine main, le souvenir de la voix qui s’est tue sans avertir – il n’y a pas de dernier mot – et les grappes du raisin qui rosit.

Fin de canicule | 2006
La suprême élégance des morts, lorsqu’on les a aimés, c’est qu’ils emportent avec eux tout ce qui aurait pu nous encombrer et qu’ils n’auraient pas voulu retrouver à leur retour, ils nous laissent le grain sans l’ivraie. Et cette générosité remue ceux qui demeurent ; Cerise est le dernier arrivé dans la maison, un chat noir auquel le chien et les autres chats ont demandé de faire ses preuves. Un peu de patience.
Et j’entends derrière moi la voix de cet homme attentif aux leçons des ténèbres et à celles des lumières, dans sa peinture et sa vie, hésitant entre colère et rire, en équilibre, doute et conviction.
Les volets sont fermés, l’après-midi piaffe, il n’y a pas de métier sans habitude. Je me retourne et ne vois à l’arrière de la Yaris qu’une roue crevée, et plus loin la route qui s’éloigne. Accepter l’inacceptable.
Jean Prod’hom

Avec tes défauts, pas de hâte

Cher Pierre,
Merci pour votre mot qui m’a fait grand plaisir, les noyers du Lot ne sont visiblement pas de la même espèce que ceux de l’Isère, leurs fûts renvoient d’autres reflets, et l’alignement semble moins sévère. Mais chaque image que nous emportons, que nous nous y refusions ou que nous y consentions, nous rappelle tout à la fois ce qui ne reviendra pas et ne cesse de revenir, vous en avez fait l’amère expérience.

Café à Grillon d’où je ramène une baguette, nous montons ensuite à Grignan. Françoise et Edouard font quelques courses tandis que je frappe à la porte de Lily, le fauteuil d’Hessel est vide, elle a des visites, je passerai demain. Café encore sur la terrasse du Sévigné, Edouard file à Valréas. On rentre, Françoise et moi, à pied par le chemin d’en-haut, suivis par de petits papillons jaunes et bleus que je tente en vain de photographier les ailes ouvertes.
Edouard nous régale à midi de thon et de légumes à l’étouffée.
Je relis des pages de Michaux avant de m’attaquer, avec l’aide de Françoise, aux six casses d’imprimerie qu’on dépoussière. On redistribue certaines pierres sans faire la révolution.
Je note avant de me coucher ces textes brefs de Michaux relus aujourd’hui :
Mon plaisir est de faire venir, de faire apparaître, puis faire disparaître. (Emergences-résurgences)
Dès que je commence, dès que se trouvent mises sur la feuille de papier noir quelques couleurs, elle cesse d’être feuille, et devient nuit.
Et dans Poteaux d’angle, que je voudrais citer in extenso, les six premiers « aphorismes » :
.
C’est à un combat sans corps qu’il faut te préparer, tel que tu puisses faire front en tout cas, combat abstrait qui, au contraire des autres, s’apprend par rêverie.
Toute une vie ne suffit pas pour désapprendre, ce que naïf, soumis, tu t’es laissé mettre dans la tête – innocent ! – sans songer aux conséquences.
Avec tes défauts, pas de hâte. Ne va pas à la légère les corriger.
Qu’irais-tu mettre à la place ?
Garde ta mauvaise mémoire. Elle a sa raison d’être, sans doute.
Garde intacte ta faiblesse. Ne cherche pas à acquérir des forces, de celles surtout qui ne sont pas pour toi, qui ne te sont pas destinées, dont la nature te préservant, te préparant à autre chose.
Sandra qui tousse encore – je l’engage à consulter au plus –, m’apprend au téléphone qu’Arthur a fait du bon boulot chez Marinette, Louise une grosse journée à Thierrens, Lii est restée dans ses pattes.
Jean Prod’hom

Gif | 11 août 2015

Cher Jean,
Merci des nouvelles. La saison leur confère d'étranges échos. C'est que la première quinzaine d'août transforme la grande banlieue en désert. Pas une âme. Il m'arrive de me croire seul sur la terre. Il y a encore des vivants, du côté de Crest, qui m'adressent des signes. Quel réconfort.
Les plantations de noyers offrent un spectacle bien digne d'être contemplé, mentionné. Je suis tombé, comme vous, en arrêt, devant ces arbres, il y a six ans, dans la vallée du Lot. Un souvenir qu'enténèbre, désormais, la disparition du cousin que j'avais là, emporté par un AVC, l'an passé. Encore un lieu où je ne reviendrai plus jamais. Amitiés.
Pierre
Corcelles-le-Jorat | 10 août 2015

Cher Pierre,
Michel et Lucette sont passés en coup de vent, inquiets de la santé de Sandra ; elle va mieux, tousse encore mais a retrouvé un peu de son sourire. Lorsque je les quitte, Lili est dans un bain, Louise sur le web et Arthur derrière le garage, il taille la haie. Je fais une halte aux Antipodes, avec une cinquantaine de cartons d’invitation pour Grignan que Claude a l’intention de glisser dans les exemplaires qu’il enverra la semaine prochaine aux soutiens de la première heure.

Je roule au pas entre Gland et Nyon, d’une traite ensuite jusqu’à Voiron où je bois un café. Je fais la connaissance à la poste de deux employés d’une gentillesse extrême, mais d’une incompétence dont ils ne se doutent pas, c’est le plus inquiétant ; j’espère que l’exemplaire de Marges vous parviendra avant la reverdie prochaine, les deux préposés m’ont assuré que vous le recevrez mercredi ; ne soyez pas trop sévère, la belle postface de votre ami François vous consolera, quoi qu’il en soit, de votre peine.
Les noyeraies qui se succèdent jusqu’à Romans de chaque côté de la départementale sont au garde-à-vous, mais cette sévérité n’empêche pas les frondaisons denses de contenir sous leurs jupons une belle lumière qui caresse les fûts gris de cendre des noyers, avant de se déposer sur l’herbe qui est comme un gazon. On m’avait dit l’ombre du noyer maléfique, elle est parfois féérique.
Seconde pause entre 19 et 20 heures sur la Place du Général de Gaulle à Crest ; peu de Crestois, le soleil et un Perrier menthe sur la terrasse du Café de Paris, quelques touristes. Parmi eux, quatre femmes et quatre hommes que je voudrais apparier, ils ont une trentaine d’années et prennent l’apéritif. Un peu plus loin, sur le parvis de l’église jouent leurs enfants, une bonne dizaine ; à moi d’identifier leurs parents. J’en arrive à penser que les raisons qui m’ont poussé à constituer chaque couple sont précisément les raisons qui pourraient être à l’origine de leur divorce prochain.
La nuit est tombée lorsque j’arrive à Colonzelle, au Riau, tout va bien.



Le Carnet de Dante (Poteaux d'angle)

Cher Pierre,
Il pleut, pleut pleut sur le Riau, on en avait besoin, personne ne s’en plaint, on s’en réjouit plutôt, sous cape. Sandra – qui se rétablit lentement – est descendue avec Lili et Louise chez Marinette, sans Arthur : l’exécution des travaux que celui-ci devait entreprendre est différée.

Je profite de lire bien au chaud le journal que Pascal Rebetez a tenu entre le 18 novembre 2013 et le 26 avril 2014, un recueil de notes intitulé Le Carnet de Dante, rédigées vraisemblablement pendant la préparation d’une exposition de sculptures (Jean-Pierre Gerber) et de peintures (Daniel Gaemperle) présentée en juillet de la même année dans les fours à chaux de Saint-Ursanne. Le Carnet de Dante, avec des photographies des deux artistes au travail, constituent le catalogue de cette exposition. Je m’y retrouve.
De rédiger quelque chose comme un journal, depuis plusieurs années, me conduit tout naturellement à prêter une oreille attentive à ce genre d’entreprise, dont la grosse affaire est bien entendu la réalité dont elle veut rendre compte – sans tout dire, comment y parviendrait-elle ? – choisir donc, taire, réduire mais aussi, et c’est l’autre versant, passionnant, couler le tout dans une syntaxe et un lexique préétablis, coller les morceaux bord à bord ou en usant de chevilles, c’est-à-dire se soumettre aux exigences du langage, de l’écriture et aux circonstances qui les entourent, invitant le diariste à éclairer des pans de son histoire qui seraient demeurés obscurs sans cela, et parfois, à donner vie à des événements qu’il a écartés.
Ecrire un journal c’est conjuguer deux temps, l’un révolu dont on croit pouvoir retenir quelque chose, l’autre qui fait advenir ce qui n’aurait pas été. Dante se trouve aux prises avec tout cela dans ses carnets, en tire parti, fait feu de tout bois, riant de ce qu’on lui fait dire et de ce qu’il ne dit pas, jouant des ellipses comme d’autres passent des ponts.
21 novembre 2013
La soirée fédérale s’est bien déroulée. Personne n’a tout compris mais on s’est bien entendus. L’Etat donne les sous, mais le libre marché – les éditeurs – n’en font qu’à leur tête. Le Bâlois Roger Monnerat est en train d’écrire un livre en allemand autour de la figure de Jean Cuttat. Dante prend aussitôt une option pour la traduction. Réflexe patriotique. Téléphone à Béatrice qui craint toujours les débordements dès qu’il boit. Le vin tessinois évite la gueule de bois !
Dante clame un passage de Walser sur la bataille de Sempach. Léo Tuor dit le même texte en romanche : personne n’a rien compris. Mais tout le monde est satisfait de la démonstration de nos variété authentiques et AOC.
Il neige.
A la gare, des torrents de voyageurs. Au bar, un noir sert un express,. Sinon, que du blanc dans la foule. Où sont les hordes barbares annoncées à la radio ce matin à huit heures.
29 décembre 2013
Dante part en raquettes du côté du Mont-Brûlé et de possibles avalanches.
En face, les voisins skient en meute mécanique ; il préfère repérer seul les traces des cervidés. Il croise pourtant un Belge avec un chien noir qui l’aboie. C’est un trou du cul d’extrême-droite qui pratique le Krav Maga, du combat rapproché israélien, un truc qui tue quand on le veut, pire que la connerie.
21 mars 2014
Le livre servait à caler un meublée dans le grenier. Dante ne l’a plus ouvert depuis son achat – ou vraisemblablement son vol – en 1974. Il avait marqué quelques passages comme d’un livre de sagesse.
« Toujours garde en réserve de l’inadaptation », ou encore :
« Réalisation. Pas trop. Seulement ce qu’il faut pour qu’on te laisse en paix... » ou :
« Non, non, pas acquérir. Voyager pour t’appauvrir. Voilà ce dont tu as besoin. »
Dante est troublé. Il avait oublié ses écrits de ce tout petit livre « Poteaux d’angle » signé Henri Michaux.
11 avril 2014
Réunion à Martigny. Quand le littéraire suppose des choix politiques. Dante s’y rend pour taper du poing sur, mettre les points sur, mettre au point. Or, nous sommes en Suisse. le repas est payé par l’association ; le vin est bon ; le café favorable au compromis.
Sandra et les filles rentrent à midi de chez Marinette, Louise part à vélo une heure plus tard, pour rejoindre les Balances à Montpreveyres où Justine soigne des chevaux. Je reviens un instant aux textes de Grignan, pesant ce qui me reste à faire : laisser le tout reposer deux ou trois jours ; tailler encore et encore, jusqu’aux poteaux d’angle ; les dire et les récrire aussi longtemps que ne se fera pas entendre le rythme qui habite chacun d’eux.
10. Il nous faut trop souvent consentir à renoncer à ce qui nous entoure et que nous chérissons ; il sera soudain trop tard, il ne nous restera que quelques regrets pour nous consoler, quelques images, quelques souvenirs. Car au fond il s'agit bien de cela, faire revenir quelques-uns des instants à côté desquels on passe, condamnés que nous sommes, pour vivre, à nous détacher de l’immédiat en taillant des marches au fil du temps, en nous promettant au dedans qu’on ne nous y reprendra pas et qu’on recomposera sur nos claviers, plus tard, ce qui était lorsqu’on n’y était pas, songeant au bonheur que ces instants auraient pu nous apporter et qu’ils nous apportent tandis que, écrivant musique et cadence, nous ne l’espérions plus.
Je prépare la voiture pour demain : un pneu-neige à l’avant pour remplacer le pneu crevé, sept casses d’imprimerie, le quarteron de 20 litres, la marmite des petitous, quelques livres, un sac de couchage ; je passe à laiterie, paie mon ardoise et embarque des pommes-de terre. Traverse le village, monte au Pré-du-Grelot qui tombe en ruine. On mange ce soir, à la véranda, il fait bon, des raclonnettes de Corcelles et un cadeau des dieux, des myrtilles.
Jean Prod’hom


Sequitur quodlibet

Cher Pierre,
Le ciel a ce matin le bleu de la forge ; celui qui, à neuf heures, n’aura pas derrière lui ce qu’il s’était promis de faire à huit le regrettera à dix. Sandra – mal fichue hier – et Louise sont descendues au marché, Lili plus sage termine la lecture de Plum, un amour de chat, un manga qui se lit à l’endroit, et poursuit celle de la série des kinragirls.

Arthur est de retour à onze heures, il file au lit, sa nuit a vraisemblablement été courte ; je sors six casses d’imprimerie dans lesquelles je mets un peu d’ordre ; elles mériteraient un coup de balai. Je renvoie l’opération à la semaine prochaine, avec Françoise à Colonzelle, je me réjouis. Fais quelques photos avec l’aide de Lili.
Tandis que l’aventure éditoriale de Tessons est sur le point de se terminer, celle de Marges démarre. Toutes les deux vont se chevaucher à Grignan puisqu’une dizaine des quarante-cinq photos choisies par Yves et Anne-Hélène, et montrées dans la Drôme, figurent aussi dans Marges, non pas que je l’aie voulu, mais parce qu’il en va parfois ainsi, et qu’il est difficile dans ces conditions de ne pas résister aux idées que l’accord des êtres et des choses suit un plan auquel répond l’harmonie préétablie et que les miracles en font partie.
9. Frapper à la porte en espérant non pas qu'elle s'ouvre mais que refermée sur le silence qu'elle préserve elle rappelle au vivant que le chemin est encore long et qu'il aura besoin de toutes ses forces et de beaucoup de courage encore pour continuer là où les rencontres se raréfient, là où il n'y a rien, sinon d'autres portes closes, plus rares à mesure qu’il avance, qui rappellent ce peu qui fut dans nos maisons et hors d'elles et dont notre âme aura à se souvenir lorsqu'il n'y aura plus rien.
Louise regarde un James Bond dans les combles, Arthur somnole, Sandra fait des e-achats, Lili clique sur son i-pod ; je relis, avec une bière, la postface de François Bon. Ce soir nous abandonnons nos enfants, nous allons, Sandra et moi, manger dehors.
Jean Prod’hom

Plutôt celle d’un paysage de bocage

Cher Pierre,
Claude surnage au milieu de piles de bouquins, nous ne nous étions pas vus depuis quelques semaines, il est rentré de Crête la semaine dernière et a repris le boulot lundi. On évoque le vernissage : petite ou grande fête, invitations papier ou numérique, recours à des tiers ; je dédicace quelques livres, il prépare le service de presse. On termine à 10 heures, il a un rendez-vous, je vais rôder en ville.

La chaleur est étouffante, les gens marchent au ralenti ; les grandes surfaces sont des refuges, il fait bon aux rayons de l’alimentation de la COOP de la rue Saint-Laurent, encore meilleur près des frigidaires, je bois une eau minérale, traîne dans les rayons ; je monte à Riant-Mont et m’assieds au fond du jardin, l'ombre est celle d'il y a 50 ans, les fenêtres à l'arrière des studios modernes laissent entendre les mêmes rumeurs, mêmes racines affleurantes du houx, ne manquent que ceux qui ont quitté les lieux.
On mange sur la terrasse du Petit Boeuf, à deux pas du gymnase de Beaulieu, immeuble raide, gros paquebot en rade. On parle de nos gamins, de nos aînés surtout qui ont terminé au début de l’été l’école obligatoire, de ce que la rentrée des classes leur prépare, des enseignants qui leur feront aimer ces matières qui rebutent parfois, leur semblent d’un autre temps, sans lien avec la bulle dans laquelle ils vivent.
J'emporte au Riau quelques exemplaires de Marges, avec le sentiment que tout va bien se passer – Claude semble confiant –, mais aussi la crainte que Lili soit fort désappointée et me fasse des misères lorsqu'elle constatera que la photo qu'elle avait, dans un premier temps, accepté de voir figurer dans ce livre, y figure malgré un refus de dernière minute. Trop tard. Je lui promets une contrepartie, elle s’en réjouit.
Même à 870 mètres, on a toutes les peines du monde à piéger le frais dans les maisons, Oscar lézarde, impossible de le faire sortir dans le jardin, la salle à manger est vide, pas de table, pas de chaise, tout juste une table ronde et deux fauteuils bas.
8. Sur le rebord de la fenêtre, des images se chevauchent, celle d’une pierre de Patmos, un ciel, des labours, le saint Augustin de Vittore Carpaccio, un caducée, des images de vieux crépis, une chouette et quelques tessons ; un moineau s’y invite parfois, sans titre, sans date, sans lieu. Ils constituent ensemble un petit autel qui se métamorphose avec le temps, m’oblige à regarder à nouveaux frais l’hétéroclite qui va et vient, me dissuadant de donner à la partie dans laquelle je suis engagé la forme d’un puzzle dont j’aurais à trouver la dernière pièce, mais plutôt celle d’un paysage de bocage dont j’aurais à lever le plan changeant. Le monde a lui aussi ses fenêtres et ses rebords, ses haies et ses talus, ses champs et ses clairières à l’abri du vent.

Claire Le Baron
Je rattrape Arthur sur la route qui remonte de Villars-Mendraz à la croisée de Sottens, il pédale comme un forcené et me fait penser à un héros d’André Dhôtel ; les 36 degrés ne l’ont pas fait hésiter à avaler les 15 kilomètres qui le séparent de la fête. Lili et Louise ont passé une fois encore leur journée à Thierrens, offrant leurs petites forces à un projet qui a du souffle, participer à une telle aventure est sans prix.
Je reçois un gentil mot de Claire le Baron, une photographe dont j’ai fait la connaissance à Port-Joinville ; elle a reçu Tessons par la poste, elle est en train de le lire, mais de plus en plus doucement pour qu'il en reste. Je suis allé sur son site revoir les photographies exposées cet été au Musée de la Pêche et à La Fabrique, une association d’artisans-créateurs dont elle est l’une des animatrices ; ça vaut le détour, des images colorées, à son image. Et puis, j’aime beaucoup le texte dans lequel elle raconte comment elle a été amenée à faire des photos, sans prévoir, ni faire exprès, ni composer. Guetter du coin de l’œil trois fois rien qui change tout, la lumière qui dépose une robe de princesse sur une chose modeste, le beau milieu du banal.
J’ai cherché, mais en vain, les pichets du cimetière de Port-Joinville qu’elle a, elle aussi, photographiés.
Jean Prod’hom
Rapatrier l’obscurité

Cher Pierre,
Curieuse impression ce matin, lorsque j’ai mis le point final à la première mouture du septième texte pour Grignan, c’est-à-dire le dernier, puisque les huitième, neuvième et dixième seront tirés de la fosse à bitume des marges.net. Je pensais en effet, avant de me jeter à l’eau, qu’il me suffirait de dérouler, pas à pas, le raccourci de ce que je croyais voir très clairement ; il m’a fallu au contraire, ou à l’inverse, rapatrier l’obscurité qui se tenait dans les plis de ce raccourci et lui donner non seulement une forme, un contour, mais aussi une teneur.

7. On aperçoit parfois, marchant et levant la tête, des formes, des couleurs, des ombres qui dessinent alentour des visages éphémères, paysages-visages, visages-images d’un polyptyque sans fin : formes, couleurs, ombres que l’on voudrait serrer dans les ailes du plomb, un ourlet, un faufil ou un cadre doré à la feuille. Mais l’éphémère a une main de fer, les horizons ne l’arrêtent pas, il dure le temps de nos vanités. L’enfant solitaire se saisit parfois aux mauvais jours de quelques-unes de ces natures mortes qu’il écorne au hasard, y passe un fil qui donne à son ennui l’allure d’un récit, le semblant d’un mouvement, d’une pente et d’une direction.
Claude m’envoie en début d’après-midi des images, ce sont les piles d’exemplaires de Marges, ils seront dans les bacs fin août ; je le rejoindrai demain matin pour rédiger quelques dédicaces. Je monte au triage, mets bout à bout quelques phrases d’introduction pour Grignan. Le soleil est lourd, même dans les bois.
Le jardin demande qu’on s’en occupe, Arthur accepte contre salaire de s’y coller ; on passe en revue les tâches et on fixe le salaire, ces relations marchandes ont du bon. A la condition qu’Arthur se rende à Ogens à vélo, j’accepte de co-financer les achats du repas canadien auquel il participe demain soir. On finit nos tractations commencées dans la douleur par des sourires.
Sandra va récupérer Lili et Louise qu’elle a emmenées ce matin à Thierrens, elles se font belles, c’est mon anniversaire, nous allons manger à Montheron.
Jean Prod’hom


L'Air libre | Albane Gellé

Cher Pierre,
C’est pour donner un coup de main que Louise se rend cette fois-ci à Thierrens, où je la dépose à 9 heures ; elle descend l’allée d’un pas décidé, le sourire aux lèvres. Un agent d’assurances, qui s’occupait il y a quelques années de nos affaires, s’assied en face de moi sur la terrasse de l’Auberge du Cheval blanc, prolixe, pressé, un peu sourd mais plein de bon sens et d’énergie ; j’en profite pour me taire, hoche la tête ; il s’excuse bientôt de ne pas pouvoir en dire plus, il a un rendez-vous et il n’a pas encore lu le journal local qu’il se met à feuilleter. je me tais une seconde fois. Plus loin, ramassé, le village de Boulens.

Lili dort à poings fermés lorsque je rentre, Sandra et Arthur sont descendus en ville. Une heure de lecture avant de repartir pour Thierrens et en revenir, sans recevoir le signe de reconnaissance qu’on espère de temps en temps de ceux au bénéfice de qui on oeuvre. Pas le temps de me plaindre, je file à Moudon, la Broye traîne les pieds, s’empêtre dans ses algues, sans force, ses os mis à nu.
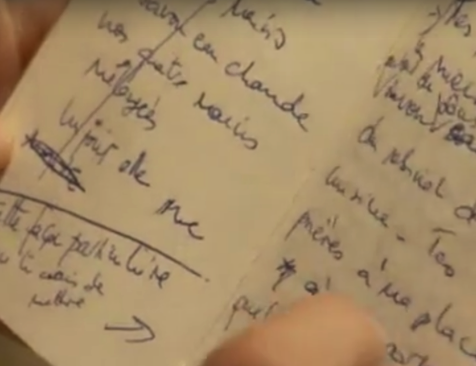
Je visionne au retour une émission de Soir 3 intitulée Sur les traces de Julien Gracq à Saint-Florent-le-Vieil, j’y croise aussi – et surtout peut-être – Albane Gellé, sa voix ; elle raconte un peu de sa cuisine à Saumur : tous les trucs que j’utilise, je les note dans un carnet, une fois que je les ai utilisés, je les barre, quand je n’ai plus grand chose, je réalimente. Ça la fait rire et produit de belles choses, simples, amples :
Le mot cheval au-dedans. Les mouvements les muscles quand au galop, cette chaleur dessous. Quand tout se rassemble, est rassemblé, pour faire vivant le cheval à deux têtes que nous sommes.
des arguments pas besoin à vrai dire pour jusqu’au bout sur le sable suivre la Loire dans un sens ou dans un autre il suffit de descendre du train
Je me souviens d’une lecture de L’Air libre par Sylvie Lebrun. Ce texte paru en 2002 aux Editions le dé bleu m’avait emballé ; je me souviens avoir organisé en 2005 un atelier avec de jeunes élèves autour de l’expression – comblée – du manque : le ciel est bleu c’est bien mais est-ce que ça suffit que nous faut-il donc que nous manque-t-il encore quand tout est là sous nos yeux. Certains des textes avaient été publiés dans un recueil que je n’ai pas retrouvé, intitulé L’eau froide de la rivière me monte à la tête. J’aurais bien aimé trouver sur le net, là où je l’avais téléchargé, le fichier de la lecture du texte de L’Air libre par Sylvie Lebrun. Tout a disparu.
On descend en fin d’après-midi au bord du lac, en famille ; on y retrouve les K et les T, soleil et pique-nique.
Jean Prod’hom
Marges déboule au quai 3 de l’Ecole de Commerce

Cher Pierre,
Claude m’envoie un mot, des centaines d’exemplaires de Marges ont passé le col du Grand-Saint-Bernard et vont débouler ce mercredi vers 15 heures au quai 3 de l’Ecole de Commerce ; le dentiste avec lequel j’ai rendez-vous m’empêchera de leur faire la fête.

J’emmène les filles à Thierrens, le ciel est lourdement chargé mais l’éthologie du cheval peut se pratiquer sous couvert. Je fais une halte à Saint-Cierges, bois un café et lis le journal.
6. Ce n’étaient que photographies de rien du tout au milieu d’objets sans importance, placés sur le damier sans bord de sa vie, sur le dessus d’un large buffet sculpté, très vieux, témoignant de ce quelque chose qui s’était maintenu à ses côtés, que la vieille de Pra Massin n’emmènerait pas, qu’elle était allée au contraire rejoindre au fond d’un carton tandis que la nuit se mêlait au jour. Les architectures sacrées sont en miettes, le tout qu’elles abritaient s’est dispersé, nous voici coupés des origines, tout juste bons à garder de ce côté-ci l’empreinte de ce qui s’est absenté de ce côté-là, grains de lumière et poussières entre chien et loup.
Sandra nettoie les vitres de la véranda, Arthur cueille des petits fruits. Je poursuis mes lectures autour de la photographie, la Petite histoire de la photographie (1931) de Walter Benjamin et la première version de L’Oeuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique (1935). Je peine et la ligne de crête semble se perdre dans des zones trop pointues pour moi ; je finis par revenir sur mes pas avant d’avoir vu le bout.
C’est au tour de Sandra d’aller chercher les filles, je remplis une passoire de gros cassis. Arthur, qui est descendu à la Molleyre proposer ses services à Marinette, nous prépare des hamburgers, végétarien pour Louise. Les trois petits montent ensuite visionner un James Bond ; on va Sandra et moi faire le petit tour, une famille a dressé son camp à la Moille-au-Blanc : une roulotte, un chien, 4 ânes et 4 enfants. On babille, ils sont partis d’Yvonand il y a une semaine, ils y retournent dans dix jours. L’année prochaine, c’est Bordeaux.
Jean Prod’hom


Comme les cartes orphelines d’un memory géant

Cher Pierre,
Dans la chambre de séjour toute neuve, Sandra s’est réorganisée et a repris la rédaction du second volume d’Eurêka ; Arthur vit sa vie, en même temps à mille milles d’ici et tout près de nous, il va falloir faire le point. Louise et Lili participent aujourd’hui et demain à un stage d’éthologie à Thierrens, je les y conduis pour neuf heures. Griffonne au retour, sur mon ipad, un bout de texte pour Grignan.

Françoise a rencontré Christine hier et part quelques jours avec Edouard dans le Piémont, je décide de les rejoindre à Colonzelle lundi prochain, avec les casses d’imprimerie. Ce sera l’occasion de rencontrer Christine une fois encore avant septembre et de régler quelques détails.
Ce sont finalement dix textes qui sortent de l’atelier, d’un peu plus de cinq cents caractères chacun. Il me faudra encore les menuiser de l’intérieur et creuser, de l’extérieur, les vides qui les séparent.
5. Nous naissons aveugles et le demeurons aussi longtemps que nous n’extrayons pas notre âme de la pâte dont nous sommes faits, en décollant manuellement nos paupières, puis en taillant les ouvertures par où elle aura tout loisir de s’étonner des paysages et des visages qui se tiennent désormais éloignés de nous et auxquels elle retournera lorsque le corps qu’elle habite l’obligera à quitter la partie. Pendant ce sursis, nous sommes invités à la fête, à faire jouer à tort et à travers la profondeur de nos yeux télescopiques : le disparate tient, miraculeusement, sans ciment, comme les cartes orphelines d’un memory géant.
Termine un peu vite La Littérature à l’estomac que Julien Gracq a publié en 1950. D’une étrange actualité, en usant d’une langue presque étrange, qui n’est précisément pas au diapason d’une actualité qui, à l’inverse, n’a guère changé. C’était un de ses livres préférés. Je monte avec Oscar au triage, lit sur mon iphone, couché sur un lit de terre et d’épines sèches un autre pamphlet du même acabit, celui que Baudelaire a écrit en 1859 : Le public moderne et la photographie. M’y retrouve pas, relis pour donner le change à non humeur les premières pages des Eaux droites.
A Thierrens, les filles sont radieuses, moins enjouées au retour ; on fait le point en famille après le repas, nous n’avons pas terminé l’éducation de nos enfants.
Jean Prod’hom



Il y a les moellons luxueux

Il y a les moellons luxueux
l’Offrande musicale
le taboulet
les girons des Jeunesses campagnardes
il y a le museau des hérissons
les petites et les grandes vanités
les autels portatifs
l’île de la Madeleine
il y a le livre qu’on referme
Jean Prod’hom
Premier dimanche d'août

Ce premier dimanche d'août donne une petite idée de l’automne, il bruine et les sorbes orange ont remplacé partout les fleurs blanches des sorbiers.

Je m’esquinte à fixer les neuf entrées pour Grignan, que je voulais organiquement, ou géométriquement distribuées ; or certaines se chevauchent, se confondent même ; d’autres semblent ouvrir sur des régions où l'on parle des langues très différentes ; bref, je suis loin du compte, à chaque fois surpris rétrospectivement de ma naïveté initiale de croire que l’affaire est dans le sac, naïveté sans laquelle pourtant je ne me jetterais pas à l'eau et qui m'oblige, m'y trouvant soudain nu, de faire un peu d'ordre dans le tout venant que j’y ai déversé, avec l’assurance que j’y découvrirai, tôt ou tard, ce que je n'y ai pas mis.
Sandra continue dans le hall ses travaux de Titan, Arthur rentre au milieu de l’après-midi des hauts de Montreux, les filles désoeuvrent, dedans et dehors puisque le soleil est revenu. Je monte dans les combles : Mein Name ist Bach est un beau film réalisé par Dominque de Rivaz sur une idée originale de Jean-Luc Bourgeois qui imaginent la rencontre attestée de Jean-Sébastien Bach et de Frédéric II de Prusse, et donnent une réponse, à leur manière, c'est-à-dire singulière, au ménage de l'histoire et de l'art. E falso sequitur quodlibet.
Nous sommes invités à manger â Froideville. Lucette et Michel fêtent un peu avant l’heure mon soixantième anniversaire, je suis gâté. Le cortège des jeunesses qui ont participé au Giron du centre descend du haut de La Carnacière jusqu’au village, un tracteur par village, de la musique, beaucoup de bière et un peu de vin, mais aussi le bonheur d’en être. On est tous au lit à 23 heures.
Jean Prod’hom


Le Roi Cophetua

Cher Pierre,
C’est au réveil, sur l’une de ses presqu’îles que je lis dans un demi-sommeil Le Roi Cophetua, au conseil de François Bon qui en a la plus haute estime ; il y revient à plusieurs reprises dans les textes qu’il a consacrés à Julien Gracq (tierslivre et remue.net).

Ce que je pense de ce récit ? En préambule ceci :
François Bon ne manque pas de louer les analyses de Gracq, notamment celles qu’il a consacrées, dans En lisant en écrivant, à l’auteur de la Recherche, tout en regrettant que Gracq ne puisse s’empêcher, après de fines remarques, de disqualifier son aîné. François Bon cite cet extrait d’En lisant en écrivant :
Dans chaque partie, un minimum de pierres d’attente est ménagé pour se mortaiser à la partie voisine ; la densité, la solidité intrinsèque du matériau, monté par blocs puissants, sont suffisantes pour que la juxtaposition suffise à l’équilibre, comme dans ces murailles achéennes de moellons bruts qui tiennent debout par simple empilement, sans ciment interstitiel.... quand le récit se démeuble, englué et presque arrêté quand il se sature d’un magma de réflexions, d’impressions, de souvenirs, au point de s’engorger et de donner l’impression, tant il est chargé d’éléments en dissolution, qu’il va prendre d’un moment à l’autre comme une gelée ».
Je reconnais que la charge de Gracq n’est pas aussi bienveillante que je voulais le croire d’abord, mais c’est toute autre chose que je voudrais retenir de ce passage, les moellons, si présents ailleurs dans l’oeuvre de Gracq.
Dans la Forme d’une ville par exemple:
[…] quand j'ai visité Rome tardivement, je me suis trouvé tout de suite faiblement attiré par le Forum, chantier encombré de matériaux où me frappait la qualité pauvre, l'usage mesquin du contre-plaqué architectural, et dont le premier aspect n'est pas loin d'évoquer pour l'œil non prévenu, plutôt que les éboulis nobles des moellons de Delphes ou de Macchu-Picchu, une foire aux puces du débris historique.
Dans les Carnets du grand chemin :
Le chapeau pointu des médecins de Molière coiffe ça et là, non sans humour, la tourelle des gentilhommières éparses dans la campagne : il flotte un air de gueuserie à la fois délabrée et parodique sur les gîtes de cette noblesse amie de l'opérette qui semble vraiment,, à considérer son standing rustique, n'avoir compté que des cadets. Castels paysans de peu d'apparence, bâtis de matériaux médiocres sous le crépi qui s'effrite : des grumeaux d'argile jaune, plutôt que des moellons, font ici le plus souvent, quand le pisé ne les remplace pas, la substance des murs..
... Quand à mes origines, je manque de mélange. Pas de croisements profitables dans mon ascendance. Du côté paternel, mes attaches sont à Saint-Florent, au moins depuis la Révolution et sans doute au-delà ; du côté maternel, à Montjean, la Pommeraye, Champtocé, depuis aussi longtemps : un cercle d'un rayon de huit kilomètres entre le tombeau de Bonchamps et le château natal de Gilles de Rais, a contenu toute mon ascendance depuis six générations et au delà : tout cela Mauges, vallée de la Loire et Mauges encore, artisans de village presque tous, « filassiers », boulangers, forgerons, mariniers, tous, aussi loin que je remonte, parcimonieux, âpres au gain, comptant sou par sou, fermes sur les liens de famille, acharnés à acquérir, à hériter et à conserver. A l'extrémité de cette chaîne de « clos », bouts de prés, vignes et masures thésaurisées et léguées boisselée après boisselée et moellon par moellon, la mosaïque de biens-fonds minuscules qui est la mienne, éparpillée et éclatée sur tout un canton, m'a ancré à ce terroir par des liens que je n'ai jamais rompus, ni cherché vraiment à rompre...
On les retrouve aussi dans le Rivage des Syrtes, moellons qu’une humidité lourde couvrait d’un drapé de mousse qui feutrait les bruits, laissant tinter le son très clair de l’eau qui filtrait partout en ruisselets rapides sur les pierres...
Ils sont là encore dès les premières pages des Eaux étroites :
C’est ainsi que le vallon dormant de l’Evre, petit affluent inconnu de la Loire qui débouche dans le fleuve à quinze cents mètres de Saint-Florent, enclôt dans le paysage de mes années lointaines un canton privilégié, plus secrètement , plus somptueusement coloré que les autres, une réserve fermée qui reste liée de naissance aux seules idées de promenade, de loisir et de fête agreste. Ce qui constituait d’abord pour moi, il me semble, sa singularité, c’était que l’Evre, comme certains fleuves fabuleux de l’ancienne Afrique, n’avait ni source ni embouchure qu’on pût visiter. Du côté de la Loire, un barrage noyé, fait de moellons bruts culbutés en vrac, et qu’on pouvait traverser à sec en été vers l’Ile aux Bergères, empêche de remonter la rivière à partir du fleuve; un fouillis de frênes, de peupliers et de saules cernait le lacis des bras au-delà du barrage et décourageait l’exploration vers l’aval. Vers l’amont, à cinq ou six kilomètres un barrage de moulin, à Coulènes, interdit aux barques de remonter plus avant.
Aller sur l’Evre se trouvait ainsi lié à un cérémonial assez exigeant qu’il convenait de prévoir un jour ou deux à l’avance: le temps d’alerter dans un café du Marillais la tenanciére et de retenir l’unique bachot centenaire – bancal, délabré, vermoulu, cloqué de goudron, et parfois dépourvu de gouvernail...
Enfin, à propos de Huysmans, Gracq écrit dans En lisant en écrivant :
Il est difficile de trouver un écrivain dont le vocabulaire soit plus étendu, plus constamment surprenant, plus vert et en même temps plus exquisément faisandé, plus constamment heureux dans la trouvaille et même dans l'invention...
Et il est difficile d’en trouver un dont la syntaxe soit plus monocorde, plus ressassante, plus indigente et comme délabrée. La phrase procède par à plats d’éblouissantes touches au couteau juxtaposées, que nul lien de relation ou de subordination sérieusement ne cimente... ses livres ressemblent à un édifice de pierres rares fracassé par un séisme ; les moellons luxueux, et tout ce qui a pour destination de s’arcbouter pour s’étager en hauteur, gisent à terre côte à côte, comme s’ils ne rêvaient que de retourner à la carrière originelle. Ce sont de somptueux éboulis de livres
Vous me voyez venir, n’est-ce pas ? Le Roi Cophetua est un moellon au grain fin, sans crépi ; un seul moellon, noble, luxueux qu’un narrateur traverse de l’intérieur tapissé de mousse feutrant les bruits, sur une embarcation dépourvue de gouvernail ; quelques mots à peine, ni source ni embouchure ; une réserve, un canton, un clos. C’est tout pour aujourd’hui.
Jean Prod’hom


Retour au triage

Cher Pierre,
Il y avait plus d’un mois que je n’étais pas retourné au triage ; les ronces et les myrtilliers ont étendu leur empire et ce n’est pas sans réticence qu’Oscar me suit jusqu’à la lisière de la petite clairière où je m’allonge, terre meuble couverte d’épines, chaud-froid entre soleil et bois.

Je m’attarde sur les textes brefs que Julien Gracq consacre dans En lisant en écrivant à la rauracisation du français (sans évoquer le « l ») ; à l’obsession de la suture dans le champ littéraire français... qui veut qu’on rapproche toujours étroitement les deux bords avant de coudre ; au court circuit syntaxique que produisent les deux-points. Rien à propos du point-virgule. Ailleurs peut-être.
Le peintre passe une seconde couche sur les murs du hall et des toilettes d’en-bas. Heinz passe en coup de vent, visse à coin le syphon de la baignoire. Salut la compagnie, il s’en remet désormais à l’architecte et au fournisseur. Bonnes vacances Heinz !
3. Le torrent de liens motivés, né de l'arbitraire du signe, hante le langage et ouvre dans ses profondeurs d’innombrables galeries que le poète explore mot à mot, une baguette de sourcier à la main, d’où lui parviennent d’énigmatiques échos, ceux du lointain qui se mêle au proche, de l’étranger au natif.
Le réel ne s’y refuse pas et se prête sans réticence au rythme, à la mélodie, au jeu des voyelles et des consonnes qui ouvrent à la conscience des voies inédites pour offrir à la terre qui vieillit le langage et les chemins qui la renouvellent, en pressentant même parfois ce qui sera.
4. La photographie ne dit rien ni ne se préoccupe de l’avenir, elle représente le monde qui s’est tu ou est sur le point de se taire, de ce qui passe, a passé et dont nous craignons d’être les uniques témoins. C’est toujours à reculons que nous faisons des photographies, dos au mur, elles témoignent de ce qui aurait pu nous éclairer, au carrefour d’une autre vie qui aurait pu nous combler, mais qui a passé et que nous laissons derrière nous, une chance qui nous a été donnée de rester et dont nous n’avons su retenir que la promesse, l’imperceptible mouvement d’une main qui fait signe, ou une ombre qui s’éloigne, ou un contraste qui nous rappelle que la neige fond et que le vent chasse le sable.
A l’écriture la voyance et les récits de fondation, à la seconde l’inéluctable et l’oraison funèbre.
Arthur est allé fêter son 1er août, le 31 déjà, sur les hauts de Montreux ; nous irons, Sandra, les filles et moi fêter le nôtre Sous la ville demain, avec un rallye, une partie officielle et des saucisses grillées. En attendant on mange à la véranda les restes du risotto, une salade et des fromages. Lili conseille à Martine qui me l’a demandé qu’elle offre plutôt à sa petite-fille, si elle ne les possède pas déjà, Flicka 1, 2 et 3. Quant à Grand Galop, c’est une série de plusieurs épisodes qui va bien au-delà de l’amitié d’une jeune fille et d’un cheval.
Jean Prod’hom

Heinz de Laupen

Cher Pierre,
Ce matin à huit heures, j’entends frapper à la porte, je l’avais oublié, c’est Heinz, la casquette vissée sur la tête, les mains au fond des poches comme souvent les artisans qui les ont habiles. Je l’ai entendu toute la semaine réciter comme un poème la succession des opérations qu’il avait à mener, pour qu’elles ne s’échappent pas d’une tête qu’il a dure. Une heure lui suffira pour que la fuite de la baignoire rende gorge et qu’il manifeste son contentement : Je suis heureux.

Dans la maison, Heinz, tout le monde l’aime bien, avec ses yeux bleus qui deviennent transparents. Le bonhomme a retrouvé le sourire, on boit un café ; il vient de la région de Laupen, là où les Bernois (aidés par les Walstätten), sous le commandement de Robert de Erlach, ont repoussé en 1339 les troupes de Louis IV de Bavière (aidé par des seigneurs de la région romande) et où son père était ingénieur. Louise l’écoute. Il obtient successivement trois certificats fédéraux de capacité, de mécanicien d’abord, de sanitaire ensuite, chauffagiste enfin. Il y a vingt-cinq ans qu’il est en Suisse romande ; marié, il met son second pilier dans l’achat d’une ferme. Divorcé, tout se complique, l’homme travaille jour et nuit, le dos cassé par une hernie discale dont une rhabieuse le soulage pendant plusieurs années ; l’hernie est revenue avec son divorce, c’est une large ceinture qui le fait tenir droit.
Guillaume passe nous voir, fait quelques bricoles et repart avec une belle commande : bibliothèque, armoires, armoire à habits ; il nous en sait gré. Sandra, les enfants, les A, les K et les T descendent en ville faire un lasergame. Heinz s’en va de bonne humeur, fier je crois d’en avoir terminé avec un chantier qui lui aura donné du fil à retordre. Il repart avec ses outils pour Sullens ou Saint-Légier, Heinz est un ouvrier solitaire qui veut le rester.
2. Tout en maintenant en son centre un silence qui fait tache d’huile, l’instant déborde bien au-delà du territoire que la conscience lui octroie et, de proche en proche, offre du lopin de terre qui lui revient une image égarante de l’éternité, de même dimension que les innombrables éternités qui coexistent en chacun des points du monde et que d’invisibles gouffres infranchissables tiennent à l’abri, comme les douves d’un château-fort. Du chemin de ronde dont nous somme le centre, nous pouvons apercevoir au bout de nous-mêmes comment ombres, formes et lumières se mêlent nous invitant, lorsque nous en éprouvons le besoin, à saisir des petits morceaux d’éternité, à y passer le fil qui nous permettra d’habiller nos vies d’un semblant de mouvement, d’une pente et d’une direction.

Visite d’un autre solitaire au milieu de l’après-midi, c’est un hérisson dodu contre lequel Oscar aboie de derrière la porte vitrée du salon, il s’attarde au pied des roses trémières, me regarde en fronçant les sourcils, je le laisse tandis qu’il longe la façade. Me régale de quelques pages que Gracq consacre, dans En lisant en écrivant, à ses lectures et à l’écriture, c’est admirable, drôle parfois, très drôle mais toujours bienveillant et assassin – à propos de Saint-John Perse :
J’en fais usage, à des intervalles éloignés, un peu comme d’un chewing-gum d’où au début à chaque coup de dent gicle une saveur, mais le goût pour moi s’épuise en une douzaine de pages, à mon dépit. N’empêche que je le reprends : le nombre des poètes qu’on rouvre n’est pas si grand.
Julien Gracq fait partie de ces écrivains qui réussissent à prolonger la voie dans des régions où nous ne voyions que d’inextricables ronciers, à les écarter et à en tirer ce dont on avait rétrospectivement le pressentiment, sans y toucher, avec la facilité de ceux qui écartent les eaux de la Mer rouge. Et puis il fait partie de ces rares écrivains qui, au XXème siècle, n’ont pas laissé tomber le point-virgule. A lui aussi je lui en sais gré.
Ce soir Lili et Louise se baignent pour la première fois, le bateau est à sec ; quant à Arthur il est monté à Froideville faire du volley ball avec la Jeunesse de Ropraz, on ne le reverra vraisemblablement que demain, le bosco paie ses galons. Sandra qui est allée promener Oscar prépare un risotto. La scoumoune fait sont retour alors qu’on la croyait définitivement écartée, avec l’eau qui goutte sur le plan de travail.
Jean Prod’hom



Dieux Lares

Cher Pierre,
Sandra et les enfants sont allés faire quelques courses, de quoi charger le frigo et assurer que demain chaque chose retrouve sa place ; je suis de permanence à la maison, accueille les maîtres d’état qui se succèdent. Guillaume rabote la porte d’entrée et son frère pose les poignées de la salle de bains, de la bibliothèque et de la chambre d’Arthur ; trois peintres rafraîchissent le hall, deux carreleurs posent des joints de silicone à la salle de bains, de ciment à l’entrée.

L’eau qui est apparue à deux reprises sur le plan de travail de la cuisine, contrairement à ce que j’ai cru hier, n’est pas le résultat d’une maladresse de l’un de nos enfants, mais d’une fuite dans l’écoulement de la baignoire ; l’appareilleur dépêché en urgence et qui reviendra demain, repart avec le sourire, satisfait d’avoir mis le doigt sur le problème et dissipé notre inquiétude : il est donc fort probable que nous démarrions notre nouvelle vie au sec.
Tout ce monde, bienveillant, courageux, grossier parfois, raconte tout en travaillant la vie de chantier, les collègues absents, les métiers, les femmes, les vacances. Je regrette de n’avoir pas assez prêté l’oreille, mais je brouillonnais quelques idées, timorées, hésitantes, espérant au fond de moi, comme toujours, que tout se fasse à mon insu et que je n’aurai qu’à me réjouir du temps qu’il fait lorsqu’il me faudra me jeter à l’eau.
1. Notre regard est aimanté par ce quelque chose avec lequel nous ne faisons qu'un, que nous croyons pouvoir précéder, que nous surprenons parfois lorsque nous viennent le courage et la force de ralentir, que nous voudrions retenir en en fixant l'empreinte avant qu'il ne soit trop tard, jusqu’à ce que nous nous avisions que ce qui devait être une rampe d'accès nous lâche, devient précisément la porte dérobée par laquelle ce qu'on avait cru pouvoir rejoindre prend la poudre d'escampette. Comme une phrase longue et sinueuse qui commence et se ferme, métamorphosant le manque en secret.

Ce soir, c’est à moi que revient l’honneur d’utiliser la cuisine pour la première fois, je prépare des pâtes au pesto et une salade. Nous descendons ensuite une bibliothèque du bureau dans laquelle Sandra range ses livres, Arthur me donne un coup de main pour monter la petite armoire que mon père a fabriquée en 1951 pour l’obtention de sa maîtrise fédérale ; j’y loge dedans et dessus mes dieux lares : une aquarelle de tante Augusta, un mobile de Daniel Schlaepfer, quelques rebuts, une boîte à crayons du grand-père d’Epalinges, un vase de Christine Macé, une photographie de Geoffrey et de Romain, quelques livres, une chouette que Sandra m’a offerte, un album de photographies colorisées, un galet de Patmos, un cairn de Louise, le cygne que j’ai sculpté à la naissance de Lili. Il est minuit passé lorsque nous allons nous coucher.
Jean Prod’hom
Corcelles-Servion

Cher Pierre,
L’architecte est passé en fin de matinée, la responsable de la salle de bains aussi, on a eu droit à quelques frictions. Les vacances des entreprises s’approchent et le temps file, le chantier est partout, les carreleurs s’affairent dans le hall et les toilettes d’en-bas, l’appareilleur installe la baignoire. Je m’attelle de mon coté à une autre tâche, la résiliation d’un abonnement à swisscom : une montagne, l’employé me prend pour ce que je suis, un pigeon.

Sandra et les enfants se rendent à Vevey en début d’après-midi, ils me laissent au pied du mur : j’extrais quelques textes pour Grignan, mets en page cent-trente Il y a, avec une intention qui perd ses contours à mesure que j’avance. Il me reste à la fin moins que rien, sans même savoir si je dois m’en inquiéter.
Je renvoie le tout à des jours meilleurs, prends mon sac à dos et me mets en route pour Servion où j’ai rendez-vous. Le défanage et l’éradication des mauvaises herbes donnent un aspect lunaire aux champs de patates, le maïs manque d’eau ; je franchis le Cerjux après la Goille et traverse le pâturage qui porte le beau nom de L’Echu, plonge sous l’église de Montpreveyres au fond du vallon de la Bressonne, remonte par le sentier du Bois de la Côte. Une nouvelle fontaine a remplacé l’ancienne que les mousses et la vermine rongent en contrebas. Je traverse les bois à l’estime jusqu’aux Chardouillles, puis à travers ceux des Riaux jusqu’aux Pendens et les anciennes carrières de molasse.
Je retrouve Sandra et les enfants à Servion, avec les A et les K qui nous accueillent. On mange dehors, parle de chantiers et de transformations de maison, de vacances en Corse, en Bretagne, à la montagne. Il est près de minuit lorsqu’on rentre, un peu ivres d’avoir copieusement arrosé nos retrouvailles.
Jean Prod’hom



27 octobre 2013 | 29 juillet 2015
Les vieux chéneaux

Cher Pierre,
Les vieux chéneaux, les pavatex de protection, les restes de lambourdes et les bris de tuiles alignés au bord du chemin avant notre départ pour l’île d’Yeu ont été bienveillamment balancés sur les lierres qui souffraient déjà de la sécheresse, pas sûr qu’ils repiquent. Un clou de charpentier a eu raison de l’un des pneus de la roue de la Yaris ; la poussière qu’on croyait avoir vaincue avant de partir a fait son retour à l’occasion des travaux dans la salle de bains.

Sandra fait une offensive avec aspirateur et serpillière qui durera toute la journée, épaulée par Louise qui démontre une efficacité remarquable ; Arthur quant à lui n’a pas tout à fait encore terminé ses vacances. Je rassemble ce qui traîne dans le jardin et dans la maison, fais trois trajets à la déchèterie, Lili reprend contact avec Grand Galop. Flicka 3 et Spirit.
Marc-André passe nous voir en fin d’après-midi, il entreprendra les travaux d’assainissement le long de la façade orientale et le rafraîchissement de la courte allée jusqu’au portail. On prend un apéritif près de l’étang que la canicule a mis à sec, il est d’accord d’engager Arthur une semaine cet automne.
Une journée qui ne figurera pas au tableau des grandes heures, la crêperie de Rue et une bolée de cidre nous ramènent toutefois un instant à nos deux semaines sur les rives de l’océan et bien au-delà. Je lis en effet à notre retour de Rue un mot du curé de l'île d'Yeu qui me fait chaud au coeur : Vous écrivez très bien, et avec indulgence! Merci de venir nous dire bonjour à l'occasion.
Qu'un curé soit l'hôte des marges.net me réjouit, mais qu'il officie sur l'île d'Yeu et me propose son hospitalité me comble. Je viendrai vous voir, Monseigneur, avec des cadeaux pleins les bras.
Jean Prod’hom
Transition

Cher Pierre,
Sandra prend le volant de la Nissan à Tours, se cale à gauche sur un muret d’un mètre, elle le suit et il la suit, fidèle, avec à son pied, imprévisibles, quelques bouquets de mauvaises herbes ; ce muret sépare sur l’autoroute ceux qui vont de ceux qui viennent, lesquels vont, ils le croient, chacun de leur côté ; mais ce sont les mêmes assurément, dans un miroir inversé, c’est un monde et sa réplique, l’un rembobinant l’autre, tous deux ponctués d’imperfections, de singularités et d’écarts dont nous ignorons tout ; c’est à l’occasion de ces incidents que les conducteurs qui perdent les pédales sont invités à prendre, aussitôt qu’elles se présentent, l’une ou l’autre des sorties prévues à cet effet.

Il est préférable de se détourner des mondes qu’on croise et de se consacrer au seul monde qu’on traverse, de suivre les six lignes blanches qui permettent d’éviter que les mondes parallèles, solidaires, ne se chevauchent ; l’une est continue, la seconde à segments courts, la troisième à segments longs. Une glissière de sécurité offre un premier verrouillage de sécurité à droite ; au-delà s’étend une zone franche, dans la terre meuble de laquelle sont ancrées les piles extérieures des ponts qui font communiquer les deux côtés du miroir ; un haut treillis clôt cette bande dans laquelle il est interdit d’entrer ou de sortir. Au-delà un monde immense qui nous fait signe et qu’on ne reverra pas.
Que de temps pour en arriver là ! Songez à la pose des treillis et des glissières, aux hommes qui ont donné leur sang, à notre ingratitude. Sachez désormais que quelqu’un pense identiquement de l’autre côté du miroir, à l’envers, et que ça tient.

Sandra me laisse le volant un peu après Blois, me mettant dans l’obligation de fermer aussitôt les yeux sur ce qui précède, par prudence ; pendant deux bonnes heures, jusqu’à l’aire de Ferté. On se dégourdit alors les jambes, je fais deux pas avec Oscar pendant que Sandra et les enfants se livrent à quelques achats ; je les rejoins avant de m’asseoir dehors sur un banc ; Louise me rejoint bientôt, fidèle à ses engagements, avec un taboulet et une salade de carottes sous cellophane ; Arthur la suit, trois sandwichs triangulaires, pain suédois, poulet et fromage ; Lili pain de mie, jambon et fromage ; Oscar satisfait de ce qu’on lui tend, Sandra sur mes genoux. Et soudain, de cette aire d’autoroute qui condense toutes les laideurs du monde se lève sans que je n’y puisse rien un peu de ce bonheur qui jette son voile de proche en proche sur le pire. Et concourent à cette étrange fête le souvenir des restes de moutarde sur la poignée de la porte des toilettes, le rouge impérial du ketchup sur la haute table ronde de la cafétéria, la pisse des chiens sur les aubépines, les pins maritimes, malingres, la pâleur des automobilistes. Ne rien toucher, le grand jour est entamé, je n’y puis rien.

Jean Prod’hom
Magnifique Tom Blaser

Un seul membre du Trial Club Passepartout de Moudon était qualifié pour défendre les couleurs de la Suisse lors des championnats d'Europe de trial qui se sont déroulés ce week-end à Alpago, à une centaine de kilomètres au nord de Venise, c’est Tom Blaser, très motivé à la suite de son titre de champion suisse 2015. Une finale de très haut niveau que Tom a entamée un peu tendu, mais très concentré. Au fil des zones, sa confiance et donc ses chances de médaille ont augmenté.
Et c’est seulement à l'avant-dernière des dix zones qu'il a réussi à prendre le meilleur sur le quatrième. Explosion de joie pour une médaille de bronze qui récompense une remarquable préparation – plus de vingt heures par semaine depuis octobre dernier.
Un plan dont la mise en place et le suivi ont été assurés par son entraîneur Jean-Daniel Savary. Un entraînement qui, s’il est centré naturellement sur la technique et la condition physique, ne néglige pas non plus la préparation mentale. Le fin équilibre des ces trois ingrédients aura donc fait ses preuves, gageons que d'autres résultats suivront.

Jordi Araque (Espagne) | Nicolas Vallée (France) | Tom Blaser (Suisse)
Pays de la Loire

Cher Pierre,
La mer creuse au large d’Yeu, nous rêvons à des histoires de marins, alignés sur le pont arrière du Saint-Sauveur. J’aperçois sous les arches de Noirmoutier un bateau de pêche, rouge et noir, lignes à l’eau, c’est le Challenger et son équipage de Port-Joinville qui taquine le bar.

On remet le pied sur le continent à Fromentine ; les K font quelques courses avant la fermeture des magasins avec l’idée de rentrer d’une traite, on décide de nous arrêter en route, ça nous a souvent bien réussi. Sandra prend le volant
On traverse les marais du pays de Retz et ses canaux que caresse ici et là le ventre de filets aux courbes géométriques, suspendus à des fourches archaïques.
Une barque sur les bords de la Loire, couleur sépia, avec dessus le nom de Saint-Florent-le-Vieil ne nous fait pas dévier ; on roule d’une traite le long de la Loire sans la voir jamais, jusqu’à Tours Quelques vaches et leurs veaux se tiennent immobiles dans de rares taches d’ombre ; du grain qui restait à battre il y a quinze jours ne subsistent que d’innombrables balles rondes et de lourdes bottes rectangulaires ; on franchit le Maine que des parois de verre dépoli embuent, on devine Angers mais on continue jusqu’à Villandry.
Le soleil, rouge, ressemble du haut de la grande roue de Tours à celui qui a basculé l’autre jour derrière les Chiens Perrins, le jour s’attarde longtemps encore dans le miroir de la Loire. Il est tard, on remonte une avenue qui n’en finit pas jusqu’à la place de la Liberté au centre de laquelle Jean Royer harangue une foule qui, depuis une vingtaine d’années, a quitté la salle.
Jean Prod’hom
La messe est dite

Cher Pierre,
Pas une sole dans le filet de cinquante mètres, mais une cinquante d’araignées d’un kilo dans une bassine. On en souffre tous, me confie un pêcheur qui nettoie, rue de la Sicardières, un filet tendu de chaque côté du muret de son jardin. Il faudrait un hiver froid pour les faire disparaître, très froid, une semaine à quatre ou cinq degrés au-dessous de zéro. En attendant, qu’on soit des amateurs ou des professionnels, on peste.

Chacun descend au port faire quelques achats, demain on s’en va ; la matinée est bientôt derrière nous. Les activités prévues après midi scindent le groupe en deux ; Martin et les garçons se rendent aux Vieilles ; Valérie, Sandra, les filles et moi au manège des Violettes ; Lili. Louise, May et Zoé font la connaissance respectivement de Shogun, Nestor, Nelly et Oyo. Nous allons pendant ce temps, Sandra et moi, faire un tour à l’intérieur de l’île, le long de haies pleines de verts sombres et tristes ; de rues, de routes et de chemins ocres et gris dont les noms racontent par endroits davantage les occupations des derniers venus que les rêves des premiers, et leurs fantômes. Les garçons préparent des hamburgers, Tatie Bichon des gaufres. La messe est dite, chacun plie ses habits, boucle son sac, les têtes et le frigo sont vides. Mais ceux qui ont élu domicile loin de l’océan n’oublient pas sa respiration, qui rejoint celles qui animent les montagnes et les saisons, familière lorsque nous reviendrons, heureux de retrouver ce nous croyions avoir perdu et qui a su faire sans nous.
Jean Prod’hom
Sainte Brigitte et Philippe Pétain

Cher Pierre,
Les deux gendarmes qui se tenaient bien droits à une vingtaine de mètres du parvis de Notre-Dame-du-Port m’ont indiqué, eh! monsieur, le panneau de sens interdit que j’avais un peu négligé, je dois l’avouer, pressé par les cloches de l’église dont j’avais entendu sur le port le premier des onze coups. Je les ai remerciés, comme il se doit en de telles circonstances, j’ai appuyé négligemment ma bécane contre un arbre, ils ont repris leur travail.

Je fais la connaissance des membres de l’Association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain, chics et sérieux, précédés d’un drapeau tricolore sur lequel sont brodés d’or leur acronyme et sept étoiles. Je fais également la connaissance de la dizaine de membres de Jeune Nation qui ont fait le pèlerinage de l’île d’Yeu ; le nom de leur association est imprimée au dos de leur polo, avec sur la poitrine ceci : CAMP école | Maréchal Pétain ; ils me font immanquablement penser à une sympathique équipe de moniteurs de colonie de vacances, n’étaient posés sur leur tête et portés de travers des bérets surmontés d’une croix celtique. Les deux groupes semblent se bien connaître, mais prennent garde de ne pas se faire d’ombre ; pas sûr qu’il partent en vacances ensemble, tout indique en effet qu’ils appartiennent à des mondes différents : les premiers parlent latin, les seconds portent, remontées sur le front, des lunettes à soleil américaines.
Il y a du monde dans l’église, mais incomparablement moins que dimanche passé ; une soixantaine de personnes réparties dans la nef à respectable distance les unes des autres, maintenant ainsi le chaudron à bonne température, et permettant au clergé d’honorer à feu doux, ensemble sainte Brigitte et Philippe Pétain. Je reconnais derrière l’autel certains des prêtres qui ont officié dimanche. Il devront jouer serré. Des photographes vont et viennent dans les bas-côtés et fixent l’événement.

C’est donc jour de sainte Brigitte de Suède, et la messe du jour est offerte par les parents et les amis de Philippe Pétain, maréchal de France, pour le repos éternel duquel le prêtre demande de prier, mais aussi pour toutes les victimes de la première guerre – cent trente habitants de l’île ont donné leur vie.
Dans son homélie, le prêtre rappelle que sainte Brigitte, conseillère au XIVème siècle des grands de son temps, de Stockholm à Rome, a été proclamée en 1999 par Jean-Paul II co-patronne de l’Europe – aux côtés de Sainte Catherine de Sienne – faisant d’elle l’ange gardien de tous ceux qui exercent des responsabilités, les accompagnant dans l’exercice de leur autorité, l’application de la justice et l’entretien du bien commun.
Le prêtre prépare le miracle de la transsubstantiation, tout le monde se tait. Dans le choeur de l’église, bien en vue de ceux de la nef, un père rasé de frais et une mère alourdie par la naissance des cinq enfants qui l’entourent sourient, ils semblent sortis d’une image d’Epinal.

Le gros des fidèles se rend en cortège jusqu’au cimetière, les curieux s’y rendent par le chemin des écoliers, je récupère mon vélo, les gendarmes ne sont plus là, j’emprunte quelques sens interdits. Le président de l’ADMP témoigne de sa fidélité et de celle des siens à l’illustre soldat qui repose ici, dans l’attente de la translation de sa dépouille à Douaumont.
Il cite longuement son héros qui, le 23 juillet 1945, avait pris la parole devant le tribunal politique qui prétendait le juger, disant en substance qu’il avait passé sa vie au service de la France, qu’il l’avait menée à la victoire en 1918 puis, alors qu’il aurait mérité le repos, n’avait jamais cessé de se consacrer à elle, acceptant de revenir à sa tête lorsqu’on l’en avait supplié, devenant du même coup l’héritier d’une catastrophe dont il n’était pas l’auteur, les vrais responsables s’abritant derrière lui ; il n’avait fait en réalité que son devoir en demandant l’armistice, d’accord avec les chefs militaires, sauvant ainsi la France et contribuant à la victoire des alliés en assurant une Méditerranée libre. On peut lire la suite de cette déclaration dans les livres d’histoire.
Au terme de cette partie officielle, chacun prend contact avec son voisin, un membre de Jeune Nation demande au secrétaire de l’ADMP s’il dispose de photographies du maréchal, format 20 X 30 ou cartes postales. Un autre évoque l’interdiction de l’Oeuvre française, trois photographes tournent autour des protagonistes, une femme déplore que de nouvelles tombes aient été placées devant la tombe du maréchal, il avait plus de place avant, c’était tellement plus agréable.
Un membre de l’ADMP insiste auprès d’un journaliste japonais sur la position apolitique de son association ; notre but est la translation de l'illustre soldat de l'île d'Yeu à Douaumont et la révision du procès de 1945, c’est tout. Le chef de file de Jeune Nation, qui ressemble de moins en moins à l’animateur d’une colonie de vacances, insiste au contraire sur le rôle politique de la leur et rappelle à un journaliste de Sept.info qu’il n’y a plus ni famille, ni patrie, ni travail.
Je m’éclipse, passe la fin de l’après-midi à l’Escadrille pour en savoir plus sur ce que j’ai vu. On va pique-niquer sur la plage du Cours du Moulin sans prendre en compte la fraîcheur du soir, on revient tôt ; m’arrête sur la plage de la Borgne qui me livre un dernier tesson. Je fais encore une halte au cimetière ; le chef de l’Etat français a passé par là et déposé une gerbe au vainqueur de Verdun. Si on regarde bien, on devine qu’elle provient du fleuriste qui a préparé celle qu’ont déposée les membres de l’ADMP. Toujours cette même interrogation devant l’océan, la marée qui monte, la marée qui descend.
Jean Prod’hom
La pointe du But

Cher Pierre,
La longue descente à vélo sur la rue Ker Pierre Borny, à 6 heures 30, me met l’eau à la bouche, comme hier et avant-hier ; je me plais à imaginer qu’elle se prolonge quelques kilomètres encore.

Personne sur la plage de la Borgne où je fais halte, à tout hasard ; en repars bredouille. Monte à l’étage de l’Escadrille où je mets à jour le billet de la veille ; les habitués s’installent, règlent au téléphone les affaires qui ne peuvent pas attendre : commerciales, de coeur ou boursières. Mes journées semblent raccourcir, comme si elles avaient un souffle au coeur, la plage a mis la main sur le gros de nos après-midis, j’en vois le bout à midi déjà.
Toute l’île est à nouveau sous le soleil, j’ai pu le vérifier en en faisant le tour ; je roule jusqu’à la Pointe du But, trois bateaux tournent autour des récifs des Chiens Perrins et de la balise qui les signale ; continue jusqu’au Châtelet et la plage des Sabias où je retrouve Sandra. Oscar vit sa vie, sans laisse ; je lis un peu et prends du plaisir à regarder les filles qui collectent des coquillages.

Je continue mon tour au large du Vieux Château, longe l’ancienne carrière Fourneau qui a fourni pendant pendant trente ans le gravier et la pierre à la construction locale, condamnée en 1995 lorsque la Côte sauvage a rejoint les sites classés de France. Les travaux de réaménagement ont débuté il y a quelques années, l’ancienne carrière, comblée en partie par les graviers et les pierres de démolition, deviendra combe, alimentée en eau douce pour fournir un milieu favorable à la faune et à la flore. Les travaux ont visiblement pris du retard.
Il y a plus de monde au café de la Meule que dans la chapelle qui surplombe le port, j’espérais quelques ex-votos, je ne trouve qu’une vierge au teint pâle entourée de moulures bleu-néon. Continue jusqu’aux Vieilles, La Croix et le cimetière de Saint Sauveur – pichets bleu et rouge – fais une visite-éclair à la mosaïste de Saint-Sauveur avant de rentrer à la maison.
Sandra et les filles ont préparé des crêpes, et comme si l’après-midi n’avait pas suffi, les grands retournent jusqu’à la nuit à la plage des Vieilles. J’en profite pour suivre le soleil qui roule derrière l’horizon ; la nuit déborde, orange d’abord, sombre et verte ensuite, se mêle enfin à l’huile épaisse de l’océan.
Jean Prod’hom
Julien Gracq envie les peintres et les sculpteurs

Cher Pierre,
Je me penche ce matin sur les 9 ensembles de 5 photographies qu’Yves et Anne-Hélène m’ont fait parvenir hier, sans méthode et en craignant le pire. Seule méthode dont je tire parfois quelque chose, lorsque je me sens démuni et que ma tâche demeure imprécise, séparée de mes forces.

Je m’avise pourtant, chemin faisant, qu’hésitant sur le tour à donner à ce que je me suis promis d’écrire, un carrefour se présente ; chacun des neuf textes pourrait en effet commander – dans leur langage – les cinq images en leur fournissant l’équivalent d’une légende ; ou se faire l’allié de l’une d’elles et ramener les autres à son aune ; mais ce serait dans les deux cas renoncer aux pouvoirs de l’écriture, succomber à la fascination des images et à leur manie rétrospective.
Ces photographies n’ont au premier regard rien à faire les unes avec les autres, ou de très loin. Elles sont cependant toutes des images cueillies sur le bord du chemin, taillées pour qu’elles entrent dans des cadres, séparées par ce qui se révèle être des gouffres qu’il serait vain de vouloir combler.
Bien au contraire, à moi donc de souligner les mondes invisibles qui tout à la fois les séparent et les unissent, en empruntant à chacune d’elles un peu de ce qui les déborde, les porte et ainsi prospecter en direction de leur lointain, c’est-à-dire de l’autre côté de la taille.

On passe l’après-midi aux Vieilles, un peu dans l’eau et beaucoup sur le sable. Nous faisons à manger avec Zoé, cinq kilos de moules marinées dans des échalotes, du persil et du vin blanc. On reste entre adultes dans le jardin alors que la nuit tombe et que les enfants font une expédition chez Tatie Bichon. Je reçois un message qui me réjouit, Claire nous invite au vernissage de son exposition à l’étage du Musée de la Pêche ; mais il faudra voir, nous partons pour le continent samedi matin, tôt.
Julien Gracq envie les peintres et les sculpteurs ; ce qu’il leur envie, c’est le miracle d’économie, le feed back de la touche et du coup de ciseau qui dans un seul mouvement à la fois crée, fixe et corrige ; c’est le circuit de bout en bout animé et sensible unissant chez eux le cerveau qui conçoit et enjoint à la main qui non seulement réalise et fixe, mais en retour et indivisiblement rectifie, nuance et suggère – circulation sans temps mort aucun, tantôt artérielle, tantôt veineuse, qui semble véhiculer chaque instant comme un esprit de la matière vers le cerveau et une matérialité de la pensée vers la main. Je me trompe peut-être, mais il me semble qu’avec le numérique l’écriture, pour qui le veut, peut devenir peinture ou sculpture : je crée, fixe et corrige en un seul geste, tandis que ce qui apparaît à l’écran me permet de rectifier immédiatement, de nuancer et me suggère touches et coups de ciseau.
Je reçois en soirée un mail d’Alain Chanéac, le responsable de faire part, cette revue ardéchoise dont le siège est situé à 40 kilomètres de Vals-les-Bains où nous avons passé quinze beaux jours en 2014. C’est Jean Gabriel Cosculluela qui est à l’origine de ma participation à ce numéro. Alain Chanéac me renvoie, bellement mis en pages, les douze proses que je lui ai envoyées.
Jean Prod’hom

Plage des Vieilles

Cher Pierre,
Trois bonnes nouvelles ce matin ! Arthur s’est levé à un peu plus de 8 heures, sans rien dire à personne, il a fait le tour de l’île à vélo, une vingtaine de kilomètres, seul, s’est baigné en route, entre la Pointe des Corbeaux et la Grande Conche ; il nous raconte au retour ses aventures avec une espèce de fierté. C’est à l’aune de ce type d’événements que je considère avec un peu de sérénité son avenir et celui de notre espèce ; je prends aussi conscience que certaines de nos orientations n’ont peut-être pas été vaines. Malgré les deux pains complets et les deux baguettes que j’ai achetés à Port-Joinville, le bosco craint la disette, il repart à la boulangerie que je viens de quitter et en ramène deux baguettes supplémentaires. Cet été est un peu son été, on a désormais chacun le nôtre.

Sandra a reçu un message de Michel, les travaux ont repris au Riau, c’est la seconde bonne nouvelle. Le peintre est à ses oeuvres, les meubles de la salle de bains seront posés mercredi. Il est donc possible que, lorsque nous rentrerons, nous débarquions dans un chantier moins lourd que celui que nous avons quitté.
Troisième bonheur, j’ai trouvé ce matin, sur la plage de la Borgne, une pierre qui m’a fait rêver le reste de la journée ; c’est un fragment de terre cuite sur lequel on distingue les plis d’une jupe ; la manche retroussée d’une blouse blanche d’où sort un avant-bras – le gauche ; dans la main droite une baguette. Au verso l’essentiel des indications de fabrication, il s’agit du fragment d’une assiette née dans les faïenceries de Sarreguemines en Alsace, une scène champêtre dans un décor Obernai.
Il a plu cette nuit, elle part et puis revient jusqu’au soir, si fine qu’elle n’afflige pas nos humeurs, elle donne à la plage des Vieilles où l’on passe l’après-midi un air de Bretagne, l’île en avait bien besoin.
J’ai reçu d’Yves et Anne-Hélène les 9 ensembles de 5 photos qu’ils m’avaient promis ; je ne connais rien des raisons qui ont présidé à leur choix. A moi d’écrire quelque chose pour chacun d’eux. On arrive au bout de juillet, je ne dois pas tarder
Je retourne à l’Escadrille en fin d’après-midi. Martin prépare le repas, Sandra et Valérie sont allées acheter des vêtements, les enfants sont au cinéma. Je finis par mettre la main sur l’assiette d’où provient le fragment que j’ai trouvé ce matin, on y voit une gardeuse d’oies, habillée en Alsacienne par Henri Loux (1873-1907) pour les faïencerie de Sarreguemines. Elle conduit ses trois oies à une espèce de mare crémeuse et tourmentée, le chemin de sable rose sort de haies vives, des nuées grises traversent le ciel. Comment ce morceau est-il arrivé sur la plage de la Borgne, c’est naturellement une autre histoire.

Jean Prod’hom
Plage de la Borgne

Cher Pierre,
A l’étage de l’Escadrille, qui met à la disposition de ses clients une connexion wifi, tu peux t’asseoir sur l’un ou l’autre des bancs qui font le tour de la pièce comme dans une salle capitulaire ; avec l’océan, les cris des goélands et le continent qui te poussent dans le dos ou sur l’un des confortables poufs qui leur font face.

Claire Le Baron, à qui je disais hier mon étonnement de trouver si peu de pierres, bois, fers roulés et ramenés par la marée sur le littoral de l’île d’Yeu, m’avait confié qu’une de ses amies se rendait volontiers sur les plages des Bossilles et de la Borgne sous le Super U. Je m’empresse de m’y rendre ce matin, avec un k-way sur le dos ; le ciel est gris, l’océan aussi, sans ourlet, thermocollés.
Mon dernier séjour sur les côtes atlantiques datent d’il y a une dizaine d’années, mais je retrouve vite ce plaisir-là ; une heure à aller et venir, retourner des leurres, éviter la vague, ramasser enfin deux belles pierres à l’extrémité de la plage de la Borgne que je glisse au fond de ma poche.
Les cloches sonnent à l’église de Notre-Dame-du-Port et la foule se presse sur le parvis pour le seizième dimanche du temps ordinaire. Les quatre prêtres qui officient, si j’ai bien compris, sont en vacances sur l’ìle, ils se présentent. Il y a l’archiprêtre de la cathédrale de Bourges ; un prêtre en mission à Vienne ; un autre, sans mission, baptisé il y a 80 ans dans cette même église ; et, plus curieux, l’un des aumôniers des artisans de la fête, c’est-à-dire des forains, des gens du cirque et des artistes de rue. C’est ce dernier qui se charge de l’homélie, il y est question du berger et de ses moutons, mais aussi des moutons et de leur berger. Je m’éclipse avant de connaître le fin mot de l’histoire, je le devine, on m’attend à Ker Borny.
Le ciel crachineux de ce seizième dimanche du temps ordinaire nous invite à lézarder sous toit : jeux de cartes, discussions théologiques, visites de frigo, siestes, lectures. Pour donner un profil plus honorable à cette fin de journée, je redescends sur la plage de la Borgne, la mer est basse ; vais et viens sous l’oeil intrigué d’un tournepierre à collier, me penche et me redresse, retourne enfin une pierre qui cache une merveille et à laquelle je promets les hauts de casse.

L’abondance ou la rareté des tessons sur une île ne joue évidemment aucun rôle dans l’émotion qu’elle peut susciter, n’augmente ni ne diminue son attrait ; elle constitue toutefois, dans certains cas, un puissant indicateur sur l’état de santé de ses habitants, de la relation que ceux-ci ont avec leurs déchets, éclairée ou aveugle ; de la confiance qu’ils placent en les pouvoirs de l’océan de reprendre et digérer ce que l’homme en a momentanément tiré.
Les enfants passent à la caisse à 19 heures, chacun reçoit 20 euros pour manger ce qui lui plaît. On se rend de de notre côté aux Bafouettes, On y mange bon, très bon.
Jean Prod’hom




La Grande Conche

Cher Pierre,
Si le centre de Port-Joinville ne désemplit pas jusqu’à tard dans la nuit, les plages du nord-est de l’île se vident tous les jours à mesure qu’on s’approche de la Pointe des Corbeaux. On déroule nos onze linges sur le sable de la Grande Conche, l’eau est froide ; on passera plus de temps dehors l’océan que dedans ; depuis que nous sommes sur l'île, Oscar n’y amis que les pieds. Derrière nous, les lagures, les jasiones et les chardons bleus se partagent la ligne de crête de la dune, ici et là une espèce d’oeillet rose. Si j’osais déranger Claude Bugeon une nouvelle fois encore, j’irais m’informer rue des Mimosas.

C’est à mon tour, au retour, de tirer le charroi, vent debout, avec Oscar calé entre glacière et combinaisons détrempées ; trois vitesses pour venir à bout de la route qui longe la côte – Sandra m’accompagne –, la rue de la Filière et la rue de la Belle Poule, le chemin Frinaud et un court segment de la rue Georges Clémenceau, la route des Sicardières et celle de la Vigne. Ça aura été, je crois, l’unique façon de prendre conscience de ce que les autres ont enduré, Sandra surtout. On se change avant de redescendre au port.
Les galeries de peinture se succèdent sur les quais ; je suis allé ce matin jeter un coup d’oeil aux natures mortes de Frédéric Choisel. L’homme a du métier : les artichauts, les oignons et les tomates, les pivoines et les oeufs ; les poires, les pots, les pichets et les plats semblent tout droit sortis d’une dressoir laqué du XVIIème siècle, intacts, sans poussière ; il y a même un arrosoir.
Je monte à l’étage du Musée de la Pêche, Claire Le Baron y expose une vingtaine de photographies, les fenêtres sont ouvertes, un peu partout des fleurs, pétales et bouquets ; mais d’autres cueillettes aussi : des vagues, des sardines, des reflets, des cageots, des plastiques, des flotteurs, des bateaux. Une de ces photos m’intrigue tout particulièrement, on y voit deux pots bleus avec un estagnon d’huile de vidange, bleu lui aussi. J’ai fait l’autre jour une variante de cette photographie, ce sont en effet les pots suspendus du cimetière de Port-Joinville, seule la couleur de l’estagnon d’huile a changé. Tout s’en suit, on discute le coup, de son appareil-photos, semblable au mien, qu’elle emporte partout ; elle pinseye à qui mieux mieux et conclut ses explications par des « Et voilà ! » de modestie, convaincue que le sourire peut faire bon ménage avec l’art et que tout ce qu’on donne n’est pas à reprendre. Elle écrit quelque chose de très joli à propos des fleurs :
On soupçonne tout ce qui touche les fleurs de mièvrerie, on leur reprocherait même leur joliesse. Pourtant joli comme ça, avec du beau à l’intérieur, tout le temps, capable d’accompagner nos saisons, de résumer le vie, sa fin et ses espoirs à tous les coins de chemins, de jardins, aussi obstinément, à force, ça devient bouleversant.
Il est 19 heures 30 lorsque je remonte à Ker Borny ; Martin est une perle, il nous a préparé des pâtes aux seiches, Zoé des crêpes. Après le repas, les enfants vont jouer un moment encore dehors, jusqu’à la nuit. Le silence se fait au salon, un silence profond, on lit Gala, Voici, Grazia, Point de Vue, Elle. De quoi alimenter nos rêves en têtes couronnées tout en nous tenant à l’abri des guillotines. Je lis avant de m’endormir le dossier complet qu’Antoine Michelland a consacré au baptême de Charlotte de Cambridge dans le dernier Point de vue. Où trouvent-ils la force de sourire ?
Jean Prod’hom

Saint-Sauveur

Cher Pierre,
De notre lit ce matin, il est difficile de déterminer avec certitude, comme hier d’ailleurs, si le ciel est nu où s’il se cache derrière la pâleur uniforme des nuages ; je me lève pour vérifier, ferme les volets, Sandra dort. C’est seulement en m’arrêtant sur la route de Cadouère que j’aperçois des plis dans la couverture nuageuse et quelques coulées d’argent, j’en profite pour mettre le nez dans les chèvrefeuilles en fleurs.

Ils sont trois au café du Centre, cigarette aux lèvres, à se refiler des tuyaux sur le mouvement des poissons ; deux d’entre eux travaillent sur le Challenger et pêchent à la canne, ramassent les lançons avec lesquels ils appâtent le bar. Leur bateau est au bout du ponton où un troisième collègue les attend. Je les vois bientôt enfiler leur ciré et relever les bouées.
Je reste avec Désiré, un patron un peu désabusé mais l’oeil vif et la langue bien pendue. Désiré pêche au palan, il me raconte la disparition des activités sur le plateau ; il y a 50 ans, il y avait au port autant de bateaux que de tombes au cimetière, les marins étaient même un peu cache-crue (?) ; mais l’impéritie des politiques, l’ineptie des règlements, le coût de la sécurité, les contraintes écologiques les ont vidés, eux et le port. Ils ne sont aujourd’hui qu’une dizaine, au palan, à la canne ou au petit filet ; et il n’y a guère que deux gros bateaux qui partent pour la semaine. Quand il s’est mis au boulot, il y a trente ans, 27 bateaux ont jeté l’ancre la même année, définitivement. Désiré rit, Désiré est pessimiste, Désiré s’en va sur son palangrier, seul à bord comme son père, faire sa tournée habituelle. Jusqu’à quelle heure ? Il n’en sait rien. ça dépend de lui, et du poisson.

Les réseaux sociaux on ceci de bien qu’ils vous mettent en contact de très loin avec des gens qui sont tout près. Bernard Bretonnnière, un habitué de l’île, qui lit ces notes et à qui je demande des informations sur deux fleurs aperçues sur la dune, me communique l’adresse de Claude Bugeon, rue Mimosas à Saint-Sauveur ; cet homme à tout faire me reçoit dans une petite pièce remplie de ses bouquins, de ses peintures, de ses gravures – celles de sa femme aussi. Claude Bugeon s’est réfugié sur l’île en 1982 et s’est mis en tête de sauver ce qui pouvait l’être encore ; il a commencé à faire l’inventaire de tout se qu’on peut rencontrer sur l’île : faune, flore, géologie, économie, préhistoire, histoire... Il n’a pas non plus hésité à batailler contre les élus locaux prêts à livrer leur île aux forces de l’argent, il a fait interdire un golf sur la Côte sauvage, classer l’île dont le tiers désormais est inconstructible ; l’indépendance du bonhomme lui a permis de tout dire si bien qu’il ne s’est pas fait que des amis.
Les montgolfières que j’ai observées l’autre jour sur la dune sont en réalité des lagures ovales, et les petites bleues, qui avaient la coiffure hirsute des raiponces, des jasiones des montagnes. Je repars de chez lui avec le premier volume de son journal : Perpetuus Liber (1982-2005), de Yeu, Nature & esprit d’une île – un livre plein de mots commençant par une majuscule et, piquée sur son lexique, la définition du mot cache-crue entendu ce matin dans la bouche de Désiré.
Cache-crue : oiseau le troglodyte. Parfois donné aussi au roitelet. Tous deux espèces très petites et fugaces. Par ce fait on utilise ce mot pour désigner un gros cachottier, car ces oiseaux sont souvent dans les frondaisons avec des comportements vifs et discrets. La seconde partie du mot (« crue ») souligne bien le sens de « vigoureux » connu au figuré pour le latin crudus.
Je m’arrête encore à la Dilettante, achète à la vigneronne une bouteille de rosé, lui transmets les salutations de François qui m’a soufflé son adresse, elle me parle alors de Marie, de Constance et de Constantinople. Je repars avec sous l’autre bras la correspondance d'Henri Calet et de Raymond Guérin. Il est près de 13 heures lorsque je retrouve les miens à Ker Borny. Tout s’enchaîne alors selon une belle nécessité : catamaran à la Pipe, balade sur la plage, grillades le soir, descente expresse chez Tatie Bichon : gaufres.
Jean Prod’hom
Le monde entier les avait abandonnées

Cher Pierre,
Le texte que j’ai commis ne précède ni n’annonce quoi que ce soit, il est plutôt un supplément dont le corps principal pourrait volontiers se passer. La préface deviendra une postface, et c’est bien ainsi.

Quatrième jour de catamaran, le vent a forci sur la plage de la Pipe et les enfants prennent du plaisir ; il bascule au milieu de l’après-midi et cinq d’entre eux chavirent : Lili et May se retrouvent soudain en haut de la coque bâbord, se jettent courageusement à l’eau avant de prendre pied sur la coque tribord qui devient leur refuge ; je fais des photos de leur naufrage, dix-sept interminables secondes pour ces gamines de 11 ans, et leurs parents qui, malgré leurs sourires, n’en mènent pas large ; Benjamin file à leur rescousse, leur donne un coup de main pour redresser l’embarcation. Quant aux trois grands, ils tournent leur catamaran à deux reprises, la première fois parce qu’ils n’ont rien vu venir ; la seconde lorsque l’un d’entre eux se suspend au trapèze face au vent et, plutôt que de contrebalancer la gîte du bateau précipite tout l’équipage à l’eau.
Deux heures donc à ne rien faire, sinon à les regarder évoluer du haut de la Pointe du Pè-de-Coulon, avec une inquiétude qui croît lorsque le bateau de Lili et de May, à la cape, dérive comme une coque de noix en direction de l'Amérique. Benjamin, qui est au four et au moulin, les rejoint 10 minutes plus tard alors qu'elles et leur bateau ne sont qu'un point évanescent, ils les remorque derrière son zodiaque. Elles nous raconteront plus tard, lorsqu’elles auront mis pied à terre, qu’elles avaient eu assez de temps, seules, pour se convaincre l'une l'autre que le monde entier les avait abandonnées.
J’ai rendez-vous au salon de Léa à 17 heures, son employée a du retard ; j’en sors à 17 heures avec une coupe à la Steve Warson. Je fais quelques courses en remontant, les filles ont préparé des pizzas et un tiramisu de fraises.
Il y a de la fatigue dans l’air, chez les enfants et chez les parents. Les plus optimistes promettent à ceux qui le sont moins que tout le monde sera au lit à 22 heures ; à 23 heures, rien n’est encore fait.
Jean Prod’hom
Les préfaciers devraient écrire des postfaces

Cher Pierre,
C’est à mon tour de tirer la charrette jusqu’au marché de Port-Joinville où Sandra me rejoint à pied autour de 9 heures avec Arthur, Louise et Oscar. Reprends sur la terrasse de l’Equateur, en les attendant, la préface à laquelle je n’ai pas touché depuis deux jours ; j’aperçois en transparence le fil directeur qui la traverse. J’ai travaillé dur, comme pour Tessons, par gros tas, petits tas et modelage ; ça prend du temps, mais je ne vois pas, en l’état, d’autres manières d’écrire.

Je remonte à pied avec Louise et Sandra, par la citadelle, en essayant de résilier un abonnement qu’une femme-araignée m’a vendu pour l’utilisation de mon natel depuis l’étranger, c’est un attrape-nigauds. S’il lui a été facile de me convaincre de rejoindre sa toile et sa glu, – il a suffi d’un clic –, ce sera assurément une autre histoire de m’en défaire ; les mouches le savent bien.
On déjeune une nouvelle fois dans le jardin, mais toujours plus tardivement : c’était 10 heures le premier matin, c’est 11 heures passées aujourd’hui.
Tandis que les enfants, Sandra, Martin et Valérie se rendent au Centre de voile, je reste avec Oscar à Ker Borny. Il me faudra quatre heures et demie pour arriver à bout de ce texte, en doutant franchement que l’auteur y trouve son compte. Je décide donc de le lui envoyer avant d’aller dans le détail. Avec le sentiment pourtant que quelque chose se libère, et la conviction que je ne pouvais pas écrire autre chose, mais également que ne pouvais pas écrire cette même chose autrement. Il est temps que je passe à autre chose, mais cette autre chose c’est Grignan, et Grignan, c’est encore un peu la même chose.
On se rend à 23 heures sur la prairie de la Citadelle où l’on projette La Chèvre, un film de Francis Veber ; on en revient refroidis. Je reçois un mail de l’auteur du livre dont j’ai été chargé d’écrire la préface ; certains éléments du texte que je lui ai fait parvenir sont, dit-il, trop complexes pour le public à qui il destine son livre, il est en outre un peu trop long. L’auteur me fait parvenir une introduction en fichier attaché, nos textes font double emploi ; me voilà fort emprunté, mais la situation intéressante. Une réflexion assez sommaire, face à l’océan, sur les relations problématiques des auteurs avec leur préfacier m’amène, yeux mi-clos, à conclure ceci : les préfaciers devraient écrire des postfaces.
Jean Prod’hom
Pierre-Levée

Cher Pierre,
Longue trotte ce matin à vélo, un peu après 6 heures, par Ker Bossi, Saint-Sauveur ; les Vieilles, par La Croix jusqu’à la pointe des Corbeaux à l’extrémité est de l’île. Retour par la Grande et la Petite Conche ; par le Marais salé et le Centre nautique. Les massifs d’hortensias et les roses trémières fragiles et solitaires se partagent équitablement les façades des maisons, quelques lauriers aussi, quelques roses.

Au port les rescapés de la fête nationale, branlants et avinés, se réjouissent du bon tour qu’ils ont joué à la nuit ; mais, soudain inquiets, ils se demandent d’où ils viennent, plus encore où ils vont, seuls ou à deux ; à respectable distance les uns des autres pour éviter les collisions et les brouilles. Je m’assieds à la terrasse de l’Equateur, la serveuse me demande si je prends la même chose, me lance un à demain lorsque j’enfourche ma bécane.
Julien Gracq et Jean Carrière qui l’interroge ne sont pas tendres avec le Grand Meaulnes, ne voyant dans la première partie que du merveilleux plaqué sur le réel, alors que, me semble-t-il, le merveilleux, si tant est qu’on peut l’appeler ainsi, semble surgir de la masse dans laquelle il sommeillait. Quant à la seconde partie, taillée à la hache, au romanesque décousu, en miettes, elle n’abîme pas le Grand Meaulnes, elle réussit au contraire à faire voir et entendre rétrospectivement le réel enchanté de la première, le réel délivré de ses chaines, l’enfance entière et oublieuse.
Les enfants descendent de leur catamaran lorsque le vent forcit ; on rentre une nouvelle fois à la queue-leu-leu ; mais je leur fausse compagnie à l’entrée de Port-Joinville, file à la Maison de la Presse avant de m’arrêter au cimetière où une veuve m’indique la tombe que je cherche ; celle d’Emile Taübel, coiffeur allemand à Paris, interné à Pierre-Levée au commencement de la guerre, mort sur l’île en 1917 d’une pleurésie, il avait 45 ans. C’est ce que m’a appris l’exposition présentée dans la cour de la citadelle que les garçons nous ont fait traverser hier soir lorsque nous nous rendions au feu d’artifice. La tombe de l’Allemand a subi une rotation de 180 degrés, comme celle du Maréchal Pétain pour lequel une messe sera dite le jeudi 23 juillet dans l’église de Notre-Dame-du-Port. La tombe de Pétain est à l’abri de hauts cyprès, celle de Taübler est surmontée d’un beau relief de pierre blanche, transparente, c’est le visage du Christ aux douleurs qu’un jeune interné autrichien a réalisé à la mort de celui qui était devenu son ami, Rudolf Willersdorf, en résidence d’artiste à Paris, déporté à Noirmoutier sitôt la guerre déclarée, à Pierre-Levée ensuite jusqu’à l’armistice.
Les virées à vélo de ces derniers matins m’ont mis sur les genoux, Valérie et Sandra sont allées se coucher, j’entends Martin qui joue derrière la maison avec les enfants, les nouvelles du jour me tombent des mains.
Jean Prod’hom
Port-Joinville

Cher Pierre,
Le ciel est couvert devant les anciennes conserveries de Port-Joinville, je fais quelques photos. Tire ensuite trois longs bords pour une maigre collecte ; les caractéristiques de la grève me semblaient pourtant tout à fait comparables à celles de Kérity où la pêche a été si souvent miraculeuse. Fais halte au retour à l’Equateur, la jeune femme à qui je veux passer commande anticipe : c’est bien un cappuccino et un jus d’orange que vous désirez, comme hier, y aurait-il raison, diable, que les choses changent et que vous vous vous rendiez demain chez le concurrent ? J’hésite à contrarier son plan, mais il serait idiot de refuser, aux premières heures, l’occasion qu’elle m’offre de me taire.

Yves m’envoie un mail, il m’indique qu’Anne-Hélène et lui ont bifurqué une nouvelle fois ; mais à y regarder de près, ce n’est qu’un aménagement de la même idée : les ensembles de cinq photos sont toujours prévus, disposés cette fois sur des tables basses (58 x 38 x 58), couleur gris clair ; les photos sont glissées dans des enveloppes pergamine, qui remplacent donc les boîtes. Hâte de recevoir ces ensembles pour rédiger ce qu’ils appellent les textes de référence.
Je rentre sur ces bonnes nouvelles, le gros de la maisonnée dort, il est 9 heures ; mais Lili bientôt, May, Sandra, Oscar et Louise, aux commandes du vélo à la charrette descendent à la boulangerie pour acheter du pain qu’on tartine de miel et de confiture sous le parasol. Tout le monde est réveillé, le ciel est bleu.
On désœuvre trois bonnes heures, Sandra douche Oscar, Lili et May joue à Ben-Hur, avec les risques que cela comporte ; les garçons ont quinze ans et ça se voit, je lis deux entretiens de Jean Roudaut avec Julien Gracq.
Il y a, en début d’après-midi, un peu de tension sur la plage de la Pipe, chez les enfants et chez nous, on remet en effet pour deux heures et demie nos enfants aux mains d’inconnus. Les deux petites, avec d’autres du même âge, ont besoin d’un peu de temps pour prendre possession des trois catamarans que les animateurs remorquent au large de Port-Joinville ; le vent d’ouest les ramènera au Centre quoi qu’il arrive. Elsa et Louise sont déjà bien loin et semblent bien décidées à se passer de nous ; quant aux trois grands, qu’ils continuent à filer ainsi, vent arrière, en direction du levant ; mais qu’ils apprennent qu’il leur faudra désormais, s’ils souhaitent qu’on les nourrisse encore, tirer de sérieux bords pour remonter le vent jusqu’à la maison. J’essaie, sans le succès escompté, de photographier des papillons jaune-orange qui butinent les immortelles.
Disons qu’on s’est un peu simplifié la vie, Zoé et moi, en achetant trois poulets sortis du grill, des pommes-de-terre frites congelées et des tomates de toutes les couleurs, qu’il a suffi respectivement de glisser au four et d’émincer en rondelles. On repart au port pour le dessert, à la queue-leu-leu, sans Oscar auquel on a confié les clés de la maison ; file indienne à nouveau chez Tatie Bichon pour une gaufre ou une glace, cortège enfin conduit par le porte-enseigne de la fanfare de Saint-Hilaire, caisses claires, trompettes et clairons qui ouvrent les festivités du 14 juillet.
On rentre après un beau et interminable feu d’artifice, laissant derrière nous, au pub de l’Escadrlle et sur la place du port, des restes de rock 'n' roll et les flonflons d’un bal musette, pédalant dans la nuit noire balayée par les lueurs drapées du grand phare.
Jean Prod’hom
La plage des Sabias

Cher Pierre,
Les goélands, leur nombre, leurs yeux, leurs cris, la tache de sang sur leur bec effraient, j’appuie sur les pédales, le sentier de la pointe du Châtelet au Vieux Château est étroit, des bancs de brume se prennent à la lande.

Le calme revient au port de la Meule, un retraité lève l’ancre ; la Gazelle repose sur le flanc, plus haut sur l’estran. Je rentre par Saint-Sauveur, l’église est fermée ; sur la place, les exposants mettent à l’abri les étals qu’ils n’ont pas eu le courage de plier hier. Depuis que je suis parti ce matin à 6 heures, plusieurs dizaines de lapins, surpris dans les jardinets des maisons des vacanciers traversent la route en coup de vent et disparaissent dans les ronciers épais ou sur la dune.
Bois un café et mange un pain au chocolat à l’Equateur, il est 8 heures ; les jeunes tenanciers des bars de Port-Joinville préparent leur terrasse, embarqués pour l’heure dans la même histoire ; ils sourient, plaisantent avant de redevenir des rivaux ; les clients sont encore rares, on devine qu’il en ira autrement tout à l’heure ; à l’Equateur le wifi est libre, je relève mon courrier. M’arrête au cimetière en remontant ; avec leur hautes croix blanches, on dirait un port de plaisance bondé, mais ici pas d’accastillage, pas de souplesse, la mer est de terre ; les tombes s’enlisent, quelques-unes se déchaussent, d’autres se brisent ; les vagues sont comme des statues de sel ; des jarres à anse, en plastique bleu, sont suspendues à des crochets en trois endroits du cimetière. Me demande bien ce qu’est venu faire Pacifique Ricolleau dans ce bazar
Oscar devra s’y faire, sanglé de près dans le charriot fixé à l’arrière du vélo de Sandra, surveillé par Louise qui les suit. On se rend au Casino faire quelques course ; je monte à Notre-Dame-du-Port d’où j’entends les grandes orgues s’ajouter aux dunes pour contenir l’océan.
Il y aura du va-et-vient toute la journée entre Port-Joinville, la plage des Sabias et Ker Borny ; il convient en effet, à douze, de s’accorder au plus vite sur la forme de l’île, de fixer quelques amers, se familiariser avec deux ou trois itinéraires, et pour certains, apprivoiser quelques noms propres.
Je crois voir, un peu avant minuit le bout de la préface qui m’a été demandée, je constate à ma stupeur que ce n’en est pas une.
Jean Prod’hom
Ker Borny

Cher Pierre,
La ville de Poitiers, comme celle de Lübeck, entretient soigneusement les traces de son ancienne prospérité ; elle abrite aujourd’hui, comme la petite ville du Schleswig, des grappes d’étudiants qui peinent à se réveiller le matin ; pas un bruit dans la rue, on n’ouvre l’oeil qu’à 8 heures.

La moquette de l’hôtel de l’Europe où l’on a passé la nuit donne une image assez juste de l’état de notre continent : les bords s’effilochent, le centre est usé jusqu’à la corde ; les dirigeants racontent à qui veut que les étoiles brillent encore, si bien que la grande brocante passe aux yeux du naïf pour un magasin d’antiquités, l’usure pour de la patine, le Mont-de-piété pour une banque.
Pendant que Sandra et les enfants font quelques courses au marché, je vais poster un colis pour Chamaret avant de faire une visite à Notre-Dame-la-Grande ; y fais la connaissance de saint Expedit à qui les étudiants, lorsqu’ils sont à la bourre, ont l’opportunité de demander un peu d’aide. Les ex-votos au pied du saint indiquent qu’ils sont nombreux à recourir, avec succès, aux services express de saint Expedit.
Ma foi aura montré ses limites entre Poitiers et Niort, on roule en accordéon ; mes prières ferventes n’ont en effet pas convaincu le patron de la circulation routière qui a placé sur l’autoroute deux ou trois chicanes. Nous arrivons à un peu plus de 15 heures à Fromentine. Sandra est arrêtée par la gendarmerie nationale entre le parking et le point d’embarcation, pour avoir roulé cinquante mètres sans ceinture de sécurité et avec Valérie au bout du fil. Elle écope d’un avertissement, ça aurait pu être pire.
La maison qu’on va occuper à douze – un chien, sept enfants et quatre adultes – est à l’intérieur des terres, tout près de la citadelle. Elle ressemble à ces maisons de style international qu’on rencontrait autrefois à Cos et à Ibiza, mais qui ont colonisé aujourd’hui les rives des mers et des océans du monde entier.
Jean Prod’hom
Monsieur Picassiette d’Eduardo Franzosini

Cher Pierre,
Les cuisinistes posent ce matin les derniers éléments tandis qu’on charge la voiture, avec les variations d’humeur que provoque immanquablement ce type d’événement. Pour couronner le tout, la connexion téléphonique nous lâche, et avec elle l’internet. Il est un peu plus de 10 heures lorsqu’on s’en va.

Une étude très superficielle des itinéraires jusqu’à Fromentine me fait pencher pour celui de Bourg-en-Bresse, Mâcon, Montluçon, Bourges, Tours, Angers et Nantes ; pas sûr que le GPS auquel je confesse mon choix me donne l'absolution. Il nous envoie finalement en pénitence au nord, par Orléans et Chartres, sans qu’on puisse réagir à temps si bien qu'on ne quitte pas l’autoroute de la journée. Je cherche des yeux la maison où vécut Raymond Isidore, je ne vois que l’ivraie que laissent les batteuses. Poursuis la lecture de la curieuse biographie (Monsieur Picassiette) que lui a consacrée, il y a exactement 20 ans, Edgardo Franzosini.
Les K nous ont dépassés un peu avant Genève, on ne les reverra pas avant demain, ils nous ont parlé de Poitiers alors qu’on songeait à la Loire, Tours et pourquoi pas Saint-Florent-le-Vieil. Total les K dorment à Tours et nous à Poitiers.
Je termine la lecture du Monsieur Picassiette, qui me rappelle le Saint Benoît Joseph Labre d’André Dhôtel ; j’en extrais ceci : ... pour comprendre pleinement un homme et son oeuvre, plutôt que d’en lire la biographie, il vaudrait toujours mieux en écrire une soi-même.
Jean Prod’hom


Dans la place forte

Cher Pierre,
Les deux heures passées à la bibliothèque, sitôt réveillé, me font croire un instant que je suis entré dans la place forte, et que cette préface à laquelle je travaille depuis deux jours pourrait être hors d’eau en fin de semaine ; c’est de l’intérieur alors que j’aurai à terminer la bâtisse, pièce par pièce, de telle manière qu’on puisse passer de l’une à l’autre, quel que soit l’itinéraire. Je souris à l’idée que, lorsque j’aurai terminé, personne ne pensera une seconde aux efforts qu’il m’aura fallu déployer pour que ces quelques pages atteignent, comme je l’espère, leur point d’équilibre.

Michel jette un coup oeil aux travaux qui seront entrepris pendant que nous serons à l’île d’Yeu, c’est lui qui sera notre répondant auprès de l’assistante de l’architecte avec laquelle nous avons rendez-vous à 14 heures ; le peintre et le chauffagiste nous rejoignent. On traite des détails dans lesquels se cache le diable, tout le monde semble mettre de la bonne volonté.
Les filles ont fait leur sac, Arthur peint avec sa mère la porte d’entrée. Ce soir, Sandra, Louise, Lili et leur frère descendent au Stade olympique pour Athletissima, je feuillète les premiers numéros du Passé simple, tout nouveau mensuel romand d’histoire et d’archéologie que j’ai reçus hier par la poste, m’arrête aux éditoriaux ; j’y lis plusieurs choses : d’abord que l’homme est plus fort que la machine et le croisement mécanique des données informatiques ne remplacera jamais l’esprit de finesse. Que les croyances, en histoire comme ailleurs, ont la vie dure. Et enfin, que les récits de fondation des groupes sont pris en charge tout autant par ceux du dedans que par ceux du dehors.
Il est temps de faire mon sac.
Jean Prod’hom
Double opération de jardinage

Je laisse Louise au parking d’où j’aperçois, en contrebas, une grande tablée autour de laquelle les douze fillettes du camp déjeunent. Au café où je fais une halte en rentrant, la conversation de hier matin continue, mais plus trace du suicidé de la veille qui semble avoir commencé à se faire une place viable dans leur mémoire.

Double opération de jardinage, je fauche le verger et, pour la première fois cette année, le talus. M’attaque ensuite au fouillis dans lequel j’ai laissé cette satanée préface hier avant d’aller me coucher ; deux bonnes heures ce matin à faire des andins puis cinq ou six tas cet après-midi, avec l’impression que tout n’est pas perdu, mais bien loin encore de cet archipel auquel il me faudra bien enfin toucher.
M’accroche avec Arthur à propos du travail libre et du travail rémunéré, il ne comprend pas l’intérêt du premier ; quant au second, il doit être naturellement vite fait pour rapporter plus ; nos points de vue sur la question sont actuellement irréconciliables, il est préférable que je m’éloigne ; coaché par sa mère qui termine de ranger la véranda dont j’ai rendu hier soir l’accès possible, Arthur se lance finalement dans le rafraîchissement de la porte d’entrée.
On voit le bout des travaux et le temps a fraîchi, ce sont les deux bonnes nouvelles du jour. Et puis Louise a passé une belle journée à Thierrens, elle me raconte un peu en rentrant ce qu’elle a fait ; sa conception du travail est diamétralement opposée à celle de son frère.
Marinette nous invite à manger, dehors ; on assiste impuissants, dedans, à la défaite de Wawrinka contre Gasquet. On ressort avec une petite laine.
Jean Prod’hom
Ces artistes-là avancent par à-coups

Les choses vont leur chemin, j’ai vu hier Yves et Anne-Hélène, je m’y fais bien ; ces artistes-là avancent par à-coups, s’enflamment, refroidissent, bondissent, se raidissent, bifurquent ; c’est ainsi, semble-t-il, qu’ils trouvent des équilibres.

On se quitte d’accord sur les points suivants : dans la salle du fond, quatre ou cinq casses d’imprimerie (65 x 52) posées sur des chevalets, avec quatre ou cinq textes tirés de Tessons, grand format, sur les murs.
A l’entrée, des ensembles de cinq photos choisies par Yves et Anne-Hélène (format carte postale) avec, pour les accompagner cinq textes écrits pendant l’été, le tout installé sur cinq panneaux posés sur des chevalets. Aux murs, les tessons des hauts de casse fixés avec des « gommettes » ; un texte, grand format, au statut à définir ; et peut-être un ou deux extraits de Marges (le livre ou le site).
Seront mis en vente, à des prix raisonnables, les vingt-cinq photos et les cinq textes écrits pendant l'été, glissés dans une boîte fabriquée ad hoc, série limitée.
Ma tâche consistera donc, dans les jours qui viennent, à choisir les extraits de Tessons pour la salle du fond, ceux de Marges pour l’entrée ; à rédiger, d’ici fin août, les cinq textes qui accompagneront les cinq ensembles de cinq photos que m’enverront Anne-Hélène et Yves vendredi prochain ; et puis choisir les textes qui seront lus à Grignan.

C’est finalement à 9 heures seulement que je conduis Louise à Thierrens, les participants au camp déjeunent à l’ombre d’un tilleul. Je fais une halte au retour sur une terrasse ; à la table voisine, trois paysans boivent un café, l’un s’en va mais un autre aussitôt le remplace ; ils parlent, parce qu’ils ne peuvent pas y croire, du suicide de l’un des leurs ; ils bégaient des questions, cherchent une explication, évoquent la lourdeur de leur tâche, les paiements directs, les sautes d’humeur de la météo qui mettent sur leurs épaules une pression qu’on n’imagine pas, c’est ainsi qu’ils se serrent les coudes.
On bat le colza à Valeyres, il est vert à Chavornay comme à Saint-Cierges ; idem à Chapelle ajoute celui qui en revient ; à force, chacun sait ce qui se passe chez ses voisins et les informations vont jusqu’au bout du canton. Ils se sentent ainsi moins seuls. Lorsque je m’en vais, ils ne parlent plus du mort, l’obligation de vivre a été plus forte ; non pas qu’il soit oublié, au contraire, c’est parce qu’ils laissent au disparu le temps de chercher et de trouver sa place dans leur mémoire, ça prendra du temps. Le soleil tape fort, les trois paysans semblent tous avoir été baptisés avec leur casquette vissée sur leur tête.
Je passe le reste de la journée à rassembler quelques idées pour une préface qui me semblait une partie de plaisir ; mal m’en a pris, je ne vois toujours pas quel fil saisir, et si même il en existe un. Repars donc pour Thierrens où je fais quelques courses, Gwenaëlle est contente du travail de Louise qui y retournera demain. Je fais réchauffer en rentrant des raviolis en boîte qu’Oscar renverse lorsque j’ai le dos tourné ; on mangera une tomate, une pomme, une carotte, un morceau de fromage, quelques gnocchis et le reste du taboulé.
Un vent frais s’est levé en soirée, Lili regarde Grand Galop dans sa chambre, on fait le petit tour ; Louise et Sandra dans le sens des aiguilles d’une montre, Arthur et moi dans l’autre sens ; on parvient à les convaincre, au milieu du chemin, de revenir sur leurs pas.
Jean Prod’hom
Descends à 17 heures à Treytorrens

Cher Pierre,
Les ouvriers ont attaqué ce matin les parquets du séjour et de la salle à manger, les deux pièces s’éclaircissent soudain. L’architecte est en voyage de noces, ce n’est pas la meilleure des situations, sans compter que nous ne serons plus là pour suivre les travaux – qui ne seront pas terminés vendredi. Son assistante qui le remplace a peut-être quelque chose à démontrer ; si c’est le cas, on peut partir sans crainte.

La bibliothèque est dans un désordre tel que je décide de monter mon ordinateur dans les combles. J’envoie à la revue qui m’en a fait la demande les 12 textes que Françoise a relus ; j’informe le responsable qu’ils devraient être assez indépendants pour se partager une page, j’ajoute lâchement qu’ils peuvent même être réduits à 11, 10, 9,… 2, 1 et même zéro.
Louise a besoin d’un pique-nique pour demain, elle va passer la journée avec Gwenaëlle à Thierrens ; on se rend à la COOP d’Oron, Lili nous accompagne. J’achète du taboulé que je fais tremper et refroidir dans un mélange de tomates, d’huile d’olive, d’oignons, d’un peu de citron. Qu’on mange sous le hêtre à midi, c’est tout à fait convenable.
Arthur descend en début d’après-midi à vélo pour le lac, Sandra rédige dans le garage les commentaires de son livre de physique, Lili et Louise qui se sont affairées en silence dans leur chambre la convainquent d’aller à Bellerive. Quant à moi, je peine à reprendre la chantepleure là où je l’ai laissée hier, empaquète les 100 affichettes et les 300 cartons qu’il me faut envoyer à Grignan avant la fin de semaine. Descends à 17 heures à Treytorrens retrouver Anne-Hélène et Yves, on prend quelques décisions importantes dont il faut que je parle à Christine dès demain.
Jean Prod’hom
Chantepleure

Cher Pierre,
La canicule n’a pas desserré les dents, je m’efforce de passer entre les gouttes, le matin à l’ouest dans la bibliothèque, l’après-midi à l’est dans le jardin.

J’en ai terminé hier avec l’année scolaire 2014-2015, je reprends ce matin les 12 textes que je suis allé rechercher, il y a un mois, dans la fosse à bitume ; ils attendaient bien sagement, certains depuis plusieurs années ; il ne m’a pas été trop difficile de retrouver ce qui s’y jouait et de leur redonner ici et là un peu de la lumière et de l’ombre que je croyais y avoir mis. Françoise a accepté d’y jeter un coup d’oeil avant que je les fasse parvenir au responsable de la revue qui m’a contacté.
M’attelle ensuite à la seconde tâche que j’aimerais mettre en boîte avant de partir en famille, vendredi, pour l’Île d’Yeu. Elle me conduit à une représentation datant du premier quart du XIVème siècle, on y voit un jardin qui chante ; il pourrait être celui d’Anne de Graville et Pierre de Balsac dans l’Aveyron, encadré par deux rangées d’arbres ; la main de la fortune tient une chantepleure qui répand son contenu sur les plantations. On peut lire la devise suivante : Musas natura, lacrymas fortuna, qu’on pourrait traduire par : Les arts, naturellement, mais pas sans larmes, ça ne m’avance guère.
L’auteur de l’article – wiktionary – sur chantepleure renvoie au texte de l’évangile de Matthieu qui remet un peu de jeu et d’asymétrie dans cette affaire : Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer : Je ne connais point cet homme. Et aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole de Jésus, qui lui avait dit : Avant que le coq ait chanté, tu me renieras trois fois. Et, étant sorti, il pleura amèrement.
J’ai encore bien à faire mais je m’arrête là ; on part en famille à Froideville nous doucher et manger.
Jean Prod’hom
Incorrigiblement tourné vers le bonheur

Cher Pierre,
La canicule a ceci de bon qu’elle oblige à nous coucher tard et à nous réveiller tôt, si bien que les jours s’allongent sans qu’on le veuille vraiment. Je rédige, sitôt levé, le compte-rendu de la course de trial qui a eu lieu le week-end passé sur les rives du lac de Zurich, en utilisant les notes que m’a fait parvenir Jean-Daniel ; redistribue ce qui s’est entassé depuis quelques semaines dans la bibliothèque, bois un café. Anne-Hélène me téléphone, elle est mal en point, c’est le soleil, on se verra lundi prochain seulement, à 5 heures au Bugnon.

J’en profite pour descendre au milieu de la matinée à la mine, mettre un peu d’ordre dans mes affaires, vider quelques armoires, en extraire ce qui ira à la benne ; l’idée est simple, quitter dans deux ans ma charmante prison les mains dans les poches, discrètement, léger, avec un stylo peut-être, et le livre que je serai en train de lire ; j’ai du travail, certaines armoires sont encore pleines de choses dont j’ai à me séparer.
Je mets à la poubelle des rouleaux de scotch, une cargaison de trombones que je n’utilise plus depuis des années, des boîtes de punaises dont plus personne ne voit l’emploi ; je récupère, à l’inverse, un paquet d’élastiques que j’ai gardé au fond d’un tiroir, au cas où, qui me serviront à maintenir roulées les affichettes de Grignan que je compte distribuer ici ou là.
Je place dans une boîte l’indispensable : un tube de colle, une paire de ciseaux, une agrafeuse, un taille-crayon, une machine à calculer, une équerre que jutilise en début d’année, quelques stylos et quelques crayons ; en déplace une autre qui contient quelques objets que je n’ai guère utilisés mais qui ne m’ont jamais lâché. Ils ont été comme des promesses, ou des idées régulatrices : deux clochettes qui tintent à un demi-ton près, un cadenas avec sa clé, cinq dés à jouer taillés dans de l’épicéa, un sablier.
Je réunis en haut d’une étagère une poignée de livres que je souhaite ouvrir une dernière fois dans le cadre scolaire ; il y a Claude Gueux, Un peu plus loin sur la droite de Fred Vargas, Derborence, quelques Maigret, le Christophe Colomb de Jules Verne, le Pourquoi tu veux que ça rime d'Odile Cornuz, Le Grand Meaulnes, le Double assasinat dans la rue Morgue, Le Crispougne de Daniel Thibon, De ma lucarne et Contre l'oubli d'Henri Calet, le C.V. de Dieu de Jean-Louis Fournier, Je ne veux plus aller à l'école de Claude Klotz. D’autres, je le crains, les rejoindront au cours de l’été.
Il est quatre heures lorsque je quitte la classe, m’arrête à la Dubarde, y dépose le livret scolaire de S. qui n’est pas à la maison. Raymond m’invite à boire un verre de rosé ; on parle de la mine des Roches, des travaux qu’il y a réalisés, de ses petits-enfants, de l’abbaye qui se déroule au Châtaignier, de l’école, de l’ancienne laiterie.
il est un peu plus de 18 heures lorsque j’arrive au Riau, on mange un peu de fromage, quelques abricots, des fraises. Je relis avant de me coucher les très belles pages que Jean-Christophe Bailly consacre aux jardins ouvriers dans Le Dépaysement. Admirable écriture, celle d’un homme incorrigiblement tourné vers le bonheur.
Jean Prod’hom
Tom Blaser cartonne à Zurich !

La délégation du TCPM sur les rives du lac de Zurich avec leurs entraîneurs : René Meyer et Jean-Daniel Savary.
Dans la course du samedi 27 juin, à Stäfa sur la rive droite du lac, Tom est en effet devenu Champion suisse des 20 pouces, au terme d’une course menée avec intelligence – il le fallait puisque le second n’est qu’à un seul point du vainqueur. Loïc Rogivue termine, lui, à une belle 5ème place.
Non content de son triomphe de la veille, Tom a réitéré ses exploits le dimanche 28, sur la rive gauche du lac cette fois, à Wangen dans le canton de Schwytz : il termine en effet sur la seconde marche du podium, à deux points seulement du vainqueur. Steve Jordan a obtenu une excellente 4ème place. Notons encore que la couronne de Tom Blaser le qualifie d’office pour les Championnats d’Europe et du Monde.

Tom Blaser dans ses oeuvres.
D’autres membres du club ont brillé sur les rives du lac de Zurich puisque, on l’a dit, s’y déroulaient parallèlement aux Championnats suisses, les 4ème et 5ème manches de la Velo-Trial Swiss-Cup.
A Stäfa, le TCPM fait coup double chez les Poussins : Jules Morard (1er) et Théo Benosmane (2ème) n’ont laissé que des miettes à leurs adversaires. Camille et Romain Girardin continuent leur apprentissage et se retrouvent aux 7ème et 11ème places. Même figure chez les Benjamins où Kouzma Rehacek (1er) et Michaël Repond (3ème) squattent le podium. On retrouve un peu plus loin Mathieu Habegger 6ème) et Thomas Girardin (8ème). Chez les Minimes, Théo Grin termine à la 10ème place. Loïc Rogivue (2ème) n’en finit pas de nous surprendre cette saison, il semble avoir trouvé ses marques dans la catégorie des Juniors et ne quitte plus le podium. Le travail des entraîneurs porte ses fruits, l’avenir du club est assuré.
Les pilotes n’ont guère eu le temps de se reposer ou de fêter leur succès, il leur a fallu passer de l’autre côté du lac à Rapperwil et rejoindre Wangen. Théo Benosmane (1er) monte pour la première fois sur la plus haute marche du podium, ses entraîneurs attendaient cette première victoire depuis quelques semaines, c’est fait ; Jules (4ème) l’applaudit. Camille et et Roman terminent respectivement aux 14ème et 15ème places. Michael (3e) et Kouzma (4ème), les deux vainqueurs de la veille chez les Benjamins, ont appris à Wangen qu’il convient parfois de se contenter des seconds rôles ; Thomas termine à la 9ème place, même place pour Théo Grin chez les Minimes. Quant à Loïc, on l’a dit, il n’est pas décidé à redescendre du podium, il termine troisième chez les Juniors.



Kouzma Rehacek et Michaël Repond, Tom Blaser, Jules Morard (1er) et Théo Benosmane.
Grand week-end donc pour le Trial Club Passepartout de Moudon, si chaud que la journée s’est terminée dans le lac, sauts et plongeons ; chacun a pu y noyer ses regrets ou y arroser ses succès.
Jean Prod’hom
Travaille, creuse, orpaille

Cher Pierre,
L’engagement des élèves et l’écureuil qui sommeille en chacun d’eux auront eu raison de mes prévisions ; on ramène le pactole de Naples. J’écris un mot aux parents, y joins des photos de classe et la somme qui leur revient. A eux la répartition de celle-ci selon leur conception de la justice distributive.

Il y a le feu dans l’aula et aucun air ne s’invite par les portes grand ouvertes, chacun agite son éventail ou le programme ; belle cérémonie cependant, avec deux points d’orgue : la lecture faite par le directeur de Tu es plus belle que le ciel et la mer. Je ne suis pas loin de penser avec Cendrars qu’il faut parfois dégager. Et c’est en souriant que je remets à chacun de ceux que j’ai accompagnés depuis trois ans le viatique qui les rend à la liberté. Va-t’en ! Regarde mais surtout dégage !
II y a l’air il y a le vent
Les montagnes l’eau le ciel la terre
Les enfants les animaux
Les plantes et le charbon de terre
Travaille, creuse, orpaille ; fais ton pain, mais surtout fais ton lit et dégage ! Quitte ce maître dont tu ne tireras rien ! File ! Il y a tant de choses en-dehors des murs de cette prison, regarde, descends dans le puis, monte sur les cimes.
Et puis, second point d’orgue de cette cérémonie, le coup double de Samuel qui reçoit son certificat, mais aussi le prix que le conseil de classe a décidé de lui remettre pour l’ensemble de son parcours.
Les civilités ne sont pas mon fort, je n’y coupe pourtant pas. On se retrouve tous, enseignants, élèves et parents dans la cour devant le réfectoire, on parle de certaines choses, on en tait d’autres, on sourit parfois.

Madeline a essayé de m’atteindre depuis quelques jours par téléphone, sans succès ; elle décide de faire un saut au Riau. On passe un délicieux moment sous le foyard et le chêne qui mélangent leurs branches au fond du jardin. On parle de maman, de leur cercle de lecture, de quelques livres. On prend rendez vous pour le 24 septembre ; je rejoindrai leur groupe à Peney, dans la fermette que Madeleine occupe en été depuis 1969, seule depuis que son mari est décédé. Je me réjouis.
Jean Prod’hom
Sois un peu fou mais ne perds pas de vue la raison

Cher Pierre,
Lorsque je remonte ce matin au Riau pour mettre la main sur les photos que je ne retrouve plus au Mont, les échafaudages de la maison ont été escamotés et le pignon a fière allure ; Sandra a fait du bon travail, c’est elle qui a choisi et pris les décisions qu’il fallait prendre.

Je la retrouve toute pimpante devant la salle de la Douane à Moudon où se déroulent les promotions, le mousse en finit aujourd’hui avec l’école obligatoire. Cette officialité n’intéresse ni Lili ni Louise qui font bande à part : elles ont préféré participer au cortège de leur école à Mézières.
J’ai trouvé ces derniers jours le mousse lumineux, sur le point d’accepter pour toujours que sa tête repose sur ses propres épaules. On va manger à Servion pour fêter l’événement, il boit une bière et un verre de vin, mange comme un ogre, rempli de sollicitude pour Louise et Lili qui le regardent avec une mystérieuse admiration.
Sandra, avant de rentrer au Riau, le conduit à Peney où une fête est organisée ; nous ne le reverrons certainement pas avant demain. Je m’inquiète un peu, bien conscient pourtant de la nature de ce double bind : vouloir que notre fils soit assez prudent pour ne pas succomber à la folie des groupes et à leurs égarements. Souhaiter tout de même qu’il se montre ouvert aux aventures qui se présenteront et lui permettront de goûter à l’inédit. Sois un peu fou mais ne perds pas de vue la raison, j’entends la double injonction par laquelle chacun de nous est invité à réaliser l’impossible.
Louise prend goût à la vie de sauvage, déroule un sac de couchage dans le jardin, elle s’y glisse pour la nuit ; Lili dort dans sa chambre, comme un ange.
Jean Prod’hom
Le train ne nous attendra pas

Cher Pierre,
On a déjeuné et fait les rangements, Micheline est très émue lorsqu’on s’en va, Bernard aussi mais il ne le montre pas ; on descend sur le macadam avant de trouver le sentier qui longe la Baumine. Il faut se hâter, le train ne nous attendra pas.

C’est le père d’une élève qui me ramène au Mont où je travaille d’arrache-pied tout l’après-midi. Les comptabilités des camps à Naples et dans le Jura sont prêtes à 5 heures, je repars pour Baulmes et les Combettes. Mais le berger et la bergère ne sont pas rentrés de Bioley-Magnoux où ils ont pirouetté et engrangé, avec leur fils, des balles de foin.
Je laisse un mot et une boite de chocolats sur la table en-bas des escaliers, Cannelle aboie ; Micheline et Bernard me font penser à Philémon et Baucis. Fais une halte chez A qui habite cette petite ville du pied du Jura, on y vivrait bien. Je rentre ensuite au Riau, les cartons d’invitation de Grignan sont arrivés. Yves et Anne-Hélène m’attendent au Bugnon samedi matin.
Jean Prod’hom
Les dessus de Baulmes

Cher Pierre,
La canicule s’est installée en plaine ; elle menace en altitude celui qui n’aurait pas pris les devants en aménageant, sous un sapin blanc ou un épicéa, un abri de fortune. Certains jours le soleil est trop fort, seules l’eau des ruisseaux et l’ombre des bois résistent.

Je remonte en surface à 5 heures 30, la nuit venue des montagnes par la fenêtre grand ouverte m’a lavé ; je laisse la dureté du plancher et la paillasse vide, salue les veaux qui me suivent jusqu’à l’angle de l’enclos ; je continue seul sur le chemin qui monte en pente douce de l’autre côté de la combe, avant de faire une conversion et de m’offrir d’un coup l’horizon, de Rorschach à la pointe d’Yvoire, avec derrière les Préalpes et les Alpes qui font cause commune, ne laissant à l’oeil que le tracé d’une découpe à laquelle le manque de périodicité donne son charme et qui nous ressemble.
A mes pieds, à la lisière où je m’assieds, des scabieuses et des centaurées, quelques fraises et des campanules,
Le pays de Vaud est en morceaux carrés ou rectangles, couleur de terre, vert tendre, seigle ou orge, immobilisés par le remaniement parcellaire mais que les longues courbes d’anciens tracés ressuscitent.
Les roulottes des jeunesses du canton font du pointillisme entre Valeyres-sous-Rances et Orbe, c’est dès mercredi le giron du nord. Les bois dérobent à l’oeil les ravins creusés par les rivières qui descendent du Jura avec leur secret. Témoins de ce qu’on a oublié, des haies, des sections de haie, des bosquets, des arbres solitaires. Je vous détrompe, ce n’est pas une carte postale, on est dedans.
Belle fin de matinée avec Joël qui nous fait voir les géants dont il est le gardien, sapins blancs et épicéas, foyards. Il nous raconte ce qu’on voit pour la première fois ; on reviendra pour voir ce qu’on n’avait jamais vu.
Jean Prod’hom
La Combette

Cher Pierre,
Dernière mission cette année, faire voir aux petits de 9ème l’existence, même lointaine, d’une possibilité, celle de vivre à 1200 mètres d’altitude, dans un chalet d’alpage, sans réseau et sans électricité, presque nus, avec des lapins, un chien, des veaux, des génisses et des bergers.

Les ornières du chemin que l’on suit de Trois-Villes à l’alpage des Naz n’ont pas eu le loisir de se faire un lit très profond, peu de circulation ; mais des fraises sur le talus, chaudes et douces comme un baiser, pas assez nombreuses cependant pour remplir le creux de la main et combler nos gourmandises.
Il nous faudra deux grosses heures de marche et un pique-nique, chacun cherche un peu d’ombre, pour croiser le premier troupeau de vaches.
Micheline et Bernard, qui font la saison à l’alpage de la Combette, nous accueillent avec un grand sourire ; du monde ils n’en voient guère depuis un mois. Leur fils a repris le domaine de Bioley-Magnoux, à lui maintenant de faire ses expériences à l’abri du regard des aïeux. Et puis ça fait des lustres que Micheline et Bernard souhaitent vivre au rythme des bergers et des bergères. La bergère a placardé un mot de bienvenue et placé, à son pied, une gerbera dans une bouteille, souvenir du mariage de son fils.
La pauvreté des moyens, l’étendue des pâturages et du ciel, la gentillesse de nos hôtes, les heures qui zigzaguent en tous sens, les portes qu’on ne ferme pas, la rareté des règles, le désir des hommes et des bêtes de persévérer, tout concourt à plonger les gamins dans une espèce d’euphorie qui les conduit à concevoir des jeux sans queue ni tête, des courses sans vainqueurs ni vaincus, et on se plaît à imaginer l’un d’eux lisant Alice au pays des merveilles, tandis qu’un ballon roulerait en bas la montagne, que des voix traverseraient la combette et que des friandises tomberaient du ciel.
Sandra nous livre les provisions et les sacs de couchage au milieu de l’après-midi, Joël vient aux nouvelles. Un chamois broute au-dessus du chemin qui mène à la Côtelette, on boit un verre. Le soleil finit par descendre derrière l’Aiguillon mais traîne de l’autre côté, et claire les sapins tout en-haut de l’arête qui conduit au Suchet, d’où, lorsque la nuit se sera établie, la lune se lèvera.
Les enfants auront cessé, je l’espère, de s’accrocher au jour et le tintinebulement des cloches, tantôt ici tantôt là, rappelleront la présence invisible de ce qui ne se dit pas, auquel nous faisons tous une énigmatique et mystérieuse confiance.
Jean Prod’hom
L'UBS Kids Cup

Cher Pierre,
Impossible de rester sous les couettes, par solidarité peut-être ; en effet, Sandra et Louise sont en route depuis 7 heures déjà, elles sont allées à Oron donner un coup de main aux organisateurs de la finale vaudoise de l’UBS Kids Cup. Je me lève donc, allégé de Naples, délesté du poids des responsabilités, comme reposé. Restent cependant quelques tâches qui me rebutent et dont il indispensable que je me débarrasse méthodiquement. Je m’y attelle. Je termine aussi la rédaction des notes laissées en plan hier, fais mon sac pour Baulmes. J'ai reçu hier les affichettes pour Grignan, sans les cartons, j’envoie quelques mails.

Le soleil tombe de haut à Oron, mais tout droit et brûlant, je m'en veux de ne pas avoir pensé à un couvre-chef. Lili participe à cette finale sans grand entrain, réjouie toutefois de remettre un bouquet de fleurs à Léa Sprunger, un peu moins certainement de serrer la main de notre ramoneur, syndic d'Oron, celui à qui j'avais téléphoné il y a quelques années, effrayé par le feu qui sortait de notre cheminée, et qui m’avait répondu : Pas de risque, laissez-le brûler !
Llil s'échauffe sous la direction de Léa Sprunger, puis saute, lance et court, le plus loin et le plus vite possible. Je rentre au Riau lorsqu’elle en a terminé, tandis que Sandra et Louise terminent ce qu'elles ont commencé : la première note les résultat que la seconde lui transmet après avoir mesuré la longueur des sauts de chaque concurrent.
Lucette et Michel nous ont invités à mettre les pieds sous la table, ce n'est pas de refus. Si cette fin d’année nous a mis sur les genoux, elle ne nous a cependant pas coupé l’appétit.
Jean Prod’hom
Tout se sera passé au mieux

Cher Pierre,
La ville se réveille à peine lorsque nous rejoignons, à 6 heures, la place Garibaldi ; l’Alibus nous emmène à Capodichino. L’embarquement se fait sans douleur, je traverse le ciel avec les élèves à tribord et la mer à babord, les gamins s’endorment, tout se sera passé au mieux.

Avant de quitter François et Sylviane qui m’ont fait l’amitié de nous accompagner, – et combien le métier du premier m’aura été précieux –, six élèves chantent des remerciements improvisés entre Genève et Morges. Comment ne pas fondre ?

Je remonte au Riau, Sandra et les enfants ont le sourire, la journée balade-galop a ravi les filles. Sandra a dû montrer à l’architecte qui était le maître-d’oeuvre ; quant à Arthur, il me raconte qu’il est rentré l’autre jour d’Ogens au petit matin, avec son copain de Ropraz, à pied ; il leur aura fallu près de quatre heures. Comment ne pas fondre une seconde fois
Je vais faire une sieste au milieu des gravats, avant de mettre à jour les maigres notes que j’ai prises lors de ce séjour à Naples. Attachées à un mail que m’envoie Claude, la couverture et la quatrième, tout est prêt, l'impression va démarrer sous peu, les exemplaires seront prêts pour Grignan.
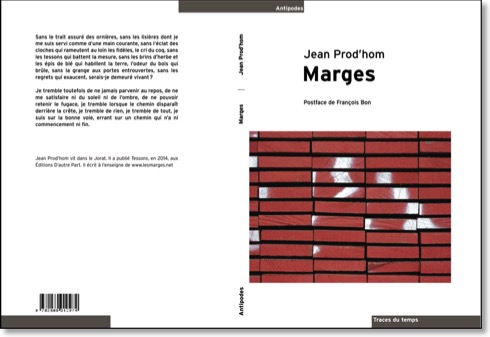
Jean Prod’hom
Largo Banchi Nuovi

Cher Pierre,
Le métro sort de terre après avoir passé le Pausilippe, la mer apparaît alors entre les HLM, parfois le cap Misène et le vieux bourg de Procida, le sommet des collines d’Ischia. Toujours le bleu du ciel. Pouzzoles ne ressemble à rien, on monte jusqu'à la Solfatare ; la Grande Bocca expire des exhalaisons qui indisposent les plus délicats, le grand bourbier est vide de fange ; des portes des étuves du purgatoire et de l'enfer s'échappe le souffle du diable. Un guide de Pouzzoles, croisé au guichet du site, ne croit guère au plan d’évacuation, mais il ajoute qu’il ne vivrait pour rien au monde dans nos montagnes.

L'épicière qui fournit la buvette me propose un pannino à la carte, un bello pannino, bello ma non a balla, ajoute-t-elle. Il a en effet belle allure mais pas que, j’en témoigne. On rentre en ville par le même chemin.
Le musée archéologique est fidèle à lui-même, comme les Napolitains : les fenêtres sont restées ouvertes, les gardiens n’ont pas quitté le fauteuil dans lequel ils somnolaient il y a une année; seuls les deux athlètes de la maison des papyrus ont fait faux bond, ils sont à Milan ou à Vancouver. Les gamins traversent les salles au pas de charge, s’étonnent au passage de la taille des abacules ; les peintures de Pompéi laissent ce sentiment étrange que, si les hommes du 1er siècle représentaient et se représentaient les choses un peu comme nous, ils le faisaient avec une profondeur un peu différente, moins technique, moins raisonnable, moins systématique, donnant aux choses et aux êtres un corps, une peau, une vie que nos calculs et nos chambres obscures ont raboté.
Les gamins vont faire quelques achats, je retrouve un peu de liberté. Piazza Bellini, une trentaine de personnes tournent une scène d’une comédie intitulée Vita cuore battito. Une heure de cris, de regards noirs, de discussions, de reproches, pour la mise en boîte d’une quinzaine de secondes ; pas de place pour le hasard et les circonstances dans ce cinéma-là ; on se réjouit de son autre orientation, car au fond le cinéma c'est ça, disait Godard, il suffit de filmer des gens libres.
A Santa Chiara, Michèle épouse Francesco ; j’assiste à la cérémonie avec, à mes côtés, Ludovico da Casoria, mathématicien et physicien, préoccupé par la pauvreté, créateur de revues, de congrégations, béatifié en 1993, sanctifié l'année dernière ; à bien regarder son visage, je comprends pourquoi certains ont tout donné pour le suivre.
Sur la place Bellini, ça s’agite encore, mais l’équipe n’a pas avancé d'un pouce ; je les quitte fatigué, fatigué à l’idée de ce qu’il leur reste à faire, sans même oser imaginer quoi et pourquoi. L'écriture a ceci de particulier qu'elle n'use de rien ; tout est si lourd en dehors d'elle, hormis marcher. L’atelier des deux frères Lebro est fermé, leurs voisins de palier me confient qu’ils ont bien vieilli.
Des élèves ont réservé des tables au sud de Santa Chiara, pour un repas qui conclut leurs onze ans d’école obligatoire. En remontant à l’hôtel, nous nous arrêtons sur le Largo Banchi Nuovi pour une fête imprévue, rythmée par des voix, une guitare, des castagnettes et des tambourins. On regroupe les sacs à dos dans un coin de la place, les gamins se lancent à l’eau, accueillis à bras ouvert par les Napolitains ; danser la tarentelle, ils ne pouvaient espérer meilleure fin.
Jean Prod’hom














Procida

Cher Pierre,
Diane à 6 heures 30, déjeuner, métro ; embarquement à Beverello ; on longe le golfe de Naples jusqu’au cap Misène avant de lâcher le continent et mettre le pied, à deux pas seulement, sur l’île de Procida.


On monte par petits groupes au sommet du bourg médiéval ; visite de l’abbaye de Saint-Michel l’Archange, lequel a sauvé l’île des Sarrasins : une dizaine d’ex-votos sont accrochés dans le couloir qui mène à la salle de la confrérie ; on s’installe dans les stalles de bois vernis, embellies par les ans ; de vieux cercueils ont échoué dans la pièce ; on aperçoit d’autres barques par la fenêtre ouverte, avec le bleu de la mer qui se confond avec celui du ciel, une rumeur. Les Bénédictins avaient décidément bon goût.


C’est dans le petit port de pêche de Corricella, blanchi par le soleil, retouché par les couleurs pastel des barques qu’on mange. Baignade ensuite sur la plage qui jouxte le port, la Chiaia, ambiance bon enfant, je ramasse quelques tessons, les gamins m’en amènent, Samuel m’en offre une poignée.
On retrouve en soirée au Gambrinus notre guide pour une visite extraordinaire des citernes et des cuniculi creusés sous les quartiers espagnols, aqueduc assurant la distribution de l’eau jusqu’à l’extrémité de la baie, aux locataires des palais du centre comme à la soldatesque rangée à Misène.
Ces galeries remplies d’eau, dont le tuf récupéré a permis d’ajouter de étages aux immeubles et aux palais, cloaques dès la fin du XIXème siècle, ont été réaffectées pendant la seconde guerre mondiale. Abris anti-aériens où se réfugiaient les Napolitains, que les Américains ont arrosés de bombes jusqu’en automne 1943.
Il est plus de minuit lorsqu’on sort du souterrain, les Napolitains n’ont pas sommeil, ils sont nombreux à prolonger la journée.
Sur le Corso Umberto I, ce ne sont pas des érables qui rythment la longue avenue, mais des grappes de jeunes filles en fleurs qui tentent de boucler leur fin de mois ; elles se retirent au passage des gamins qu’on ; ce n’est pas, semblent-elles dire, misère de misère, un travail à faire. Je crains que leur corps et leur visage ne vieillissent trop vite.
Jean Prod’hom


San Gennaro

Cher Pierre,
Une dame passe une serpillère dans la chapelle de San Gennaro ; plus tard, dit-elle, revenez plus tard. Mais nous ne verrons pas les ampoules du sang du saint, l’ostensoir qui les contient est bien caché à l’arrière de l’autel, il faudra revenir le 19 septembre, ou à Noël, ou à la mi-mai.

C’est à un autre miracle que nous sommes conviés, un prêtre se glisse en effet dans la crypte de San Gennaro ; je m’empresse de le suivre avec les 8 gamins qui m’accompagnent ce matin.
Une dizaine de fidèles sont là, dix grosses minutes vont suffire, tout y est : pénitence et absolution, lectures de l’ancien et du nouveau testament, alléluia ; assis, debout, assis, à genoux, debout ; les quelques mots d’explication du prêtre n’entament pourtant pas le mystère ; prière pour les affligés, les Napolitains, les hommes du monde entier ; sanctus sanctus, consécration du pain et du vin, voici mon corps, voici mon sang, tempête et transsubstantiation. Souvenez-vous du jeudi saint, des morts et des vivants, intercédez pour les âmes du purgatoire, offrez-nous vos grâces, vous qui avez associé à la passion de votre fils l’évêque et martyr de Bénévent. Le prêtre rompt alors le pain, communion et bénédiction, avant de nous envoyer paître : allez en mission. Personne n’a rien vu venir, le miracle a eu lieu, bien plus difficile certainement à réaliser que la liquéfaction du sang de San Gennaro.
On a pris un peu de retard, nul ne saurait dire sur quoi ; longue halte pourtant à la chapelle de Sansevero, le Christ de Sammartino respire sous son suaire de marbre ; alternance des perceptions, hallucinations : est-ce le suaire qui frémit ou le corps dessous qui respire, ce ne saurait être les deux ensemble.

On se retrouve tous au marché de la Pignasecca, sous Montesanto, avant de prendre le métro linea 1 pour la gare centrale ; la Vesuviana nous conduit jusqu’à Sorrente où l’on passe l’après-midi dans la mer, dans un petit pré carré que les privés ont bien voulu laisser à ceux qui pensent que la terre, le ciel et la mer appartiennent à tout le monde. Avec de l’eau jusqu’à la taille, sans bouger, laissant à la mer le temps de faire passer un peu de sa fraîcheur au-delà de notre peau, dans ce qui pourrait bien être notre coeur.
Jean Prod’hom
Le Vésuve mousse du jaune des genêts

Cher Pierre,
Les Napolitains se satisfont d’une informatique de la première heure ; ainsi les 112 billets que je commande ce matin au guichet de la gare Giuseppe Garibaldi sortent un à un du capot d’une imprimante, que l'employé soulève de temps en temps pour souffler sur le ruban ; il me faudra une bonne heure pour les obtenir. Ces manières de faire ne rebutent pas ce peuple d’artisans, de maçons, d’épiciers, ce peuple de marchands de tripes et de fripes ; ça leur réussit même assez bien, à preuve le train de 10 heures 11 pour Sorrente, bourré jusqu’à la gueule.

On descend de la Vesuviana à Ercolano scavi. Ici, ce n'est pas comme dans le centre historique de Naples, les morceaux d'histoire ne s'empilent pas, ni ne se plissent, ils ne se chevauchent pas non plus ; à Herculanum, les ruines anciennes côtoient les ruines du jour, bord à bord ; impossible de concevoir les unes sans les autres. On s’étonne alors de la passion excessive des hommes pour les premières et de leur désintérêt inexpliqué pour les secondes.
Le Vésuve mousse du jaune des genêts et du rose de fleurs cousines des adénostyles ; quelques bourses de silène rampent à la hauteur du trèfle ; au bord du chemin, des cirses et des papillons. Lorsque le Vésuve s’est mis en colère en 79, les habitants d’Herculanum ont voulu fuir, on en voit aujourd’hui quelques-uns à la devanture de leurs magasins qui donnaient autrefois sur le front de mer, squelettes figés, dégagés par une mission archéologique américaine à la fin du siècle passé de la vague de lave qui les avait submergés. C’est subitement le passé qui côtoie le présent bord à bord, et qui devient tout entier la veille.
On remonte à pied jusqu’à la gare d’Ercolano ; la Vesuviana offre quelques places assises aux plus habiles d’entre nous, soulagés de nous retrouver, après une grosse journée livrés aux ardeurs du soleil, dans le hall climatisé de notre hôtel.


Jean Prod’hom
Ecrire c’est encore marcher

Cher Pierre,
Même si écrire c’est encore marcher, j’ai bien trop battu le pavé pour avoir la force de jouer du clavier ; l’énergie dépensée à garder un oeil sur les vingt-quatre adolescents que j’accompagne cette semaine à Naples n’y est pas pour rien.

Nous avons suivi l’itinéraire proposé par trois d’entre eux, du Corso Umberto I jusqu’à Spaccanapoli, enchaîné les zigzags sur le damier du Decumanus inférieur jusqu’à la rue de Tolède, traversé les quartiers espagnols avant de prendre le funiculaire central pour le Vomero, jusqu’à la place Fuga où l’on a mangé, au Trianon la pizza simplissime des premiers temps : tomate, mozzarelle et origan.
Les plus courageux sont redescendus dans la nuit, de l’esplanade de la Chartreuse jusqu’à la rue de Tolède, dans la nuit, bris de verre et basalte de piperne. Retour à minuit, tout va trop vite, les gamins sont pressés, sans jamais lever les yeux du côté des balcons, ou les plonger dans les arrière-cours qui abritent d’extraordinaires palais antiques.
Ecrire c’est encore marcher, je m’arrête avant l’épuisement ; chacun reçoit au réveil son quota d’énergie qu’il est tenu de ménager en certaines circonstances ; il est plus d’une heure et le réveil réglé sur 6 heures ; j’aurai ainsi demain les mains libres, avant le réveil des gamins, j’achèterai les billets pour Herculanum et Sorrente, boirai un café sur une terrasse tandis que le jour se mettra en place.Toujours la même leçon, compter sur ces propres forces.
J’apprends qu’un incendie s’est déclaré dans la gare de de Lausanne en début d’après-midi, immobilisant tous les trains, peu après que le nôtre nous emmène à l’aéroport de Cointrin. On a passé à côté du situation fâcheuse, très fâcheuse, mais du bon côté.



Jean Prod’hom
La Chartreuse de San Martino

Cher Pierre,
Nous sortirons à 16 heures du hall central de Naples-Capodichino, une bouffée de chaleur incompressible nous fera suffoquer; la lumière blanche, poudreuse, d’un seul tenant nous aveuglera. Certains voudront certainement rebrousser chemin, trop tard ; l’Alibus jusqu’à la piazza Garibaldi les raisonnera. Chacun tirera sa valise sur le corso Umberto I, un peu étonné, de la circulation, du bruit, du désordre apparent, jusqu’au numéro 377, à côté du bar Louis. Nous déposerons nos valises dans nos chambres avant de rejoindre un peu plus tard la Forcella ; on suivra la saignée jusqu’à la place Gesù Nuovo. Le funiculaire nous conduira sur l’esplanade de la Chartreuse de San Martino, on verra le damier des toits de la ville et l’insensée partie de ses habitants, la mer et tout le bassin méditerranéen, d’Athènes et Jérusalem déjà dans la nuit. On verra après.

J’ai traversé en fin de matinée le Gros-de-Vaud, jusqu’à Orbe où j’ai longuement cherché une place de parc et acheté un gâteau à la crème chez Guignard ; j’ai mangé à Chavornay, chez un collège qui quitte l’établissement scolaire du Mont-sur-Lausanne, avec des collègues qui y restent. Nous sommes allés nous doucher en famille à Froideville, puis mangé à Servion ; j’ai fait ma valise en rentrant.
Dominique de Rivaz m’avait parlé, lorsqu’on s’est rencontrés il y a quelques jours – c’était la première fois – d’un ouvrage de Giulia Enders paru chez Actes Sud, Le Charme discret de l’intestin ; c’est un des deux coups de coeur de la chronique qu’elle tient dans le Nouvelliste ; l’autre me réjouit tout particulièrement, elle écrit : petits morceaux de céramique digérés puis rendus par la mer..., à glisser dans sa poche et son coeur.
Bel été à toi, Dominique. Et à toi, Pierre.
Jean Prod’hom
Môtiers 2015

Cher Pierre,
Louise a été réquisitionnée ce matin par les responsables de l’école de musique d’Oron pour présenter aux tout petits ce qu’on peut faire de ses deux mains et d’une guitare. On en profite, Sandra et moi, pour aller boire un café et lire le journal au tea-room. Louise revient enchantée, on remonte au Riau avec des croissants.

Il y a fête à Vufflens-le-Château, fête aussi à Môtiers. Sandra et les filles optent pour les dessus de Morges, moi pour les dessous de l’art en plein air et ses travers, Arthur reste à la maison.
J’emprunte la route de Peney, Bioley-Magnoux, Donneloye. Mais des travaux entre Cronay et Pomy me déroutent. Qu’importe, il fait beau. Orzens donc, Ursins, Valeyres-sur-Rances et Yverdon, puis Vuiteboeuf et Sainte-Croix. Tout s’assombrit de l’autre côté du col des Etroits, une bonne dizaine de kilomètres le long du ruisseau qui se jette dans l’Areuse. A Fleurier tout s’éclaire à nouveau, je me souviens de Buttes, je m’y étais rendu en camion à côté de Croc, dans le Saurer de chez Belet, mon père y travaillait. On disait Croc sans que je sache comment Croc s’écrivait, puisque je ne savais pas en ce temps-là que tout ce qui se dit peut s’écrire. Croc avait la mâchoire d’Erri de Luca et de mon grand-père maternel. Je devais avoir sept ou huit ans.
Rendez-vous à 14 heures 30 sous cantine, la fanfare précède les discours ; le dernier invite chacun à remonter la grande rue en cortège ; avec ses maisons basses, elle ressemble à celle du Landeron, à celle aussi de certaines petites villes du sud-ouest. Les amateurs d’art sont à l’affût, guettant les signes de l’intervention humaine, placards déchirés, ciel, images du ciel, reflets, indicateurs de direction, camion abandonné dans une gravière, poules dans un enclos dressé autour du cadavre d’une Peugeot, tombe creusée à la va-vite, Bied et lit du Bied, tertre élevé à la pelle carrée, souvenirs de Rousseau, portraits de Siciliens, quartier de poudingue transporté en hélicoptère du Lavaux, chemin vert, fers tordus, centrale électrique, tas de pierres, piquets de clôture, bois vieux et bois neufs, gamins buissonniers. Les amateurs cherchent le Graal en rangs serrés, sourient tout autant aux variétés que les artistes ont rendues visibles qu’à celle, invisible, que l’un d’eux a fait disparaître sous terre.

Je rentre, les cloches sonnent à Fleurier, il est 18 heures ; je reviens par Baulmes, Chavornay, Vuarrens et Fey. Ce samedi chez les artistes a été comme un dimanche rempli de petits dieux : marcher, s’amuser, sourire, sourire de tout, mais ne pas se moquer pour autant de l’idée de clôture, ne pas franchir le pas, circonscrire le corps étranger.
Sortir des sentiers battus, oui, mais en les suivant scrupuleusement ; ce serait folie que de prendre quelque chose du dedans pour quelque chose du dehors. Bien distinguer les vrais nains de jardin, des faux barbecues, et vice-versa. Je le sais, chacun fait toujours de son mieux. Qu’il est difficile d’écrire ce qui s’est dit avant qu’on sache que ça peut s’écrire !
Jean Prod’hom
Ce livre va donc enfin sortir

Cher Pierre,
La centralisation des données par les moyens informatiques donne aux utilisateurs de ceux-ci des garanties très relatives, si bien que je me lève à 4 heures du matin pour éviter les embouteillages sur le réseau. Ça fonctionne un bref instant, puis plus rien, je peste, finis par descendre au Mont où d’autres tâches m’attendent.

Les responsables des services informatiques ont la fâcheuse tendance à faire croire à l’usager qu’il devrait être capable de manier cet outil, lui parlent comme à un attardé, quand bien même il aurait vu juste. La pièce de cinq centimes que je trouve dans la cour du collège, sous le soleil, me renvoie au vrai mystère.
On m’a demandé, il y a quelque temps, de quitter les deux classes dont j’ai été le responsable cette année et de déposer mes valises dans une troisième. Ce transfert, pénible, me permet de jeter encore à la benne un peu de l’inutile qui me suit depuis des années, mais aussi de me réjouir du paysage qui s’offre à l’ouest, du lac au Jura, jusqu’à la Praz, en passant par Montricher et la tache blanche de la Maison de l'Ecriture. Je crois deviner Mollens, Berolle et Bière sous le soleil ; un peu plus haut Gimel et Saint-Oyens. Il me reste deux ans pour cartographier le plateau et y voir un peu plus clair.
Le conseil de classe des grands est rapidement mis en boîte, on se retrouve quelques collègues, Sandra et moi au Central. On revient sur l’échange vif de la veille, à l’occasion du conseil de classe des petits, mais un homme s’effondre à la table d’à côté, les yeux révulsés ; celle qui pourrait être sa femme semble ne pas s’inquiéter, je lui donne un coup de main pour l’étendre sur le sol, elle lui lève les jambes, ce n’est pas grave, dit-elle, ça lui arrive parfois.

Retour au collège pour des rangements, jusqu’à 15 heures 30. Romain passe la commande des cartons et des affichettes pour Grignan. Je remonte au Riau, le toit est terminé, les peintres ont avancé. Je fais cuire quelques pâtes, sors des miettes de thon et une boîte de pesto, pèle des pommes, des carottes et un concombre. On mange dehors.
Claude m’a envoyé la maquette des première et quatrième de couverture de Marges. La photo qu’il a choisie me plaît bien, les indications me concernant un peu moins, on les simplifie. Je demande à Claude d’ajouter en quatrième de couverture le nom de François Bon qui a rédigé la postface. Ce livre va donc enfin sortir.
Jean Prod’hom
Seule la loi affranchit de la loi

Cher Pierre,
Dans les institutions qui vacillent en temps de paix, les employés les plus solides restent au rez, les bras au-dessus de la tête, chargés de soutenir le plafond qui se lézarde ; les moins courageux sont à l’étage, plaisantent, discrets et légers ; les plus lâches se calfeutrent benoîtement dans les caves, les rêveurs vivent incognito dans les combles.

Quelques gardiens font tout autour des rondes, interdisant à quiconque d’entrer et de sortir ; quand aux responsables – mais en existe-t-il encore ? –, ils sont à mille lieues de la bâtisse, se congratulent à l’abri, inventent des matériaux inédits, conçoivent des contreforts, lambourdent de faux plafonds, imaginent des colles qu’ils tendent sans y entrer à ceux qui sont dedans, placent des fusibles, coordonnent ce qui ne communique plus, invoquent des mots sacrés qu’ils soulignent pour faire sésame. C’est écrit noir sur blanc, disent-ils, peu importent les raisons.
Chacun demande à l’autre de bien noter ceci ou cela, et de le faire dans les plus brefs délais, sans prendre de dispositions si la mesure demeure sans effet. Ceux du rez, du premier, des caves et des combles deviennent comptables de potions inutiles, répétées à satiété. Alors chacun en appelle aux lois, en redemande pour parer au plus pressé ; les règlements d’application grossissent et de vieilles habitudes se transsubstancient en lois, le système se durcit, personne n’ose plus imaginer une gestion différente des problèmes ou un renversement des ordres et des priorités (assiette plutôt que couvercle).

Si donc la bâtisse continue à vaciller, ce n’est pas tant en raison d’un manque législatif, mais en raison de l’indigence des interprétations de la loi. Et par un curieux paradoxe, je me suis mis à entendre cet après-midi, au coeur même de celle-ci, non seulement une musique que je ne soupçonnais pas, mais le lieu même de l’invention et la promesse de grandes manoeuvres. Seule la loi affranchit de la loi.
Jean Prod’hom
En quête d’un nom (Jean Roudaut)

Cher Pierre,
J’ai retrouvé mon chapeau, les examens sont terminés, la classe déserte, les stores baissés. Les élèves ne se sont pas tous engagés avec la ténacité et la rigueur qu’on aurait pu souhaiter, mais ils ont laissé entendre qu’ils sont armés pour quitter l’école obligatoire, tous, et s’ils le souhaitent et sont prêts à en payer le prix, continuer l’aventure, c’est-à-dire chercher, descendre dans leur propre obscurité et celle du grand puits, avec pour seules assurances l’ignorance et l’étonnement. Reste le voyage à Naples ; je suis allé faire quelques achats à Romanel avant de rentrer au Riau.

Alain Veinstein accueillait Jean Roudaut en 2008, à l’occasion de la parution d’En quête d’un nom. Je n’ai lu aucun de ses livres, je n’avais jamais entendu sa voix, c’est fait.
Une voix qui fait entendre l’inépuisable qui se déverse d’un mot à l’autre, et le silence de ce qu’ensemble ils manquent, silence, notre asile, au coeur duquel les choses reposent.
Une voix qui balbutie avec ténacité, rigueur, ce vers quoi tend l’écriture ; dans les parages du mot juste, espérant ainsi faire entendre cette autre voix, celle qui vient d’ailleurs.
Mot juste qu’on croit avoir trouvé et qui se dérobe, voix condamnée à reprendre et faire jaillir ce qui immanquablement retombe, mais qui, progressant toujours plus avant dans le neutre et l’anonyme, nous rapproche des choses, en usant précisément du langage qui nous en a écartés. Il n’aurait pas dû en aller ainsi et le poète aurait voulu, s’il en avait eu le temps, tout reprendre autrement.
Je connais depuis cet après-midi l’écriture de Jean Roudaut ; j’ai reçu en effet un gentil mot de la presqu’île de Crozon où il vit ; il a lu Tessons qu’une amie lui a offert. Ce livre sera donc allé jusque dans le Finistère, bonheur, il me reste à lire ses livres.
Jean Prod’hom
Pendant que la ferme du poète brûlait

Cher Pierre,
Pendant que la ferme du poète brûlait – et que celui-ci se réveillait nu comme un ver, vivant, comme on doit l’être –, dans sa maison à elle, l’oubli s’était installé depuis quelques mois déjà, sans fracas ; il avait entamé l’ordre précaire dans lequel chacun de nous vit, défait les piles fragiles, dispersé ce qu’elle avait cru bon laisser : tout. Son ombre faisait le ménage chaque jour mais la poussière effaçait ses traces. Dedans sa tête, quelque chose avait bougé.

Il n’y avait pas eu de tragédie, elle était bien vivante, loin du lieu où on l’attendait, avec l’essentiel dont elle semblait nous parler. Elle avait pris un peu d’avance, dans l’abandon auquel nous serons tous tôt ou tard invités, indiquant en souriant ce qu’on aurait à vivre, sans insister ni vouloir convaincre, risquant des passages inouïs entre coq et âne, non pas qu’il fût nécessaire de passer par là, ou de nous rendre dans telle ou telle direction.
Tout ceci n’a évidemment aucune importance ; la manière dont on disparaît, dont on s’efface, dont on se retire n’est pas une question prioritaire. Mais que dire lorsque quelqu’un vous fait entendre du dedans qu’une seconde vaut une éternité ? Bien sûr on n’y comprend rien, d’autant plus lorsque cette personne ajoute qu’elle est à la fois celle qui aurait pu tout perdre et celle qui a tout perdu.
Jean Prod’hom
Les Rogivue d'Oron à Tramelan

Loïc, un incontournable du TCPM
Il y a deux façons de se rendre dans le Jura bernois, par Berne et Bienne ou par Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds. Si vous choisissez le premier itinéraire vous gagnerez quelques minutes, si vous choisissez le second, vous aurez à traverser les Franches-Montagnes, c’est un enchantement : les sapins y sont comme des îles ou des archipels dans le vert sans bord des pâturages, les fermes ont de larges hanches et une façade blanchie à la chaux, les poulains ne lâchent pas d’un sabot leur mère, les auberges vous offrent leur terrasse, l’étang de Gruère sa fraîcheur. Mais sachez qu’en vous y rendant de ce pas, il faudra vous lever tôt pour être à l’heure.
Les carrières Huguelet, c’est une saignée de pierres et de terre au milieu des prés ; chaos et ruines qui auraient pu servir de décor à un James Bond de banlieue. C’est dans cet abandon que les meilleurs trialistes de Suisse se sont retrouvés pour déterminer qui auraient à tenir les premiers rôles. A ce jeu, les coureurs du TCPM se sont bien défendus.
Chez les Elites, Tom Blaser a terminé à une excellente 5ème place, Romain Bellanger plus loin, à la 12ème ; chez les Minimes, Théo Grin à la 10ème. Chez les Benjamins, Michaël Repond qui revient de blessure finit à une remarquable 4ème place, à deux points seulement du podium qui l’attend ; tout près de lui, Kouzma Rehacek (5ème) et Matthieu Habegger (6ème) prêts à jouer les premiers rôles. Chez les Poussins, Jules Morard se retrouve au pied du podium, sur lequel Théo Benosmane (2ème) monte pour la troisième fois cette saison. Bastien Perrin (6ème), son frère Maxime (9ème) et Kelian Crausaz (11ème) poursuivent leur apprentissage.
Il y a un pilote dont nous voudrions aujourd’hui souligner la performance, c’est Loïc Rogivue ; un ressortissant d’Oron qui tient cette saison les premiers rôles dans la catégorie des Juniors, il obtient une belle troisième place. La progression de Loïc, qui s’est mis au trial en 2007, à 8 ans, est constante. Loïc a fait toutes ses classes au TCPM, entraîné par René Meyer et Jean-Daniel Savary ; on ne compte plus ses podiums, il est devenu un incontournable sur le circuit, toujours prompt à donner un coup main, généreux, jamais avare de ses efforts et de son temps. Et le temps, il en a moins ; Loïc a commencé en effet un apprentissage de charpentier en automne dernier, il continue pourtant à s'entraîner deux fois par semaine, avec le sourire. Dans ces conditions, il n'est pas simple de continuer un sport à un tel niveau, il le fait. Pas seul, ses parents sont à ses côtés depuis le début, ils ont juré fidélité au club ; Martine, sa mère, s’occupe depuis quelques années de la caisse du club et Stéphane, son père, pour ne pas demeurer en reste, a fait les cours de juge et officie toute l’année sur les courses. Ce sont les Rogivue d’Oron qui assurent, avec les parents de Baulmes et de Marnand, de Belmont, d’Hermenches, de Moudon et de Palézieux, de Vulliens,... l'existence de ce club qui fait la fierté de la région. Bravo aux Rogivue !


Martine et Stéphane Rogivue
Rendez-vous dans une semaine à Wangen et à Stäfa. Les samedi et dimanche 26 et 27 juin couronneront en effet, dans les canton de Schwytz et de Zurich, non seulement les vainqueurs des quatrième et cinquième manches de la Swiss Trial Cup, mais encore les nouveaux champions suisses 2015. Et à ce jeu, nous espérons que le TCPM aura, dans la catégorie des juniors, quelques cartes à jouer...
Jean Prod’hom
Vues étroites

Cher Pierre,
J’ai pensé à vous, cet après-midi, vous l’ennemi juré...

Il est pour la propriété,
mais contre les moineaux, les chats,
les puces, les merles,
contre les corbeaux, les serpents, les adolescents,
pour les clôtures,
mais contre les rongeurs, les pigeons,
les fouines, les bébés, les cafards,
les chauves-souris,
pour les apéritifs dinatoires
mais contre les taupes, les vipères,
contre les pucerons, les hérissons, les renards,
les chiens, les vagabonds, les guêpes,
pour le respect des principes,
mais contre les lièvres, contre les rats,
les sangliers, les belettes, les foetus,
contre les hirondelles, les licornes, les colombes.
Jean Prod’hom
Logis de la Licorne à La Ferrière

Cher Pierre,
Sur le balcon du premier étage du Logis de la Licorne, à La Ferrière, le soleil fait ses œuvres à l’endroit même où la fraîcheur de la nuit s'attarde. J’aurais voulu que les choses aillent de ce pas jusqu’à l’autre bout du jour.

J’y suis encore : devant, le potager, deux chevaux, des roses, une banque, la voie de chemin de fer, des géraniums, le grincement d'une balançoire avec deux gamins dessus, un randonneur qui demande son chemin. A gauche, la cime des tilleuls du parc jouxtant la maison d'Abraham Gagnebin, un parking. Sur la bute l’église. Des voix me parviennent de la terrasse, il y est question de sécurité routière, de radars, d'enfants tués. Je dois me faire à l’idée que Rousseau a passé une semaine ici, chez Gagnebin, qu’ils sont allés herboriser dans les tourbières de la Chaux-d’Abel ; j’y parviens sans être en mesure de les suivre.
Je suis parti du Riau la veille, arrivé à La Ferrière à 21 heures, après une longue halte à Chapelle chez Ginette, avec Valérie et Charles. Seul puisqu’Arthur a décidé de renoncer aux compétitions. Et si je me rends à Tramelan, c'est parce que j’ai accepté de rédiger, une année encore, les compte-rendus des courses du trial pour les journaux locaux. Il a sonné 8 heures 30 au clocher de l'église.
Je serais bien resté encore à l’écoute des heures creuses, de ce qui reste de la nuit, de ce qui se prolonge, si l'on y regarde bien, jusqu'au soir. J’en aurais profité pour raconter cet homme ivre qui m'a confié la veille qu’une femme lui avait jeté un sort, qu’aux sorts il n'y croyait pas, mais que, au vu de ce qu’il avait dû supporter tout au long de la journée, il y croyait dur comme fer, qu’il n’avait pas pu faire autrement que de s’adresser à l’une de ces bonnes sorcières qui vivent avec le don, capables non seulement de contrer les mauvais sorts, mais encore de les renvoyer à leurs expéditeurs. Et, de prétérition en prétérition, j’aurais passé ce dimanche sur ce balcon, sans avoir à recommencer ailleurs.
Il me faut pourtant lever le camp, le patron arpente son potager, arrache quelques mauvaises herbes ; deux gamins font grincer la balançoire, ce ne sont pas les mêmes, ils parlent allemand ; la barrière de la voie de chemin de fer se baisse, je regarde revenir le train de la Chaux-de-Fonds, il est 9 heure 13.
On a l'impression parfois que chacun, chacune, chaque chose se relaient, assurant ainsi la poursuite de l’entretien infini du monde avec lui-même.
Jean Prod’hom
Roxanne

Cher Pierre,
Roxanne est aide-soignante à la Vernie, un établissement médico-social d’une soixantaine de lits, pas facile à trouver ; aux yeux des ressortissants du Jorat, Crissier et Chavannes, Prilly, Ecublens et Renens constituent en effet l’une des plus solides énigmes urbanistiques du canton de Vaud.

Deux sections au troisième étage, Emeraude et Rubis ; j’entre dans la seconde, déniche sans peine la salle commune, deux chiens sur mes talons ; je n’ai pas terminé de saluer Roxanne que F s’approche en souriant ; on fait les présentations.
Je lui propose de me faire visiter le centre ; mais arrivée en début de semaine, F n’est pas encore au top ; Roxanne me donne un coup de main en m’indiquant ce qu’il faut connaître de ce labyrinthe. Elle me refile même son badge qui nous permettra de sortir et d’entrer dans la section : je m’appellerai donc Roxanne.
La Vernie est un bâtiment datant de 2010, situé à l’emplacement de l’ancienne halle de stockage Baumgartner Papiers SA. Elle comprend, outre l’EMS qui se répartit sur deux étages, un centre d’accueil pour les écoliers, un service de psychologie, psychomotricité et logopédie, une cantine, la bibliothèque. Mais aussi un centre d’hébergement informatique sécurisé et une entreprise de fabrication et de livraison de repas.
La chambre est spacieuse, remplie de soleil, F regrette pourtant que les fenêtres ne s’ouvrent pas. Rien à accrocher non plus aux fils des cimaises, ça viendra. Elle me dit avoir bien dormi cette nuit, ça n’avait pas été le cas en début de semaine.
On monte ensuite dans la salle polyvalente du 4ème, avec une bouteille d’eau que Roxanne nous a refilée. Je m’assieds au piano et tricote à l’estime quelques arpèges, elle ne s’y trompe pas, en rit ; qu’importe, j’en ris, on boit un verre. On devrait pouvoir organiser une fête un de ces quatre, réunir les amis dont je croise l’ombre depuis quelques mois.
Sur la terrasse du premier étage, un vieil homme bronze torse nu. On s’attable un peu plus loin, nos mots vont un bout ensemble, avant de se séparer sans qu’on y attache beaucoup d’importance, on a assez à faire chacun de notre côté, fragments de pensées qui soudain se croisent à nouveau dans le gris des alentours, du côté de l’enseigne orange de la COOP Brico + loisirs ; de celle, bleue d’Athleticum.
A cause peut-être de la photo de Jojo aperçue dans sa chambre, je lui raconte ce qui me reste du repas que nous avions fait à la Tour de Trême, il y a trente ans peut-être ; elle s’en rappelle bien et précise qu’Hélène était là, que c’était son anniversaire et qu’on était rentrés à point d’heure. Un moineau échappé du parc de Cery vient nous rendre visite, elle me raconte alors une histoire de rapace, un rapace qui ne tournoie qu’un bref instant autour de nos têtes avant de filer en coup de vent du côté d’Hermenches, là où Louis engraissait des poulets et des lapins.
On remonte dans la salle commune de l’Oasis, il est midi, je remets mon badge à Roxanne ; elles me raccompagnent toutes deux à l’ascenseur. F est soudain désorientée, inquiète, sort de sa poche une feuille blanche pliée en quatre, me demande de me décider si oui ou non je lui en fournirai, qu’elle voudrait bien savoir. A tout hasard je lui assure que je lui apporterai un lot de feuilles blanches : la voilà rassurée.
Elles me tournent le dos, les portes de l’ascenseur se ferment. Il y a aujourd’hui au menu un velouté d'asperges, de l’émincé de veau à la crème, du riz Pilaf, du chou-fleur à la ciboulette et une salade d'ananas au basilic.
Jean Prod’hom
Dernière épreuve écrite aujourd’hui

Cher Pierre,
Dernière épreuve écrite aujourd’hui, mais une semaine encore d’examens ; une semaine pour dire en anglais, en allemand, en français, que quelque chose s’achève ; le mousse voit le bout, passe ses après-midis à la piscine de Moudon, en rentre réjoui ; ces examens, dit-il, c’est bien le meilleur moment de l’école obligatoire. Suivra après-demain un long été – de cet été-là, tout le monde se souvient – qui nous verra, lui et moi, passer à autre chose.

Je n’imaginais pas que mon père puisse se rendre compte alors que d’autres que lui me nourrissaient depuis longtemps déjà, que mon émancipation n’était pas de la veille et que j’étais bien loin de l’image qu’il se faisait de moi.
Il devinait pourtant, peut-être, ce que j’ignorais encore, que je m’étais déjà brûlé les ailes, plus d’une fois, et que ces épisodes n’avaient refroidi ni mes ardeurs ni mon envie de prendre de la hauteur. Il avait saisi, je crois, qu’il n’était plus temps de discuter mais d’accepter. Il m’avait fait confiance en silence, comme je devais le faire désormais.
Il aura fallu du temps pour que je comprenne cette chose toute simple qui assure la succession des générations : le mousse est devenu le capitaine d’une embarcation qui n’est pas la sienne, qu’il a retapée loin des regards, sans piper mot, une embarcation qui ne lui préexistait pas ; d’autres que moi l’ont aidé à la mettre à l’eau. Nous sommes deux aujourd’hui à n’avoir rien vu venir : mon père et moi.
Jean Prod’hom
Sans les douze coups de midi

Cher Pierre,
Sans les douze coups de midi, sans l’orage, sans l’épi, sans les sortilèges, nos journées ne ressembleraient à rien. Je suis à l’affût de ce qui se glisse entre deux battements de coeur, une aile de papillon, la mèche d’une chandelle, une grimace, la feuille d’un érable, la tourbe, tout ce qui exerce son empire bien au-delà du visible, l’ordinaire et l’imprévu, c’est à-dire tout et n’importe quoi.
Une journée pour reconnaître que ce n’est pas rien, un bout du soir pour lui donner une allure, en le taillant comme un crayon dont on se serait servi pour dessiner les circonstances qui l’ont vu naître, dégager du désordre l’une ou l’autre des pièces de cette partie sans fin et sans bord, qu’on reprend chaque jour, de l’aube au crépuscule : rassembler ainsi les blés coupés.

Jean Prod’hom
Eurêka

Cher Pierre,
Les réponses, que les institutions de formation attendent de chacun d’entre nous, permettent à ceux qui ne s’y arrêtent pas d’observer les effets qu’elles produisent chez ceux qui sont portés à y croire et s’en satisfont. On voit ceux-ci se détourner, fermer les yeux de contentement, heureux de s’être débarrassés enfin de ce dont ils auraient pu, – c’est ce qu’ils croient –, volontiers se passer, persuadés que les solutions constituent une fin en soi, la liquidation d’inutiles obstacles que des fâcheux auraient placés sur leur chemin, libres désormais de prendre du bon temps dans une annexe conçue expressément pour eux : jeux, délassements, loisirs, distractions : à l’abri du monde et des vivants.

Il existe une autre manière de s’alléger : en abandonnant l’espoir d’éclairer définitivement les énigmes, d’épuiser le questionnement qui rythme nos vies et creuse des accès au monde dont nous sommes les héros ; en consentant aussi à ne toucher à rien, ou le moins possible, suivant en cela la méthodologie scientifique la plus orthodoxe et la plus exigeante, c’est-à-dire du bout des doigts.
Et je crois qu’à cet égard, ceux qui prendront le plus grand plaisir aux problèmes que proposent Sandra Cibert-Prod’hom et Sylvie Rosat dans Eurêka – le nouveau moyen d’enseignement de l’option spécifique mathématiques et physique du canton de Vaud – seront ceux qui sauront goûter aux questions plus qu’aux réponses, lesquelles tombent, on le sait, comme des fruits mûrs ; les auteures ne manquent pas de nous rappeler, en effet, que les réponses n’offrent toutes leurs saveurs que si elles sont saisies du bout des lèvres et croquées là où elles sont nées : dans le verger.
Jean Prod’hom
Sache que j’ai été pris ce matin dans la tourmente

Cher Pierre,
Sache que j’ai été pris ce matin dans la tourmente, chacun y est allé de son pas, cerné par les heures ; des visages hébétés, des voix aveugles, une allure de domestique, de l’aigreur et du ressentiment, le grincement de plumes besogneuses et des encriers secs. Le jour est resté impassible.

J’aurais aimé être sur le front de mer, avec la journée devant moi, un ciel large, de l’écume et la danse des vagues. J’ai dû me contenter d’un couloir sombre et de vieilles recettes, tout le monde était sur le qui-vive et tentait de s’enfuir ; le silence les a si bien talonnés qu’ils n’ont pas fait long feu ; je suis resté en arrière dans les locaux techniques.
A la sortie, un trèfle gonflé de sucre et un papillon entouraient un bouton d’or au pied de l’un des arbres chétifs qui se dressent sur le parking. Je me suis approché et le papillon s’est mis à tournoyer autour du trèfle avant de prendre les devants et de me conduire au pré, là où étaient tous les autres.
Jean Prod’hom
Accueil de première classe

Cher Pierre,
Accueil de première classe ce matin à l’aula, c’est jour de certificat. Dans les mains un plateau que je tends aux candidats, priés d’y déposer leur portable et leur montre – elle pourrait être connectée. Le responsable à qui je demande s’il ne serait pas nécessaire de pousser notre zèle et de les fouiller me confirme que nous ne sommes pas sortis de l’auberge.
Nous devons, me dit-il, quoi qu’il advienne, ne jamais cesser de leur accorder notre confiance...

Je profite d’un congé imprévu pour me rendre après midi à Port-des-Prés. Je n’y retrouve ni la très haute grange, ni l’âpre crépi des murs, ni le banc vide entre deux portes fermées. Pas d’eau non plus dans la fontaine du Moulin de Vucherens, mais une voix, une voix encore, celle du ruisseau sous les frênes comme une incantation monotone et profonde.
Les travaux dans la maison ont avancé, sans qu’on sache exactement quand ils se termineront : l’annexe du panneau électrique et les gaines techniques sont posées, les fenêtres aussi, la plupart des radiateurs qui devaient être déplacés l’ont été.
On n’essaie plus de combattre la fine couche de poussière qui recouvre uniformément chacun des objets de la maison, on n’y touche plus, on ne les déplace plus, on se dit qu’ils attendront. J’ai préparé le repas au garage, mis la table au jardin ; mais la pluie nous oblige à laisser derrière nous l’arc-en-ciel qui s’est brisé au milieu du ciel et à nous retirer dans la véranda.
Jean Prod’hom
Pas sûr qu’au milieu du siècle passé

Cher Pierre,
Pas sûr qu’au milieu du siècle passé, Lausanne ait bénéficié, s’il en existe, des meilleurs urbanistes ; les collines de la Cité, de Bourg et de Saint-Laurent n’ont peut-être, à la décharge de ces voyants financés par l’état, guère facilité la gestion de son centre, de ses espaces verts, de ses places publique. Si bien qu’à Lausanne, où j’ai passé un bon tiers de mon existence, je n’y retourne guère.

Mais rares sont les agglomérations de plus de 300 000 habitants qui peuvent se targuer d’avoir conservé un cours d’eau à ciel ouvert, c’est le cas de la Vuachère.
Il y a quelque mois, nous avions suivi, Olivier et moi, le sentier qui la longe, parfois de tout près, de son embouchure dans le Léman à la Perraudette. Nous avons prolongé cette balade ce matin jusqu’à la Sallaz. J’ai éprouvé à nouveau cet étrange sentiment d’être à l’intérieur d’un monde disparu, depuis longtemps déjà, mais dont ce vallon à la végétation sombre et primitive, plus impénétrable à certains endroits que celle qui annonce l’entrée des enfers, offre un accès privilégié.
Il aura certes fallu, pour que les eaux du Flon viennent épauler celles de la Vuachère, que les meilleurs ingénieurs consolident ses rives, les aménagent pour faire revenir les bêtes et qu’on découvre, au fond de son lit de molasse des truites et une fraîcheur qui rappelle celle du paradis. Et lorsqu’on traverse en coup de vent la ville pour se rendre de Lausanne à Pully, de Chailly à Sauvabelin, on ne songe pas un instant que tout au fond de ce vallon, aussi noir que l’encre, qui se dérobe aux yeux de celui qui n’y descend pas, coule une eau minérale, loin du torrent de boue tiède qui nous emporte en surface.
Pour que la fraîcheur vous monte à la tête, une paire de tongs suffit.
Jean Prod’hom


L’air était frais ce matin

Cher Pierre,
L’air était frais ce matin, je suis parti à un peu plus de 9 heures du Riau, sans bien savoir où je m’arrêterais ; j’ai fait la causette avec l’apprenti de la forge de Ropraz, avec François qui avait de la visite, avec Alain enfin, remonté contre l’exposition des photos de Roud au Musée Eugène Burnand ; c’est cette conversation qui a décidé de ma destination.

J’ai emprunté, dessous la Moille, le pont qui cambe la route de Berne, plongé dans l’ombre du vallon de la Bressonne ; je me suis trempé les pieds, l’ai descendue sur une cinquantaine de mètres, peu décidé à quitter son lit. Et plutôt que d’emprunter le sentier dont les lacets conduisent à la Louchyre, je suis monté droit dans la pente et longé la lisière avant de piquer sur le réservoir. Les églantiers sont en fleurs ; des cerises, chétives, se colorent. De là-haut, Ferlens et le Borgeau ont une autre allure. Ai rejoint enfin, sous la chaleur, la Chapelle de Vucherens en passant par la Gotte ; puis traversé le village jusqu’à la route de Mézières. Je n’ai rencontré personne depuis Ropraz.
Ils sont quelques-uns sur la terrasse du restaurant des Trois-Suisses où je bois une bière et attends Sandra et les filles ; c’est jour d’audition à Palézieux. En attendant le tour de Louise qui jouera à 18 heures, je vais guigner dans la salle polyvalente où a lieu une grande kermesse ; c’est l’Association de l’Atelier des enfants qui l’organise pour soutenir les actions de l’association Taller de los Ninos, dont Christiane Ramseyer est la secrétaire générale au Pérou. C’est la voix de celle-ci que j’entends dans la salle, je finis par m’y asseoir, emballé par la présentation de son travail et de celui des 80 personnes qui l’épaulent dans les bidonvilles de la banlieue de Lima.

Lili a beaucoup progressé et prend toujours davantage de plaisir au piano ; Louise, très fière d’avoir joué avec des filles plus âgées qu’elle, sort emballée de cette audition. On rentre, Arthur est à Gryon jusqu’à demain. Edelweiss et Fleur passent la soirée avec nous, devant le match de foot entre Barcelone et Turin. Depuis le début des travaux, les chats, on ne les avait pas beaucoup vus.
Jean Prod’hom
(FP) Devant la ferme de Roud à Carrouge

Cher Pierre,
Il est inconvenant de vouloir tirer quoi que ce soit des outils, des reliques, de la maison d’un poète. J’ai fait une halte pourtant, ce matin, devant la ferme de Roud à Carrouge, l’eau coulait dans les deux fontaines.

Mais de savoir que quelqu’un y fut, tout à la fois étranger et proche, que ce quelqu’un prit acte, autant qu’il le put, de sa condition et des alentours, qu’il la quitta chaque jour pour rejoindre le chemin de la Louchyre, de Ferlens ou la route de Missy, donne au monde dans lequel je suis une substance singulière ; une manière d’être, de se livrer ; une durée, une réalité qui s’ouvre et me soulève. Me voici embarqué et je sens la brise fraîche du matin que diffuse la maison vide du poète sise aux quatre vents.
Je longe le chemin qu’il a emprunté tout à l’heure, ça aurait pu être ailleurs et le fait d’un autre poète –, mais c’est ici, sur la route d’Hermenches, Prahins ou Molondin, c’est ici qu’il a creusé son absence et mon attente. (P)
Jean Prod’hom
J’ai retrouvé aujourd’hui

Cher Pierre,
J’ai retrouvé aujourd’hui, dans un vieux carton, un bout de papier sur lequel j’ai transcrit, il y a longtemps déjà, une de ces pensées énigmatiques que la vieille de Pra Massin avait l’habitude de prononcer à la fin de sa vie et que je m’empressais de noter : Si le diable se cache dans les détails, c'est dans les nuances qu'on sauve son âme. Ce soir-là, je m’en souviens bien, elle m’avait longuement parlé des scabieuses, des centaurées et des bleuets.

Au verso, lisible encore, mais en plus petits caractères, une autre sentence, qui semble répondre à celle qui figure au recto. Que tu ne comprennes pas ce que je dis ne doit pas te froisser et te laisser supposer que je le comprends moi-même. Ce que je dis, parfois, me précède. Te plains-tu du fait que tu ignores l'avenir ?
Rien ne permet de décider laquelle de ces deux pensées précède l’autre. Je n’ajouterai rien, il n’y a de place sur ce billet pour aucun commentaire.
Jean Prod’hom
L’homme est une usine à pathétique

L’homme est une usine à pathétique, c’est ainsi, difficile de faire autrement. Mais le rituel qui met un terme à la scolarité obligatoire, là où il demeure, inquiète, son prix est exorbitant. Pour maintenir la bastringue hors de l’eau, ses exécutants sont amenés à prendre des mesures toujours plus onéreuses et cocasses, on bricole ; tout le monde collabore, mais le bénéfice maigrit, à peine suffisant pour sauver la face, et refaire un tour. L’opération semble obéir à la loi des rendements décroissants, il serait temps de passer à autre chose. Certains s’y attellent depuis longtemps déjà, sans grand succès, ils se consolent à l’idée que la réponse viendra d’ailleurs, de là où on l’on ne s’attendait pas, comme toujours. Et c’est tant mieux. En attendant, ils font de leur mieux avec les moyens du bord : frontières, saisie des téléphones, murs, contrôle des sacs, séparatifs, logiciels anti-plagiats, encouragements à la concurrence, espionnage sur les réseaux sociaux. Bonne chance les enfants !

Trop de zones grises, disent les plus hardis, il faut légiférer au plus vite, obtenir un soutien, de l’argent. Alors les hommes de loi légifèrent pour mettre sous contrôle ces zones, systématiquement, rationnellement. D’accord. Paradoxalement, leur nombre et leur étendue croissent lorsqu’une règle ou une loi est mise sous toit, avec pour corollaire la mise en miettes du champ de leur application.
On invoque les nuances tandis que le gris s’étend, grisaille, on multiplie les coutures sans couleur. Mais, et comment faire autrement, on faufile si lâche que les filous parviennent à glisser dans l’ouverture une pince-monseigneur, à se saisir de l'infime pour en faire un précédent. Les procéduriers font de rien une affaire d'état, c'est l'envers de la peau de chagrin.
L’espace et nos vies sont pavés de bonnes intentions, de poèmes abscons et de lois magnanimes ; alors le quelque chose qui résiste recule, se tient à l’abri des peurs et des profits qui accablent nos vies. Rien n’a pourtant changé, mais toute ouverture est devenue un danger que les gardiens de l’ordre s'empressent de colmater ou de contrôler.
On a réduit simultanément d’autres zones grises, les bonnes, celles qui nous permettent de respirer, les jachères et les granges vides, les bouzigues, les chantiers et les haies. Où donc nos gamins iront-ils demain s’embrasser ?
Je crains aujourd’hui le coup de grisou, le respect de la loi suppose une confiance aveugle, analogue à celle qui permet la circulation de l’argent, tout est si fragile. Et si je suis amené à l’écrire, c'est parce que ce quelque chose qui était consubstantiel à nos vies est devenu si miraculeux qu’il est nécessaire de renouveler son bail à chaque instant, sachant que sa rupture nous contraindrait à tout reprendre depuis le début, bellum omnium contra omnes.
Jean Prod’hom
C’était un tout grand

C’était un tout grand : voyages, combats, solitude. Sa fin a été moins belle, souviens-toi de Sainte-Hélène, j’en parle d’autant plus librement que je ne m’en cache pas.

A moins que ce ne soit l’île d’Yeu ? Impossible de m’en souvenir, de me débarrasser une fois pour toutes de cette confusion, je n'y puis rien. Je n'ignore pourtant rien d’eux séparément, mais ensemble ils ne font qu’un, difficile dès lors de dire qui est qui et qui est où ? Et sur laquelle des deux îles chacun d’eux est enterré ? J’hésite, suis allé sur l’une d'elle, mais laquelle ? Celle du traître ? Je ne veux pas polémiquer, mais une seule île n’aurait-elle pas suffi ? Maréchal, empereur, général ou roi, chef du gouvernement, consul, ministre ou président, les distinguos me lassent, je me méfie des post scriptum et du transferts des cendres. Je me suis mis à confondre les épines et les lauriers, le courage et la lâcheté. Et ce n’est pas sans une certaine satisfaction que je le constate : mon ignorance et ma confusion sont demeurées intactes, avec la mer tout autour.
Jean Prod’hom
Il manque quatre roues au garage

Cher Pierre,
Il manque quatre roues au garage pour en faire une roulotte, on y a entreposé la vaisselle et un frigo. Sandra est revenue d’Oron avec deux cuvettes et un égouttoir. Le soleil est de la partie, c’est notre premier jour de vacances.

Il y en aura d’autres avant la fin des travaux, et d’autres vacances, les vraies, qui se mêleront aux premières ; on dressera alors une tente et on se lavera au jet, près de la fontaine ; faire la vaisselle en plein air délie les langues. Pas de nappe sur la table en fer blanc, chacun son canif, riz et ratatouille, compote de pommes et tome de chèvre, une petite cuillère et un morceau de pain suffisent amplement.
Après le repas, Oscar, Arthur et sa mère vont faire le petit tour, le ciel se couvre, électrique, quelque chose se tend et le ciel lâche, comme une bête ses entrailles. Je vais les récupérer en voiture, ils sont sous le tilleul, hilares, détrempés comme des chiens mouillés. Je songe à ceux qui ont fauché l’herbe aujourd’hui et qui, ce soir, se mordent les doigts. Il faudra tout reprendre demain, défaire les andains, pirouetter, les refaire.
Autour de l’étang qui déborde, quelques iris brûlent, petits incendies chiffonnés, mats, déchirés, qui interprètent à leur manière la déroutante alliance des chanterelles et des oeillets.
Jean Prod’hom
On a vécu d’expédients

Cher Pierre,
On a vécu d’expédients ; plus de douche, nos devoirs faits à la va-vite, des renvois, du sommaire. Cette semaine, Marinette et Lucette nous ont accueillis, je me suis douché dans les caves de la mine, soupes et ratatouilles.

Ce dimanche, c’était fête dans le quartier et Françoise nous a invités mercredi prochain. Merci ! Demain, on fait un pas de plus, les démolisseurs s’attaquent à la cuisine. Il n’y aura plus d’électricité, Louise ira au puits, Arthur laissera ses livres, Lili promènera Oscar ; on va devoir bricoler. Poires et pommes dans une même casserole, on en appellera aux chasseurs-cueilleurs, aux roms, aux premiers établissements lacustres ; on rédigera les strophes d’un hymne de fortune, ne rien bousculer. On fera couler de la cire et on regardera les étoiles.
Et pendant ce temps, les iris d’eau se déplieront autour de l’étang.
Jean Prod’hom
Je ne m’y serais pas penché

Cher Pierre,
Je ne m’y serais pas penché si je n’avais, aujourd’hui, à l’entrée de la COOP d’Oron, observé les publicités qui colorent nos grandes surfaces, et si l’une d’elles ne m’avait pas ramené à un billet du 24heures de la veille, évoquant un ouvrage de François Debluë, Lyrisme et dissonance, puzzle de pensées éparses, écrit le journaliste, de réflexions, commente l’éditeur, d’aphorismes, de notes, de courtes anecdotes (souvent drôles), de brefs récits et d’évocations.

Le chantier au Riau, les échafaudages, les gros travaux que nous réalisons dans la maison, l’isolation de certaines de ses parties, le carottage que le charpentier se propose de faire sur le pignon ouest, tout cela aura été, vraisemblablement pour beaucoup, à l’origine de la mise en route d’une de ces réflexions sans queue ni tête, dans lesquelles on ne peut s’empêcher parfois de s’embarquer. Peut-on calculer la profondeur d’un apophtegme, d’une remarque, d’un aphorisme, d’un brimborion, déterminer sa part d’obscurité et sa part d’illumination, son pouvoir d’accélération, sa densité,... ? C’est l’un des extraits cités par Gilbert Salem, qui m’avait conduit dans ces eaux-là :
Tout artiste tient du manchot : le poète, le peintre, le compositeur ne travaillent que d’une main. L’autre n’est guère requise, sinon pour tenir la palette, maintenir la feuille de papier ou se gratter l’oreille.
La formulation m’avait paru immédiatement exquise ; m’avait séduit le rythme ternaire, tout me semblait en place pour que, le lisant à voix basse une seconde fois, une troisième à voix haute, comme un mantra, je puisse m’échapper vers cet inconnu que promettent, sans le faire voir, ces proses brèves et ramassées. Mais quelque chose n’embrayait pas et me rivait au sol, sans que je sois en mesure de déterminer ni quoi ni où, mais qui me semblait être précisément ce qui aurait dû me faire décoller.
J’ai depuis hier renoncé à faire une demande d’aide au Fonds national de la recherche scientifique, sans pour autant cesser d’être sur le qui-vive. J’avais publié sur ce site, il y a une paire d’ans, un billet qui s’intitulait, Ecrire à deux mains. Dans lequel je commentais quelques extraits d’Une main, petit ouvrage d’une septante de pages dans lequel C. F. Ramuz évoque précisément l’état de manchot auquel une chute l’avait condamné en 1931. Et qui l’avait amené à faire voir ce dont personne ne s’était avisé : c’est à deux mains que l’on écrit, que l’on peint, que l’on compose.
Le brimborion que je cherchais et qui m’aurait fait décoller, je l’ai découpé au milieu de la page 33 d’Une Main :
... nous ne marchons pas moins sur deux pieds et un pied ne nous sert à rien ; nous écrivons sans nous en douter avec deux mains et avec les deux mains : il faut pour le savoir enfin n’en avoir qu’une.
Certains aphorismes marchent sur un pied, ils se satisfont des observations, d’autres engagent le corps de la pensée tout entier, au-delà du point d’équilibre. Les uns est les autres sont séduisants, les premiers ramènent au bercail, les seconds font voyager.
Jean Prod’hom
(FP) Le désert des pintes

Cher Pierre,
Sandra, Louise et Lili nous ont faussé compagnie, réunion de sportifs à Orbe. Alors ce soir, nous sommes allés manger aux Trois-Suisses, le mousse et moi. Un père et son fils, ensemble, ce n’est pas tous les jours, c’est même à chaque fois une nouvelle énigme, la découverte d’un nouvel état d’esprit, déroutant, avec des questions auxquelles le cadet aura à répondre et le sentiment, du côté de l’aîné, qu’il n’aurait pu en aller autrement. A lui le monde qui se lève, à moi celui qui s’éteint.

Depuis une année, le café-restaurant des Trois-Suisses est fermé le matin ; thés, cafés ou croissants ne rapportent plus, les comptes des propriétaires en attestent, on ne peut le leur reprocher. C’est donc à 11 heures que les portes s’ouvrent, pour le dîner, elles se referment à 14 heures 30 pour la sieste ; le service reprend à 18 heures 30, pour le souper, la pinte ne désemplit pas jusqu’à minuit.
Plus de grelots à 8 heures, de yass à 9, d’apéritif à 10. Le silence est seul sous le tilleul, les 3 heures à l'église tombent dans le vide : plus personne ne dira désormais les ombres qui s’allongent, le ciel vide l’après-midi, les pas sur le gravier.
Je ne confonds pas le désert des pintes avec la fin du monde, mais ça y ressemble étrangement. Et je crains que le mouvement ne soit irréversible ; le lieu, évidemment, ne disparaîtra pas, ni son esprit. Mais qui témoignera des heures creuses ? (P)
Jean Prod’hom
L'école manque à sa tâche

Cher Pierre,
L'école manque à sa tâche en cherchant à séduire ceux qu’elle accueille, en mettant tout en oeuvre pour qu’ils ne lui échappent pas ; alors qu’elle a pour tâche, précisément, de leur donner les moyens d’en sortir au plus vite ; elle échoue en voulant les amuser, en espérant leur plaire ; en les captivant, elle ne parvient qu’à les rendre captifs.

Elle contrôle entrées et sorties, a mis en place un monde second par la mise en place d’un système de communications perverses : jeux de pseudo-questions et de pseudo-réponses, trompe-l’oeil, cache-cache, bienveillance de ceux qui sont supposés savoir, confusion des rôles, devinettes, pseudo-équité, travail au mètre, exercices venus de nulle part, figures de papier, attentes, dés pipés, terrain miné, malentendus, fabrication d’énoncés factices, allocutaires fantômes, rituels scolastiques.
Alors qu'il serait prioritaire d’apprendre à sortir de son giron, quitter les chemins battus, prendre ses distances avec le convenu, de la hauteur, prêter l'oreille aux besoins ; apprendre à poser des problèmes, dégager des problématiques, se familiariser avec les langages, trouver la personne qui pourrait nous informer, nous aider, celle avec laquelle on pourrait collaborer, celle qu'on ne connaît pas.
L’école vous dira que c’est exactement ce qu’elle fait. Pas vrai. L’école est en réalité faite par et pour les enseignants, ceux qui ont refusé d’en sortir et qui recommencent. L’école a fait ses preuves, disent-ils. Quelles preuves ? On ne tourne pas aisément la page.
Jean Prod’hom
Que je n’aie au fond jamais quitté l’école

Cher Pierre,
Que je n’aie au fond jamais quitté l’école m’amène à penser aujourd’hui, rétrospectivement, que ce que j’y ai acquis ne m’a permis, à aucun moment, d’aller faire fortune ailleurs. Les apprentissages fondamentaux me sont toujours restés si mystérieux que je ne me suis jamais senti capable d’en user dans d’autres domaines.

Je suis donc resté à l’école après l’école pour y voir clair, chercher à déterminer pourquoi ce qui allait de soi demeurait à mes yeux énigmatique, sans assise, non pas que je sois plus idiot qu’un autre, quoique, mais parce que ce sur quoi les autres semblaient s’accorder et dont l’existence paraissait si assurée me manquait cruellement, incapable de concevoir les apprentissages comme un préalable à la réalisation de telle ou telle chose dont j’aurais pu devenir le maître.
Il me restait, en y restant, à chercher ce qui m’échappait, me manquait, c’est-à-dire à me pencher sur mes premiers apprentissages et les troubles qu’ils avaient engendrés, pour les reconnaître d’abord, en poursuivre l’exploration ensuite et, chemin faisant, m’aviser que ces troubles avaient été et continuaient à être l’occasion de découvertes imprévisibles.
Avec pour seule ambition – plutôt que d’occuper la place de celui qui est supposé savoir –, continuer mes apprentissages avec d’autres, hésitant, essayant, doutant, mais en connaissance de cause.
C’est à cela que je songeais en lisant Jean-Christophe Bailly :
La recherche n’est que la prolongation de l’apprentissage... Si l’apprentissage peut être assimilé à l’exploration d’un continent, la recherche correspondrait quant à elle à ce qui transforme ou relève cette exploration en découverte... Le paradoxe est même que la recherche vienne augmenter la dimension d’inconnu qui est la clé ouvrant l’apprentissage... Chercher, rechercher, c’est remettre tout le savoir en balance, c’est un métier qui fait de l’apprentissage son principe. (« Rechercher » in L’Elargissement du poème)
A moins que, à l’école, je n’y suis au fond jamais allé.
Jean Prod’hom
Lorsque le jour viendra

Lorsque le jour viendra, quand on me remerciera pour les services rendus, c'est-à-dire dans un peu plus de deux ans, je ne chercherai pas à m'incruster dans la maison, je la quitterai vraisemblablement sans regrets, avec le sentiment de m'être acquitté aussi bien que je l’ai pu de la tâche qui m’a été confiée. C’est ce que je lui ai dit.

Elle m’a répondu, je comprends, cela ne m'étonne pas, mais tu as des projets, toi. Elle a ajouté, c’est quand même une page qui se tourne.
Impossible de répondre à cela. Comment dire ? Me suis-je fait comprendre ? A-t-elle compris que je ne lis pas qu'un seul livre et que, si j'ai un jour conçu des projets, c'est il y a bien longtemps, au temps où j'avais assez de temps pour ne pas m'en préoccuper, ou différer leur réalisation, ou même, tout simplement, m'autoriser à en manquer.
Il me suffira de tourner les pages d’autres livres, et parmi eux, celui dont j’ai différé la lecture commencée il y a bien longtemps, interrompue et reprise depuis toujours. Livre compagnon de mes veilles et de mes nuits, j’en lirai et en écrirai quelques pages, dans les bois, sur la terre ou dans le ciel, en guignant du côté de l'éternité.
Jean Prod’hom
Aux sténoses qui obstruent nos manières de penser

Cher Pierre,
Aux sténoses qui obstruent nos manières de penser, Jean-Christophe Bailly propose, depuis des années déjà, des textes animés et tendus par des ressorts qui agissent comme des stents, assurant le passage d'un liquide incolore qui désencombre le lit de nos pensées et s'ouvre en delta sur une réalité élargie à laquelle on n'avait pas prêté suffisamment attention, une réalité qui contiendrait tout à la fois nos manières étroites de penser, ce que celles-ci écartent pour fonder leur légitimité, et l'échappée sans laquelle nous ne vivrions vraisemblablement pas. Il y a au-delà du corps second, laborieux, que nous charrions chaque jour, ou en-deçà, un corps premier qui nous fait marcher sans rien vouloir ni savoir, sans hâte, sans débordement. Et lever la tête.

Jean-Christophe Bailly ne cesse de rendre à l'homme une dimension dont celui-ci croit avoir été dépossédé, mais en direction de laquelle chacun se tourne, à chaque pas, d’où qu’il vienne et où qu’il aille, dimension sans laquelle il n’accepterait pas la prison dans laquelle son espèce a trouvé refuge.
Refuge donc de refuge, dont les dimensions rétrécissent toujours davantage, affaiblissant l’essentielle interrogation sur notre provenance et notre destination, dont on perçoit l’écho cependant chaque fois qu’on jette un regard à côté, du côté des friches, du côté des rivages, du côté des bois, et qu’il convient de traverser avant de réintégrer, réconcilié, les lieux qu’on a voulu quitter.
Jean Prod’hom
Il est d'autres voyages

Cher Pierre,
Il est d'autres voyages ; ainsi le dimanche matin, dans le parc d'un hôpital psychiatrique. F m'a accueilli avec le sourire, enchantée à l'idée de faire un tour ; l'infirmière lui a trouvé une polaire, je l'ai aidée à faire coulisser les deux rangées de dents métalliques. Quelques patients sur la terrasse, le soleil s'est installé. Je lui adresse quelques mots sans savoir exactement qui de nous deux parle, ou écoute. Peu. On n'est jamais aussi près de l'esprit de la pentecôte que lorsqu'on se tait. C'est jour de repos.

Où qu'on soit il y a des arbres, des plantes, des oiseaux, côte à côte ; on reconnaît sans peine les marguerites, les sauges, les érables, un merle, les lauriers. Pas besoin non plus de prendre d'automobile, ni d'aller au cinéma, on passera par les bois, avec dans la poche un billet qu'il ne faut pas perdre. Les tomates sont déjà dehors près du pavillon de l'Albatros, Blaise y avait été interné en son temps. il n'aimait pas ça. Combien d'années de travail te reste-t-il ? Trois ? Deux ?
Il y a des bistrots partout, la tête des parasols dépasse des haies, les chaises sont vides, on s'y installe. C'est agréable un tilleul, à l'abri de la bise, avec le soleil. Regarde là-bas, il y a des lumignons dans les haies ! Mais non, ce sont les boucles d'une chaîne en acier. C'est vraiment grand ici, tiens ! je n'avais pas remarqué cette baie vitrée, c'est beau, il suffit de ramasser, lorsqu'on en voit, les papiers que les gens ont jetés. Calypso, ça ressemble à une école de danse, avec des géraniums devant. Une autre école tout près, avec devant une pancarte où il est écrit Docteur Veillon. Pourquoi un docteur ? Ça, je ne le sais pas !
Il y a moins de plantes de ce côté-ci, plus de bitume, alors les responsables en ont profité pour faire un parking, c'est vraisemblable, les iris sont en tout cas très jolis. Et là du millet, goûte ! Que peut-on vouloir de plus ? Mais tu dois savoir que les plantes demandent du travail, on est obligés de s'en occuper.
Bonjour Monsieur ! Bonjour! Le temps passe vite n'est-ce pas ? 11 heures 57. Le repas va être servi. Vous êtes un visiteur ou un patient ? Visiteur ! Alors vous comprendrez : un tour de clé et vous laissez tout derrière vous. On prend l'ascenseur, il y a un code. Pas sûr que F soit capable de l'entrer, moi non plus d'ailleurs... je suis monté à pied tout à l'heure. Un patient nous aide.
On s'assied dans des fauteuils de la salle commune, devant la TV ; les repas tardent comme souvent le dimanche. Ecopsychologues, psychanalystes, psychologues, thérapeutes se succèdent et évoquent les spécificités de leur métier, on est quelques-uns à les regarder, à mi-hauteur, ils ne nous demandent rien, on est tranquilles, on les laisse dire. Ici le temps n'avance pas, inutile de courir, on regarde le petit écran, personne n'entend vraiment ni n'attend. Certains sont un peu ailleurs, sans être bien loin ; d'autres cherchent un contact, voudraient monter dans un rafiot qui ne bouge pas. Moi, on m'attend.
Il est temps de se séparer, les repas sont servis, je la salue dans le couloir. Ce n'est pas vrai, F ouvre tout grands les yeux, une ombre, comme si elle s'avisait qu'elle ne devait pas être là. C'est une infirmière qui va aller la rechercher, en saisissant la main qu'elle lui tend ; elle remonte à la surface, démunie, entre en flottant dans la salle à manger.
C'est ça qui est difficile, me dit l'infirmier lorsque je quitte les Mimosas, c'est le retour à cette réalité-là. Je crois comprendre sans en être bien sûr.
Jean Prod’hom
Le Dictionnaire insolite de Naples

Cher Pierre,
Le Dictionnaire insolite de Naples, rédigé par Maria Franchini, parvient en un peu moins de 160 pages à donner une vue résolument fragmentaire de cette ville des surpelatifs, sans jamais céder aux poncifs des romantiques ni à ceux des rationalistes. Un abécédaire plutôt qu'un dictionnaire.

Les mythes, les traces, les sédiments, les cendres, sous lesquels les villes n'en finissent pas d'étouffer, maintiennent brûlant le feu qui couve. Celui qui se rend à Naples souffle, souffle sur les braises, les pénultièmes, les dernières braises, je ne vois pas d'autres raisons à son voyage.
Nous obéissons tous au principe de Carnot et n'en finissons pas d'enterrer ceux qui nous ont vu naître, de dire adieu à ce qui s'éloigne, vivant, aussi fin que la poussière, jusqu'à disparaître, laminé par un marteau qui ne ralentit pas sa cadence. Mais qui nous oblige à rejoindre le lieu que nous occupons, où que nous soyons, Naples ou le Riau, avec nos maigres moyens, là où il n'y a, à la fin, que de l'ouvert et le jour qui se lève.
Jean Prod’hom
J'ai perdu le nord

Cher Pierre,
Ce matin j'ai perdu le nord, d'un coup, une bonne dizaine de minutes, lorsque je me suis rendu compte, au moment d'aller faire des courses, que mon portemonnaie n'était pas là où il devait être ; impossible de mettre la main dessus : adieu ma carte d'identité, mon permis de conduire, ma carte bancaire, ma carte de crédit. Bonjour l'administration, les duplicata, les déclarations de perte, les coups de téléphone, l'attente aux guichets. Je retourne dans la maison tout ce qui peut l'être : rien... Je téléphone au patron du café de Thierrens où j'ai bu un café hier, au centre équestre : toujours rien. Je m'y rends par acquis de conscience, je prie, espère un miracle, discute avec le patron du bistrot, avec Gwenaëlle, rien. Je bloque au retour, par précaution, l'utilisation de ma carte de crédit, regarde encore là où j'ai déjà passé, ouvre des boîtes que j'ai déjà ouvertes, vide des poches que j'ai déjà vidées, jette enfin un dernier coup d'oeil dans la corbeille à linge ramenée hier de Froideville, ma journée est gagnée, il est là, je ne l'imaginais ni ici ni ainsi ; tout se remet en place, je retrouve le nord.

Jean Prod’hom
J'aperçois ce matin deux chevreuils

Cher Pierre,
J'aperçois ce matin deux chevreuils, près du réservoir de la Mussilly, à l'abri dans la brouille, les dépouilles, la pluie et les bois gris. Ils paraissent moins inquiets, hésitent, curieux même. Me voient-ils comme je les vois dans la brouille et les bois ? Eux et moi, gris sous la pluie ?

Les deux démolisseurs sont déjà au travail ; je fais la causette sur le seuil avec l'un d'eux, il me confie la peine qu'il a, chaque jour, à remettre la machine en route. Ils s'attaquent aujourd'hui aux murs du salon, à la masse d'abord, au burin ensuite. Dehors les cytises et les boutons d'or, les pissenlits, les colzas. Bientôt le trèfle et les épilobes, les scabieuses, les centaurées et les bleuets.
A midi au café, une femme demande à l'homme qui lui fait face ce qu'il pense de la mort.
- C'est effrayant, dit-elle, rien qu'à y penser ; dites, à quoi ressemble le paradis ?
- A ces points que la caissière des grandes surfaces propose au client, le samedi matin, lorsqu'il a payé son dû, ou à ces images qu'attendent ses enfants.
- C'est ça, dit-elle, ça doit être ça.
Ils sourient, ces images et ces points qu'on leur tend, le samedi matin, dans les grandes surfaces, ni l'un ni l'autre ne les prend.
Dans la boîte aux lettres un livre, en guise de remerciement pour un billet de 2011 ; et en rentrant de Thierrens, un chevreuil encore, près de l'étang.
Jean Prod’hom
Après-midi de travail

Cher Pierre,
Après-midi de travail à la salle des maîtres, sans personne et de la place, dehors il pleut. J'étale toute ma paperasse, en jette une partie, fais des piles du reste ; cela suffit à réduire d'une première moitié le volume de ce que j'ai à faire et mon inquiétude de ne pas venir à bout de la seconde se dissipe. Je boucle mon sac à dos à 16 heures, assez satisfait.

La bonne humeur règne à la la gare d'Echallens, où je réserve les billets pour Baulmes et Genève, si bien que personne ne s'impatiente au guichet, qu'on plaisante, en nous félicitant que la vie puisse prendre parfois cette allure. Je repars non seulement avec les réservations, mais avec les billets et le sourire.
Je rentre sous la pluie par les Poliez et Villars-Tiercelin. Au Riau, Sandra et Louise se préparent, elles se rendent à Mézières pour la présentation des options spécifiques. Louise est toujours bien décidée à suivre les trace de sa mère.
Petit tour avec Oscar, Lili m'accompagne avec son vélo avant de me fausser compagnie, il s'est mis à grêler et les nuages sont noirs. De savoir que la pluie vient de l'ouest et le froid du nord me soulage, je hâte le pas.
En repensant, ce soir, à ce moment heureux passé avec des inconnus au guichet de la gare d'Echallens, je dois m'avouer que l'extension ou la multiplication de tels moment ne me suffirait pas. Qu'il me faut chaque jour dégager et aménager, dans un espace que je découvre pour la première fois, un passage qui n'existait pas.
Jean Prod’hom
Je ne peux m'empêcher

Cher Pierre,
Je ne peux m'empêcher de penser que, en affirmant haut et fort qu'ils ne reviendront jamais en arrière, les chefs de service de nos administrations laissent supposer qu'il y aurait un pilote aux commandes de l'engin, parfaitement libre de le faire avancer ou reculer ; alors que de pilote, il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu, pas même de frein d'ailleurs. Les choses iront ainsi, grossissants, aussi longtemps qu'un mur n'interrompra pas brutalement la course folle du mastodonte. Fracas, ruines, silence.

Aussi loin que l'on remonte, il n'y a jamais eu en nos affaires de vraie orientation, malgré les historiens qui nous le laissent supposer, mais une agitation stochastique dans un bocal aux dimensions de notre espèce, une eau qui frémit. Impossible d'en sortir, on n'y est jamais entrés.
Beaucoup de choses ont changé au Riau, bennes pleines de gravats, ossature de bois fixée au pignon, engin de dix-sept tonnes dans le jardin, radiateurs déposés. Inutile donc de remettre en route le chauffage, il va me falloir dès demain refaire un feu dans le poêle.
Jean Prod’hom
On s'est dit – Raul et moi

Cher Pierre,
On s'est dit – Raul et moi – après la découverte en salle des maîtres d'une imprimante en sale état, que l'état de sainteté a ceci de retors qu'il n'autorise pas de régression ou de coup de mou : le saint est une fin de série qui doit le rester. On s'est dit alors qu'il est préférable, somme tout, de faire partie des vauriens, et parmi eux de ceux qui ont l'élégance de déclarer leurs forfaits, leurs ignorances ou leurs manques, bref de se faire connaître pour ce qu'ils sont. C'est ainsi que le vaurien fait, à son insu, ses premiers pas sur le chemin de la sainteté, mais en son tout début, vraiment, sans jamais laisser supposer qu'ils pourraient devenir un saint ou, pire, qu'ils le sont devenus.

J'ai hâte de rentrer à la maison et d'évaluer l'avancée des travaux ; la seconde partie des échafaudages est dressée, les lames de bardage du pignon sont en tas dans le jardin, la vieille ferblanterie pliée.
La laine de verre, placée il y a quelque années avec mon homonyme de beau-cousin, réapparait de chaque côté du poinçon, dans les triangles formés par les arbalétriers – parole de charpentier –, les contre-fiches et l'entrait ; le bois semble sain. Quant à la salle de bains, à la dépense et aux petites toilettes, elles ne font plus qu'un, un tas de ruines.
Les démolisseurs ont laissé sur leur passage une fine couche de poussière que l'un deux, solide comme un joueur de rugby, efface délicatement en fin de journée, avec un chiffon humide.
Jean Prod’hom
Les oies et les poules font bon ménage au Mélèze

Cher Pierre,
Les oies et les poules font bon ménage au Mélèze, les canards et les moineaux, les dindons et les pintades ; un grillage les protège du renard. Je dépose dans l'armoire une facture pour Martine qui boucle les comptes de la course du 3 mai, considère devant la petite mare ce à quoi notre vie collective aurait pu ressembler si nous n'avions pas disqualifié, pas à pas, nos manières premières d'être au monde, barré l'autre chemin. On a la vie de basse-cour qu'on mérite, à nous désormais d'administrer la nôtre, d'en répondre avant de la vivre, ou d'en mourir.

Remonte au triage, me cale et lis Un Abîme de la pensée, texte de 1988 repris dans La Fin de l'hymne. Jean-Christophe Bailly y commente, en son axe, un passage du roman autobiographique, Anton Reiser, que Karl Philipp Moritz a rédigé à la fin du XVIIIème siècle.
Depuis cette époque, quand il voyait abattre un animal, sa pensée se ramassait toujours sur ce point – comme il avait souvent l'occasion d'aller chez l'équarrisseur, pendant toute une période il fut uniquement préoccupé de savoir quelle différence pouvait exister entre lui et ces animaux que l'on abattait.
Souvent il se tenait des heures à regarder un veau, la tête, les yeux les oreilles, le mufle, les naseaux ; et à l'instar de ce qu'il pouvait faire avec un étranger, il se pressait le plus qu'il pouvait contre celui-ci, pris souvent de cette folle idée qu'il pourrait peu à peu pénétrer en pensée dans cet animal – il lui était si essentiel de savoir la différence entre lui et la bête – et parfois il s'oubliait tellement dans la contemplation soutenue de la bête qu'il croyait réellement avoir un instant ressenti l'espèce d'existence d'un tel être.
Voilà qu'après leur mise à ban, au bel âge de Pic de la Mirandole, dans les parties pourrissantes et bourbeuses du monde inférieur, les bêtes guignent aujourd'hui à nouveau, aux lisières, entre cris et silence. Notre dignité, entamée, attendait de renouer avec la dignité des bêtes, pour se relancer et trouver dans la fragmentation de l'édifice qui s'est effondré, dans le fugitif et le circonstanciel quelque chose d'éternel.
Nous voici à nouveau dans les bois, là où on avait relégué les bêtes, devant ce qu'on leur avait demandé d'emporter, ce souvenir qui nous remettra d'aplomb. Il suffit qu'un chevreuil réapparaisse dans une clairière pour qu'on comprenne ce qu'on n'a jamais cessé d'avoir en partage : nous sommes. Chance qui nous est offerte de ne pas avoir à payer notre arrogance d'avoir cru pouvoir reléguer les bêtes dans l'obscurité qui nous est promise, d'avoir cru pouvoir faire cavalier seul.
La maison est vide, les portes ouvertes, Lucie nous rend visite, chacun s'affaire, on mange, on range, dernière vaisselle, dernier carton. Oscar passe entre les mailles du filet. Dernière descente à la déchéterie. Demain, c'est autre chose, nous entrons au Riau dans une économie de guerre.
Jean Prod’hom
Le dentiste auquel je rends visite ce matin

Cher Pierre,
Le dentiste auquel je rends visite ce matin reconnaît que le travail réalisé par sa collègue, il y a une année, n'a pas résisté ; il me propose de revenir dans quinze jours, il s'en chargera.

Je ne m'attarde pas à Moudon, rentre au plus vite ; Sandra et Louise sont descendues au marché, Lili fait du piano puis range sa chambre, Arthur aussi : les travaux commencent lundi. Je fais rapidement un saut au triage ; les lieux semblent déserts, je m'approche du nid : vide ; mais je crois reconnaître leur chant, aperçois bientôt mes deux protégés dans les sous-bois, sans leurs petits, dont je peine à imaginer leurs premiers pas, leur premier vol, leurs premiers jours, leurs premières nuits.
Les enfants m'aident au retour à descendre les restes du parquet stockés dans le combles, on les entasse dans le hangar, ils pourraient intéresser Guillaume. Sandra descend plusieurs fois à la déchèterie, avec Arthur ; fait de l'ordre avec Louise. Les quatre sous-pentes sont vides, la dépense aussi. Tris d'habits, de jouets, mais aussi de tout ce qu'on a mis de côté depuis plus de 15 ans, au cas où ; de tout ce qui n'a pas encore tenu ses promesse.
Avec ce paradoxe que l'oubli dans lequel on les a reléguées au fond d'un carton, d'une armoire ou d'un grenier, le silence auquel on les a réduites semblent nous obliger, si on ne se sermonnait pas, à leur offrir une nouvelle chance, c'est-à-dire à les conserver plus précieusement encore, jusqu'au moment où, enfin, on les invitera à nouveau parmi nous ; elles révèleront alors leurs secrets et dispenseront leurs trésors...
il faut se faire violence, l'étouffement menace ; cesser de raisonner, parer au plus pressé ; s'arracher et agir sans se retourner ; s'en débarrasser, les oublier.
Jean Prod’hom
J'ai fait la connaissance de Léonard Limosin

Cher Pierre,
J'ai fait aujourd'hui la connaissance de Léonard Limosin, émailleur sur cuivre au service de François Ier, Henri II, François II et Charles IX. Qui a représenté en son temps la Sybylle d'Erythrée (1537) et le Jugement de Pâris (1562). J'ai fait également la connaissance de deux danseurs de hip-hop, anonymes. Et de l'un des rois représentés sur l'arbre de Jessé par Suger à Saint-Denis. De deux gisants enfin, Robert II le Pieux et Constance d'Arles.

Je le dois à la poste, ils figuraient sur les timbres d'un colis contenant une cargaison de tessons, tout frais venus de Montreuil, dans une boite de pellicule de film. Sur le papier de la déclaration douanière, le poids : 780 grammes ; et la valeur : 1 €. Un beau cadeau.
Pour le reste, des allers et des retours de la maison à la déchèterie, la fin de la correction des travaux des grands, et la pluie qui n'a pas cessé de la journée.
C'était l'anniversaire de Lili, elle a eu 11 ans.
Jean Prod’hom
Vous êtes dans un état précaire mais stable

Cher Pierre,
Cette journée de congé est la bienvenue, Arthur est à Glion, les filles se réveillent tard, nous aussi. Je descends à Ropraz récupérer les adresses des entreprises de la région qui ont soutenu la course du 3 mai, achète du pain à Mézières, glisse dans des enveloppes, avez l'aide de Lili qui s'est réveillée, une lettre de remerciements. On déjeune dans le jardin, à l'ombre des échafaudages, ce n'est pas désagréable de vivre avec la sensation d'avoir les étages à portée de main ; les filles apprécient aussi, c'est jour de l'Ascension.

Je lis quelques travaux d'élèves, avec le sentiment un peu paradoxal que j'aurais beaucoup à dire aux auteurs des bons travaux, beaucoup moins aux autres : par où commencer ?
Louise m'appelle, c'est une journaliste de 24 heures qui aimerait que je lui parle d'Hessel. Je bégaie des banalités, mais corrige des inexactitudes qui circulent sur la parution de la monographie qui lui a été consacrée. Évoque, en bégayant encore, la fatigue de son organisme et l'extrême vivacité de son esprit, sa drôlerie, sa fidélité, sa mémoire vertigineuse. Lui refile le numéro de téléphone de Nicolas, en espérant qu'il ne m'en voudra pas.
La reconnaissance des milieux artistiques, la grande exposition de Martigny, celle de Grignan, le vernissage de l'ouvrage qui lui a été consacré, il y a quelques jours à Lausanne, auront eu raison de ses forces, il le savait. Il m'avait rapporté en avril, au retour de chez son cardiologue, que celui-ci lui avait dit : Vous êtes dans un état précaire, mais stable. Il en avait ri.
Sandra a commencé à faire du rangement, je la rejoins au grenier, transporte derrière le garage les tuiles que je stockais dans les sous-pentes, avec un sac à dos et deux à main, Louise fait quelques voyages. Prépare ensuite le repas : grenade et bananes dans un jus de citron et d'orange ; purée de pomme ; fromage, oeuf au plat et salade.
Je constate que l'encyclopédie Wikipédia a déjà enregistré l'événement : Jean-Claude Hesselbarth est un peintre et dessinateur suisse. Né en 1925 à Lausanne, il s'était établi à Grignan en Drôme provençale. Il est décédé le 13 mai 2015.

Rivière II (détail)
Jette en passant un coup d'oeil à Rivière II, encre de Chine à la petite plume d'acier et au bambou taillé sur papier à la cuve, 53 x 34, daté de l'hiver 1982 et qui me suit depuis 1998. Vais me coucher.
Jean Prod’hom
C'est une autre nuit qui s'abat

Cher Pierre,
Nous sommes descendus ce matin à Vevey, c'était la troisième fois seulement que j'entrais dans une étude de notaire. D'abord à Pully suite au décès de ma mère, la seconde fois à Oron lors de l'achat de la maison que nous habitons aujourd'hui, ce matin à Vevey pour l'augmentation de notre cédule hypothécaire.
À chaque fois le même décor : une table ovale, plus de chaises qu'il n'en faut ; au mur des tableaux que jamais personne n'a regardés, un téléphone en retard d'une génération, une collection de stylos ; quelques ouvrages, Le Droit fiscal, le Code civil suisse et code des obligations annotés et, pourquoi pas, Le Petit Robert ; tout autour un vide métallique. A chaque fois la même mise en scène : le notaire se fait attendre, finit par entrer, lit mot à mot les deux pages de l'acte dont il nous a donné préalablement une copie, nous tend un stylo, signatures à tour de rôle, Madame d'abord, Monsieur ensuite, c'est fait, ça marche ; c'est beau, c'est froid, c'est technique.

Jean-Claude Hesselbarth dans son atelier | 06.08.2014
Sandra me dépose au Chalet-à-Gobet, se rend au collège ensuite ; je remonte avec la Yaris au Riau et travaille, presque sans interruption jusqu'à 17 heures, bien aidé par Elsa et Louise qui prennent en main les deux repas.
Passe un moment dans je jardin, les échafaudages sont dressés au sud et à l'ouest ; les monteurs reviendront terminer vendredi matin. Complète l'idée que j'ai commencé à me faire, hier, de la pratique actuelle du football, en suivant à la télévision l'autre demi-finale de la Ligue des Champions qui oppose le Real de Madrid à la Juventus de Turin. J'en sors réjoui, comme de chez le notaire ce matin : beau, froid, technique.
Alors que la nuit m'invitait au repos, c'est une autre nuit qui s'abat ; Lily m'envoie un message qui m'annonce que Jean-Claude est mort aujourd'hui. Elle ajoute que la présentation de l'ouvrage qui lui est consacré, ce vendredi 15 mai, à Grignan, est maintenue, en son hommage et en son souvenir.
Je t'embrasse Lily courage.
Jean Prod’hom
La fenêtre restera ouverte toute la nuit

Cher Pierre,
Passe plus d'une heure et demie avec des parents, ils souhaiteraient que je leur procure une de ces recettes qui ont fait leurs preuves. Je leur peins un tableau qui n'a pas grand intérêt, mais qui est sensiblement le même que celui qu'ils me peignent : nos mondes sont compatibles.

D'avoir enseigné, c'est-à-dire fait découvrir à ceux qui n'en disposent pas, les différents langages qui structurent nos vies, et d'avoir signalé, aussi souvent que je l'ai pu, à ceux qui ne s'en satisfont pas, certains de leurs rouages et quelques-unes de leurs roueries ne m'a jamais permis de pronostiquer quoi que ce soit de ce que peut ou ne peut pas l'enfant qui aurait marqué son enthousiasme ou qui s'y serait opposé. On attend trop les uns des autres. Ce qui infléchit la trajectoire d'un enfant - comme celle d'un adulte - relève d'un ensemble de circonstances dont le concours est si improbable qu'il vaudrait mieux compter sur l'imprévu. On ne peut donc pas réconforter les parents qui doutent ou qui souhaiteraient qu'il en soit autrement. On peut au mieux faire voir notre étonnement et notre ignorance ; il m'aura fallu 30 ans de compagnonnage avec des gamins pour dire tout haut que j'ignore ce qui dans leur formation et la mienne est cause de quoi. Et dans ce repli, ou ce retrait, non pas succomber à la lâcheté, mais consentir et, par là, signifier les vertus de l'acquiescement.
Passe à Ropraz récupérer le mousse. Souriant, content. Deux fois content, et pour la deuxième fois cette semaine. De son travail d'abord, mais aussi de ce que celui-ci doit à d'autres travaux et à d'autres personnes. Comme s'il découvrait les joies de l'orchestration et, je l'espère, ses pouvoirs.
On mange à la véranda, Sandra est fatiguée, je regarde avec les enfants la première partie du match de football qui oppose le Bayern de Munich et le Barcelone, seul la seconde. La fenêtre restera ouverte toute la nuit.
Jean Prod’hom
L'approche de la fin de l'année scolaire

Cher Pierre,
L'approche de la fin de l'année scolaire me fait perdre de la hauteur, au moment même où il serait nécessaire que j'en prenne davantage. C'est, je crois, une variante d'une loi universelle dont chaque homme sensé aimerait s'affranchir ; mais il lui faudrait pour cela être assez fou pour renoncer aux bénéfices que lui procure l'organisation acharnée de la concurrence.

En rentrant, je fais une halte sur la terrasse de Praz Collet où je tente de mettre des mots sur ce que j'ai vu - une image ? un paysage ? un souvenir ? - lorsque je me suis arrêté, un jour d'hiver 1999, au Riau.
J'embarque Arthur à l'arrêt de bus, content de son travail sur la Seconde Guerre mondiale ; je le dépose, il s'installe dans le hamac, lunettes de soleil et costume de bain. Je monte avec Oscar au triage, demeure à respectable distance du sapin des bouvreuils, assis sur une souche. La femelle est dans son nid, je patiente une bonne demi-heure. Je vois enfin une lueur rouge qui s'agite, c'est le mâle qui se penche, deux fois, trois fois ; les petits sont nés. Je rentre raccommodé.
Arthur n'a pas quitté le jardin et travaille ; je lave une salade, prépare une crème au chocolat minute, beurre des tranches de pain sec, pose un morceau de fromage sur des quartiers de tomate, réchauffe des nouilles et casse dans la poêle cinq œufs.
C'est l'époque de l'année où les dernier rayons du soleil se glissent à l'arrière de la maison, je m'assieds sur l'une des marches de l'escalier de l'entrée. Sandra va faire le petit tour avec Oscar, Louise l'accompagne en trottinette jusqu'à la rivière. On entend les sonnailles des bêtes à Jean-Paul, Louise et Arthur jouent. Il y aurait tant à dire des hommes qui se réconcilient tandis que la nuit tombe. Il ne reste au soleil qu'une largeur de main avant de disparaître derrière le bois.
Jean Prod’hom
On a cessé de l'attendre

On a cessé de l'attendre, le printemps est là, il a enfin trouvé sa vitesse de croisière ; il est temps désormais de le retenir. On serait même prêts à tout pour que les cerisiers prolongent leur floraison et les hêtres le règne du vert tendre. On a vu aujourd'hui des soldanelles, des petites gentianes – les bleues –, les grandes sortent de terre ; les trolls sont prêts à éclater.

On laisse la Nissan en face de la chapelle de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, un peu après le Pralet. On longe la rive droite du Motélon jusqu'au Paquialet, avant de grimper jusqu'à Tissiniva, le lac n'existe plus. Trois jeunes marmottes jouent dans les marécages, d'autres lézardent devant leur terrier, celles qui se sont aventurées un peu plus loin rebroussent chemin sitôt qu'elles nous voient.
Cent mètres plus haut, six chamois paissent, aux limites des névés. On monte jusqu'au Plan où le chemin s'arrête.
Près de neuf cents mètres de dénivellation, ça suffit, on ne s'aventurera pas plus loin, à nous de rebrousser chemin, alors qu'il eût été possible – on l'apprendra plus tard –, de redescendre en suivant la crête jusqu'aux Noires Joux, puis en empruntant le chemin des Polonais.
Pause sur les rives du Motélon où l'on trempe nos pieds, un dernier bain à Charmey, quelques achats, le temps passe ; il était prévu qu'on soit à 17 heures à Vevey, on y arrive à 18 heures, on en repart à 21 heures, je boucle ces notes à minuit.




Jean Prod’hom
On est tous les cinq à nouveau réunis ce matin

Cher Pierre,
On est tous les cinq à nouveau réunis ce matin ; Sandra va acheter du pain, je monte avec Oscar au triage : la femelle couve.

Les quelques jours passés à Stockholm ont transfiguré le mousse, il considère ses sœurs avec bienveillance, elles le regardent comme un grand frère ; pourvu que ça dure, qu'il tienne bon jusqu'à cette sotte épreuve qu'est le certificat et qu'il dise adieu, souriant, à ses onze années d'école obligatoire. Avec l'envie d'entrer de plain pied dans un nouvel épisode de son existence, pour lequel il serait tout à fois le scénariste, l'acteur principal, et pourquoi pas le musicien. Je ramasse l'herbe râtelée hier et en fais un tas au pied du marronnier.
On laisse nos trois enfants à Vevey, chez Françoise et Édouard, Lucie est là. Arrêt à Bulle au musée gruérien ; Lorna Bornand y expose ses travaux, cheveux longs et cheveux courts, volutes et limaille, roux, bruns ou blonds. Fleurettes coupées par deux fois de leurs origines, ou dépouilles avec, à leur traîne, l'ombre des vivants et la voix des morts.
A côté, sous verre, une série de reliquaires contenant un peu de la toison du bien aimé ou de la bien aimée, fleurs épinglées promises à la poussière, épitaphes à pattes de mouches.
Bijoux au statut indécis ; pas trace de sang mais quelque chose à été coupé, ambiguïté, signes imputrescibles de la putréfaction.
Au fond d'une annexe, plongée dans la nuit, la peau d'une bête, étendue, la peau d'une bête collective, mille poignées de mille cheveux, innombrable, soyeuse, innommable, chatoyante. Ne pas toucher.

On se baigne au centre thermal de Charmey, mange au restaurant de l'Étoile. J'entends une belle chanson à la télé de l'hôtel, elle clôt l'épisode d'une série que je suis distraitement. Bruits de verre dans les containers, il est minuit, je me lève pour fermer la fenêtre.
Jean Prod’hom
La femelle couve

Cher Pierre,
La femelle couve, sans broncher, puis change de position ; j'entends tout autour, sans le voir, le mâle qui s'inquiète ; les laisse à leur travail et vais au mien. Sors la tondeuse du poulailler, pour la première fois cette année, c'était le dernier moment ; deux heures feront l'affaire.

Théâtre des Osses | Café littéraire (7 mai 2015) | Focus sur les éditeurs romands
Tondre ne met pas la tête à l'endroit, ni à l'envers, ne l'emballe pas non plus ; me reviennent toutefois à l'esprit une ou deux choses de la soirée à Givisier : la voix de Roger Jendly, liquide, goûteuse, mélangée à un peu d'hélium ; celle d'Anne Jenny, perchée, nerveuse ; celle de Geneviève Pasquier au goût de framboise, charnue ; celle de Nicolas Rossier, pensive, analytique. Mais aussi la précieuse gentillesse dont ne se départit jamais Jasmine, soucieuse ; l'oeil amusé de Pascal, Claire et Denise, et puis la généreuse hospitalité de toute l'équipe du café littéraire. Mais pas que. Il y également ici et là, bien apparentes, les certitudes et ses alliées, la suffisance et la surdité ; elles donnent toutes les trois l'envie de fuir. Entre deux les habituels propos nés du Grand partage : nous c'est le roman, vous la poésie, eux les témoignages ou les récits de vie. Il est parfois préférable de se taire.
Et ce désir de fuir, de laisser tout en plan, je l'explique par la présence, où qu'on soit, de deux types d'individus : ceux qui sont bien décidés à conquérir le monde, quel que soit le prix que d'autres auront à payer ; ceux qui, rongés par un ennui malfaisant, passent leur temps à se faire des ennemis pour ne pas être seuls et oubliés.
C'est décidé, je laisserai le gazon monter en herbe en-haut dans le verger, pour les papillons, les scabieuses, les marguerites, les bleuets, les centaurées. J'y taille une allée, étroite, pour Lili et ses chevaux, et des contre-allées qui se mettent à tourner autour du cerisier, du pommier, du prunier, du cognassier, la serre et les escaliers.
Louise et Lili mangent à l'école, je fais l'impasse sur le repas, vais jusqu'à Servion, m'installe sur la terrasse du motel des Fleurs avec Le Moindre Mot de Gil Jouanard. Me rends ensuite à la COOP d'Oron, il pleuvine.
Sandra est à la maison, on fait l'état des lieux, je lui raconte la visite de l'architecte ce matin : les échafaudages seront dressés mercredi prochain ; Sandra pense à tout, elle a installé un rudiment de cuisine dans le garage, nous sommes parés. Je râtèle l'herbe devant l'entrée et la véranda.
L'avion qui rentre de Stockholm a du retard, Sandra diffère d'une demi-heure son départ, on mangera sans eux la quiche et la tarte aux pommes que j'ai préparées. Je laisse filer la journée, bien décidé à ne rien en retenir sinon, tout à l'heure, le retour d'Arthur.
Jean Prod’hom
Il serait dommage de rater leur naissance

Cher Pierre,
Il serait dommage de rater leur naissance, je consulte donc mes notes au retour du triage... Le mercredi 15 avril, une tache rouge se détache sur un fond de bartasses ; la femelle se glisse sous les branches d'un sapin nain : ce sont deux bouvreuils pivoine. Il se confirme, le vendredi 17, que la femelle attend un heureux événement. Le jeudi 23, deux oeufs reposent au fond du nid, trois le lendemain, ils sont cinq le dimanche 26. Je les laisse tranquilles jusqu'au mercredi 29, les aperçois ce jour-là tout près l'un de l'autre dans les branches nues d'un jeune foyard. Aujourd'hui 7 mai, à 7 heures la femelle couve encore, pas trace du mâle.
Si le site des oiseleurs que j'ai consulté le 24 avril dit vrai, que 13 à 14 jours sont nécessaires pour que les oeufs éclosent, les deux premiers oisillons devraient voir le jour aujourd'hui ou demain. Mais si l'éclosion des premiers oeufs pondus s'alignent sur celle des derniers, il me faudra attendre samedi, dimanche ou même lundi pour fêter l'heureux événement.

Nouvelle expédition au Centre intercommunal de gestion des déchets, avec les petits cette fois ; le travail réalisé hier, la présentation exhaustive de ce que l'animateur allait nous présenter aujourd'hui, dans une perspective certes un peu décalée, a conduit une élève que j'ai interrogée après la visite à me faire la remarque suivante : Non seulement j'ai compris, mais je me suis sentie intelligente. Elle confirme une fois encore l'idée que celui qui n'a pas vu double n'a rien vu, que lire, c'est d'abord relire.
Fais quelques emplettes chez Jouanard, au Central, devant la porte grand ouverte qui donne sur la terrasse, temps de printemps : Ailleurs c'est n'importe où avant... Chez soi, toujours plus près de chez soi... Par le chemin de l'écriture, il tente aujourd'hui de regagner les berges fermes et les climats fertiles d'avant l'histoire...
Prends à 4 heures le chemin des écoliers pour me rendre à Fribourg ; lorsque je plonge sur la Sarine, les cloches de l'abbaye de Hauterive sonnent les vêpres. Je m'assieds sur un banc, une douzaine de Cisterciens sortis de je ne sais où s'installent dans les stalles savoisiennes de l'abside, l'un deux ouvre la grille de la clôture, ils chantent des psaumes devant une petite dizaine de fidèles, ou d'amis, ou de pèlerins. Leurs voix glissent le long des voûtes et remontent le long des piles pour finalement occuper tout l'espace : bonheur qu'un silence brutal interrompt, pour faire un peu de place au chant d'un merle resté dehors. Les moines s'éclipsent après avoir éteint les lumières du coeur, ils retournent je ne sais où, faire je ne sais quoi.
La Sarine, grosse des eaux des jours passés, ronge les parois de molasse, le pré gras me rappelle qu'il faudra que je m'occupe demain de l'herbe du jardin, un tailleur de bois a fait apparaître de beaux visages sur la tête de larges piquets de chêne.
Le théâtre des Osses n'est pas la porte d'à côté, Givisier non plus, c'est dire que je m'égare plus d'une fois ; ce sont finalement deux retraités, dont je fais la connaissance sur un rond-point paralysé, qui m'y conduisent. Et là, petit bonheur, Roger Jendly lit quelques extraits de Tessons.
Jean Prod’hom
Ce n'était pas prévu

Cher Pierre,
Ce n'était pas prévu, mais les circonstances en ont décidé autrement : nous regardons, les grands et moi, les 20 minutes que les journalistes de Viva, avec la collaboration de deux ethnologues, ont consacré en 1990 aux clubs de supporters de l'équipe de football de Naples, et notamment à celui des Quartieri spagnoli. Il est curieux de constater que les acteurs et les auteurs de ce documentaire tiennent un discours auquel il suffirait d'ajouter quelques doctes commentaires, pour en faire une analyse que ne désavouerait pas René Girard. Footballeurs, ethnographes, nous serons bientôt tous girardiens.

Images ensuite du musée archéologique de Naples, visité par Katherine Joyce dans Voyage en Italie ; des hommes et des femmes de pierre y ressuscitent. Ailleurs quelques mots, beaucoup de silences, à l'hôtel, dans la voiture, au bar ; rien de tranché, d'urgent, rien de décidé ; des frôlements, des froncements de sourcil, des rumeurs intérieures. Les élèves n'ont jamais rien vu de pareil, ils sont intrigués et ont du mérite ; ce qu'ils voient, et font, et disent, et vivent n'est pas à la même échelle, n'est pas saisi dans les mêmes formes ; film énigmatique, solide, qu'ils sont prêts à écarter de la main, mais qui pourrait les amener, s'ils ne sont pas offusqués par la beauté, jusqu'au seuil de ce qu'ils ne savent pas encore.

Google Earth
En route pour Berne ; un bus nous dépose à 14 heures 30 devant l'Ecole cantonale de langue française, à la Jupiterstrasse, où les élèves de 9ème participent à la finale du rallye mathématique transalpin. Cela me laisse une bonne heure pour aller et venir dans les allées des jardins familiaux qui jouxtent l'école. Des arrosoirs en pagaille, je fais près de 140 photographie, fébrilement, avec le regret de n'avoir pas su porter mon attention sur d'autres aspects de ce cabinet de curiosités.
Sandra m'écrit un mot, les enseignants ont bien accueilli le bouquin de physique sur lequel elle travaille depuis de longs mois. Les élèves remportent dans leur catégorie la seconde place du concours, ils ne cachent pas leur déception, au retour ils oublient. Dans le bus mes paupières tombent à deux reprises.
Jean Prod’hom
Je crains devoir me séparer bientôt

Cher Pierre,
Je crains devoir me séparer bientôt de la Yaris ; le collecteur d'échappement est en train de se faire la malle et le réservoir a vieilli. Je souhaitais prolonger sa vie au-delà des 200 000 kilomètres, la prochaine expertise pourrait sonner le glas de mes espérances, elle finira sa vie à l'exportation.

Propose aux grands, un peu avant 8 heures, un schéma du voûtage de la Louve et du Flon, du réseau des eaux usées et pluviales de la ville de Lausanne. Cette aventure souterraine commencée au début du XIXème siècle est extraordinaire, les élèves n'y sont pas insensibles.
Tout est beau et bon dans la première page du Grand Meaulnes, sans parler du reste. L'exploitation du tiret et du point-virgule permet non seulement de combler le manque lié à la linéarité de la langue, mais encore d'ouvrir sur une architecture invisible, qui se développe comme une fugue, de mot en mot, attaché chacun à une notion primitive, complexe, dont le sens fait osciller la phrase entre deux mondes singuliers, l'un qui s'éloigne, l'autre qui prend le large, établissant un quasi-lieu où reposent des souvenirs, des traces et des ombres.

Rendez-vous à 18 heures 30 aux Editions Antipodes pour une relecture des épreuves corrigées ; m'étonne du peu d'erreurs. On décide d'un calendrier avant d'aller croquer une morce au Baz'Art de l'avenue de France. Il est passé minuit quand je vais me coucher.
Jean Prod’hom
J'ai le plaisir d'apprendre

Cher Pierre,
J'ai le plaisir d'apprendre, en fin de soirée, que les Editions Samizdat, Faim de siècles et D’autre part parleront, mercredi et jeudi prochain au Théâtre des Osses à Fribourg (Focus sur les éditeurs romands), de leurs choix, de leur travail et de leurs combats pour publier les auteurs de notre pays. Roger Jendly, Anne Jenny, Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier liront les extraits des oeuvres proposées par les éditeurs tandis que la pianiste fribourgeoise Véronique Piller les accompagnera au piano. Tessons sera de la partie ; entendre Roger Jendly en lire des extraits, ce serait extra...

Bus numéro 8 jusqu'à Bel-Air, puis numéro 17 jusqu'au Galicien. Il nous faudra ensuite une dizaine de minutes pour atteindre, par Kleber Meleau, le Centre intercommunal de gestion des déchets.
Un animateur – le même qu'à Tridel – raconte aux élèves les grandes étapes de l'épuration des eaux à Lausanne, de l'évacuation des déchets directement dans la Louve et le Flon, du voûtage de la première en 1812 et du second en 1873, de la pose de plongeurs pour évacuer le tout loin des rives du Léman, de la mise en place de la station d'épuration en 1964, de la dérivation des eaux claires du Flon dans la Vuachère en 1996, de la restitution de celles de La Louve directement dans le lac.
Ne roulent aujourd'hui dans les anciens lits de la Louve et du Flon que les eaux usées. Coup d'oeil encore, en-bas la vallée de la Jeunesse, au déversoir du Capelard.





Si on peut considérer que le processus de la séparation des eaux claires et des eaux usées trouve son origine en 1812 dans le voûtage de la Louve, c'est en 1812 également que le Petit Conseil du Canton de Vaud arrête qu'aucun cimetière ne peut être établi dans l’enceinte d’une ville ou d’un village, que les cimetières seront clos et fermés et qu'ils ne serviront pas à d’autres usages qu’à enterrer les morts. Séparer les eaux claires et les eaux usées, les vivants et les morts, c'est tout un.
Je lâche donc les élèves dans le cimetière du Boix-de-Vaux, conçu par Alphonse Laverrière en 1912 en raison de la forte croissance démographique. Pour justifier une telle invitation qui leur semble tout à fait saugrenue, je précise que ce cimetière bien vivant, avec de vrais morts, est inscrit à l' Inventaire cantonal des monuments historiques et fait partie de la liste des Jardins historiques recensés par l'UNESCO. Ils s'égaient ensuite dans les allées, repèrent la tombe de Coco Chanel, de Pierre de Coubertin et d'un adolescent dont on a beaucoup parlé l'été passé. Je fais de mon côté quelques photos d'arrosoirs.
Le bus scolaire nous ramasse devant le siège du CIO, je reprends la Yaris derrière l'église du Mont. Me simplifie la vie pour le repas du soir, rédige l'article sur la course de trial de la veille pour les journaux locaux. Arthur est à Stockholm, il nous a laissé son absence.
Jean Prod’hom
Ropraz, une 30ème édition bien arrosée

Tom Blaser à 1 point du podium chez les élites
Les organisateurs, les juges et les pilotes ont regardé le ciel, consulté météo-suisse, sorti leurs amulettes, touché du bois et croisé les doigts, rien n'y a fait, la pluie ne s'est pas arrêtée ce 3 mai.
Mais le sport a des vertus qu'on n'imagine pas ; il a suffi d'un coup de sifflet pour que les septante concurrents relèguent les intempéries au second plan et se concentrent sur l'un ou l'autre des douze parcours tracés par René Meyer et Jean-Daniel Savary. Les cirés se sont mis à briller, les concurrents se sont battus loyalement et, comme toujours, les meilleurs se sont retrouvés devant.
Chez les Poussins, Théo Benosmane (2ème) et Jules Morard (3ème) sont montés pour la seconde fois en deux courses sur le podium ; ce n'est vraisemblablement pas la dernière fois... Derrière Jules et Théo, d'autres pilotes du Passepartout de Moudon se sont lancés courageusement dans la bataille, venus des alentours, de Thierrens, Puidoux et Vucherens, de Moudon, Hermenches et Promasens. On veut ici tous les citer, car ils ont été, sous cette pluie, admirables de courage : Alec Clerc (7ème), Bastien Perrin (8ème), Loïc Guyaz (11ème), Maxime Perrin (12ème), Maël Simon (13ème), Kelian Crausaz (14ème) ; mais aussi Nathan Bongard, Camille Girardin, et Romain Girardin qui on couru pour le fun. Un grand bravo à ces tout jeunes coureurs qui constituent l'avenir d'un club qui connaît toujours davantage de succès.
Idem chez les Benjamins, où Kouzma Rehacek confirme sa deuxième place de Savièse par une troisième à Ropraz. Les autres suivent à quelques encablures : Mathieu Habegger obtient une belle cinquième place, Jeremy Bolomey (7ème) le suit de très près. Thierry Remund (10ème), Thomas Girardin (12ème) et Colin Novelle (13ème) complètent le tableau.
Théo Grin (8ème) continue à progresser chez les Minimes, quant à Tom Selz (7ème), absent à Savièse, il revient à la compétition. Loïc Rogivue, troisième en Valais, finit à une magnifique seconde place dans la catégorie des Juniors.
Restent les Elites : si la pluie n'a guère convenu à Romain Bellanger (14ème), Steve Jordan a tiré son épingle du jeu en terminant à la 8ème place. Mais c'est Tom Blaser qu'il convient de féliciter aujourd'hui ; il termine, dans des conditions extrêmement difficiles, à la 4ème place, à un point seulement de Lucien Leiser, champion suisse 2014. Il s'est même payé le luxe de terminer 1er ex-aequo au terme du premier tour. Au bilan donc, excellent résultat d'ensemble du TCPM.
Et celui qui serait entré dimanche soir dans la grande halle vide de Ropraz aurait pu voir en son centre une belle tablée : l'équipe d'organisation et quelques bénévoles. Les rangements avaient bien avancé et ils avaient le sourire. Ils n'étaient pourtant pas prêts d'oublier cette 30ème édition d'une course dont ils sont tout à la fois les héritiers et les artisans, mais ils songeaient déjà à celle de 2016.
C'est à ce moment-là que le soleil, je crois, fit son apparition sur le visage des convives et alluma, en haut la côte du Mélèze, les fleurs de colza.
Jean Prod’hom
Les arbres pataugeaient dans les flaques d'eau

Cher Pierre,
Ce matin, les arbres dont la cime avait été rongée par le brouillard pataugeaient dans les flaques d'eau ; les colzas s'étaient éteints, chacun avait enfilé ses bottes ; on allait, c'est clair, vers une journée difficile. J'ai pensé aux bénévoles qui s'étaient mobilisés toute la semaine pour que la course soit une fête. (On n'imagine pas exactement l'engagement et le travail qu'il faut pour organiser une telle course.) Mais le sport a des vertus qu'on connaît ; il a suffi d'un coup de sifflet pour que les concurrents relèguent les circonstances au second plan et se concentrent sur l'un ou l'autre des douze parcours tracés par René et Jean-Daniel. Les cirés se sont mis à briller.

Je les ai quittés en début d'après-midi pour me rendre à Genève ; y retrouver Jasmine et Pascal, dédicacer quelques livres, revoir Céline, discuter le coup avec Nicolas Esse – un voisin dont j'ai lu, signalées par François Bon, les Epitaphes utiles pour ne pas être pris de cours en cas de mort imprévue. Ecouter Pajak, saluer Pahud chez Antipodes, acheter le Journal de Gustave Roud chez Empreintes. Je n'avais pas revu Rochat depuis des années, il me raconte, vite, ses années de fréquentation avec Ramuz.
Je rentre au Riau, fais un saut à Ropraz où l'équipe d'organisation a le sourire : les rangements ont bien avancé, il y a même un peu de soleil. Trop fatigué pour aller au-delà, je rentre, traverse la bibliothèque sans m'arrêter et vais me coucher.
Jean Prod’hom
Personne au Mélèze

Cher Pierre,
Personne au Mélèze, erreur ; on avait rendez-vous à 9 heures, c'est Jean-Daniel qui, passant par là, nous l'apprend. Arthur ne m'en veut pas de l'avoir réveillé au clairon ; on va s'offrir, en guise de consolation, un thé froid et un chocolat chaud à Mézières.

Les bénévoles arrivent à un peu plus de 9 heures et se mettent aussitôt au travail. La pluie a cessé, Jean-Daniel a mesuré 85 millimètres d'eau ce matin dans son pluviomètre ; dans les pentes, les champs labourés lâchent des coulées de terre. Nous nous mettons à trois pour organiser le bureau d'inscriptions et préparer les cartes de pointage.
Je fais l'école buissonnière en début d'après-midi, traverse la route de Berne, descends sur la rive gauche de la Bressonne, que je longe jusqu'au Moulin des Vaux, deux chiens aboient. J'aperçois à l'intérieur d'une clôture électrifiée une nuée de poules, un couple de paons, des canards, des oies ; plus loin une caisse grillagée avec des canetons ; adossée à la maison une volière avec des perdrix, des faisans, une autre dans un cabanon, des poules sur la table du jardin, et tout autour les chants des oiseaux de l'arche de Noé.
Je fais la causette avec l'un des deux locataires des lieux, ils sont là depuis une année. Lui, il est originaire de Braga, il cherche sans succès du travail dans le domaine de la mécanique de précison ; en attendant, il s'occupe avec son ami de plus de deux cent cinquante bêtes à plumes. Ceux dont j'ai fait la connaissance, mais aussi ceux que je ne verrai pas : des canaris, des diamants de Gould, des perruches callopsites, des tourterelles, des colombes, ... Ils vivent de l'aide sociale, des vingt oeufs qu'ils ramassent chaque jour et de peu.
Le responsable technique de la course a fait le tour des zones, tout va bien ; puisse le ciel faire le reste et nous garder du déluge.
Jean Prod’hom
Les prévisions sont inquiétantes

Cher Pierre,
Les prévisions sont inquiétantes, 6 heures, il fait cru, je fais du feu dans le poêle ; il pleut, il pleuvra cette nuit, il pleuvra demain, il pleuvra dimanche : pas bon pour la course de Ropraz.
Impossible de remuer Oscar, vautré toute la matinée dans un fauteuil ; vautré moi aussi, dans le mien, je poursuis la lecture du récit de Pierre-Laurent Ellenberger ; qu'il me faut suspendre pour faire des emplettes à Oron : fruits et légumes surtout, l'engagement végétarien de Louise ne nous facilite pas la tâche. Je prépare du riz et de la salade, pèle deux carottes et une pomme, prépare une tarte pour ce soir.

Louise rentre seule à midi, sans Lili qui pique-nique avec ses copines à Mézières ; elle rentre de petite humeur, peu satisfaite de ses travaux ; ils sont pourtant très bons et elle comprend vite les quelques erreurs qu'elle a commises. Des erreurs pleines d'enseignements, j'ai beau le lui dire, ça ne change rien, elle n'est pas contente et je la comprends ; rien ne sera repris de tout cela, il y a le programme, on n'a pas le temps.
Cette école fait des ravages chez tous nos enfants, les bons et les moins bons. Les notes, la langue de bois, les impératifs, les pièges et les fourches caudines réparties tout au long de leur parcours, l'absence de suivi réel, font des dégâts dont on n'a pas encore mesuré le coût réel, l'effet sur le capital de confiance ; nous sommes peu à penser qu'il pourrait en aller autrement, alors les choses continuent ainsi. Et les gamins se soumettent aux épreuves de ceux qui sont supposés savoir. L'évaluation à laquelle les gamins sont assignés est une réelle catastrophe, elle ne rend compte d'aucune compétence, n'atteste à la fin que de leur aptitude à se conformer aux normes et à supporter le dressage. Le concept de résilience, qui a bon dos, fait le reste.
Pour toi la guerre est finie, c'est le livre que m'a offert Karim la semaine passée. Il s'agit d'un récit posthume de Pierre-Laurent Ellenberger, né en 1942 et mort en 2004, qui raconte – plusieurs années après ? – ses journées à Lausanne, de 1966 (projection de La guerre est finie d'Alain Resnais) à 1972 (Tueries aux JO de Munich) ; qui raconte aussi les événements dont il a été le spectateur éloigné.
J'avais tout juste 17 ans lorsque le récit se termine, j'avais fait mes premiers pas dans les bistrots où Ellenberger a passé une partie de ses soirées, comme moi : Le Major Davet, Le Jour et Nuit, le café du Marché, le café des Philosophes...
En lisant ces pages, j'ai eu le curieux sentiment de n'être jamais vraiment entré dans ces cafés, ou seulement lorsque la fête était finie, d'avoir été un tard venu ou d'avoir passé à côté, de n'avoir été qu'un figurant : nous l'avons tous été. Cette impression est un effet de l'écriture, qui a le don de donner une seconde vie – la seule – à ce qui a été englouti, une consistance rétrospective – la seule – à ce qui a passé comme l'eau sous les ponts.
Il en va de même, mais à l'inverse, pour les romanciers, qui ne se sont dégagés qu'imparfaitement des motifs de leur maigre vie, si maigre qu'ils s'abreuvent à ce qu'ils ont lu. Rien de plus conservateurs donc, mis à part ceux qui ont fait basculer ou bifurquer les habitudes, en raison d'une expérience qui les a obligés à renouveler les caves et les combles du récit. Quant à la kyrielle de romans qui paraissent aujourd'hui, on voudrait parfois qu'ils touchent terre, apportent, comme les démonstrations mathématiques, quelque chose d'essentiel, de bref, quelque chose de simple et d'élégant, quelque chose de beau et de ramassé.
Je réchauffe du riz et fais sauter un émincé, on mange. Renonce ensuite à accompagner Sandra et les enfants au cinéma de Carrouge, monte à la bibliothèque et rédige ces notes; dehors le brouillard a plongé la nuit dans un noir épais, qui ne laisse passer que la pluie.
Jean Prod’hom
Voici ce que j'ai tiré de quelques mots décousus

Cher Pierre,
Voici ce que j'ai tiré de quelques mots décousus, tapotés à la va-vite sur mon natel ce matin, derrière l'Ecole hôtelière du Chalet-à-Gobet :
Les récits usent les plus résistants, le fil sur lequel on a pris l'habitude de pincer les événements dépérit, le présent ne remorque plus le passé, l'avenir est sur nos talons, voilà que les événements se mettent à tournoyer sur eux-mêmes comme des samares, et donnent naissance à autant d'îles que d'érables. Difficile d'y consentir sans inquiétude, mais on a tant besoin d'un peu d'éternité.
L'idée de destin a depuis toujours offert ses lettres de noblesse à la liberté, en rétrocédant le mince filet de l'histoire à l'étendue qui la borde, en rabattant la fin sur le commencement, en établissant ainsi la possibilité de la durée.

Pour le reste peu de choses à signaler, sinon ce mail que les enseignants de l'établissement dans lequel je travaille ont reçu ; qui les invite, avec les gamins dont ils ont la charge, à réfléchir à ce qu'ils pourraient bien mettre dans la capsule temporelle (50 x 50 x 72) qui sera mise en terre lors de l'inauguration du complexe scolaire dans quelques mois ; et qui sera réouverte dans 25 ans.
On ne peut que se réjouir, se réjouir que l'on pense à ceux qui viendront après nous, mais il convient qu'on s'interroge aussi sur la valeur de ces réjouissances. Car c'est vouloir encore garder la main sur l'avenir que d'exiger le jour et l'heure, que d'imaginer qu'il nous revient de choisir ce qui mérite de demeurer. Le demander aux enfants qui n'ont jamais participé aux processus de décision dans l'école est une manière de se débarrasser de ses responsabilités. On n'a jamais demandé aux mineurs de témoigner de leurs conditions pour les générations futures, mais on a pu souhaiter que les patrons des mines s'engagent à améliorer la vie difficile de leurs ouvriers, et qu'ils honorent leurs promesses. De quelque façon que ce soit, les dés sont pipés. Cette capsule temporelle me fait davantage penser à une bouteille de naufragés qu'à une pierre de fondation.
On pourrait, j'y songe, donner une autre dimension à cette capsule temporelle, l'agrandir au point qu'elle puisse contenir le complexe scolaire lui-même. Une conférence internationale réunie à Londres a levé mercredi les 180 millions d'euros manquants pour démarrer la construction du sarcophage de béton qui recouvrira le réacteur accidenté de Tchernobyl.
Nous descendons, Arthur et moi, à 18 heures 30. J'aménage avec J-P le bureau de la course et on bricole la tente des samaritains, qui donnera à la course de dimanche un petit air de Solférino.
Jean Prod’hom
Quand je dis vouloir éclairer l'obscurité

Cher Pierre,
Quand je dis vouloir éclairer l'obscurité, ou la nuit, ce n'est évidemment pas dans l'intention de la faire reculer, de la séparer d'elle-même ou de l'apprivoiser ; ni de repousser, comme on dit, les limites de mon ignorance, mais de faire voir ce dont le jour et la connaissance lui sont redevables, en saisir la matité et le lissé, les yeux fermés, les pleins, les vides, une voix ; disposer d'un lieu aussi, sans partage, sans nuage ; entier, sans bord et sans cadastre. J'ai quelquefois le sentiment, écrivant, d'en être entouré, de m'y ébrouer et de m'y frotter.

Cinq périodes à la suite qui me laissent presque intact, je file donc à la gare d'Echallens prendre les billets collectifs pour la semaine prochaine. Rentre ensuite par Poliez-le-Grand, Poliez-Pittet et Peney pour guigner un coin de morilles où j'allais autrefois, au bas de la route des Chênes : deux voitures sont stationnées, trois inconnus vont et viennent le long de la haie viive ; je continue mon chemin.
S'impose à moi chaque jour davantage l'idée que trop de vivants se sont donné le mot pour n'avoir à choisir qu'entre deux manières d'être : grogner ou se divertir. Autant d'attitudes qui ne font qu'entériner la situation sans issue dans laquelle nous nous trouvons. J'exagère certainement, mais c'est la raison pour laquelle je m'éloigne toujours plus loin des geignards et des amuseurs publics, qui reconduisent à leur insu les convenances, c'est-à-dire fournissent de nouvelles raisons à ceux qui en manqueraient encore, de se plaindre de ce qui est, ou de s'en détourner.
Dominique m'écrit de gentilles choses sur Tessons et me propose d'ajouter quelques mots à ceux qu'elle a écrits sur les arrosoirs. Je ne sais pas encore très bien à quoi ressemblera son livre, mais sa demande m'honore et j'accepte.
Une sourde fatigue s'installe, dans la tête et dans le corps, trop pour que je m'assoupisse ; monte au triage – m'y suis abstenu depuis dimanche –, m'approche à petits pas, fais quelques photos, plus près, l'oiseau file. Je vais m'asseoir sur une souche à une quinzaine de mètres du nid. Et ce que j'attendais depuis le début arrive, les deux bouvreuils sont perchés haut dans les branches d'un jeune foyard dont les feuilles sortent à peine de leur étui, restent là quelques minutes, jouent à clicli-mouchette. Je me mets à siffler : ils s'habituent peut-être à moi. La femelle m'interrompt et rejoint en quelques coups d'aile les cinq oeufs qui l'attendent.


Dans le deuxième des dix-sept volumes du Dictionnaire classique d'histoire naturelle que Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent a publié aux côtés d'Etienne Geoffroy Saint-Hilaire en 1822, je lis en rentrant ceci.
Ces Oiseaux se font chérir, non seulement par les agréments de leur plumage, mais par une sorte de sociabilité et de confiance dans l'approche de l'Homme. Pendant l'hiver, on les voit dans les campagnes, répandus sur les routes, autour des habitations, y chercher les petites graines que la nature semble leur avoir réservées à dessin sur les tiges flétries et desséchées, et c'est avec beaucoup de grâce et de vivacité qu'ils emploient leur instrument nourricier à briser l'enveloppe cornée ou ligneuse qui recouvre et cache l'amande salutaire. Au retour de la belle saison, ils se retirent dans les bois pour s'y adonner entièrement à l'amour ; le nid qu'ils construisent dans les buissons, consiste en un peu de duvet qu'entoure un tissu de mousse et de lichen, qui prend son point d'attache entre la bifurcation d'une branche : la ponte est de quatre à six oeufs. Les Bouvreuils, dont le chant n'a rien de bien agréable, sont cependant susceptibles éducation ; avec des soins peu extraordinaires on parvient à leur faire imiter le ramage de divers Oiseaux dont on admire la flexibilité de gosier. Ils rendent même les inflexions de la voix humaine au point que l'on y reconnaît des mots bien articulés.

Toute cette histoire me fait rêver – sans compter les points-virgules qui ont le don de me réjouir –, je vais essayer de leur parler, dès la semaine prochaine. D'ici là on mange en coup de vent les fromages et les salades que Sandra a préparées ; il est 18 heures 30, on descend à Ropraz ; on y reste jusqu'à un peu plus de 21 heures. Arthur se propose, alors que la nuit tombe sur l'herbe nouvelle et les champs de colza, de redescendre demain pour terminer la zone que René lui a confiée et que Jean-Daniel l'aide à réaliser. Je l'accompagnerai.
Jean Prod’hom
Rien ne prend le pas sur rien

Cher Pierre,
Rien ne prend le pas sur rien, je m'y fais et ça me convient. Ce qu'on raconte importe peu, pour autant qu'on le fasse entendre, qu'on en fasse deviner le grain, en éclairant les régions lointaines vers lesquelles il essaime, bien au-delà de ce qu'on voit et de ce qu'on croit. A cet égard l'organisation d'une grande ville n'en dit pas plus que celle du jardinet d'un Chartreux.

Pour y parvenir il faut être deux, celui par lequel, avec lequel et pour lequel le réel semble se déployer, même vitesse, même référence ; celui qui paraît s'en être retiré, si diffus et pointu qu'il croit parfois n'en être plus, immobile, hors jeu ; nos vies tournent. comme chez Kepler, autour de deux foyers, un premier - plein - autour duquel un ordre se fait, des aires se répartissent, des corps se mêlent, des mots s'échangent, des volontés s'unissent ; un second - vide - qui fait entendre une voix – née du silence – dont on use pour faire entendre de proche en proche ce qui existe hors de nous, dans un espace réduit, comme sur une puce ou une barrette de mémoire, vive plutôt que morte, en lui attribuant les propriétés qui sont aussi les autres.
Quant au bien et au mal, il se répartit selon les axes des représentations de nos souffrances ; il est vrai qu'il y a, en ce sens, parfois des urgences.
On voudrait rassembler ces deux foyers, on y parvient parfois lorsque la respiration de nos représentations épouse le rythme de ce qu'elles représentent, lorsque la phrase vertèbre le jour blanc ou le pas le quatrain,
Je fais un tour du côté du nouveau bâtiment scolaire ; des ouvriers plient à l'extérieur les échafaudages, d'autres peignent à l'intérieur les murs, posent des tableaux qui n'auront d'interactif que le nom. Réunion ensuite pour l'organisation de l'inauguration de ce nouveau complexe, personne n'y croit vraiment, on plaisante, on rit jaune. La séance se termine à 17 heures 30 ; je ramasse Arthur au Riau, on descend à Ropraz et, pendant qu'il s'entraîne, je donne un coup de main à Jean-Daniel et Tom qui préparent une zone pour les Elites. Sandra a préparé un soufflé au fromage et une salade de carottes. Les enfants ressortent jusqu'à la nuit dans le jardin, avec Oscar et leurs diabolos.
Jean Prod’hom
Une belle âme a fait du petit bois

Cher Pierre,
Une belle âme a fait du petit bois, Arthur vraisemblablement ; j'en saisis une poignée que je pose en équilibre sur une demi-page froissée du 24heures, ajoute par dessus deux morceaux de tilleul, minces, secs et boute le feu à l'ensemble. Une allumette a suffi, je ne peux m'empêcher de penser que la journée a commencé sous de bons auspices.

Edelweiss et Fleur attendent je ne sais quoi à la cuisine, leur écuelle est pleine ; je vide la machine à laver la vaisselle, remplis un tupperware d'un mélange de fruits et d'avoine, et hop ! à la mine. Le trafic sur la route de Berne se densifie chaque jour davantage, et si cette tendance se confirme, il me faudra partir plus tôt de la maison.
Je reprends avec les grands la réflexion commencée la semaine dernière sur la ponctuation, l'utilisation de la virgule et le destin singulier du point-virgule. L'extraordinaire quatrième paragraphe du premier chapitre de la première partie du Grand Meaulnes est à cet égard exemplaire. Du point de vue rythmique, mais aussi du point de vue de l'organisation des contenus, on imagine mal comment Alain-Fournier aurait pu faire sans ce mal aimé de la ponctuation. J'aimerais en convaincre les élèves.
Une longue maison rouge, avec cinq portes vitrées, sous des vignes vierges, à l'extrémité du bourg ; une cour immense avec préaux et buanderie, qui ouvrait en avant sur le village par un grand portail ; sur le côté nord, la route où donnait une petite grille et qui menait vers La Gare, à trois kilomètres ; au sud et par derrière, des champs, des jardins et des prés qui rejoignaient les faubourgs... tel est le plan sommaire de cette demeure où s'écoulèrent les jours les plus tourmentés et les plus chers de ma vie — demeure d'où partirent et où revinrent se briser, comme des vagues sur un rocher désert, nos aventures.
J'ai commencé depuis quelques années à retirer mes billes de l'école, ou plutôt à cesser d'y replacer tous les bénéfices qu'elle me procurait, d'en réinvestir ailleurs sans succomber au divertissement, dans une autre région, centrale. C'est bien compréhensible si on admet qu'il existe une vie en dehors du travail. Mais nous pourrions ne pas y prendre garde et courir le risque, à l'instant même où notre employeur prendra congé de nous, de manquer d'un coup de cette moitié de réalité sans laquelle l'autre n'est pas. La retraite des retraités est aussi exigeante, somme tout, que celle des ermites et des Chartreux.
Une assistante sociale s'entretient, à la table voisine du café où je fais halte, avec une femme prise dans un filet aux mailles si lâches qu'elle ne semble pas près de s'en défaire. Elle oublie tout, ne retrouve rien, elle dit je n'ai plus rien, plus de chien et je pose des lapins ; les hommes, je ne veux pas avoir à faire avec, ils m'exaspèrent, je voudrais les frapper. Elle dit encore je n'arrive pas me l'expliquer, mais j'ai peur qu'on me prenne pour une folle, j'avance comme si le chemin était déjà tracé et que je ne devais pas m'en écarter, et j'ai l'impression d'avoir déjà vécu tout ce que je vis, mes perceptions sont décuplées. J'ai des maux de tête, je ne peux plus rien faire, ni lire ni écrire, ni faire le ménage, ni promener mon chien ; mon chien, je l'ai ramené à la SPA, deux grandes promenades, c'était trop ; je ne vois plus mes enfants, on me les a retirés : sa voix s'éteint, je ne l'entends plus, celle de l'assistante claironne.
Arthur est devant Chez les Burdet lorsque je l'embarque ; au Riau le feu s'est éteint et il pleut, il n'y aura pas de seconde allumette ; sitôt rentré Arthur va promener le chien, les filles rentrent d'Oron, Sandra a fait des courses. On se retrouve tous devant une soupe et un morceau de pain, une salade et un oeuf au plat.
Les filles au lit, on prend une ou deux décisions concernant les travaux qui vont démarrer dans moins d'un mois. Arthur qui vient nous souhaiter une bonne nuit m'apprend que les belles âmes du petit bois, ce sont ses soeurs, Louise et Lili.
Jean Prod’hom
Les ornières des chemins sont remplies d'eau

Cher Pierre,
Les ornières des chemins sont remplies d'eau et les clairières détrempées, mais le soleil troue les nuages de temps en temps, il aura tôt fait d'éponger la pluie de cette nuit. Je monte au triage jeter un coup d'oeil à mes protégés : la femelle couve, je fais quelques photos ; le mâle passe en coup de vent et, caché dans la sapinière, lance des avertissements. J'essaie de m'approcher encore un peu, trop, la future mère s'éclipse et laisse cinq oeufs au fond du nid. Attends à quelques pas que l'un ou l'autre reviennent ; ils semblent bien organisés, la femelle réapparaît après un long détour, s'allonge discrètement sur ses oeufs et reprend sa couvaison là où elle l'a laissée.

Pouillot véloce
Louise me demande de l'aider à travailler sur la naissance du christianisme ; on passe une bonne demi-heure à traverser l'un des quatre chapitres qu'elle doit réviser ; pause ensuite. J'en profite pour terminer le compte-rendu de la course de trial de Savièse, en ajoutant quelques mots sur l'église de Saint-Germain et les noces, en fin de journée, de la pluie et du soleil. Sûr que le journaliste sportif de la Broye s'empressera de les supprimer ; je rouvre enfin le dossier de la Campanie et m'en vais d'Alphonse d'Aragon aux Quatre journées de Naples.
Je retrouve Louise après les quatre-heures, je n'ose dire ici ce que l'école attend d'une gamine de treize ans, c'est tout simplement une vilaine farce ; on décide donc d'aller terminer notre chemin de croix sur le plan de travail de la cuisine ; et pendant que je pèle des pommes de terre, émince des poireaux, des carottes, des tomates et les reste d'une courge, coupe des pommes, des poires, des oranges et des bananes, elle lit les dizaines de pages photocopiées d'un manuel d'histoire dont l'enseignant a fait souligner de longs extraits. Au terme de cette étude, précise l'habituelle page d'objectifs, l'élève sera capable de
- donner les raisons internes et externes qui plongent l'empire dans l'insécurité durant le IIIème siècle,
- citer l'essentiel de l'oeuvre de Constantin,
- énumérer les raisons du partage de l'Empire romain,
- citer quelques apports que la civilisation romaine nous a légués.
Mais aussi
- comprendre et utiliser le vocabulaire religieux (abbaye, abbé, baptême, cathédrale, clerc, clergé, diocèse, ecclésiastique, clergé, laïc, moine, monastère, pape),
- rendre compte de l'organisation ecclésiastique du haut Moyen âge ainsi que la distinction entre clergé et les laïcs.
- expliquer le développement du mouvement monastique,
- expliquer la toute puissance de l'Eglise sur la société au Moyen Age,
- mentionner quelques règles et principes de vie que l'Eglise imposait à ses fidèles,
- différencier l'architecture romane de l'architecture gothique,
- fournir les raisons qui ont poussé les chrétiens de l'époque à exclure certaines catégories d'individus de la société.
Ce n'est pas tout, mais je ne prendrai pas la peine de transcrire la seconde série d'objectifs, ce serait indécent. Pauvres enfants ! pauvre histoire ! pauvre école !
La lecture de deux textes qu'Eric a écrits et dont il m'a parlé l'autre jour à l'occasion de notre balade au bord du lac de Neuchâtel m'apaisent : lire ce qu'un ami a pris la peine d'écrire, pour dire au plus près ce qu'il pense, m'a toujours fait du bien.
Jean Prod’hom
Ouverture de la saison en fanfare à Savièse

Concurrents et copains, Théo (2ème) et Jules (1er), ont dominé leur catégorie (Photo | Philippe Benosmane)
Si le soleil n'a pas été au rendez-vous, la pluie est restée si discrète que les parapluies sont demeurés fermés. Belle journée donc.
Il a fallu que les pilotes s'habituent d'abord aux modifications du règlement, et tout particulièrement aux deux minutes qui leur sont désormais imparties pour boucler chacune des zones. Pas le temps donc de regarder, de l'autre côté du Rhône, les restes de neige sur les hauts de la piste de l'Ours, ni les vergers en fleurs.
Les pilotes du TCPM ont fait fort, très fort ; voyez plutôt.
Dans la catégorie des Poussins, Jules Morard et Théo Benosmane ont terminé ex-aequo avec huit points de pénalité seulement ; c'est donc le nombre des sans faute qui les a départagés. A ce jeu, Jules est le vainqueur. Trois autres pilotes du TCPM participaient dans cette catégorie pour la première fois à une compétition : Maël Simon de Moudon termine à une belle 10ème place ; les deux frères Maxime et Bastien Perrin de Puidoux obtiennent respectivement les 7ème et la 5ème places.
Kelian Crausaz (11ème) et Thomas Girardin (10ème) ont réalisé, eux aussi, leur première course à Savièse, mais chez les Benjamins ; quant à Jeremy Bolomey et Matthieu Habegger, ils continuent leur apprentissage. Il faut féliciter haut et fort Kouzma Rehacek qui, vainqueur la saison passée chez les Poussins, monte sur la seconde marche du podium pour sa premier course dans cette nouvelle catégorie, à un point seulement de la première marche. Théo Grin termine à la 9ème place chez les Minimes.
Bravo à Arthur Prod'hom qui obtient une belle 2ème place chez les Cadets, mais il a choisi de rejoindre, dès la prochaine course, les Juniors. Loïc obtient dans cette catégorie une remarquable 3ème place.
Quatre pilotes du club de Moudon sont engagés chez les Elites. Il faudra les surveiller tout au long de la saison : Steve Jordan (12ème), Romain Bellanger (11ème), Brian Allaman (8ème) et Tom Blaser (5ème) pourraient réaliser de belles choses.
Impossible de quitter Savièse sans faire un saut à l'église Saint-Germain dont le clocher a veillé sur la journée. Il y a bien sûr Ernest Biéler, ses vitraux et les mosaïques du chemin de croix qui, à certains endroits, ne font pas tant penser à Byzance qu'à Cordoue, mais il y a surtout les hautes colonnes de tuf dont les nervures se déploient, sans chapiteau, jusqu'aux clés de voûte, et les voutains recouverts de chaux, qui font penser aux ailes ouvertes des piérides de l'aubépine.
Au retour, la pluie qui nous avait épargnés toute la journée se met à tomber, elle mêle ses traits aux rayons du soleil ; tous deux déposent sur le bitume et dans le ciel deux immenses feuilles d'or.
Rendez-vous à Ropraz dimanche prochain pour la seconde manche de la Coupe suisse de trial, il y aura du spectacle. Mais il y aura aussi à boire et à manger, pensez donc, c'est la trentième édition de cette épreuve d'envergure nationale... internationale cette année, puisque vous pourrez y voir à l'oeuvre Gilles Coustellier, une figure extraordinaire du trial, champion du monde à plusieurs reprises. Venez nombreux !
Jean Prod’hom
Échos avant l'aube d'une fête techno

Échos avant l'aube d'une fête techno qui secoue notre cage thoracique ; craquements d'os dans les combles, Fleur se fait les dents ; sonnerie du téléphone enfin, c'est l'heure. Le billet de la veille étant resté en plan, je commence par là, il est 7 heures lorsqu'on quitte le Riau plongé dans la grisaille. Pas de circulation sur l'autoroute, ni sur la route qui monte à Savièse. On fait une halte au centre de Saint-Germain, Arthur achète des boissons à la COOP, je sors de la boulangerie avec des pains au chocolat.

Arthur se rend au bureau des inscriptions ; trop tard pour rouler dans la catégorie des juniors, il restera donc avec les cadets pour cette première course de la saison. On se donne rendez-vous à dix heures, j'en profite pour entrer dans l'église paroissiale de Saint-Germain.
Alors bien sûr, il y a Ernest Biéler, ses vitraux et les mosaïques du chemin de croix qui, à certains endroits, ne m'ont pas tant fait penser à Byzance qu'à Cordoue, mais il y a surtout les hautes colonnes de tuf dont les nervures se déploient, sans chapiteau, jusqu'aux clés de voûte, et les voutains recouverts de chaux, qui font penser aux ailes ouvertes des piérides de l'aubépine.
Arthur réalise une belle moitié de course, il est surtout moins fébrile que l'année passée. Une main par terre, lors de son dernier passage, lui rapporte 5 points de pénalité, ce qui ne l'empêche pas de terminer à une belle seconde place.
Départ de Savièse à un peu plus de 17 heures, arrivée dans la cuisine du Riau à 19 heures 30 ; je cuis des pâtes, lave de la salade, Sandra prépare une sauce, je plonge une poudre à la vanille dans un demi-litre de lait, le tour est joué.
Et pendant que Sandra et les enfants regardent Pirates des Caraïbes 4 ou 5, je travaille au compte-rendu de la course de Savièse, sans en venir à bout. La pluie qui nous a épargnés toute la journée se met à tomber, elle mêle ses traits aux rayons du soleil ; tous deux déposent déposent sur le bitume et dans le ciel deux immenses feuilles d'or.
Jean Prod’hom
Un troisième oeuf est né

Cher Pierre,
Un troisième oeuf est né, je suis allé le voir ce matin à vélo ; sans Oscar qui fait trop de bruit. J'ai taillé au sécateur quelques rameaux du saule qui a poussé entre eux et moi, la femelle s'est envolée. La femelle est revenue, le mâle ne s'est pas montré. Me réjouis des jours prochains.

En roulant sur le chemin du retour, sous le soleil, avec les chants à la fois pointus et liquides des oiseaux, le vert de l'herbe nouvelle, avec le ruisselet et les chevreuils dans le pré de la Mussilly, les ruches et tout ce qui autour ne demande rien, avec la campagne et les bois qui bougent à peine, je songe une fois encore aux récits d'André Dhôtel, avec la conviction que la féerie et le délicat tremblement qui traversent ses récits sont bien réelles.
Je lis au retour, sur un forum d'oiseleurs – Au paradis des canaris –, la notice concernant Pyrrhula pyrrhula europoea. J'y apprends que les bouvreuils s'élèvent en volière, avec des chardonnerets et des verdiers par exemple, qu'ils demandent en captivité autant de soin que des nourrissons de notre espèce.
- Le bouvreuil présente comme caractéristique une allure trapue, accentuée par son bec court et massif qui lui a valu son nom de « petit bœuf ».
- Le bouvreuil est un oiseau relativement discret. Il aime fréquenter les bois assez denses, les buissons touffus à la végétation broussailleuse, les parcs, les jardins ainsi que les vergers. En montagne, il se retrouve dans les forêts de conifères où il monte très haut.
- Le bouvreuil pivoine est, lui, sédentaire, où il erre en petite bande à la recherche de nourriture.
- Dans la nature, le bouvreuil aime construire son nid dans un buisson épineux, un thuyas, un petit résineux, etc… à une hauteur relativement faible au dessus du sol (généralement à moins de 2 mètres du sol). Pendant la construction du nid, le mâle, qui a choisit l’emplacement, accompagne fidèlement sa femelle qui bâtit le nid avec des brindilles sèches de bois, d’herbes, de poils, de plumes, de lichens, etc… Pendant toute cette période, le couple se dissimule avec soin.
- Pendant la période nuptiale, le mâle chante de plus en plus. Il va prendre une brindille dans son bec et sautiller autour de la femelle en gonflant son plumage. La femelle va pousser des petits cris et entamer également des petits sauts, allant et revenant vers le mâle. Les rectrices de leur queue sont également écartées. Les deux oiseaux donnent ainsi l’impression de danser. De plus, la becquetée avec la femelle est un autre signe de pré accouplement.
- Deux couvées peuvent être réalisées chaque année, d’avril jusqu’en août. La femelle pond quatre à six œufs au fond bleu pâle tacheté de roux, de dimensions moyennes de 21,4 |14,8 mm pour le ponceau et de 19,3 |14,4 mm pour le pivoine, que la femelle couve seule 13 à 14 jours, tandis que le mâle la nourrit au nid. La femelle ne réchauffe plus ces jeunes vers le 11ème jour après la naissance. Les jeunes quittent le nid entre le 15ème et 17ème jour. L’élevage des petits est assuré par les deux parents. Néanmoins, il est conseillé de laisser la femelle élever seule ses jeunes, le mâle étant placé dans une cage concours, car il a la fâcheuse habitude de tuer les jeunes. Ce problème est dû notamment à une nourriture très riche en captivité, surtout avec les vers de farine qui l’incite à se reproduire.
- Le bouvreuil est un végétarien, se nourrissant principalement de graines, semences végétales, baies, bourgeons. Lorsque l’occasion se présente, quelques insectes complètent son menu, surtout en période de reproduction.
Une jeune femme, tout droit sortie d'une bande dessinée, passe une partie de la matinée dans la maison à repérer les traces d'amiante. J'en profite pour terminer notre déclaration d'impôts et réunir les éléments qui devraient figurer sur le carton d'invitation pour Terres d'écritures, que j'envoie à Romain.
Les plus hautes instances de la Direction générale de l'enseignement obligatoire (Direction organisation et planification) remercient, par courrier électronique, les enseignants pour leur compréhension et leur patience dans un contexte délicat ; depuis le 20 mars dernier en effet, la navigation Internet est extrêmement difficile, voire impossible sur certaines pages et à certains moments de la journée. Cela a pour conséquence un impact négatif considérable sur le travail des uns et des autres avec les outils informatiques. On s'en est effectivement rendu compte.
L'extraordinaire n'est pas tellement dans l'incident lui-même (qui révèle, une fois encore, la fragilité des réseaux actuels de communications à "très haut débit"), mais dans la coïncidence relevée dans l'historique : les premiers signes de lenteurs sur le réseau des réseaux ont été repérés lors de l'éclipse solaire, le 20 mars 2015 ; nous laisserons aux épistémologues le soin de tirer routes les conséquences de cette fabuleuse coïncidence.
Il y a des adultes qui mériteraient une fessée, interdite de nos jours ; leurs coquetteries, les méchants chemins qu'ils empruntent, les calculs qui les rongent pour ne rien perdre de ce à quoi ils ont droit, leur suffisance, leur arrogance, la bêtise, tout de leur vie les assèche, comme ces écorces qu'on répand dans les plates-bandes pour bâillonner les mauvaises herbes. Ils parasitent la société qui les nourrit, sans l'élégance du gui, accablent leurs voisins ; ils ne méritent pas même qu'on leur donne des noms d'oiseau. Un courrier reçu par la poste ce matin m'en donne à nouveau une nouvelle preuve. L'écrire m'aura fait du bien.


C'est aujourd'hui l'anniversaire de Sandra. Françoise et Edouard nous ont invités à Vevey, tôt, puisque nous allons Arthur et moi à Savièse demain pour la première manche de la Swisscup trial. Lili reste au Riau, c'est l'anniversaire de Mylène. Edouard nous a à nouveau gâtés.
Jean Prod’hom
Les bêtises nées de l'impatience

Les bêtises nées de l'impatience menacent de faire fuir ce qui nous est cher et qu'il nous aurait suffi d'attendre ; ainsi ce matin : en dépit de ma promesse de ne pas m'y rendre avant la fin de la semaine, je retourne au-dessus du triage m'assurer que les deux bouvreuils n'ont pas déserté les lieux en abandonnant leur nid. Je m'assieds dix minutes sur une souche, à bonne distance ; aucun rameau ne balance, pas un bruit.
M'approche pour en avoir le cœur net, lève une branche, s'envole l'oiseau rose. Restent deux œufs dans une pelote d'herbes sèches, dont je m'empresse de faire une photographie avant de déguerpir en me rongeant les ongles. Attends à trente pas le retour de mes protégés que j'ai chassés, ils tardent. J'aperçois finalement, à la cime du haut sapin qui surplombe leur domaine, une tache rouge immobile. Ni une ni deux, je m'en vais et m'en veux de ma précipitation, en priant les dieux que les oiseaux sachent distinguer les maladroits des voleurs.

Au Mont, la vie continue, plus d'insectes sociaux mais moins de couleurs, beaucoup de dedans et peu de dehors, à nous d'ouvrir les fenêtres, j'essaie de le faire tout au long de la matinée.
On mange, Celsa et moi, les dernières dents-de-lion sur la terrasse du Central ; Naples se rapproche, on avance, une sieste serait la bienvenue.
Je passe l'après-midi avec les petits du premier, entre médiathèque et salle de classe, à tout faire pour qu'ils se détournent un moment du groupe qui les aliène et trouvent un peu de repos dans un livre. Ils finissent par y parvenir, presque tous, sans hâte, quand bien même l'un d'eux se montre si récalcitrant qu'il me condamne à le tenir en laisse. Elle me suffit l'idée que les enseignants auraient à offrir à chacun des élèves qui leur sont confiés un lieu et un moment pour leur permettre, sans jamais les occuper, de rassembler leurs désirs mis en pièces par les vendeurs de loisirs.
Ramasse Arthur à l'arrêt de bus du Riau, le dépose à Ropraz pour l'entraînement, file à Thierrens où j'embarque les filles, comme tous les jeudis. Ce qui change aujourd'hui c'est qu'il me faut encore aller donner un coup de main au Mélèze, la course a lieu dans un peu plus de semaine. Il est près de 23 heures lorsque je rentre, Arthur me montre la coque vide de son natel ; je regarde admiratif la tas de pièces qu'il en a retirées, en couvant l'espoir qu'il soit capable de replace l'un dans l'autre.
Jean Prod’hom
Le réservoir d'essence

Cher Pierre,
Le réservoir d'essence de la Yaris goutte depuis deux jours, je la dépose à 7 heures au garage. Lance ensuite dans les trois classes, à partir de trois textes différents, la même activité à visée technique : identification du degré de solidité des différentes régions de la langue, utilisation des moyens de référence, extension du doute. Je mange un bircher à la salle des maîtres.

Le garagiste m'apprend à 13 heures, en grimaçant, que le réservoir est vraisemblablement troué, sur le haut, mais que ce n'est pas très grave ; il parie qu'il cessera de goutter lorsqu'il sera à moitié vide. Il vaut mieux toutefois prendre un rendez-vous ; on le fixe pour la semaine prochaine. Il m'indique avant qu'on se quitte qu'il a eu le temps de poser les pneus d'été.
Éric m'attend devant la gare d'Yverdon, on va sous le soleil jusqu'à Champ-Pittet, il me raconte les années difficiles qu'il a vécues depuis la fin de notre mandat au Burofco, pleines trop pleines : la surcharge de travail, la famille, ses dernières années à la HEP. Les foulques, les colverts, les grèbes font un bruit d'enfer, on boit un coup sur la terrasse de la buvette du Centre. Il y a deux ans qu'il est à la retraite, j'y serai dans deux ans et demi, je tends l'oreille.
Céline et Sylviane nous accueillent à la librairie de l'Etage, Aude est déjà là, Karim nous rejoint. Puis des visages connus, Marc, Isabelle et leur enfant, Lucie et Annette : une bonne douzaine de personnes en tout.
Nos hôtes ont de l'énergie et des sourires à revendre, Céline lit des extraits des Neiges de Damas et Karim de Tessons. Table ronde ensuite, impressions de lecture et d'écriture, bribes de récits. C'est la première fois que je participe à ce genre de réunion, on finit autour d'un verre, nous dédicaçons quelques livres. Agnès me confie être une fidèle des marges dont elle lit les billets le soir avant de s'endormir ; mes petites histoires, ce que je dis de l'école, ma rencontre avec le bouvreuil l'autre jour ne la laissent pas indifférente. C'est le plus beau des compliments.
C'est à la pizzeria du tennis que nous finissons la soirée, nous sommes six ; on raccompagne Aude et Lucie qui rentrent à Genève en train, nous sommes quatre ; on laisse Céline et Eric devant le1400 où l'on a bu un café, nous sommes deux ; Karim me dépose à l'hippodrome, je suis seul, guigne sous la Yaris : pas d'essence. Je rentre dans la nuit qui s'allonge par Valeyres, Ursins, Orzens, Oppens, Rueyres et Fey. Personne sur la route mais un chevreuil.
La maison est silencieuse, je ferme la porte à clé ; il y a de la lumière dans la bibliothèque, je monte embrasser Sandra. Dehors, la nuit s'épaissit.
Jean Prod’hom
L'utilisation du langage

Cher Pierre,
L'utilisation du langage assure, à lui tout seul, le maintien de la paix parmi les hommes et nous autorise à l'imaginer perpétuelle ; on aurait pu aisément se passer de la monnaie. Mais ni le premier ni la seconde ne sont capables de faire autre chose que d'établir des relations d'équivalence entre des réalités aveugles. Qui peut en effet imaginer que l'autre perçoit, éprouve, pense ce que je pense, éprouve et perçois ? C'est pourtant cette supposition reconduite dans nos échanges qui nous fait croire en retour que ce que nous pensons, éprouvons et percevons confusément pourrait être dit.

C'est à Oron, que j'écris ces propos pour le moins décousus, en attendant Lili qui court, saute et lance. Au café de l'Union, devant une verveine ; la porte de l'établissement est ouverte, mais le dehors ne se mêle pas au dedans, un seuil large comme la main l'en empêche. Nous sommes 4 clients à deux pas les uns des autres : un ouvrier qui mange, un retraité devant un verre de rouge, un quadragénaire qui tapote sur son portable. Cette mise en scène qui assure la paix de l'espèce est d'une complexité qui donne le vertige. Nous sommes parvenus à nous désolidariser des processus physiologiques pour n'abriter qu'un esprit. C'est de très loin qu'on entend désormais battre nos coeurs, sans y croire vraiment, ou dans l'effroi.
Retour par Ropraz où les jeunes cygnes se sont mis à déployer quelques-unes de leurs 24 vertèbres cervicales, l'air a fraîchi ; Sandra a préparé un gratin de choux-fleurs et une tarte aux framboises.
Il est peu de personnes qui ne se soient amusées, à un moment quelconque de leur vie, à remonter le cours de leurs idées et à rechercher par quels chemins leur esprit était arrivé à de certaines conclusions. Souvent cette occupation est pleine d’intérêt, et celui qui l’essaye pour la première fois est étonné de l’incohérence et de la distance, immense en apparence, entre le point de départ et le point d’arrivée. (Edgar Allan Poe)
L'harmonie universelle a toujours fait l'économie des substances.
Jean Prod’hom
Debout un peu avant 6 heures

Cher Pierre,
Debout un peu avant 6 heures, tandis que le jour se lève à peine ; la bise est tombée. Traverse le jardin pour vider les cendres du poêle sous le marronnier, fais tintinnabuler la vaisselle de la machine à laver : poignées d'assiettes, de fourchettes, poignées de couteaux ; fais du feu.

Ça m'est devenu toujours plus difficile de reprendre le travail après les vacances, de me refaire une assurance. Mais sitôt arrivé à la mine, le plaisir grandit lorsque les mômes se penchent sur leur ignorance ; les choses se remettent en place et soudain tout s'éclaire. Belle matinée à la bibliothèque avec la moitié des petits, à Baulmes avec l'autre ; belle après-midi à Naples avec les grands, à la salle des maîtres avec des collègues ; belle soirée à Ropraz avec les membres du comité du TCPM : le certificat est en boîte, la course de Ropraz bientôt du passé.
Toutes ces activités m'auront toutefois coupé les jambes, sans que je sois parvenu une seule fois à me retrouver autrement qu'en avance ou en retard, à chaque coup précédé ou suivi par des leurres.
Oh! si, chez Jean-Daniel, lorsque les deux cygnes noirs et leurs trois petits m'ont ramené du côté des vivants vivants, de ce qui n'était déterminé ni par le temps ni par le lieu. Parfois il faut tenir, à peine, le moins possible ; permettre ainsi à ce qui sommeille de rompre la loi des fatalités, au soir d'aller et de revenir, sans hâte, jusqu'à la nuit.
Jean Prod’hom
Il fallait en avoir le coeur net

Cher Pierre,
Il fallait en avoir le coeur net ; je suis donc allé à 7 heures au-dessus du triage, assis une demi-heure dans la sapinière, inquiet que ma présence trop insistante des jours passés près de leur nid ne les ait eux inquiétés. Soulagement lorsque le bouvreuil me fait une visite, sa compagne le rejoint. Ni les motards ni moi ne les auront dissuadés, je m'en réjouis ; ils ne restent pourtant pas longtemps, comme s'ils se méfiaient. C'est décidé, je n'y retournerai pas avant vendredi prochain.


Bruand jaune mâle
Sandra et les filles se rendent chez Marinette, Arthur dort, je monte à la bibliothèque. Après-midi studieuse à écouter su Youtube les entretiens de Felix Guattari et à regarder des images sur Naples ; écoute à la radio Schifano très en colère contre l'unification de l'Italie et l'exploitation du sud qui s'en est suivie. Fais une mayonnaise et cuire des artichauts, râpe des carottes rouges, prépare un bircher pour demain. Après le repas, Louise me pose quelques questions sur le récit d'aventures, mais renonce aux questions d'orthographe qu'elle voulait me soumettre, on renvoie à mardi. Retourne à Naples jusqu'à 21 heures.
Jean Prod’hom
Comment y voir clair dans le brouillard

Cher Pierre,
Comment y voir clair dans le brouillard ? et les bêtes sauvages, s'en réjouissent-elles ? Les changements climatiques, secondaires, infléchissent-ils leurs habitudes ? Connaissent-elles l'hésitation ? Et leur semaine est-elle rythmée par ce qui correspond à nos weekends ? lèvent-elles la tête le dimanche quand sonnent les cloches de l'église ? Leur arrive-t-il de prolonger, comme les hommes, leur sommeil, ou leurs rêveries ? Vivons-nous dans le même monde ? ou chaque espèce a-t-elle son ciel et des manières toutes à elle de s'interroger au coeur d'une énigme qu'incontestablement nous partageons. Elles sont à coup sûr notre chance et notre avenir, en ce sens qu'elles ont choisi de ne rien nous dire.

On finit par se lever et je dresse la liste des courses du weekend. Sandra et les filles se rendent elles aussi à Oron, pour acheter des cartons utiles au stockage de nos affaires pendant les travaux et des fleurs que Louise veut placer dans la plate-bande.
C'est un constat sur lequel tous les observateurs avisés s'accordent, l'agressivité des automobilistes, insupportable au premier étage des parkings, se réduit à mesure que l'on descend dans les étages inférieurs pour totalement disparaître au dernier. Par un paradoxe que les sciences de l'homme connaissent bien, ce constat ne peut être fait que par ceux du dernier étage, qui ont compris que s'éloigner de leur but les en approchait parfois considérablement. Alors que ceux qui auraient tant besoin d'un peu de paix et de recul s'agitent, tournent, vitupèrent à deux pas du leur.
C'est ce à quoi je pensais assis dans la Yaris au parking de la COOP d'Oron, ce matin, rempli de véhicules jusqu'à la gueule, en raison du comptoir qui a ouvert ses portes, mais qui offrait en périphérie d'innombrables places, avec le vent qui agitait l'herbe déjà haute, le ciel et le piaillement des moineaux. Je m'y suis trouvé si bien que je me suis demandé pourquoi je ne resterais pas jusqu'à la nuit, comme cela m'arrive parfois lorsque je m'étends sur les herbes sèches en-dessus du triage. Et c'est dans ces instants, je crois, que l'envie d'écrire ou de ne pas écrire est la plus forte, parce qu'il n'y a presque rien tout autour.
Et si je suis malgré tout de retour à la maison, c'est bien parce qu'il a bien fallu que je me décide à glisser dans un caddie des cornflakes, du lait entier de Gruyère, des fruits, des légumes et du riz. Mais je l'ai fait de très loin, avec dans les yeux les herbes hautes et le ciel, à distance des états d'âme des gens, et en même temps très près de leur cœur. Cette aventure m'a fait penser à l'écriture de Walser, à cette ligne mélodique qui fait entendre l'harmonie des mondes disjoints, qui concourent soudain, miraculeusement, à ce qui pourrait être et qui est. Oui, la vie est très belle, pleine de surprises et de noirceur, d'agitation et de sourires.
Au parking, les oiseaux se sont réjouis de mon retour, heureux, je crois, que je leur demande comment ça allait pour eux, et les herbes hautes ont applaudi.

Mésange nonette
Olivier entreprend de nouveaux travaux à Ferlens, un peu obligé par les circonstances ; le jardinet au sud des écuries est charmant. On ne s'était pas revus depuis plusieurs années, si bien qu'on a beaucoup parlé ; les moineaux se sont succédé au goulot de la fontaine, visible de la table de la cuisine autour de laquelle on était assis.
Le brouillard s'est levé, les pommes-de-terre sont pelées et coupées, la courge et les poireaux lavés et émincés, la tarte au four, les pointes d'asperge blanchies. Je confie le tout à Sandra et vais rejoindre au-dessus du triage le couple le bouvreuils et leur nid. Invisibles! Ai-je été trop présent ces derniers jours ou les motards qui vont et viennent sur leurs engins trafiqués les dissuadent de se montrer ?
Sandra et les enfants jouent aux dés lorsque je suis de retour, je fais cuire du riz et râpe du fromage. La rentrée c'est pour après-demain, Lili nous confie pendant le repas sa position sur la question : elle n'en veut pas à Charlemagne qui a inventé l'école, mais elle en veut sérieusement à celui qui l'a rendue obligatoire. Je ne suis pas loin de penser comme elle.
Jean Prod’hom
C'était donc ça

Cher Pierre
C'était donc ça : si la femelle que j'ai aperçue hier, et deux fois ce matin, se cache dans les branches du sapin nain, c'est pour y construire un nid, tandis que le mâle, bien visible, fait le guet. J'aurais pu le deviner le premier jour ; mais c'est tout autre chose d'avancer dans l'ignorance et de se réjouir de ses découvertes.

Cette histoire est d'autant plus curieuse que Sandra me fait voir le premier exercice de la première partie du manuel de physique dont elle est responsable, rédigé il y plusieurs mois déjà.
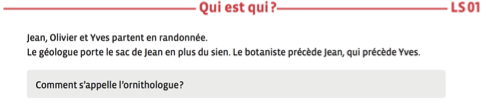
J'ai rendez-vous à 15 heures au Musée de Vidy où je salue Laurent qui travaille dans son bureau à sa prochaine exposition ; je récupère le carton contenant les tessons. Le lac, qui est à son niveau le plus bas, m'invite à aller jeter un coup d'oeil, jusqu'au pont de la Chamberonne au pied duquel je trouve une fleur bleue.
L'autoroute est bien dégagée si bien que j'arrive à l'heure à Baulmes ; l'hôtel de ville ressemble à un château, sa construction a été financée par les ventes de bois, m'explique Joël, le garde-forestier, des bois qui occupent la grande partie de la commune. La baisse des prix et le gui dont les graines sont rejetées et dispersées à la cime des sapins par les grives sont les principaux responsables de la baisse des revenus de cette petite ville de 1000 habitants, située au pied du col de l'Aiguillon.
Ce n'est pas loin de ce col que Joël m'emmène, à Grangeneuve où la classe des petits passera trois jours. Il se propose de nous accompagner un peu plus haut, dans la forêt de Limasses, et de nous raconter l'histoire de sapins trois fois centenaires, dont les deux plus imposants portent les noms de président et de vice-président ; de pique-niquer avec nous – ce Joël mérite d'être connu.
De nous retrouver également le lendemain dans un petit refuge, à deux pas de la carrière des Rochettes dont l'exploitation du calcaire marneux, souterraine d'abord, transformé dans l'usine de Chaux et ciments à Baulmes, a connu ses heures de gloire dans la première moitié du XXème siècle. Elle s'est poursuivie à ciel ouvert après la seconde guerre, jusqu'en 1962. Il faut noter encore que le dénommé Joseph Bon a établi en 1953 une champignonnière dans les galeries inférieures désaffectées ; le Joseph en question n'a visiblement pas fait fortune puisque l'Office des poursuites d'Orbe a procédé en 1957 à la vente aux enchères d'un aérochauffeur, de plusieurs centaines de m3 de fumier et des grillages.

J'espérais que Pierre-Alain R pourrait nous faire voir les oiseaux de sa région et tout particulièrement ceux qui ont élu domicile dans la carrière, il m'apprend au téléphone qu'il sera en voyage.
Je rentre en m'arrêtant en vitesse à Epalinges où j'achète du pain, à Corcelles où j'achète du fromage. On appelle fondue le mélange de ces deux produits.
Jean Prod’hom
La littérature érotique en Suisse romande

Cher Pierre,
Le ciel s'est couvert à l'aube ; ce qui ne nous empêche pas, Sandra, Oscar et moi de faire la boucle des 4 kilomètres ; on évoque sans les exagérer les désagréments que les travaux dans la maison vont amener, on en rit ; on ajoute pour prolonger notre plaisir une seconde boucle, autour du grand étang qui n'existera bientôt plus : les graminées, les carex, les mousses et diverses variétés d'arbrisseaux ont colonisé les lieux ; des bouleaux, des aulnes prennent racine.

Je me sépare de Sandra au triage, rejoins le sous-bois où j'ai aperçu hier un bouvreuil. Il n'est pas seul : la femelle est cachée dans les branches d'un sapin nain. Ils filent en trois coups d'aile, je m'installe. Ils reviennent après un quart d'heure, se posent un instant, lui sur une branche qu'il semble affectionner, elle à la cime d'un arbuste. J'aurais voulu faire une photographie de la femelle, plus claire ; ils sont loin, je ne les reverrai plus aujourd'hui.
Les chants puissants des oiseaux donnent l'impression que les bois en sont peuplés jusque dans leurs moindres recoins. Il faut pourtant du temps pour les apercevoir, beaucoup d'entre eux sont perchés trop haut dans le ciel.

Rougegorge familier
Sandra et les enfants sont allés pique-niquer avec les K au-dessus de l'Escarogotière, je monte à la bibliothèque pour travailler, mais Après beaucoup d'années, recueil de petites proses que Jaccottet a publié en 1994, me distrait ; je l'ai déposé hier sur la table ronde dans l'intention de relire les quelques lignes qu'il consacre aux eaux du Lez. La présence de deux point-virgules naturellement me réjouit, mais c'est la manière dont Jaccottet parvient à éloigner les métaphores et les comparaisons qui me ravit, dont il s'est servi comme d'un véhicule pour approcher ce qu'il tente d'épingler ; la méthode avec laquelle il réussit à se débarrasser de la rhétorique : certes oui! mais..., mais ce n'est pas cela..., dirait-on mais en réalité, si l'on veut..., pour libérer à la fin, par son nom, ce qu'il n'est parvenu à énoncer qu'en le manquant :
Ce sont les eaux de Lez, en avril, au gué dit de Bramarel.
Le menuisier et l'architecte font un saut à 16 heures pour qu'on décide ensemble des fenêtres et des portes d'en-bas ; le menuisier c'est Guillaume et on est bien contents de travailler avec un ami. Je les quitte un peu après 16 heures 30 pour aller récupérer au Musée de Vidy la centaine de tessons qui ont passé l'hiver dans le vestibule de cette auguste maison, que je ne parviendrai jamais à rejoindre, à cause de Monsieur François Hollande dont le discours à l'EPFL et le bain de foule à Ouchy ont bloqué tout le sud de la ville. Il m'aura donc fallu 1 heure et demie pour rejoindre la Grange de Dorigny où se rencontrent universitaires et auteurs autour d'une table ronde sur la littérature érotique en Suisse romande.
On reconnaît les universitaires à leur physique – ce sont des sportifs ; les écrivains à leur gentillesse et leur prévenance – ils ont toujours quelque chose de gentil à vous dire ; jolie soirée donc. J'y apprends également une ou deux choses ; une étude quantitative des textes relevant de ce genre a listé 600 synonymes pour le mot vagin, 600 (différents j'imagine) pour celui de pénis et 1300 pour coït : ce qui prouve une fois encore que le tout est supérieur à la somme des parties.
Je ne suis pas intervenu parce que je n'avais rien à dire; mais si on me l'avait demandé, j'aurais osé le poncif suivant, sans citer mes sources : L'écriture et la lecture, lorsqu'elles se font caresses, relèvent de la littérature érotique. Ç'aurait fait un flop.
Si on avait insisté pour que j'en dise plus, j'aurais raconté Madeleine qui, avant d'être un de ces gâteaux courts et dodus... qui semblent avoir été moulés dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques... , fut celle sur laquelle je portai mes lèvres pour la première fois... je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. II m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire,... en me remplissant d'une essence précieuse : ou plutôt cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel.
Je quitte ce beau monde pour le Riau où je retrouve Sandra et Arthur qui reviennent du cinéma, Louise et Lili dorment à Servion. Je rédige ces notes.
Jean Prod’hom
Je m'y étais engagé

Cher Pierre,
Je m'y étais engagé, c'est fait ; les tâches qui m'attendent jusqu'à l'été sont à nouveau listées, réparties cette fois sur trois colonnes ; cette opération aura eu le mérite de dégonfler, une fois encore, ce que je m'évertue à dramatiser ; ça durera le temps que ça durera.

Bouvreuil pivoine
Sandra et Louise sont allées à Nyon commander le carrelage de la salle de bains, Arthur et Lili dorment. Le voyage d'étude à Naples est devenu depuis tout à l'heure une priorité, je rédige les premières informations que je remettrai aux élèves et à leurs parents, elles auront eu la vertu de me faire entrevoir ce qui me reste à faire : inscrire les bagages des élèves, mettre un point final à la réservation sur easyJet, vérifier les numéros des passeports, réserver le train jusqu'à Genève et retour, faire travailler les élèves sur l'activité qu'ils ont à préparer avant de nous y rendre.
Il est 10 heures lorsque je sors. Les chevreuils sont très actifs, ma présence et celle d'Oscar les inquiètent, ils aboient. Près de la clairière où j'ai fait halte hier et où je retourne ce matin, j'aperçois le miroir blanc d'un arrière-train de l'un d'eux qui s'enfuit.
Une tache rouge passe en coup de vent dessus le tracé d'un chemin qu'envahissent les bartasses. A gauche une futaie dans laquelle s'engouffre l'oiseau, et d'où il ressort un peu plus tard pour disparaître à droite dans les taillis. Je remonte dans le couloir qu'il a emprunté et m'y fixe. Il finit par sortir du taillis et se poser sur une branche. Distingue derrière lui une autre forme qui bouge. Oscar ne peut s'empêcher de signaler notre présence, le bouvreuil nous fausse compagnie. Je reviendrai demain matin.
M et E rejoignent Louise et Lili pour le goûter, puis je descends au cinéma à Lausanne avec les deux grandes: Divergente 2 : l'insurrection. M'informe avant sur Allociné.
Dans un monde post-apocalyptique où la société a été réorganisée autour de 5 factions (Audacieux, Érudits, Altruistes, Sincères et Fraternels), Tris a mis au jour un complot mené par la faction dominante, les Érudits, dirigés par Jeanine. Abandonnant une ville à feu et à sang, à la recherche d’alliés, Tris et Quatre sont désormais traqués par les autorités. Jeanine décrète la loi martiale pour anéantir les Divergents, tandis que la guerre entre les factions prend de l’ampleur. Pourquoi les Divergents sont-ils une menace pour la société ? La découverte d’un objet mystérieux, hérité du passé, pourrait bien bouleverser l’équilibre des forces…
J'apprends en outre, par Wikipédia, qu'il existe un sixième groupe, celui des Sans Faction. Ça ne va pas être simple pour un esprit aussi lent que le mien, d'autant plus que je n'ai pas vu le premier volet de cette saga, et qu'un troisième est annoncé, en deux parties. Cette situation délicate me décide, on fera une halte avant de rentrer à la crêperie de la Chandeleur.
Jean Prod’hom
Rendez-vous de chantier

Cher Pierre,
Rendez-vous de chantier ce matin avec l'architecte, l'électricien, le cuisiniste et le chauffagiste ; manquaient le charpentier, le maçon et le menuisier. Ce qui étonne chez ces gens-là, c'est d'abord leur confiance ; non pas celle de l'infatué qui croit savoir, mais celle qui se nourrit de l'assurance que les choses ne se passent jamais exactement comme on le veut, mais qu'elles n'ont jamais eu l'intention de mettre en défaut qui que ce soit et qu'il y a toujours une solution pour contourner ou même prendre appui sur l'obstacle qu'elles représentent tôt ou tard.
C'est ensuite la faculté que chacun d'entre eux a de collaborer sans déborder sur les compétences des représentants des autres corps de métier, sans en douter non plus, en maintenant la distance qu'il convient, sachant que leur actes ne sont pas indépendants, qu'ils concourent aux mêmes fins : ensemble et chacun séparément. Tout cela paraît évident,
Lorsque je compare leur travail, la façon dont ils l'abordent et les principes qui les animent, je me plais à imaginer que quelque chose de pareil pourrait animer le corps des enseignants, qui pâliraient de jalousie s'ils se penchaient sur l'efficacité des échanges de ces gens qu'ils disqualifient si souvent, sur leur bon sens aussi, non pas tant celui auquel on recourt idéologiquement pour recouvrir d'un voile nos ignorances, mais celui qui donne assez de jeu pour que la logique de nos actions puisse s'ouvrir à l'imprévisible.
Il faudrait exiger des candidats à l'enseignement qu'ils fassent un stage d'une année au moins dans le secteur de la construction, ne serait-ce que pour les garder de l'idée simpliste qu'ils se font de la connaissance comme empilement de briques, colportée depuis des lustres par les responsables de l'école obligatoire.

Je retrouve pour la première fois cette année le sol des sous-bois, assez sec pour s'y asseoir, Oscar les explore. Et le calme revenant, je m'avise du rôle de l'appétit, de la soif, de la digestion, de l'oxygénation, de la marche, des saisons dans le fonctionnement de l'intellect, de tout ce que celui-ci aurait bien voulu se passer.
Reviens en pensant à cette phrase du prologue qui ouvre Les Neiges de Damas d'Aude Seigne que j'aurais la chance de rencontrer le mercredi 22 avril à Yverdon (Libraire l'étage) :
C'est un livre contre la dictature du sens et de la cohérence, contre l'obligation de conclure.
Propos décidé, qui semble répondre à une fringale et à un insatiable désir de totalité, provocation aussi à laquelle les plus solides d'entre nous pourraient souscrire, mais aussi les plus faibles ; mot d'ordre en forme de paradoxe, écrit par une jeune femme dans les premières années du XXIème siècle, mais qui aurait pu l'être également par un jeune Nietzschéen du troisième quart du XXème. Car enfin, cet énoncé, en vertu même du principe de réflexivité, ne permet pas de conclure, ni sur son sens ni sur sa cohérence.
En réalité, ce paradoxe est une épreuve. Faut-il tenir jusqu'au bout à cette logique qui n'en est pas une en s'y accrochant par souci de loyauté et renvoyer l'explication finale, la clé de voûte et la conclusion à plus tard ? Ou y renoncer séance tenante ?
La littérature, comme la philosophie, est tout à la fois un poison et un remède : poison pour les êtres faibles qui inventent des fables pour se convaincre eux-mêmes de l'impensable et obliger ceux sans lesquels ils seraient seuls à les suivre ; remède pour ceux qui sont en pleine santé, assez forts pour expérimenter une voie singulière au risque d'aller de ce pas vers l'insensé et l'incohérent. Sans conclure.
Dictature du sens soit, mais en quel sens, en sacrifiant les principes d'identité et de non-contradiction ? Ne pas conclure pourquoi pas, mais en différant le dernier mot de telle manière qu'on pourrait croire s'être débarrassé des fins une fois pour tout ? Voilà où j'en suis. Pas sûr que tout cela soit très sensé et cohérent.

Je monte à la bibliothèque et réunis les éléments qui devraient constituer ce qu'on appelle pompeusement un dossier de presse en vue de l'événement qui aura lieu à Grignan en septembre. Là encore, je suis tenaillé par la crainte de faire faux.
Jardin en fin d'après-midi, je déplace les trois dernières lavandes, taille un lilas. Arthur rentre de ses deux jours de camping, Louise et Lili reviennent de chez Marinette. Ils ont faim, je fais bouillir des pâtes, râpe des carottes rouges et réchauffe les restes du gigot de dimanche. On parle des chamboulements que les prochains travaux vont amener dans la maison ; Sandra sourit, elle est un ange.
Jean Prod’hom
Grand beau

Cher Pierre,
Grand beau ! C'est à plus de 9 heures que Mylène et Lili sortent le bout du nez de la tente où elles ont dormi la nuit passée ; pas de nouvelles d'Arthur, Louise fait un peu de guitare et Sandra se rend chez l'ostéopathe.

Rougequeue à front blanc
Je télécharge VaudTax 2014 et le miracle a lieu : je récupère les données de la déclaration d'impôts 2013 et complète vite fait celle de 2014 avec la paperasse mise en tas dans un coin de la bibliothèque : tout trouvé! deux heures auront suffi. Si fier que je renvoie la vérification à demain.
Je déplace des lavandes en martyrisant quelques tulipes, termine Les Neiges de Damas au soleil dans le jardin, taille le pommier en espalier, dérive l'eau de la fontaine dans l'étang, suis les manoeuvres des oiseaux dans le chêne.
Louise et Lili dorment ce soir chez Marinette, on va manger au Chalet des Enfants ; confiants, on parle du chantier dans lequel il va nous falloir vivre cet été.
Il est 21 heures lorsqu'on rentre, Arthur nous envoie un message du fond des bois avec la photo d'un feu et celle d'un hamburger.
Jean Prod’hom
Sandra lit

Cher Pierre,
Sandra lit, je parcours les dernières pages de L'Oeil de la terre quand Olivier téléphone. Je m'arrête à Chailly pour acheter de quoi accompagner le café qu'on boira sur la terrasse qu'il a aménagée en un lieu improbable : on aperçoit trois jeunes saules qui font leurs feuilles, la Vuachère, deux geais qui bataillent, un chêne qui tarde à mi-pente et les squelettes de feuilles que je ne reconnais pas. On fait un tour d'horizon.

Il y a foule au bord du lac, le niveau est bas, on espère trouver des trésors, ce n'est pas le cas ; ou d'une autre espèce, car Daniel Dunkel a passé par là, ou plutôt est revenu ; j'apprends en effet qu'il a déjà dressé une foule de cairns, il y exactement une année. C'est encore une foule qu'il fait voir, de la même famille que la précédente. Olivier me fait remarquer que pour chacun d'eux, c'est la dernière pierre qui importe, la tête donc, son équilibre, son inclinaison ; c'est elle qui fait comprendre les pierres qui la soutiennent. Simple mais pas facile.
Foule encore à Lutry : grillades, jeux de ballons, amoureux, bière, enfants. Monsieur Hulot a passé par là mais n'a laissé aucune trace, personne ne semble tenir son rôle jusqu'au bout. Tati décidément nous manque.
On s'assied sur un banc sans bien savoir s'il convient de rester ou de nous en aller. On finit par s'en aller, jusqu'au terrain de foot où l'équipe de Lutry, 5ème au classement de deuxième ligue affronte Echichens, 1ère. La violence qui affleure ne va pas jusqu'au bout. Tant mieux. On les quitte à la mi-temps. Je pensote sur le chemin du retour, il y a dans le mot épagomène un trésor qu'il faudrait filer comme les carriers le font du filon de calcaire argileux dans les sous-sols du désert des Chartreux, je vais peut-être m'en charger. Par en-haut ou par en-bas, comme eux,
Je mets au four un gigot, avec des carottes, des tomates et des pommes-de-terre, les enfants jouent dehors. Je passe une heure à la bibliothèque, je le soupçonnais, Echichens a battu Lutry un à zéro.
Après le repas, Sandra bosse au corrigé des exercices de physique du bouquin qui est chez l'imprimeur. Arthur a rejoint un copain à Ropraz. Louise et Mylène vont se coucher dans la tente que Sandra et les enfants ont montée cette après-midi dans le jardin. Je regarde le 2ème des 18 épisodes de la 5ème des 8 séries de Heartland avec Louise. A moi la nuit.
Jean Prod’hom



Passepartout à Saillon

Il n'y a pas que les oeufs de Pâques qui roulent au printemps. Sachez en effet que 17 coureurs du TCPM de Moudon se sont retrouvés à Saillon, la semaine passée, pour préparer la nouvelle saison de trial.
Les pilotes, âgés de 9 à 17 ans, ont roulé du mardi 7 au vendredi 10 avril, 6 heures chaque jour, sur le terrain mis à leur disposition par le Moto-Club de Fully. Le soleil valaisan était au rendez-vous.
René Meyer et Jean-Daniel Savary ont entraîné tout au long de la semaine les jeunes pilotes, Martine Rogivue s'est chargée de soigner les bobos et de réconforter les petits. Cette semaine aura été la meilleure façon de peaufiner l'entraînement hivernal à 15 jours de la première compétition de l'année. Malgré les différences d'âge et de niveau, l'esprit d'équipe a été excellent, plusieurs coureurs se sont même dits prêts à prolonger le séjour.
Les coureurs et leurs entraineurs remercient le Moto-Club de Fully qui a mis à leur disposition son site naturel, ils remercient également la commune de Moudon et les sponsors pour leur aide financière.
Si les coureurs ont travaillé dur, c’est parce que le début des compétitions approchent ; le samedi 25 avril, la commune de Savièse accueillera les trialistes pour la première manche de la Trial Swiss Cup. Quant à Ropraz, les bénévoles sont à pied d'oeuvre, c'est en effet le dimanche 3 mai que le TCPM organisera, pour la 30ème fois, sa traditionnelle course. A cette occasion, la compétition sera internationale ; on peut d'ores et déjà le confirmer, vous aurez la chance de voir à l'oeuvre Gilles Coustelier, coureur français multiple champion du monde. Venez nombreux!
Retrouvez les informations sur le site www.trial-moudon.ch
Jean Prod’hom
Je ne le dirai pas épagomène

Je ne le dirai pas épagomène à strictement parlé, même si je sais que chacun de nos jours l'est, si on n'y prend garde, bien plus qu'on ne l'imagine.

On a déjeuné à la véranda, Sandra et les enfants sont descendus au marché, j'ai rattrapé le temps perdu : rédaction du billet de la veille, envoi des photographies d'arrosoirs à Dominique, demande à Christine d'un modèle de dossier de presse. Je suis allé ensuite chercher mes deux paires de lunettes à Oron, j'ai acheté un gigot d'agneau ; puis coupe de cheveux chez Gremaud. J'ai fait quelques achats à la Coop pour ce soir, demain et après-demain, j'ai lu le journal au café de Châtillens.
Il est près de 16 heures lorsque je mets le feu aux dépouilles des tailles faites avant Pâques et que les enfants ont mis en tas à côté du hangar. A 18 heures tout est en cendres. Me reste à préparer le repas, à cocher ce qui n'est plus à faire et à ordonner ce qui l'est encore: rien de bien neuf.
N'étaient des soirées, des moments et des rencontres qui ne riment à rien, on serait, c'est sûr et sans le savoir, bien malheureux.

Jean Prod’hom
Réveil à 8 heures

Réveil à 8 heures, je réunis mes affaires et pousse Édouard jusqu'à Viviers ; un café en ville, à deux pas du Grand Séminaire, avant de le déposer devant l'Office de tourisme, à l'extrémité du pont qui franchit le Rhône. J'apprends par le journal que le double de la grotte Chauvet sera inauguré aujourd'hui, une belle histoire qui se termine. J'emprunte l'autoroute jusqu'à Grenoble où je bifurque pour la Chartreuse ; aperçois les premières vaches de la saison dans un pré au-dessus de Saint-Laurent-du-Pont.

Je fais une première halte à l'entrée de la forêt domaniale de la Grande Chartreuse et du tunnel de Fouvroirie. J'y apprends que la porte de Jarjatte a été démolie en 1856, autorisant l'accès au couvent. Quant à la route qui longeait le Guiers mort elle a été abandonnée au profit d'un tunnel inauguré en 1995. Trois ponts franchissent la rivière en aval du barrage en bois qui fournissait, dès 1333, la force motrice aux martinets et aux soufflets des maîtres de forges du couvent des Chartreux. Le plus vieux des trois date de 1203.
Du patrimoine industriel dont les bâtiments ont abrité tout au long de l'histoire des scieurs et des travailleurs du fer, il ne reste que des ruines. On y fabriquait encore, il y a moins d'un siècle, des limes et des baleines de soutien-gorge, m'indiquent, en salivant, deux ouvriers qui fument des cigarettes dans un container. Ils travaillent pour une entreprise qui a loué l'une des immenses halles de ce complexe qui menace de s'écrouler.

Quelques centaines de mètres en amont, la pierre est blanche ; j'entre dans une cour traversée par une double voie ferrée, étroite, propriété de la société Vincat, sise Tour Manhattan, Paris la Défense ; ça fait drôle de lire ces mots ici. Cette société exploite, sous les anciennes terres des Chartreux, la carrière souterraine de la Perelle. Un carrier, douché, frais rasé, m'apprend que les 30 ouvriers qui travaillent sur ce site sortent du fond d'une galerie de plus d'un kilomètre du calcaire argileux (70% / 30%), dont ils attaquent le filon depuis en-haut. Ils l'emmènent dans des wagonnets dans une usine située de l'autre côté de la rivière et en tirent du ciment prompt. Le carrier, qui n'est pas un mineur – régime des retraites oblige –, a terminé sa journée, il a commencé à 6 heures.
Discute encore avec un passionné de chemin de fer industriel et son amie, il vient de Lyon, elle vient du coin. C'est sa passion, sait tout des mines et des chemins de fer, écrit dans des revues. Impossible de le retenir, inutile aussi, j'ai trop de questions, il me donne l'adresse de son site, j'irai voir. Nous ne pourrons pas entrer dans la galerie, mais le miracle à lieu, les portes d'acier s'ouvrent et deux locomotives miniatures sortent de la montagne, toute blanches, sans les 19 wagons chargés de ciment qu'elle tire parfois, mais avec un container jaune d'où sortent trois hommes souriants.
Je fais une halte devant le grand Som pour manger un morceau. Reçois quelques messages de Sandra, je remonte désormais le Guiers vif. Me réjouis de tous les retrouver, elle, les enfants, Oscar.
Col du Granier, Chambéry, Genève. La circulation me met à trois reprises de très méchante humeur; ça bouchonne à Aubonne, je passe par Lavigny et Bussigny ; ça bouchonne à Bussigny, je passe par Cheseaux ; ça bouchonne à Cheseaux, je passe par Morrens. Je retrouve en fin Sandra et les enfants, il est plus de 18 heures. Pas le courage de faire à manger, on va fêter nos retrouvailles au motel des Fleurs de Servion. Je reçois un mail de Françoise : Edouard est arrivé à Aiguebelle.
Jean Prod’hom
Croche noire pointée croche

Cher Pierre,
Croche noire pointée croche, croche noire pointée croche, ni sifflement, ni cri, ni chant, un roucoulement, dit-on, celui de la tourterelle, mat et liquide, un « l » plutôt qu’un « r », rond, dont on peine à repérer la provenance. C’est à cet oiseau de madrigal que revient aujourd’hui la tâche de rappeler à l’homme, depuis que nous avons exigé du coq qu’il se taise, ses reniements et ses lâchetés. Les tourterelles le font sans déchirer les âmes, avec douceur, sans heurter les consciences. Il faut dire qu’elles restent sur le qui vive, elles ont en effet bien compris qu’elles étaient en sursis, que certains pourraient juger qu’elles font trop de bruit et ordonner qu'on leur coupe la tête.

On quitte Colonzelle pour Nyons à un peu plus de 8 heures. Je tire de l’argent au bancomat , on boit un café ; Françoise et Edouard vont faire leurs emplettes dans la vieille ville, chacun de leur côté, je descends du mien sur la rive droite de l’Eygues ; impossible de le remonter au-delà du moulin, beaucoup trop d’eau. Les micocouliers, les érables, même les houx ont déclenché leurs opérations de séduction. Du vieux pont roman en haut de la ville, le regard remonte l’esse de l’Eygues, il en devine un second, un troisième et le sentier qui les longe, jusqu’à Curnier où l’Ennuye mêle ses eaux à son aînée. On aimerait aller voir de plus près.
Mais c’est sur l’autre rive qu’Edouard nous emmène. On laisse la voiture sur l’aire de Toulonne, on grimpe jusqu’au ravin entre Taillas et Grèzes qu’on suit jusqu’au col de Roux ; une bonne heure de marche sous le soleil, avant de pique-niquer au pied de chênes rabougris, qui se partagent le les collines avec des buis ardents, le jaune des genêts, les piques des genièvres et le blanc des épines noires. On croise deux colonies de chenilles processionnaires, il y a des restes de neige sur la montagne d’Angèle: le texte qui s'efface est illisible. On redescend par le centre équestre de la Garde, les chevaux sont en liberté. On aperçoit Condorcet et les dernières fleurs des amandiers. Le morceau de terre cuite, égaré sur le premier raidillon et glissé dans ma poche, a bien supporté la balade ; il a même, de frottement en frottement, commencé son travail d’usure et d’épure.
On boit une bière sur une terrasse à Nyons avant de rentrer à Colonzelle. Douche. Fais un saut à Grignan pour remettre une copie du discours de Philippe à Lily, Hessel prépare une salade de fruits.
On mange sur la terrasse, il fait bon, je reçois un message de Joëlle, un billet sur Jean-Claude Hesselbarth paraîtra demain dans 24heures.
Jean Prod’hom
Les premiers jours de printemps

Cher Pierre,
Les premiers jours de printemps, souvent, virent au gris à l’aube, même si, au même moment, le ciel vire au bleu. A cause de l’humidité.

Lis au réveil les premières pages de L’Oeil de la terre, que Gil Jouanard a fait paraître en 1994 chez Fata Morgana. Les pages qu’il consacre à Jean Follain et à Canisy sont radieuses ; celle dans laquelle il règle ses comptes avec René Char et certains de ses épigones ne réjouira pas tous mes amis ; il met à part, pour les consoler, les Matinaux et Fureur et mystère.
Ses réflexions sur la nature du poème me ramènent naturellement à ce brouillon qui traîne sur le bureau de mon ordinateur : trop long, si bien que je retire ce que je peux retirer facilement, à tel point que je finis par voir en transparence la carcasse ; m’interrompt avant qu’il n’y ait plus rien, j’y reviendrai après-demain. Quant aux cinq poèmes qu’on me demande de joindre à cet envoi, ils ne seront pas à strictement parlé des poèmes, mais plus modestement cinq textes d’humeur différente dont la coexistence devrait faire entendre l’un des restes de ce qui reste lorsque tout a été dit.

On braise entre 11 et 12 au soleil, Edouard cuisine dedans. Je cherche les fruits secs du laurier et de la glycine ; Françoise me parle de Riant-Mont, de Zappelli, des Jaton, des Jaquier, de la boulangerie remplacée aujourd’hui par un salon de coiffure. La boulangère de Riant-Mont 2 vendait sa marchandise du lundi au samedi soir ; c’est donc son mari qui était chargé des courses pour la maisonnée, un mari un peu poète qui aurait confié un jour à Françoise : c’est même moi qui achète les hottes à nichons de ma femme.
Je monte chez Hessel à 14 heures 30, il boutique. On s’assied, il est insatiable ; de rien il tire un fil qu’il ne lâche pas, revient en arrière pour repartir de plus belle ; mais il me parle aussi du temps qui lui est nécessaire pour disposer de quelques heures. Il me charge de sortir et d’arroser un bougainvillier et un jasmin assoiffés depuis plusieurs mois, je remplis ma tâche, sans me cacher que ce serait un miracle s’ils reprennent. J’en profite pour faire une photo des trois arrosoirs qui serrent les coudes sous l’évier et vais jeter un coup d’oeil au bassin au fond du jardin. Au retour, on parle de choses et d’autres, un peu de peinture, de Stéphane et de Martine. Lily rentre lorsque je dois les quitter. Mais ils m’invitent à les rejoindre ce soir pour manger avec Alain.
Christine m’accueille dans sa galerie avec suffisamment de délicatesse pour que je sois en mesure, assez rapidement, de surmonter les doutes qui m’assaillent. On se retrouve deux heures plus tard avec un plan de bataille pour les deux salles qu’on occuperait en septembre prochain : dans la première – où devraient avoir lieu les lectures – 5 ou 6 polyptyques, une table étroite de 3 mètres 60 où seraient déposées côte à côte les boîtes avec le texte correspondant ; sur des parallélépipèdes rectangles répartis au hasard 4 ou 5 récipients, transparents, contenant 1, 2 ou 3 tessons.
Dans la seconde, une longue table de 4 mètres dont on pourrait faire le tour et sur laquelle seraient posées 5 ou 6 casses d’imprimerie ; au mur 5 ou 6 polyptyques ; et face à l’entrée une table basse d’un peu plus de 2 mètres sur laquelle seraient jetés du sable et les tessons des hauts de casse.
Je rejoins Lily, Hessel et Alain pour une belle soirée, on mange et on rit. Hessel raconte leurs virées en vélomoteur, Lily revient sur les raisons pour lesquelles elle et sa petite équipe ont fondé l’Association Jean-Claude Hesselbarth. Je repasserai demain pour leur amener l’enregistrement du discours de Philippe Jaccottet, Liliane me remettra en échange des copies de quelques-uns des films qu’elle a réalisés.
Ah oui, j’oubliais, on a décidé avec Christine que l’événement à Terres d’écritures s’intitulerait – jusqu’à nouvel ordre : A défaut de prière, ramasse une pierre. Et qu’elle aurait lieu les samedi et dimanche 12 et 13, 19 et 20 septembre 2015. Au boulot!
Jean Prod’hom
A l’impression d’avoir couru tout le matin

Cher Pierre,
A l’impression d’avoir couru tout le matin derrière ce que je m’étais promis de faire, succède celle de voir s’éloigner ce que j’aurais pu entreprendre si j’avais mieux estimé mes forces. Je prends conscience de tout cela lorsque j’essaie de rassembler les images du jour, que je peine non seulement à retrouver mais encore à rogner et à placer dans l’ordre de leur succession.

Je suis parvenu pourtant à boucler l’essentiel à midi, au Grenier à sel, d’où j’ai pu envoyer à Joëlle les photographies que m’a fait parvenir la journaliste de Montélimar, le texte que j’ai rédigé la veille au soir pour ce site et le communiqué de presse que m’a expédié Nicolas.
Je croise Lily dans son jardin, le weekend de Pâques a bien entamé Hesselbarth qui reprend pourtant du tonus. Je passerai demain après-midi avant de rejoindre Christine à Terres d’écritures.
Redescends à Colonzelle par le manège, jette un coup d’oeil discret sous les chênes, guigne sur les rives sablonneuses du Lez, au cas où des morilles me feraient signe. Croise une piéride qui remonte le chemin, elle s'échappe, je me tourne dans tous les sens, elle a disparu. Une douzaine d’abeilles se désaltèrent dans une flaque ; bruit de sanglier dans le sous-bois, c'est un merle qui remue les feuilles mortes et qui s'envole. Salue les pervenches observées la veille, fais une halte contre la pile du pont de l’ancienne ligne reliant Pierrelatte à Nyons, à côté de deux pissenlits solaires. L’eau du Lez qui se gargarisait plus haut paresse, un lézard vert pâle se faufile entre les ronces, les chardons rouges de l’été passé ont séché.
Il suffisait de se donner la peine de le dire. Et cette journée qui manquait de tout retrouve une allure, sept coups au clocher de l’église de Colonzelle, on n’apercevra bientôt plus les boules de gui, l’écriture a un indéniable pouvoir de réhabilitation.
Je téléphone au Riau, pas de nouvelles d’Arthur qui s’entraîne en Valais. Sandra, qui est le maître d’oeuvre des prochaines transformations de la maison, ramène mes histoires à de justes proportions : elle me raconte l’architecte, le menuisier et le maçon. Quant à Lili et Louise, ravies de leur journée à Thierrens, elles me racontent la belle histoire de Peony et de Stella.
Jean Prod’hom
A propos de Tessons

Littérature romande : Avez-vous l'âme d'un collectionneur?
JP : Amateur de collecte certainement, mais étranger depuis toujours à l'idée de collection. Un rien les distingue, invisible, mais tout les sépare : la seconde suppose une clôture, la première un peu de cet égarement qui oblige celui qui s'y livre à guigner du côté de l'imprévu.
Ainsi, ces morceaux de terre cuite, que je ramasse depuis plus de 25 ans, m’ont permis de connaître des lieux dont je n’aurais jamais entendu parler, ils sont aussi à l’origine d’aventures que je n’aurais jamais osé imaginer ; ce livre, Tessons, est l’une des dernières en date.
Mais j’ai eu comme chaque enfant, bien sûr, quelques velléités à rassembler dans un album de timbres la totalité du monde, toutes les espèces de coquillages au fond d’une armoire. Sans grande conviction.
Cette collecte ne m’aura jamais empêché de l'interrompre, de regarder autour de moi, de faire des rencontres, bien au contraire ; j’ai ramassé d’autres reliefs que les hommes abandonnent et que la mer, le sable et le vent ont usés, abrasés, embellis: pierres, plastiques, bois, fers. Mais, je l'avoue, avec mon d’assiduité que les tessons. Ces restes constituent ce que j’appellerai, pour reprendre le titre d'un petit livre de Pierre Bergounioux, un Abrégé du monde. Quant à Pascal Rebetez, le courageux éditeur de Tessons, il m'a invité à en dire un peu plus, je lui en sais gré.
Est-ce l'empreinte humaine qui vous a poussé dans ce choix ?
Disons d’abord que je n'ai pas choisi. Dans ce genre d’aventure, obscures, ce n’est qu’à la fin que quelque chose s'éclaire à la lumière de ce qu'on a fait, trouvé, pensé ; il n’y avait donc aucune raison que je me mette à ramasser ces « merdouilles », comme le disent si poétiquement David Cuendet et Laurent Flutsch. Ce n'est qu'un concours de petites circonstances, j'en ai levé de sérieuses par après que j’évoque dans ce livre.
Mais disons tout de même que la nature double du tesson n'aura pas été pour rien dans mon obstination, à moins que celle-ci ne m'ait permis de penser celle-là.
On le sait, les oeuvres de la nature se mêlent, parfois, à celles de l’homme pour faire naître des merveilles, les artistes en sont les ouvriers. Artiste je ne le suis pas, j’ai simplement laissé faire ; c’est ce qui m’a occupé. Et j'ai essayé d'être présent au moment voulu, lorsqu’il n’y avait plus qu’à les cueillir dans les laisses de mer ou sur les berges des lacs et des ruisseaux, abandonnés, loin de tout.
Que personne – ou presque – ne s’y soit intéressé m’aura permis de vivre plus de 25 ans sans rivaux, ce n'est pas rien, 25 ans à l'abri des batailles.
J’ai été, pour dire la vérité, plusieurs fois tenté d’en faire quelque chose ; j’en ai fabriqué des faux, j’en ai peint, j’ai cherché à accélérer leur rédemption en les plongeant dans des bains d’eau salée ou dans les cascades des rivières du Jorat. Sans succès. Ces pierres, j’ai dû l’accepter, se sont faites sans moi, ce livre en témoigne, sans manquer de m'aider à vivre et à penser. On ne se moque pas, c'est vrai.
Et lorsque Pascal Rebetez m’a proposé de raconter tout cela, il m’a suffi de choisir quelques-unes de ces pierres, recueillies sur la bande indécise qui unit – et sépare – la terre et la mer et de donner une forme aux songeries qui m’ont accompagné pendant tout ce temps. Ce n’est tout compte fait pas grand chose : une petite cinquantaine de pierres, une petite cinquantaine de proses qu’il m’a fallu rogner pour les apparier à ce qui les avait motivées, les polir avec le risque bien réel qu’il ne reste plus grand chose à la fin, presque rien, à l'image de ces objets oubliés du monde qui recèlent une dignité et une beauté mystérieuse.
Les tessons sont de parfaits représentants du temps qui passe : on les trouve lavés par les flots, les rivières. Y a-t-il nostalgie dans leur découverte ?
Il y a d'abord une joie, celle de rencontrer quelque chose qui me semble, chaque fois, m’avoir donné rendez-vous ; il y aussi le plaisir de les tenir dans la main, de suivre du doigt leur courbe, de me pencher sur leur motif, de reconnaître la lente usure de ces formes éclatées qui trouvent, à un certain moment, leur éclat. J'ai décidé de les retirer des laisses où ils ont été jetés et où ils ont fleuri avant que la mer et le sable qui les ont faits les fassent disparaître.
Alors? nostalgie aucune. Ou alors la nostalgie de cette époque rêvée où l’homme avait le temps, ou le prenait, de considérer les miracles par lesquels nous somme faits et défaits. Ces pierres sont nées dans le fracas, bols jetés, assiettes brisées, rejetées, abandonnées ; elles ont vécu oubliées en marge des règnes ; et c’est là qu’offrant leur flanc à la mer, au sable et au vent, sans rien dire, certaines d'entre elles ont su devenir une comme nulle autre pareille avant de retourner au sable. La vie de l'homme n'est pas différente de celle de ces pierres.
Vous dites ne pas collectionner, mais vous ne conservez pas moins précieusement ces tessons. Vous les exposez même dans les musées à l'occasion. Alors, avez-vous un côté Petit Poucet ?
Je répondrai en deux fois. D’abord le petit Poucet, une histoire qui me ravit. Petit Poucet, nous l'avons tous été et nous le demeurons ; à mesure que l'on s’éloigne de là où l'on vient, il devient en effet toujours plus difficile d'y retourner et il convient, comme Poucet nous l'a appris, de prendre quelques précautions.
Mais comme toutes les histoires qui imposent leur évidence – revenir sur ses pas en ramassant les cailloux qu’on a semés –, elles passent sous silence la moitié de ce qu’il faut entendre. Poucet va grandir et sera invité à aller de l’avant, il faut bien un jour quitter le giron, et il ne sert plus à rien de laisser derrière soi des cailloux, nous devons les jeter devant nous pour établir ce gué sans lequel on resterait sur la même rive sans rien comprendre de ce qui reste à comprendre.
Si donc ces tessons me permettent de revenir sur mes pas, ils sont aussi ces pierres jetées dans la rivière pour rejoindre des paysages inconnus, là où il n’y a personne pour me rassurer et dans lesquels il a bien fallu que je me risque si je voulais m'approcher un peu de ce qu'on ne m'a pas dit. En ce sens, ce livre aura été important, il m’aura permis de rassembler ce qui ne reviendra pas, mais aussi de découvrir, écrivant, devant moi, ce que je ne soupçonnais pas.
Quant à leur exposition, n’exagérons rien ; si ces tessons ont effectivement trouvé une place dans le musée romain de Lausanne-Vidy, apprenez qu'ils n'en occupent pas le naos, mais le vestibule.
Fierté tout de même, naturellement, fierté que ces petits paradis portatifs soient arrivés jusque-là et que j’aie pu contribuer à leur reconnaissance. Mais amusement surtout, amusement qu’ils se retrouvent à deux pas des vieux briscards de cette illustre maison, fibules, tuiles et verres soufflés, identifiés, étiquetés, classés sous clé ; mais à deux pas aussi du lac, prêts à prendre la poudre d’escampette, là, tout près, dans le sable et sous le vent, sur les rives du Léman.
Ce ne sont pas non plus des pièces reconnues par les amoureux de l'art, quand bien même ces tessons vont être exposés dans une galerie d’art, à Grignan : Terres d'écritures.
C’est la faculté de ces pierres de faire bonne figure sur les seuils, entre mer et terre, entre deux eaux, à égale distance des science et des arts, qui me ravit. Je n'aurais pas pu espérer mieux. Mais je m’égare, il ne faudrait pas qu’on se méprenne, ni eux ni moi ne nous prenons vraiment au sérieux : ridentes in vestibulo.
Vous avez été assistant en philosophie : y a -t-il un lien unissant la marche, l'écriture, la philosophie et votre passion très spécifique ?
Faudrait d'abord s'entendre sur le mot de passion. Mais certainement. La lecture de Nietzsche a été par exemple importante, les questions de l’affirmation, de l'acceptation, de la métaphore et de la métamorphose, et naturellement celle plus générale du fragment ; elles m’ont fait entrevoir un autre continent que, lorsque j'ai quitté la Faculté, je me suis mis à vivre de l’intérieur, avec le langage et le monde dans lesquels nous sommes immergés, pour mieux comprendre et pouvoir en sortir. Et je vois mal d’autre chemin que l'écriture.
Par ailleurs, je ne suis pas sorti indemne de la lecture de René Girard, mais je n’en dirai pas plus, c’est si loin. J’ai dit mes dettes : Quignard, Perec, Dhôtel ; il faudrait en citer d'autres.. Nos vies ne sont pas compartimentées comme semblent le ressasser nos vieilles encyclopédies. Disons que je ne vois pas comment on peu y voir clair, c’est-à-dire penser, sans marcher, observer, rêver, écrire. Sans sortir et rentrer, s'asseoir à une table et donner une forme à ce qu'on traverse et qui nous traverse. Tout ça ne fait qu'un.
Les photographies des tessons qui ornent votre livre sont très réussies : comment avez-vous procédé au choix ?
J’ai cru pouvoir choisir, au même titre que j’ai cru pouvoir classer ces objets. Impossible, c'est donc dire que beaucoup d’autres auraient pu figurer dans ce livre. Disons que ceux qui y figurent logent dans un meuble d’imprimerie, et que la première casse est la plus prisée. Après 25 ans, certains tessons ont su s'y installer, pour des raisons souvent secondes. Une centaine de tessons peut-être. C'est parmi eux, surtout, que j'ai plongé la main. De fil en aiguille il en est resté une cinquantaine, dont le choix a obéi, dans certaines circonstances, à des raisons si fragiles que je n’ose en parler.
La présence de certains me paraissait incontournable, j'ai aidé d'autres, plus timides, à s'imposer. C'est le rôle des textes qui les accompagnent de faire entendre quelques-unes des raisons de leur présence et les événements qui ont présidé à leur découverte.
Mais j’ai choisi surtout deux extraordinaires photographes, Geoffrey Cottenceau et Romain Rousset, et Chatty Ecoffey, une graphiste de talent.
Vous écrivez quotidiennement sur votre blog (www.lesmarges.net). Quelles différences voyez-vous entre l’éphémère du support informatique et celui figé du papier pour un texte publié ?
Et bien je ne vois pas bien, c’est pour cela que j’écris, pour y voir un peu plus clair. Mais cette activité quotidienne me conduit à penser que, si j'écris, c'est d'abord pour donner forme à une ou deux choses qui se présentent chaque jour, les ficeler en leur donnant un nom et une allure, pour mieux m'en débarrasser. Et être assez libre le lendemain pour recommencer. Le blog s'y prête bien, c'est ce qu'on peut appeler, après François Bon, l'effet fosse à bitume. Mais le blog a aussi ses inconvénients.
Il s’est trouvé un éditeur assez courageux pour nous lancer dans l'aventure papier, je ne le regrette pas, mais cette aventure va certainement m'obliger à donner une réponse plus solide à la question que vous me posez. D’autant plus qu’un second éditeur m’a proposé de réunir sur du papier un certain nombre des textes publiés depuis 2008 sur lesmarges.net.
Mais disons-le tout net, sans l’avènement du numérique, je n’aurais jamais écrit ; je l'ai fait, en temps presque réel, pendant près de 7 ans, sans jamais rien demander à quiconque, avant que ceux du papier s’avisent que j’écrivais une ou deux choses qui pourraient les intéresser.
Je ne sais donc pas ce qui va se passer, j’ai quelques projets, nés sur le net, que je voudrais reprendre, mais cela demande du temps, et je ne sais si je suis assez vaillant pour mener de front ces deux modes d'écriture. En attendant, j’ai créé sur mon site une rubrique atelier qui me devrait me permettre, pendant quelque temps, de ménager la chèvre et le chou.
J’ajouterai que l’écriture quotidienne sur lesmarges.net n’est pas sans rappeler ma cueillette de tessons : je ramasse avant la nuit ce quelque chose que seule l’écriture est apte à sauver de l’oubli en lui donnant une forme et un peu de cette lumière susceptible d'éclairer les jours suivants, là où on n'est jamais allé, comme sur un gué, de proche en proche. Et je ne suis pas sûr que je puisse m'en passer.
Vous avez un nouveau projet de publication aux éditions Antipodes. Pourriez-vous nous en dire plus à ce propos ?
Il s’agit d’un recueil de billets écrits entre 2008 et 2014, il devrait faire voir un certain nombre de balises le long d’un chemin qui continue. Dans des paysages variés. Le livre est dans la boîte. Il dit en substance que nous ne sommes pas fait d'une seule pièce, mais d'un ensemble de perceptions aussi nombreuses que les feuillets ce ce livre dont parle Borges, aux nombres de pages infini et où aucune page n'est la première, aucune n'est la dernière.
Et lorsque je mourrai, ce n’est pas, j'ose l'espérer et j'y travaille, un vase qui se brisera, mais les morceaux d’un vase incomplet brisé depuis longtemps, dont un soi toujours plus ténu et fugace aura assuré le poli et qui rejoindront ceux qui l’ont nourri.
Bise ou mistral c’est du pareil au même

Cher Pierre,
Bise ou mistral c’est du pareil au même, on se réjouit lorsqu’ils prennent congé et que tout redevient comme avant, et ceux qui le peuvent prolongent leur repos. Vérifie ce matin la présence des hirondelles.

Les mêmes clients sont attablés au café de la Bourgade à Grillon, on y parle de morilles de 300 grammes. La place pavée de neuf est désormais fermée au trafic, protégée par des piquets télescopiques ; ont été ajoutés de jeunes platanes et de nouveaux bancs. Recopie le dernier des cinq poèmes que je m’étais engagé à mettre en ligne.
Il y a nos absences. D’une heure ou de plusieurs mois, d’un instant.
Qu’allons-nous chercher? de l’utile? de l’accessible?
Réponse qu’il faut briser comme un bâton.
Savoir aussi qu’il y a quelque chose autour de nous qui ne sert à rien. Mais qui peut être aussi précieux que le reste.
Pars de Colonzelle à 10 heures 30 pour arriver à 11 heures. Prends un peu de retard à cause du soleil et des pervenches. Belle exposition de Denise Lach que Christine Macé présente à un public nombreux et averti. Lucie doit nous quitter. Je repère une journaliste présente avant-hier au vernissage d’Hesselbarth, Elle m’enverra des photos. Denise Lach propose une visite guidée à ceux qui le souhaitent.
On redescend à pied en fin d’après-midi, je remonte en voiture avec Edouard qui récupère la sienne. Suffit pour aujourd’hui. Téléphone à Sandra, à Louise et à Lili, Arthur est à Ropraz. La semaine de cheval à Thierrens commence demain, les filles se réjouissent.
Jean Prod’hom
Ce ne sont pas les tâches

Cher Pierre,
Ce ne sont pas les tâches qui nous obligent à rester dedans alors qu’on voudrait être dehors, mais le mistral ; une matinée donc placée sous le sceau du tout et du rien autour d’une même table ; on déjeune puis on dîne en babillant de voyages ; de ceux qu’on faisait il y a une trentaine d’années, lorsque murs et idéologies opposées indiquaient qu’il existait de l’autre ailleurs ; des voyages qu’on entreprend aujourd’hui pour fuir un monde sans altérité, s’éloigner du même dans l’espoir de retrouver des particularismes locaux, sans savoir où, et comment revenir, les mains vides. Il y a eu 1991 dont on n’a pas fini de voir les effets.

Edouard monte faire la sieste, Lucie va lire, Françoise met à jour un album de photographies. Je vais me glisser dans un transat sous le tilleul qui lance ses rejets, raie le ciel que traversent des lambeaux de nuages poussés par le mistral, il déboule de partout, comme une avalanche. Et lorsque les poussées du vent s’interrompent, montent du lit du Lez le roulement discret de ses eaux et des saules qui le bordent le chant des oiseaux.
La dernière douane
Depuis que le silence
n’est plus le père de la musique
depuis que la parole a fini d’avouer
qu’elle ne nous conduit qu’au silence
les gouttières pleurent
il fait noir et il pleut
Dans l’oubli des noms et des souvenirs
il reste quelque chose à dire
entre cette pluie et Celle qu’on attend
entre le sarcasme et le testament
entre les trois coups de l’horloge
et les deux battements du sang
Mais par où commencer
depuis que le midi du pré
refuse de dire pourquoi
nous ne comprenons la simplicité
que quand le coeur se brise
Les branches nues des feuillus ont pris des couleurs, leur balancement donne le vertige. Je repense à la soirée d’hier, à la satisfaction de Lily, à celle d’Hesselbarth et à son air canaille, à la générosité d’Isabelle, à l’intelligence bourrue de Raboud, au visage transparent, aux yeux liquides de Jaccottet. C’est le moindre mal que l’on peut espérer d’un weekend pascal sans cloche ni commémoration, qui promet cette année encore, non pas tellement la venue de l’homme neuf mais, plus modeste, celle prochaine du printemps. Deux hirondelles ont tracé cet après-midi d’illisibles signes dans le ciel. Stéphane m’apprend qu’elles en a vu aujourd’hui au-dessus du lac.
Jean Prod’hom
Peindre le pays où fleurit l’oranger

Cher Pierre,
Du jaune, des rouges, de l’orange, avec du bleu et les premières hirondelles, le printemps s’était bel et bien installé à Grignan. Et il y avait foule vendredi dernier, pas seulement parce que le soleil avait fait son retour et que les terrasses étaient ouvertes, mais aussi parce que l’Association Jean-Claude Hesselbarth et la ville de Grignan s’étaient donné la main pour fêter le 90ème anniversaire de ce peintre majeur, en présentant dans le bel Espace d’Art François-Auguste Ducroz quelques-uns de ses dessins à l’encre de Chine et un bel ensemble de ses peintures solaires.

Photo | Danielle Marze
Il y avait, pour entourer l’artiste né à Lausanne en 1925 et installé aujourd’hui dans la Drôme provençale, sa femme, sa famille, ses proches, ses amis – et parmi eux Philippe Jaccottet l’ami de toujours. Il y avait aussi le maire de la ville, Monsieur Bruno Durieux, ancien ministre.
Il faut préciser que le vernissage de cette exposition à Grignan ne constitue que le début des festivités, puisque la fête se poursuivra à Lausanne le jeudi 23 avril à 11 heures, au Théâtre de Vidy. C’est en effet à cette occasion que sera présentée au public romand une importante monographie rétrospective : Jean Claude Hesselbarth. Peindre le pays où fleurit l’oranger. Dans cet ouvrage, les auteurs Lauren Laz et Nicolas Raboud analysent les différents aspects d’une oeuvre importante, sur laquelle Pascal Ruedin, Philippe Jaccottet, Jacques Chessex et Francine Simonin donnent leur éclairage.

Photo | Danielle Marze
Et parce que l’oeuvre de cet homme et l’homme lui-même en valent la peine, l’ouvrage repartira le 15 mai pour Grignan, il y sera présenté une seconde fois, non plus à ceux qui l’ont vu naître, mais à ceux qui l’ont accueilli à Grignan, il y a longtemps déjà.
Jean Prod’hom
Des longues traversées d’autrefois

Cher Pierre,
Des longues traversées d’autrefois, avec presque rien sur le dos, me reviennent à l’esprit les images heureuses et transparentes de la première heure, sitôt tiré hors du sac de couchage, quel que soit le ciel, ou des draps du lit d’auberge que je m’étais, la veille, autorisé.

Et ce que je comprends ce matin, en quittant Crest, c'est que l’inquiétude qui m’étreignait alors, au moment des préparatifs – Avais-je tout pris? Trop pris? N’avais-je rien oublié? –, je l’avais remisée dès le premier soir au fond de mon sac à dos rebondi, contre lequel je retrouvais à l’aube ma tête vide et reposée. Et qu'il suffisait pour entamer cette nouvelle traversée du jour de me lever, dirigé par une seule idée, celle de suivre la course du soleil, en mettant un pied devant l’autre et en acceptant la compagnie du silence de ceux que je laissais derrière moi et dont je voulais me montrer digne. Avec, rétrospectivement, le sentiment que ces premiers pas du premier matin me rapprochaient de l’existence des bêtes croisées soudain, sans les abois qui écourtent leur vie.
Ce sont, je crois, cette liberté et cette légèreté, quand tout est joué et qu’on ne peut plus revenir en arrière, quelles que soient les circonstances, qui pourraient me convaincre de reprendre ces voyages, avec un sac qui ne contiendrait que ce dont j’aurais besoin, c’est-à-dire rien ou presque rien, de le jeter sur le dos et de marcher au rythme de la conscience qui s’éveille. A peine des pensées mais des pensées tout de même, avec personne au contour, parce que de contour il n’y aurait pas, soutenu seulement par les bras ouverts du jour dans lequel mon corps se confondrait comme il le fait dans la nuit, sans savoir de qui il s’éloigne, de quoi il s’approche, et qui s’efface.
Une ombre peut-être, rien qu'une ombre inventée
Et nommée pour les besoins de la cause
Tout lien rompu avec sa propre figure.
Si faire entendre une voix venue d'ailleurs
Inaccessible au temps et à l'usure
Se révèle non moins illusoire qu'un rêve
Il y a pourtant en elle quelque chose qui dure
Même après que s'en est perdu le sens
Son timbre vibre encore au loin comme un orage
Dont on ne sait s'il se rapproche ou s'en va.
Je fais un tour dans le lit de la Drôme, monte à Bourdeaux. Fais une halte dans le cimetière situé en contrebas du camping des bois du Châtelas, sur la route de Dieulefit ; ils sont dans la pente, pour la plupart des Turc : Henri et Emma (née Dufour), Henriette Bovero (née Turc), Max, Louise, Emilie (née Gresse), Hippolyte, Alexandrine (née Faure) dont je retrouverai plus tard les frères et soeurs dans le cimetière qui jouxte la belle église romane de Comps. Il y a encore un étrange couple ensemble sous la même pierre, dans l’angle du cimetière, Hippolyte Turc mort en 1930 à l’âge de 59 ans et Simone, morte à 17 mois. Paul Lelièvre, le pasteur Henri Jersey et Marie René, institutrice au milieu du siècle, complètent le tableau.
C’est à 13 heures que j’arrive à Colonzelle, Françoise rempote, la glycine est sur le point de fleurir. On mange des crozets, avec du poulet qu’Edouard a préparé.
Nous partons à pied au milieu de l’après-midi, Françoise, Lucie et moi, on longe le Lez. C’est le vernissage d’Hessel à l’Espace d’Art François-Auguste Ducros de Grignan, il y a du monde, un accrochage et une lumière sans comparaison avec celui et celle de Martigny. Hessel et Liliane sont souriants, le maire prolixe, Nicolas évasif. Je retrouve Paula, une collègue d’il y a 20 ans qui vient pour l’occasion de Bagnols, on parle de ce qui nous est arrivé depuis, Jaccottet me demande si j’ai reçu le mot qu’il m’a envoyé.
On se retrouve chez Isabelle qui nous accueille dans son mas de Cordy, à la sortie de Grignan, après la zone industrielle ; on mange libanais. Je reconnais un graphiste de Lausanne, Gilles, retrouve Paula. Hessel rentre se coucher au milieu de la soirée, je rejoins Philippe, Nicolas et sa femme près du feu. Philippe, malgré une chute dans les escaliers il y a une semaine, tient une forme d’enfer, on rit, aucune tache, de la légèreté. Nicolas me fait gentiment le reproche de ne pas avoir mentionné le nom de mon illustre voisin à la fin de Tessons ; il a raison, je me repens. Je rentre à près de 23 heures.
Jean Prod’hom
En définitive ce qui m'attache à la poésie

Cher Pierre,
Signes pour voyageurs
Voyageurs des grands espaces
lorsque vous verrez une fille
tordant dans ses mains de splendeur
une chevelure immense et noire
et que par surcroît
vous verrez
près d'une boulangerie sombre
un cheval couché dans la mort
à ces signes vous reconnaîtrez
que vous êtres parmi les hommes.
En définitive, ce qui m'attache à la poésie, ce sont des poèmes que tout oppose. Les premiers renvoient à la possibilité de donner à voir et â entendre, hors de nous, la coexistence mystérieuse des choses ; les seconds, â celle de faire exister une phrase si simple et si légère qu'elle chemine, en nous, sans toucher à rien, en donnant un écrin intérieur â ce qui nous manque.

Les Signes pour voyageurs de Jean Follain sont de la première espèce. Le Si peu de Jean Grosjean est de la seconde.
Le Silence
Il y a la luminosité fugace des choses, cailloux, bains de paille, pans de murs, pans de ciel entre les branches. Les passages de l'air, les frissons du feuillage, l'herbe qui bouge, les flaques qui se rident, tout se montre et se dérobe...
...
Le grand silence que j'ai toujours entendu derrière les charivaris, je m'écartais d'eux pour mieux l'entendre. Lui seul veut dire quelque chose. Tout ce qu'on voit, tout ce qui bruit, tout se tait, mais derrière le mutisme, il y a ce silence de quelqu'un qui est sur le point de parler.
On se dit au revoir, Sandra et les filles partent à pied pour Froideville. Je boucle mon sac, charge la voiture, oublie le câble d'alimentation du portable, me trompe à Bardonnex, sors de l'A40 à Bellegarde, repique sur l'A41 à Annecy, en sors aux Abrets, m'égare près de Voiron, décide de faire confiance à l'Isère et de lui donner la main, jusqu'à Romans. Les noyers n'ont pas vieilli, l'herbe reverdit : Moirans, Albenc, il faudrait s'arrêter quelques jours, la vitesse enlaidit.
Je quitte l'Isère pour bifurquer vers le sud. Le soleil plonge derrière les nuages qui couvrent les montagnes de l'Ardèche, il allume les contreforts de celles de la Drôme, les peupliers, les saules, les premiers cerisiers, les fleurs jaune pâle, timides encore, des colzas.
Fais halte à Crest pour la nuit.
Jean Prod’hom
Follain / Grosjean / Des Forêts / Bouvier / Metz

Cher Pierre,
Follain, Grosjean, Bouvier, Des Forêts, Metz, cinq poètes invités par Mathilde Roux à entrer dans la danse. Cinq poèmes pourquoi pas, mais je ne voudrais pas oublier les autres, les poèmes qu'on entend parfois lorsqu'on tend l'oreille, ceux qu'on n'entend pas ou à peine, ceux que quelques-uns d'entre nous seront bien obligés d'écrire.

André Dhôtel souligne la nudité de l'écriture de Jean Follain, cet homme a en effet su mettre la rhétorique en quarantaine, se satisfaire d'un mode sommaire : la parataxe, pour témoigner de l'étrangeté de ce qui est.
Signes pour voyageurs
Voyageurs des grands espaces
lorsque vous verrez une fille
tordant dans ses mains de splendeur
une chevelure immense et noire
et que par surcroît
vous verrez
près d'une boulangerie sombre
un cheval couché dans la mort
à ces signes vous reconnaîtrez
que vous êtres parmi les hommes.
Avant ça, terminer le job : faire du feu et le petit tour avec Oscar, descendre au Mont avec l'idée toujours plus claire et distincte que ce sont les élèves qui doivent travailler, penser, trouver des correspondances ; mon travail à moi étant de les y conduire.
Mange avec C au Central, on parle de Naples, des vacances, de la manière dont on remplit notre ministère. Deux périodes encore à tout faire pour que la majorité des élèves se penchent ou lèvent la tête sur quelque chose, quelle qu'elle soit.
Quitte le Mont, ramasse Arthur à l'arrêt de bus, repars presque immédiatement pour Thierrens par Villars-Mendraz où je croise Ernest du Moulin de Peney. Il me parle de J qui est rentré malade de Madagascar, me donne des nouvelles d'Hermenches et de Mont-Frioud, de ses deux fils et de sa fille. Cet homme, vieux déjà, a une mémoire vive étonnante, me rappelle des événements dont je ne me serais, sans lui, jamais souvenu.
Je reprends la route jusqu'à Thierrens sous le crachin. Les filles sont radieuses, Louise a monté Stella, Lili Paditcho. Heureuses aussi de me confier leurs bons résultats scolaires. On s'arrête à l'auberge communale de Corcelles pour fêter le début des vacances, j'achète un morceau de gruyère à la laiterie, que je compte offrir la semaine prochaine à Jean-Claude.
La journée n'est pas finie, il me faut encore prendre de l'essence et récupérer Arthur à Ropraz, Il est un peu plus de 8 heures lorsqu'on mange, un peu moins de 10 lorsque les filles sont au lit, exactement minuit lorsqu'il est minuit.
Jean Prod’hom
Gil Jouanard

Cher Pierre,
Gil Jouanard écrit :
Invariablement, nous voici ramenés sur les traces d'un sentier à orties et à ruines, à racines et à tessons, au fond d'un village où se trouve condensée la mémoire entière de l'espèce. Un seul vieux paysan, un ouvrier fourbu, un seul vagabond ou l'un de ces passants anonymes et graves suffit à donner le signal : l'ineffaçable sentier se remet en chemin. Rien de vraiment important ne nous a jamais reconduits ailleurs que sur cette sinueuse montée à travers les champs et les bois, bordée de murs anciens et de friches analphabètes. C'est ici, définitivement, la patrie de terre et de roc, poussant ses soixante-dix ou quatre-vingts centimètres de largeur jusqu'à des pâturages et des cultures désaffectées. Et le soleil, c'est surtout à travers les feuillages du bord de ce chemin que nous le connaissons, et c'est sur le bord du chemin que le bruit de l'eau nous est le plus familier. Tout ceci s'explique peut-être par ce seul mot : enfance.

L'enfance est notre viatique, ceux qui craignent qu'un malheur ne le rabote se trompent. Le vaisseau de l'église craque, ils sont tous là, dedans et dehors, familles, amis, copains, collègues, tous venus de leur plein gré pour entendre parler de la mort. A l'avant de l'embarcation, le père et ses quatre enfants reprennent un peu de force, les vents sont tombés, il pleut. Il leur faut repartir de rien, du pot-au-noir, sans portulan, redistribuer les cartes ; mais on le sait, on le devine, le vent n'est pas loin.
C'est une histoire de courage, le courage d'une femme qui est demeurée debout jusqu'au bout parmi les vivants, sans rien cacher ni rien laisser paraître, souriant à ceux qui s'étaient mis à douter ; ne doutant pas, au fond, d'avoir obtenu ce qui lui était promis.
Courage qui essaime dans le coeur de son mari ; il dit, stupéfait, debout, incrédule, quelques mots à ceux que le moindre mot effraie ; courage qui se fixe dans le coeur des enfants qui cherchent à se souvenir ; des proches, des amis. Courage enfin, parce qu'il faut bien se donner les moyens de consentir à l'impensable.
On se dit qu'à cinq ils seront plus forts, ils comprendront : ce que laissent les morts ne meurt pas mais nourrit les vivants. A côté de moi, avec son violon, celle qui avait fait entendre il y a quelques années, la Méditation de Thaïs, elle joue cet après-midi, sur la galerie de l'église du Mont, la sarabande de la Partita II de Jean-Sébastien Bach.
Je rencontre à 16 heures 30 un père et son fils, le fils ressemble à l'élève. Alors nous les adultes, on cherche à faire voir à l'enfant une voie discrète, une alternative élégante à celle qui fait feu de tout bois. Pas sûr que nous y soyons parvenus.
Je repasse au Centre paroissial saluer O et ses enfants, avant de rejoindre la vingtaine de personnes qui assistent à la conférence de Laurent Flutsch au musée romain de Lausanne-Vidy : on rit des fictions des archéologues. Je perds mon téléphone dans la salle de conférence, le retrouve sous le siège de la voiture : il y a décidément des miracles. Lorsque je termine cette note, il est minuit.
Jean Prod’hom
Holan a écrit ceci

Cher Pierre,
Holan a écrit ceci: Tu ne sais d'où vient ce chemin qui ne te mène nulle part. C'est la fin de l'après-midi, le soleil a transformé en or tout ce qu'il a touché, même la pluie. Personne. L'heure s'attarde, je resterais bien encore un petit bout d'éternité, sans savoir comment et pourquoi je me trouve là.

Il n'y a que la langue que nous avons en partage, sur laquelle reposent nos échanges et nos vies ; à l'intérieur de laquelle il est possible, cependant, de considérer ce à quoi il nous a fallu renoncer, terre immense et buissonnante dont nous devinons l'étendue et à laquelle nous devons, quel que soit le prix, préserver l'accès, ne serait-ce que poétiquement. Terre qui ne s'est jamais défilée et qui veille, prête à reprendre ses droits si nous excédons les limites qu'elle nous invite, depuis la nuit des temps, à fixer nous-mêmes, en recouvrant d'une fine poussière le plateau d'un jeu dans lequel on se sera tout à la fois égarés et rendus captifs.
Reçois un mail que la Fondation pour la collaboration confédérale a envoyé à Pascal Rebetez, il s'agit d'une fondation qui encourage les échanges culturels entre les régions linguistiques par la publication de traductions d'auteurs suisses contemporains. Elle lui signale que la Commission de publication a proposé de mettre dans son programme Tessons (traduction en allemand et en italien). C'est dire que, si j'ai bien compris, ce petit livre sera proposé aux maisons d'édition suisses. Et s'il s'avérait que l'une d'elle s'y intéressait, elle serait soutenue par une contribution aux frais d'impression, et la traduction subventionnée par Pro Helvetia. Ce serait encore une bien jolie histoire.
Les enfants dorment, les taux hypothécaires sont bas, l'emprunt a été accepté. Une fois encore, jusqu'à tard, on se penche sur les plans, ceux de la salle de bains cette fois. Il est passé minuit quand je vais me coucher.
Jean Prod’hom
Il n'est pas sûr que les derniers morceaux de foyard

Cher Pierre,
Il n'est pas sûr que les derniers morceaux de foyard stockés à la véranda suffisent à boucler la saison ; la têche diminue de manière inquiétante. Plus de petits bois non plus, je passe à la Branche en rentrant de l'école. Passe aussi chez Christian à la Goille, il enverra quelqu'un, demain matin, ramasser la tondeuse, la débroussailles et la tronçonneuse qui seront prêtes dans 15 jours.

Reçois un mot de l'Association Ecoles à Berne qui va relancer les cantons, chacun séparément. Il faudra qu'ils acceptent de financer ce projet s'ils souhaitent que leurs classes puissent y participer. Pas sûr donc que je passe une dernière semaine à Berne, avec une dernière classe en 2017.
Je reçois un autre mot, de l'Association Jean-Claude Hesselbarth. Le vernissage de son exposition aura lieu le samedi 4 avril, à Grignan (Espace d'Art François-Augute Ducros) ; sera présenté également à cette occasion l'ouvrage que Lauren Laz et Nicolas Raboud lui ont consacré : Jean-Claude Hesselbarth. Peindre le pays où fleurit l'oranger.
Autre manifestation dans cette même petite ville drômoise, mais chez Christine Macé qui inaugure la nouvelle saison de Terres d'Ecritures avec les derniers travaux de Denise Lach ; ce sera le lundi de Pâques.
Le temps est humide, quelque chose s'est refroidi et il pleut ; où qu'on mette les pieds, c'est de la boue qu'on traîne, on a trop dit que le printemps était là. Ce n'est donc pas aujourd'hui que je déplacerai et brûlerai les dépouilles qui jonchent le sol du jardin. Je reprends, à la place, quelques pages du dernier livre d'Aude Seigne : Les Neiges de Damas avant de préparer à manger : des épinards à la crème dans lesquels j'ajoute deux pommes râpées ; j'organise ensuite dans un plat tous les restes que je déniche dans le frigo susceptibles d'être réchauffés, ajoute deux tomates pour faire joli, et hop! l'affaire est réglée. J'appréhende pourtant la réaction des enfants, ça passe, ils se régalent, notre travail éducatif vis à vis de la nourriture est bientôt terminé. On regarde le téléjournal qui égrène le chapelet des misères du monde, les enfants vont ensuite se coucher ; on discute, Sandra et moi, de notre future cuisine, jusqu'à tard.
Jean Prod’hom
Je n'ai pas l'heure d'été à la bonne

Cher Pierre,
Je n'ai décidément pas l'heure d'été à la bonne ; il y a d'abord les inconvénients liés à mon ignorance du moment et de l'heure, on a beau me répéter que ces changements auront lieu les derniers dimanches de mars et d'octobre, rien n'y fait, je ne m'y habitue pas. Aujourd'hui encore, nous voulions, Arthur et moi, partir à 8 heures pour les Diablerets, nous avions mis le réveil à 7 heures pour être sur les pistes à 9. Total, nous sommes arrivés à 10 heures, pris un abonnement d'une journée plutôt que d'une demi. Nous avons été les pigeons.

J'ai le sentiment, dans ce cas comme dans tant d'autres, que trop de choses se sont faites et se font encore dans notre dos, pour servir un sous-ensemble du collectif.
Les oeufs d'Isenau, que j'ai connus neufs en 1974, alors qu'on passait des vacances à la Gentiane, ont pris un coup de vieux ; un employé m'indique qu'ils devraient être changés en 2017. Ce qui ne nous a pas empêchés de trouver un peu de soleil en arrivant, avec la Palette d'Isenau dans la brouille.
On skie une bonne heure, Arthur est content de ses nouveaux skis. Mais le vent souffle, on décide de basculer sur les Meillerets et de rejoindre Bretaye et les Chamossaires. C'est la neige et la pluie qui nous accueillent ; courageux, on skie jusqu'à près de 3 heures, sans soleil, mais avec Jacky Lagger en récompense, sous un chapiteau vide à Bretaye, il neige, on écoute deux chansons, skis au pieds. J'ai un faible pour cet homme, son parcours dont je ne sais rien, son allure, sa bienveillance rugueuse.
On ramasse au retour Lucie à Epalinges ; je fais revenir un morceau d'épaule de porc que je termine dans une cocotte, râpe des carottes rouges dans laquelle je glisse des fruits de grenade ; fais cuire du riz.
Sandra et les enfants présentent à Lucie les travaux prévus dans la maison ; elle a lu Aude Seigne, on parle un peu des Chroniques de l'Occident nomade. Louise fait une tarte aux pommes.
Ecoute Comme un poisson dans l'eau, première chanson de l'album Spectacle heureux. Et puis bonne nuit.
Jean Prod’hom

KO debout

Cher Pierre,
KO debout ! en faisant, cet après-midi, un usage immodéré de la tronçonneuse pour tailler la haie vive au levant du jardin, les trois bouleaux près de l'étang -qui ont bien pris 4 mètres en deux ans-, et les repousses dans le talus qui longe le parking ; j'en sors défait, sans même m'être occupé du saule déplacé il y a trois oui quatre ans, trop imposant pour que j'aie le courage, aujourd'hui, de le tronçonner et de le débiter, avec le corollaire qu'il aura, dans quelques années, pris du poids et de l'envergure, et qu'il me faudra alors plus d'énergie encore que celle qui m'a manqué cet après-midi, pour m'atteler à un type de tâches qui me rebutent chaque année davantage.

J'ai retrouvé Fl à Ropraz, au milieu de la matinée. On se chargera de mettre en place le bureau des inscriptions, du contrôle et des résultats de la course du 3 mai. Je lui annonce que je devrai le quitter en début d'après-midi puisque je suis de piquet au Salon du livre de Genève. Il n'est pas intéressé par le poste de secrétaire du club, occupé à d'autres tâches au sein d'une société de gymnastique. Je vais donc vraisemblablement rempiler pour une année. Lis les deux premières parties de Jours sans événements de Gil Jouanard.
Il est 5 heures, je conduis Lili à Carrouge pour un anniversaire, Arthur revient de Lausanne. Je fais réchauffer des restes. Louis et Sandra partent ensuite au cinéma pour Oron, je regarde Stalker sur l'ordinateur, avec Arthur qui craque 10 minutes avant la fin. Récupère Lili à 10 heures 30, Sandra et Louise nous rejoignent peu après.
Le ballet cesse, on se retrouve tous les cinq un bref instant avant d'aller nous coucher. Demain, je monte skier avec Arthur aux Diablerets.
Jean Prod’hom
Les trois chevreuils

Cher Pierre,
Les trois chevreuils qui broutent ce matin dans le pré au-dessus de la Moille aux Blanc semblent ne pas s'étonner de ma présence à la lisière du bois ; mais il suffit que je fasse mine de m'approcher pour qu'ils déguerpissent aussitôt. Ils confirment mon impression de faire juste en commençant la journée par une balade.

Je descends à Treytorrens en trois fois : m'arrête en effet au bord du lac de Bret, dans le miroir duquel les arbres plongent leurs branches noires, tourmentées ; fais une halte au cimetière de Chexbres avant de descendre la corniche ; bois enfin un café à Cully où je relis les dernières pages du Causse en hiver de Gil Jouanard.
Il est 10 heures, Anne-Hélène et Yves sont là, on babille un instant sur la terrasse avant de commencer nos travaux. Mais les choses ne débutent vraiment que lorsque mes acolytes prennent les choses en main ; ils ne m'entendent pas, ils fonctionnent ensemble depuis des années. C'est un plaisir de ne pas les comprendre et de me retrouver sur la touche, la fenêtre qui donne sur le lac est ouverte.
Je repars avec quelques photos et des instructions pour Grignan : présenter à Christine l'état de nos travaux, obtenir son accord. Il me faudra encore établir comment fixer aux murs le support sur lequel reposeront les photographies, noter les dimensions des locaux. Il est près de 14 heures lorsqu'on interrompt les essais, on file à Rivaz manger une pizza, les forsythias sont en fleurs.

Toute cette histoire m'inquiète, ses dimensions d'abord ; il y a ensuite tellement à faire, à penser, ne rien oublier, anticiper ; il y a enfin des décisions à prendre dans des domaines où je ne suis pas à l'aise.
Je m'arrête à Oron où je fais les achats pour les repas de ce soir, samedi, dimanche et lundi, le soleil est revenu. Au Riau j'embarque Sandra pour le petit tour. Elle est allée discuter des plans de la salle de bains, me raconte tout dans le détail. L'ensevelissement du papa de F aura lieu lundi après-midi, celui de la maman de M, mercredi après-midi, l'étau se resserre.
Je me suis simplifié la vie, on mangera ce soir des délices au fromage, des pommes de terre duchesse précuites, une salade de fruits. On parle du crash de l'A320 dans les Alpes, des dispositifs de sécurité, de la pression sociale et des dépressions individuelles, de ce que la concurrence effrénée provoque, des marges et des portes étroites. On ne sait pas trop quoi dire.
Jean Prod’hom
Marcher dès le saut du lit fait du bien

Cher Pierre,
Marcher dès le saut du lit fait du bien, surtout lorsque la part de soi chargée de faire le point – qui suis-je? où suis-je? qu'ai-je à faire? – annonce au réveil, à celui qui attend les instructions, que ce qui devait être fait a bel et bien été fait la veille. Et lui indique, pour le combler, qu'il serait préférable de remettre à plus tard la tâche prévue, laquelle attend, comme le pain, son levain.

En effet, j'ai fini hier soir de rédiger les réponses aux questions qu'Amandine Gleralec m'a adressées, et les cinq poèmes que V. M-A. m'a invité à écrire demeurent dans les limbes. J'ai donc marché une grosse demi-heure en équilibre, sans appréhension, sans ombre : Mussily, Moille aux Blanc et retour.
Mais il est temps de descendre à la mine ; pas sûr que les gamins soient aussi enclins qu'Oscar à renifler les pistes qu'ils croiseront ; en voilà un qui est toujours content lorsqu'on se saisit d'une laisse.
J'aperçois en sortant de la maison les traces de deux paradis : devant la porte-fenêtre du salon et en bas des traverses de chemin de fer. Ce sont les filles qui ont sorti, hier après-midi, les craies ; elles ont indiqué, en couleur, les étapes pour y accéder ; la pluie de la nuit n'a pas réussi à les effacer et dans le jardin, l'hiver a buté contre les fragiles obstacles qu'elles ont dressés pour jouer avec leurs chevaux imaginaires, enfermés tout l'hiver dedans leur tête.
Si mes premiers pas ont baigné dans une douceur printanière, il n'en ira pas de même pour l'élève dont la maman est morte hier matin des suites d'une longue maladie. Je me raisonne, il ne faut préjuger de rien, les hommes ne manquent pas de ressources ; on leur prête trop souvent nos faiblesses, sans considération des réserves dans lesquelles ils puisent lorsque l'irréparable se produit.
Pas tous! La situation en effet dans laquelle l'organisation de la société plonge certains de nos enfants, fragiles déjà, ne les aide pas à recourir instinctivement aux forces dont ils disposent, sans le savoir ; à en user pour trouver une place qui leur ferait défaut ou à laquelle ils n'auraient jamais eu accès. Au contraire, leurs forces tendent à s'échapper, à se diluer, à se perdre dans les mailles du tissu social.
L'impératif de croissance est mortifère. Sans que l'on sache précisément si la multiplication des aides, des médiations, des marabouts, des psychiatres, des coachs, des psychologues, chaque fois qu'ils interviennent, est à l'origine de la réduction de substance des personnes dont ils s'occupent, ou si cette substance est entamée avant même qu'intervienne le filet social. Répondre à cette question ne change rien à l'affaire, puisque celui-ci ne parvient pas à endiguer la montée des pauvretés, à refaire du lien et donner un peu de confiance à ceux qui en manque. A moins que je ne me trompe, les plus optimistes n'hésitant pas à affirmer que tout va encore assez bien, qu' il ne faut pas se plaindre, que ça pourrait être pire, reconnaissant par là qu'on ne perd rien pour attendre.
L'architecte est venu en fin d'après-midi nous présenter les grandes lignes des différents travaux d'isolation sur la maison ; on risque bien de faire la totale. Je laisse Sandra à l'architecte, parce qu'il est temps de conduire Arthur à Ropraz Le temps s'est refroidi et je retrouve les filles, Lili frigorifiée, sortant du manège à Thierrens, la voltige ne les aura pas réchauffées. Le feu brûle dans le poêle.
Les derniers chapitres des Chroniques de l'Occident nomade m'occupent jusqu'à 8 heures. Aude Seigne raconte sa fâcheuse habitude de compter les marches d'escalier ; elle se souvient notamment du nombre de celles qui lui ont permis d'atteindre le sommet du minaret le plus septentrional d'Europe (XV). J'aurais pu succomber à cette tentation, si et seulement si j'avais été capable de déterminer avec certitude où commencent et où se terminent les première et dernière marches de n'importe quel escalier.
Elle évoque les malentendus qu'engendrent la collision des temporalités (XXII), la honte qui saisit le voyageur (XXVI), l'agitation qui l'amène à considérer un si grand nombre de choses en même temps qu'elles est lui se vident de leur substance (XIX).
Quelque chose doit changer, cette fuite s'interrompre, inexplicablement (XXI), en devenant effacement de soi (XXII). Le départ prend alors le pas sur le voyage (XXIII), l'écriture sur les notes. Deux ans pour donner une expression à ce besoin de voir les choses s'éloigner, dos au mur, le port d'Ancône dans les lumières d'hiver (XXV). Dire ce mouvement pour tenir les deux bouts, voyager et demeurer sur le pont d'un rafiot.
Jean Prod’hom
Ne pensais pas que les Mimosas

Cher Pierre,
Ne pensais pas que les Mimosas, l'une des unités psychogériatriques de Cery, me feraient une si bonne impression. Je m'y suis rendu à midi, après une matinée à la mine ; j'ai parqué au nord du site, près des ateliers, en zone bleue ; j'ai traversé le quartier des pavillons : le Tamaris, le Calypso, les Cerisiers, les Cèdres ; des jeunes gens s'étaient regroupés et fumaient emmitouflés dans des gros habits qu'ils semblaient porter depuis toujours. Je me suis dit que, pour certains, ce qui leur reste c'est leur veste, celle qu'ils portent depuis qu'ils ont 15 ans.

Parce que j'avais de l'avance, j'ai zigzagué entre les ateliers et les pavillons, les grands bâtiments majestueux, les horodateurs, des locaux apparemment sans affectation, une église, des buvettes, des allées, une ferme, un service social, de grands arbres, des jardins, il y a même une galerie d'art ; il y a aussi une grande salle de colloque, des routes secondaires, des chemins de terre, des pavés, un court de tennis, des bois, plusieurs hôpitaux et une pelouse pleine de jonquilles.
Quelque chose demeurait captif dans ces lieux, quelque chose qui m'a fait penser aux auberges de jeunesse en fin d'après-midi, au club med en basse saison. Ou encore à un quartier ouvrier d'une petite ville industrielle du sud de l'Europe. A un monastère aussi, mais avec des règles moins strictes que celle de saint Benoît. Ce n'était pas désagréable.
Si bien que, lorsque je suis monté en ascenseur pour retrouver F. dans l'unité des Mimosas, mon appréhension – liée au mot psychogériatrique qui me renvoie immanquablement aux instruments de torture médiévaux – s'était évanouie. J'ai rencontré des infirmières et des infirmiers pleins de bonne volonté et d'attention.
F était dans le couloir, elle n'a pas été surprise de me voir, comme si ma visite était annoncée, elle m'a reconnu. Je lui ai proposé qu'on se rende de suite de l'autre côté du village, pour jeter un coup d'oeil aux sculptures de Marie-Chantal Collaud et aux peintures de Gisèle Grana, elle n'a pas refusé. On a traversé lentement les longs couloirs souterrains des bâtiments ; dehors, on est allés d'un bon pas, le froid semblait la piquer tellement qu'on y est arrivés avant l'ouverture ; j'ai changé de plan, on est entrés, de l'autre côté de l'allée, dans l'atelier de poterie. F n'a pas montré beaucoup d'intérêt, ni pour la poterie, ni pour la balade ; elle s'est plainte du froid. Mais le ton y était, on vivait bien dans le même monde, sans que nous sachions exactement lequel, de quoi nous parlions et si ce qu'on disait aurait une suite.
On a repris le même chemin pour rentrer aux Mimosas, on s'est trompés deux fois d'étage avec ce fichu ascenseur. Les infirmières nous ont alors invités aimablement à boire un thé au salon. J'y suis resté jusqu'à près de 3 heures, l'atmosphère était paisible, celle d'une pension qui vit au ralenti. On a fait fondre des biscuits pèlerines dans un thé aux fruits qu'un infirmier nous a servis ; c'est une pension plus qu'un hôpital. Une patiente a voulu emporter une biscotte dans sa chambre, elle a pris une petite voix pour convaincre l'infirmier qui la lui refusait qu'elle la glisserait dans le tiroir de sa table de nuit et que personne n'y verrait rien. Il a accepté. On est retournés dans sa chambre, je lui ai demandé si je pouvais faire une photo, elle regarde par la fenêtre, la vie continue.
Je suis parti réconforté, on a dit tant de choses sur ces établissements, des avis à l'emporte-pièce nourris par les peurs. Mais j'ai cru comprendre quelque chose d'important, les visites soulagent les infirmiers qui en ont bien besoin, leur travail est tellement difficile. Même que je leur ai dit merci en les quittant et qu'ils m'ont souri. On est tous embarqués, mais cette fois c'est nous qui sommes dedans.
J'ai fait une halte dans la galerie en allant rechercher ma voiture ; les sculptures de Marie-Chantal Collaud méritent le détour. Un saut encore jusqu'au cimetière juif du bois de Cery : pas d'arrosoir. Rentre ensuite au Riau, longue promenade avec Sandra et Oscar par l'Escargotière et la Goille, il pleuvine.
Jean Prod’hom
On ne peut que se réjouir : le Matricule des Anges

Cher Pierre,
On ne peut que se réjouir lorsque des inconnus se saisissent des mots que vous avez laissés et leur donnent une seconde vie. Le soin qu'ils ont mis, à déposer les leurs, éloigne un instant les doutes qui vous taraudent. Ainsi les lignes transparentes de Dominique Aussenac, à propos de Tessons, dans le dernier Matricule des Anges (161). C'est dans la salle de presse de la bibliothèque universitaire de Lausanne que je les lis.

Fais un saut ensuite, avant midi, à la librairie de la Louve ; en ressors avec Le causse en hiver de Gil Jouanard. Je remonte chercher ma voiture parquée à la Borde par le Valentin et Riant-Mont. La responsable du salon de coiffure où j'allais me faire couper les cheveux, il y a cinquante ans, est sur le pas de porte. Elle a repris le commerce, il y a 10 ans, à celle qui a succédé, pendant 25 ans, à Monsieur Descloux. Je ne reconnais rien des lieux.
J'entre, à l'angle du Valentin et de Riant-Mont, dans l'épicerie-bio qui a remplacé Diga-piano. La propriétaire me raconte que le vieux Zappelli est venu la voir il y a quelques années, heureux de savoir que les lieux qu'il avait occupés autrefois accueillait à nouveau une épicerie. A dire vrai, une épicerie qui ressemble davantage à une droguerie ou une pharmacie qu'au magasin de l'Italien. La boulangerie de Riant-Mont 2 est devenue elle aussi un salon de coiffure. Je vais faire un tour au fond du jardin de Riant-Mont 4, fais quelques photographies avant de redescendre par les escaliers tournants jusqu'au Tunnel. Remonte à la mine pour trois périodes et un rendez-vous avec une mère d'élève.

Bois une verveine au café d'Oron en lisant quelques belles pages de Gil Jouanard. Me rappelle les avoir traversés, les causses, de Mende à l'Aigoual, me souviens aussi de deux nuits dans les hôtels vides de Saint-Enimie et de Meyrueis, il faisait froid, c'était vraisemblablement l'automne 1982. J'avais trouvé, en redescendant du Causse Méjean, une vesse-de-loup grosse comme un ballon de rugby.
Ramène Lili d'Oron, on passe par Ropraz pour embarquer le mousse.
Jean Prod’hom
Praz-Longet

Praz-Longet : les poules picorent, chacune de leur côté, dans la cour, autour des remises, des dépôts, se hasardent dans l'enclos des moutons. Elles semblent connaître les limites de la propriété au-delà de laquelle elles ne s'aventurent pas, c'est le prix de leur liberté. Les agneaux n'ont pas leur assurance, ils n'ont que quelques jours et appellent leur mère même lorsqu'elle est à deux pas.

A la Marjolatte, les oies s'aventurent aussi, mais en groupe ; on entend, de derrière les écuries, le chant d'un coq, une voiture qui démarre, un chien puis plus rien : la terre se réveille. Des corneilles jettent une ombre, virent avant de se percher sur les peupliers de l'allée ; un tracteur va et vient à la lisière du bois, herse, émousse, ébouse, étale les taupinières. Et tout recommence, séparé par des silences : le coq, un chien, le pédalier d'un vélo, des feuilles mortes, sans ordre ; invisibles, les moineaux et les mésanges assurent la continuité.
Une échelle est restée dans le verger tout l'hiver, pas besoin de la ranger, on en aura besoin ; demain il y aura aussi un ou deux agneaux de plus dans le parc de Praz-Longet.
Cet instant clos, en bord de route, me rabiboche avec ce lundi qui a bien mal commencé ; il me fait oublier ce que la suffisance de ceux qui battent l'air, nourris de certitudes, nous font endurer.

Je ramasse Arthur à l'arrêt de bus, il est 4 heures et demie ; j'emmène Oscar faire un tour, à la laisse, il n'en mène pas large, les chevreuils aboient de tous les côtés ; j'en aperçois un sur l'autre rive du ruisseau. On le croisera plus tard, un bref instant.
Au Riau, même poussée, des moineaux et des mésanges, les ruisseaux qui vont à visage découvert, chatons, samares mêlés à la boue et aux herbes sèches, l'eau stagnante dans les fossés que bordent des ombellifères creuses, sans ombelles, des pourpiers qui s'y abreuvent. Dernières échappées que les balsamines, les orties, les épilobes et les ronces vont bientôt combler.
Les bois se réveillent ; à plus de cent mètres de la maison, Fleur nous regarde passer, elle a, à l'évidence, plusieurs chez elles.
Jean Prod’hom
Corcelles-le-Jorat | 22 août 2014

Cher Pierre,
Que cette correspondance semi-fictive prenne ce tour imprévu me réjouit. Vous avez accepté que vos mots trouvent leur place ici, vous, l'ennemi juré, depuis toujours de la propriété privée, votre réponse tombant sous le coup de cette hostilité de principe.
Je ferai de cette liberté que vous m'accordez un usage modéré, celui qui sied à l’impossible repos, à l’impossible paix qui nous viennent parfois d’avoir assez désespéré de l’homme.

Je me hâte de dresser le tableau des opérations de la semaine prochaine à la mine, puis feuillète le Carnet de notes 2014 qui m'est parvenu hier. Suis les traces de la boîte en carton fort qui renferme l'Abrégé du monde que j'ai relu en début d'après-midi. Je pressens que l'établissement du décalage de la reverdie entre ici et là-bas ne sera pas aisé à lever.
Reprends les Chroniques de l'Occident nomade. Elles constituent une tentative désespérée contre l'oubli, contre la laideur, contre la banalité. Mais elles contiennent aussi une réflexion sur la possibilité de s'éloigner de soi sans devenir fou (VI) et sur les limites et l'oubli de soi (VII). Je retrouve Paul (IX) et fais la connaissances de Tito (XVIII), je croise des gens qui ne se recroiseront plus (XI), des villes, Trieste (XII). Il y a aussi les malentendus, les rues (XVI), il y a un dimanche à Odessa (XIV), des illuminations, les brèves et celles qui durent un peu (XIII). Il y a aussi ce romantisme du voyage qui guette et que l'écriture métamorphose.
Mais il est bientôt 18 heures, temps de descendre à la cuisine et faire à manger.
Jean Prod’hom
Gif | 21 mars 2014

Cher Jean,
C'est dès janvier que les cinq premières jonquilles ont fleuri. Elles sont plusieurs dizaines, désormais, dans leur gloire et, partout, prunus, pruniers, pommiers du Japon mettent des fleurs. Plusieurs marronniers ont déplissé leurs gros bourgeons. C'est toujours la première fois.
La grande banlieue était sous la grisaille et on n'a rien vu de l'éclipse.
En pj, les notes de l'année 2014. Vous pourrez vérifier le décalage de la reverdie entre le Jorat et la région parisienne.
Bonne soirée. Amitiés.
Pierre

Corcelles-le-Jorat | 21 août 2015

Cher Pierre,
Retour officiel du printemps – précédé d’une éclipse partielle du soleil, tout le monde en parle, c’est la grande fête des astronomes. Mais il y a une autre régularité qui me remue, c’est celle des crocus qui ont fleuri le 6 mars cette année.
Et si je consulte mes albums, je constate qu’ils ont fleuri le 5 du même mois en 2014 : même jaune, même place, même inclinaison. En 2013, ils ne faisaient que guigner le 5, à l’étroit dans leur étui. Idem en 2012, mais le 2. Et si je remonte le temps, je constate qu’ils n’ont ouvert leur corolle que le 16 en 2010 et le 14 en 2009. Qu’en est-il cette année des jonquilles à Gif-sur-Yvette ? Et en 2013 et 2012. De combien de jours leur floraison suit-elle celle des crocus? Faudra-t-il attendre pour en avoir le coeur net ou recevrai-je avant l’heure le chiffre de ces petits miracles?

Il est huit heures lorsqu’on se lève, je conduis Lili et Louise à Thierrens pour leur journée de trail, il pleuvine. M’arrête au retour à Chapelle, réveille deux de ses habitants ; je les attends dans ce qu’on appelle ici la chambre, assis sur un canapé défoncé, les volets fermés. Me souviens, avec le nez et les oreilles, du temps de Ginette.
V. me rejoint, on parle de choses et d’autres, de F. autour de laquelle une étrange agitation grandit ; chacun y va de son irrépressible envie de faire le bien, en soi et pour soi, et ça donne un joli charivari. Malgré leur désarroi profond, quelques-uns gardent pourtant la tête froide, une dignité aussi, sans laquelle ce qu’il convient d’accepter pourrait semer le désordre parmi ceux qui auraient tant voulu rester soudés.
Visite de l’atelier de C. Je regarde, curieux, la propension de certains peintres ou photographes à s’entourer de leurs travaux ; j’imaginais que le travail en ces domaines permettait à leurs auteurs de mettre en circulation ce qu'ils avaient conçu pour s’en débarrasser une fois pour tout. Et se retrouver les mains libres, assez allégés pour s'enfoncer, le lendemain, dans ce qu’ils ne connaissaient pas.
La propriétaire de la maison aux sabots s’affaire, je me présente. A son mari également qui coupe du bois à la circulaire. Trois ans que je photographie deux des faces de cette maison ; ils ne sont pas loquaces, ils ont à faire.
La maison est vide et il fait froid ; relis au chaud les 5 premiers tableaux des Chroniques de l’Occident nomade, dans lesquels Aude Seigne revisite ce qui l’a terrassée, un matin de juillet, sur le pont d’un bateau entre Brindisi et la Grèce : la mer et le ciel (I) ; évoque les lectures qui l’ont ravie et ce monde complet qui peut, à l’évidence se passer de nous (II-III). Elle raconte Paul, son premier amant (IV) et tous ces dimanches qui font bande à part en marge des décomptes (V).
Sandra rentre, elle est allée chercher en ville Arthur qui rentrait de Glion, c’est moi qui irai chercher les filles à Thierrens. On se rend ensuite en famille et Françoise à Thierrens. Arthur organise avec ses enseignants et ses camarades de classe un repas de soutien pour leur voyage de fin d'école obligatoire à Stockholm. On rentre à près de minuit.
Jean Prod’hom
S’il convient de nourrir nos enfants

Cher Pierre,
S’il convient de nourrir nos enfants, il convient aussi que nous les envoyions promener le plus souvent possible, en organisant à chaque coup, bien entendu, leur rapatriement jusqu’au jour où ils ne rentreront pas. C’est dans ce sursis qu’ils s’avisent qu’il existe d’autres modes d’exister que celui du lierre et du gui, qu’ils accèdent à un monde tiers. Pour ces raisons nous devons, chacun d’entre nous, ouvrir nos portes aux amis de nos enfants, qu’ils puissent ainsi entrevoir de nouveaux continents et goûter à la liberté, sans avoir à choisir.

Fais le petit tour avec Oscar, file à la COOP faire des courses : carottes et pommes, hot-dog et salade de fruits, joli joli. Il pleut des cendres sur Oron, le paysage a le visage des morts, il fait froid ; j’emprunte des lunettes chez l’oculiste, j’aperçois un croissant vert, c’est le soleil qui guigne derrière la lune.
Aujourd’hui, Louise ramène à la maison trois de ses amies. Elle m’a bien averti ce matin, avant d’aller à la mine, que je ne devrai pas faire mes gags pourris. Je les installe à la véranda, me tais, mange à la cuisine.
Glisse dans des enveloppes le set de table plié en 4, le flyer et l’invitation, que j’adresse à la trentaine de sponsors qui soutiennent la course de trial du 3 mai. Jette ensuite les réponses aux questions que m’ont posées les animateurs de Littérature romande et qu’il me faudra reprendre demain. Sandra et les enfants partent à un peu plus de 5 heures choisir notre future cuisine, restent en ville pour manger et aller au cinéma. Pour mon compte, je vais rejoindre d’anciens élèves dans un refuge près de Sauvabelin.
Jean Prod’hom
Tout va bien

Cher Pierre,
Tout va bien, nous avons donné notre blanc-seing au menu que les gamins ont concocté pour leur voyage de fin d’année à Naples : le Vésuve et la Solfatare, Pompéi et Sorrente, la Naples souterraine, Spaccanapoli, le centre historique et le quartier espagnol, Ischia ou Procida. Et la mer. J’ajoute le musée archéologique et la chapelle Sansevero. Reste à préparer ce voyage dans le détail en donnant aux gamins le temps de le préparer.

Il est bientôt 18 heures, nous revenons de promenade, Sandra, Oscar et moi, par la Moille Cherry et la Moille Cucuz ; je ramène un arrosoir de chez les Renevey.
Le beau temps s’installe mais nos occupations nous laisseront peu de temps, ces jours prochains, pour nous balader encore main dans la main. J’ai marché un peu ce matin, avec Oscar, en haut la Mussily et la Moille-au-Blanc. J’ai fait quelques photos : les restes de l’hiver, deux paires d’arrosoirs (jaunes siamois de chez Max, et verts fâchés de chez Fritz).
Les photos de tête que j’ai retenues pour Grignan ont les nuances du sable: gris, blanc, sépia, chamois. Il y a bien quelques couleurs, mais cuites comme la terre: un peu de bleu, de jaune, un peu de vert ; les rouges et les oranges sont rares.
Je me souviens d’une barque rouge, miniature échouée à Sienne, peinte par l’un des deux frères Lorenzetti: un rêve que j’aurais aimé faire, une barque que j’aurais aimé peindre et qui me fait pressentir, au-delà des images, une réalité désenchevêtrée. J’en suis bien évidemment incapable, je donne bien trop d’importance à l’image ; mais plusieurs photographies, séparées par d’invisibles gouffres – affinités lointaines – feront peut-être l’affaire en obligeant chacune d’elles à outrepasser ses limites.
Emmène Arthur à Ropraz avant d’aller chercher les filles à Thierrens, le genou de Louise a tenu. Ramène un sixième arrosoir perché sur le muret qui borde le couloir des box. Ramène les filles, ramène Arthur.
Jean Prod’hom
Une première partie de l’après-midi à rédiger

Cher Pierre,
Une première partie de l’après-midi à rédiger le procès-verbal de la séance du comité du TCPM de lundi dernier à Marnand, à régler par téléphone deux ou trois détails concernant la course du 3 mai : commune, pompiers, samaritains,...
L’autre moitié à reprendre sur un fichier pages les 419 brimborions écrits entre le 13 janvier 2014 et le 12 janvier 2015 ; les désolidariser des photos et des attributs que leur adjoint automatiquement RapidWeaver ; en pointer 104, puis 48, 15 enfin. J’ignore encore si cette opération a un sens, mais c’est fait.

Tirer du jour / quelque chose / à quoi l’accrocher
Ne rien ajouter / sinon / un peu de retenue
Une vie / pour quitter la partie / sans arrière-pensée
Fier d’en être / à l’envers et sans toit / mi-quincaillier mi-pèlerin
Ni aigre / ni dupe / un peu moineau
Quelque part / à l’intérieur du jour / une porte y conduit
Tirer du fatras / ce dont la pointe serait si fine / qu’elle se confondrait avec l’étendue
Un peu en-deçà / dans l’anonymat / c’est ce qu’on peut faire de mieux
Si je m’écoutais / il ne resterait rien qui vaille la peine / d'être ajouté
Les circonstances coulissent / comme les décors d’un théâtre / ça fait bien au total cent mille milliards de poèmes
Offrir une assiette / aux morceaux égarés / de la beauté du monde
À défaut / de prière / ramasser une pierre
Non pas que / ce soit vrai / mais ça tient
Aussi longtemps / que possible / sans élever de digue
Couper au plus court / au pas / avec l’âne Balthazar
Sandra et les grands sont allés voir en fin d’après-midi une salle de bains, Lili a joué dehors, il est plus de 18 heures lorsque tout ce petit monde rentre. Je fais encore un saut à Ropraz pour récupérer quelques factures et des sets de table ; il y a une belle poignée de poussins et de benjamins qui s’entraînent. Reprends les Chroniques de l’Occident nomade d’Aude Seigne. A l’envers.
Jean Prod’hom
Va pour une journée de transition

Cher Pierre,
Va pour une journée de transition, une journée qui ne retient rien, une journée qui s’ouvre dès l’aube sur le dehors, bien décidée à se déployer sur ses propres versants. En de telles circonstances, il n’y a rien à quoi s’accrocher, alors on glisse, creux, lisse et transparent. Deux mésanges font taire les voix qui s’affairent, un grand drap blanc se soulève. La place ne manque pas, mais ce qu'on s’était promis de faire disparaît dans un bâillement.

On longe les heures par le dedans, légèrement ivre, complice des mares qui ne lâchent qu'un peu d'eau, des canards, complice de la première dent-de-lion, des voies de chemin de fer désaffectées, des ronciers.
On n’attend rien, on ne demande rien. Il n'y a pas de raison pour que cette transition s'arrête, on l'imagine reconduite à l'infini, débordante de vitalité. Et les quelques idées auxquelles on tenait se mêlent au vol des papillons, dans une lumière dilatée qui tient éloignées les choses et les saisons. Une montgolfière monte dans le ciel.
Je passe au CHUV entre 5 et 6. F veut sortir, une ceinture la retenait autrefois, c’est un sécuritas qui lui barre la route aujourd'hui en exécutant une vilaine danse. F est sur le point de hausser le ton pour le faire reculer. Je lève la mienne, chante, déclame pour la détourner de la seule porte qui lui reste et qu'on lui interdit d'emprunter. Je lui raconte une histoire dont elle ne veut rien entendre.
Remonte à Oron, bois une verveine au café de l'Union en mettant à jour mon agenda : je descendrai seul à Colonzelle, à la veille de Pâques ; assisterai lundi au vernissage des Voyages d’écritures de Denise Lach à Terres d'écriture, rencontrerai Christine en fin de semaine, lui raconterai où j'en suis, lui parlerai de ma collaboration avec Yves et Anne-Hélène que j'aurai vus le 27.
J’avance aujourd’hui à l’estime, sans carte, et la fragilité des objets que je conçois m’oblige d’autant plus à leur faire confiance que je n’ai rien d’autre à leur disputer.
Jean Prod’hom
Week-end gris et laborieux

Cher Pierre,
Week-end gris et laborieux, je l’avoue ; lundi sérieux mais efficace, déroutant même. Il le faut bien si nous voulons, ne serait-ce qu’un instant, sortir la tête de l’eau. Tout compte fait, j’y suis parvenu à deux reprises.

En attendant Arthur à l’arrêt du bus, quelques minutes seulement pendant lesquelles je suis parvenu à concevoir très clairement et distinctement la possibilité de mettre ensemble 15 x 3 photos, c’est-à-dire d’imaginer 15 triptyques flottants, chapeautés chacun par l’un des 365 brimborion écrits l’année dernière, auxquels viendraient s’ajouter 15 textes inédits dont je ne sais encore fichtre rien.
Au téléphone ensuite, avec Anne-Hélène, seul devant une pizza au Gallo de Marnand. Elle m’a convaincu, sans me le dire, que cette entreprise était jouable : à moi de choisir les 15 brimborions et les 15 images qui pourraient constituer les centres hypothétiques des triptyques ; aux artistes et aux gens de métier – Anne-Hélène et Yves – de choisir les deux images qui viendront retirer les certitudes et les prétentions de la première ; à moi d’écrire enfin les 15 textes nés de la rencontre improbable mais nécessaire de ces 15 x 3 images.
J’ai du pain sur la planche.
Jean Prod’hom
Ypérite au Bois Vuacoz

Cher Pierre,
Ypérite au bois Vuacoz, cloque, ampoule et vésicule, boue et neige. Vais barboter sur le chemin des Dames entre Corcelles et Froideville, croiser la route des Flandres et celle des Paysans.

Pas de ciel, les rideaux sont tirés ; seules lumières, les ruches rouge pâle de la Mussily et les phares des voitures sur la route des Paysans. Au Chauderonnet, les pommiers brisés net du verger traînent leurs dépouilles, les plaques de neige se retirent sur la pointe des pieds. À cette saison les fers à cheval ne portent pas chance, l'eau peine à s’écouler.
On le sait par ouï-dire, les beaux jours vont éponger ce trop plein, siphonner les mares, assécher les sentiers labourés par les cavaliers. Il est temps de se rappeler que mars est le mois d’avant les grandes offensives, le mois des ornières gorgées de noirceur, des tranchées d’où naît le printemps. Attendre, attendre le soleil et la première morille.
Jean Prod’hom
Zou !

Cher Pierre,
Zou ! trois listes de ce qui m'attend, épinglées sur un panneau de sapin 220 x 70 x 15 vissé au mur, trois rubriques pour l’instant : A la mine, A la maison et Sur la page, sans considération de délais ; à moi de les définir les jours prochains pour éviter la faillite, en conjuguant flux tendus et flux poussés sans succomber au déni des circonstances.

Sandra est montée avec les deux grands aux Paccots, Louise avec un snowboard – c’est la première fois –, Arthur avec ses skis. Je fais du feu, Lili baigne Oscar, je vais repêcher quelques photos pour Marges, Lili regarde une série.
Je me prépare à aller faire quelques courses à Oron, dresse une quatrième liste : pommes, salades, pain, pesto, pâte feuilletée, cornichons au vinaigre, lait. Je reviens avec une seule salade mais deux carottes rouges, sans pommes mais avec des poires, et une grenade. Les circonstances l'ont voulu ainsi.
La neige découvre en se retirant l'herbe qu’elle a brûlée, le soleil n'est pas loin, le printemps recolle à l’automne. Il y a du travail dans le jardin, la taille des fruitiers d'abord, celle des arbustes ensuite, et la coupe des deux boulots sortis de terre près de l'étang ; vérifier l'enclos d'Oscar, mettre de l'ordre dans le hangar, déplacer les lavandes et réaménager l'angle sud-ouest du jardin. C’est noté.
Je m’arrête chez François, un passionné de cinéma et de flippers. Il anime Flips & Cinéma, un site dans lequel il inventorie les films où apparaissent ces jeux qui ont ponctué nos fins d’après-midi, à Michel, Jacques et moi. On boit une bière et on fait un flipper.
Sandra et les grands rentrent des Paccots à un peu plus de 5 heures, Louise s’est fait mal au genou. Le médecin de service pense qu’il est préférable de passer à Epalinges. On mange sans elles. Elles rentrent enfin, il est passé 21 heures, Louise avec une entorse et une attelle, elles ont faim.
Jean Prod’hom
Gégé est à l’heure

Cher Pierre,
Gégé est à l’heure, Gégé n’a qu’une seule parole, à l’image du bisse qui traverse la station et qu’on longe pour la dernière fois. On l’aperçoit en contrebas, Gégé se dresse devant son pullman et les alpes valaisannes ; avec ses lunettes à soleil il a fière allure ; de loin il a quelque chose de Roger Moore ; de près autre chose, quelque chose de René Char et de Monsieur Hulot.

- Bonjour jeunesse! Ça a été cette boum?
Géré attend une réponse qui ne viendra pas ; les gamins se remettent de leur semaine les yeux fermés, des retardataires taillent leurs vignes à l’entrée de Corin, je m’endors à la sortie de Sierre.
Réveil brutal. Ma gorge se resserre au goulet de Saint-Maurice, je n’ai rien fait cette semaine de ce que je comptais faire ; des échéances pointent leur nez, tout faire pour ne pas en être victime ; agir comme le dernier des Horaces, prendre la fuite avant de me retourner et m’attaquer à chacune d’elles, séparément.
Quelques-uns de mes jeunes voisins évoquent leurs origines. Le père et la mère du premier sont nés au Mozambique, les parents de la seconde son originaires de Madère, la mère de la troisième vient d’Estonie, son père d’Italie. Enfin, le quatrième est né de la rencontre d’un Etasunien et d’une Thaïlandaise. Ces mystères ne les empêchent pas de parler avec l’accent d’ici et de skier comme des enfants du Pays-d’Enhaut. Leurs parents les reprennent devant la laiterie, d’autres festivités m’attendent au Riau.
Jean Prod’hom
Semble que les roitelets ne perçoivent pas le ridicule

Cher Pierre,
Semble que les roitelets ne perçoivent pas le ridicule dans lequel ils sont plongés, eux et le maigre cortège de leurs courtisans, ou s'en satisfont sans se rendre compte que leur tête est en sursis.

Il est dès lors agréable de rencontrer ceux qui ont su sortir de ce jeu mortifère. Joël est garde-forestier au pied du Jura ; dans une commune qui possède assez de bois pour qu’il n’ait pas à patrouiller ailleurs, il s’organise, travaille double en été, termine les coupes avant janvier, laisse les bostryches hiberner jusqu’au printemps. A lui la montagne, une semaine ici, une semaine là pour enseigner aux enfants le ski. Pour des clopinettes.
On accompagne ce matin le même groupe ; il me raconte, sur le télésiège, ce qu'il a fait, ses projets, les chênes truffiers qu'il va planter, le chemin didactique qui doit être réaménagé.
Il a renoncé, il y a peu, à un poste de choix dans l'organisation locale du marché du bois ; toutes les conditions qu’il avait mises en avant avaient été acceptées, mais un seul déplacement jusqu'à Aigle, un matin sur l’autoroute, lui a fait comprendre ce à quoi il serait confronté toute l'année et ce qui lui manquerait. Il a préféré une forêt d'un seul tenant, la variété et l’indépendance à la vanité des promotions. On a profité cette semaine de la sagesse de sa décision. Il faudrait ériger des monuments à la gloire de ces bénévoles - ils n'en veulent pas. Ce sont eux qui font voir les minuscules mouvements de ce qui aura fait la gloire de l’espèce, devenue arrogante en dépit du bon sens.
Jean Prod’hom
J’ai un faible pour le mauvais goût

Cher Pierre,
J’ai un faible pour le mauvais goût, les stucs et les faux ; l’accordéon, les chantiers, les copies ; la poussière, le désoeuvrement et la neige de printemps. Ici à Crans-Montana, je suis gâté.

Les employés rembobinent la tuyauterie et plient les canons à neige en espérant qu’il y en aura assez jusqu’à Pâques. On se retrouve au Petit-Bonvin pour pique-niquer.
Lorsque je m’apprête à redescendre, M. demande à m’accompagner ; on va rejoindre G. qui a passé la matinée en station. Je lui avais promis qu’on poursuivrait l’exploration des lieux. On part donc à trois jusqu'à l'hôtel du Parc. La fille du directeur, une Portugaise de Madère, nous accueille comme des navigateurs après leur voyage de circumnavigation, nous emmène visiter ce vieil hôtel qui semble vivoter : 5 chambres seulement – sur les 75 dont dispose l’établissement – sont occupées ; elle nous fait voir une single et une double, au nord puis au sud, une double luxe, une junior suite et une suite royale au quatrième. Une seule aurait suffi, elles se ressemblent toutes, mais tout en haut la vue est belle.
Avant de partir, la propriétaire nous salue, le salon est vide, pas de pianiste, parquet de chêne et vue sur le lac ; et toujours ce silence que les occupations des hommes ne parviennent pas à recouvrir.
On devrait apprendre à ceux qui viennent après nous à sortir des sentiers battus, à leur montrer ce qu'on n’a pas eu le temps ou le courage d'explorer. Mais qu'on doive, comme on dit, gagner notre vie, la complique singulièrement.
Jean Prod’hom
Se réveiller à la montagne

Cher Pierre,
Se réveiller à la montagne, avec pour seule tâche d’accompagner autour de midi un enfant au glacier de la Plaine morte, vous réconcilie avec le métier.

En attendant, je décide de monter au Bella-Luy, ce sanatorium de luxe construit en 1931 pour ceux que la fortune n’avait pas épargnés de la tuberculose, malgré leur aisance. J’entre dans ce qui est devenu un hôtel un peu poussiéreux comme un client qui est depuis longtemps chez lui ; mais pas le temps de faire le curieux, je reçois un coup de fil de Véronique qui m’indique un changement de programme : G. s’est fait mal à un genou ; à moi de le récupérer en-bas Cry d’Er et de lui envoyer, par le chemin inverse, celui que je devais accompagner au glacier.
Je redescends à l’hôtel avec le blessé, la réceptionniste prend contact avec le médecin de service, rendez-vous est pris pour 14 heures 30. On mange notre sandwich dans le hall, quartier libre jusqu’à 13 heures, je propose à G. d’aller ensuite jeter un coup d’oeil au sanatorium valaisan.
Y pénétrer n’est pas difficile, s’approchent alors trois infirmières souriantes. Je leur fais mon baratin, Nicole nous ouvre les chambres du troisième dont les autorités valaisannes ont décidé de se passer. Nicole se plaint de la réorganisation des hôpitaux en invoquant les mêmes motifs que les enseignants: mauvaise évaluation des faits, éloignement du centre de décision, direction fantôme au plus haut niveau. On rigole parce qu'il le faut bien.
Les chambres sont exiguës, Nicole nous en fait visiter deux, l’une pour un seul patient, l’autre pour trois ; toutes les deux semblent avoir été abandonnées précipitamment, on cherche les signes qu'auraient laissés ceux qui ont fui. A la potence d’un des lits, deux mots sur un papier quadrillé déchiré : draps propres.
La structure de ces établissements est d'une extrême simplicité, balcon et couloir d’un seul tenant, entre eux une succession de chambres ; deux portes opposées, l'une vitrée l'autre pleine ; trois cages d'escaliers, deux aux extrémités du couloir, la troisième au centre.
C’est Anne-Marie qui nous fait visiter la salle d'opérations, mise hors service en 2007, on y pratiquait encore une opération de temps en temps, vraisemblablement pour la maintenir en usage. Sept ans ont passé, les instruments de contrôle et de régulation ont pris ce même coup de vieux que les imprimantes du même âge, massives, qui traînent au fond des bennes des déchèteries.
Je remonte avec G. au Bella-Luy, le réceptionniste nous raconte les différentes affectations de ce bâtiment, sanatorium de luxe, établissement de cures, racheté en 1945 par des Américains pour héberger des rescapés polonais des camps de concentration, hôtel depuis les années 60 : 35 chambres d'un seul lit, 15 de deux, le réceptionniste nous en fait visiter une. On se serait bien affalés dans les fauteuils du salon d’à côté la réception qui n’a pas changé depuis 1930.
Le médecin fait une radiographie du genou de G. Rien. On va fêter ça au café. Il regarde par la fenêtre, je devine ce qu'il pense. Oui, tous les immeubles du XXème siècle ressemblent à des sanatorium, et on aimerait parfois que nos vies ressemblent un peu plus à celles de ces tuberculeux qui passaient deux ou trois ans sur un balcon communautaire ouvrant sur les Alpes valaisannes, à lire et à se réjouir d’être vivants.
Jean Prod’hom
Le pullman est flambant neuf

Cher Pierre,
Le pullman est flambant neuf, Gégé est allé le chercher en fin de semaine. Je salue quelques parents, la semaine sera belle. départ à 8 heures. Salut jeunesse! lance Gégé. En route pour Montana-Vermala !

Inutile de faire des photographies, le lac a tourné le dos depuis toujours aux louanges. Le Catogne se dresse au fond, mais ce n'est pas une fin c’est un coude ; le Rhône, modeste, a fait le gros du travail. A Saint-Maurice, on voudrait glisser la main pour lui donner un peu de place, écarter les montagnes, desserrer l'étreinte.
Lis, avant d'entamer la montée sur Montana, le rapport du voyagiste qui a accompagné F. à Madras. J’imagine bien les jours qu’il raconte, mais ce sont bien sûr ce qu’on ne saura jamais qui intrigue : les 17, 18 et 19 janvier en face desquels il a écrit : Pas de nouvelles.
Hôtel Elite, on débarque avec 32 gamins, Véronique nous attend. Lorsque tout le monde a récupéré ses affaires, Gégé fait une photo de son pullman, avec le Weisshorn et le Bishorn pour décor ; une sacrée occasion, refait à neuf, moteur et carrosserie.
On pique-nique, les 12 coups de midi interrompent les chants dans les sapinières du golfe. Les cloches et les oiseaux me ramènent au temps d’avant l’aménagement du plateau, et puis aux beaux jours des sanatoriums, à mon séjour ici d’il y a deux ans ; et ces jours qui se superposent tiennent ensemble par l’esprit du lieu, que je retrouve 4 heures après lorsque je m’étends, cassé, sur le lit de la chambre 119.
Ai reçu un mail d’une femme qui prépare un livre sur les arrosoirs, à Berlin ; elle a appris par une connaissance commune que j’ai fait autrefois des photographies de ces objets. Elle me demande de lui en envoyer. Vais le faire, sans commentaire. Pas mécontent si elle me demande des explications complémentaires, elle m’obligera à réveiller mes intentions et à expliquer pourquoi j’ai mis ce projet à la cape. Bougrement intéréssé par ce qu’elle va en faire.
Rien à dire de la Dent Blanche et du Cervin, ils durent, avec les autres, sans dormir.
Jean Prod’hom
Il en reste un qui a perdu un bras

Cher Pierre,
Il en reste un qui a perdu un bras ; j’ai constaté l’hécatombe ce matin, sans savoir par où commencer, compter et recompter les arbres du verger. Ainsi dépouillés les vieux pommiers ne sont plus des pommiers. Adieu printemps ! On a laissé faire, ça devait arriver. D’autres, ailleurs, ne verront pas l’été.

Sandra, Louise et Lili quittent le Riau à 8 heures; Lili s’en va courir et lancer le boulet à Pully. Arthur garde Oscar et la maison, je vais manger au Chemin des Oiseaux une madeleine et un pain au sucre, avec la Vuachère à nos pieds. Un écureuil traverse le bois qui longe le ruisseau, je l’épingle sur une photo, il sort du cadre ; des geais s’agitent, une corneille fait son nid.
On longe, Olivier et moi, le lac jusqu’à Lutry, il fait l’hypothèse délirante que la bise de ces derniers jours a un rôle sur le brassage des rives, j’en doute, on trouve un peu de marchandise, ceci n’explique pas cela. Un photographe nous accompagne avec deux de ses petits enfants jusqu’à la terrasse où l’on fait halte : du monde partout.


M’arrête à Treytorrens, dépose dans la boîte aux lettres de la maison que Ramuz habita entre 1914 et 1916 les photos que j’ai triées ces derniers jours, jette un coup d’oeil sur les parchets qui dégringolent jusqu’au lac, fais quelques photos. Je remonte par la corniche et rejoins ceux sans lesquels je ne serais rien.
Prépare mon sac pour la semaine prochaine, m’attaque au repas du soir : poireaux, saucisses aux choux et pommes de terre, tartes aux pommes pour terminer la semaine. Lili se met ensuite au piano ; Sandra fait la vaisselle, Louise son exposé : Ecuyer et palefrenier. Arthur fait poucette sur Facebook, il est 9 heures.
Je fais ma ronde, roue libre.
Jean Prod’hom
Samedi 7 heures

Cher Pierre,
Samedi 7 heures : Louise se réveille, on se retrouve près du poêle ; en-haut, les autres dorment encore, elle parcourt des journaux ; Oscar saute sur ses genoux, je bois un café. Sandra, Arthur et Lili nous rejoignent enfin, je les quitte déjà.

Edmond Angel | détail
Ne réfléchis guère à la direction, y vais comme sur des rails, sans boussole ; c'est au large d'Avenches que je me rends compte de mon égarement et de ses conséquences ; je ne suis pas sur la bonne route et je ne serai pas à l'heure à Matran. J'avertis René qu'il serait préférable qu'on se retrouve à Vordemwald. Ça circule épais aux environs de Berne et avant Rothrist, mais je suis à l'heure devant la Turnhalle, de jeunes pilotes locaux préparent un entrainement : tonneaux, spansets et pile de palettes.
La commission technique est bien représentée mais les organisateurs ne sont pas nombreux, Kurt préside. Le règlement de la Swiss cup trial est passé en revue, rien ne change beaucoup mais le club de Lucerne aimerait organiser une course dans les années qui viennent, il suffit d'un nouveau pour qu'on recommence à zéro.
Je cherche à sortir, mais les lamelles bleues des stores m'en empêchent. La salle est éclairée habituellement par 4 fenêtres à battant simple, 4 autres à battant double et 8 impostes ; lorsqu’il fait nuit, par 18 néons de dimension standard : ce matin, c’est moitié moitié, à cause du beamer.
A mes pieds un linoléum bleu brouillé blanc ; contre le mur, au sud, une soixantaine de chaises empilées, un chariot pour stocker et déplacer les tables. A l’ouest et au nord, une succession d’armoires à simple ou double battant, numérotées de 1 à 14. On aimerait les ouvrir : difficile d’imaginer, la tête froide, ce qu’elles peuvent contenir. Les bannières des Männerchor, Musikverein et Schiessverein protégées par un verre épais au-dessus des armoires 10 à 14 nous mettent sur la piste : on imagine des partitions, un diapason, un solde d’assiettes en carton, des verres, un stock de cibles, des serviettes en papier, des archives, des chemises transparentes, un vieux piston, des rayons vides,...
Je suis assis à une table recouverte d'un formica de 2 à 3 millimètres d’épaisseur, au motif beige international. Tout porte à croire que le bâtiment et le mobilier d’origine datent de la première moitié des années 60. En attestent les dents d’un interminable radiateur qui déroule ses dents de fonte au dessous des fenêtres : deux sections de 117 éléments chacun.
Un évier, un miroir, un distributeur de savon et un essuie-main garantissent l’hygiène de chacun dans cette salle de réunion. Une pharmacie murale complète l'équipement, au cas où ; on y trouve une paire de ciseaux, de la ouate, un désinfectant, deux boites de compresses et une pharmacie portative, Dedans une couverture de survie : tout cela pourrait en effet très mal finir.
J’aurais voulu disposer du vocabulaire nécessaire pour décrire le détail du mobilier, les montures inoxydables des tables, celles des chaises. J’aurais voulu connaître leur histoire, entendre ceux qui ont pris la décision de choisir ces modèles, faire apparaître les tensions et les regrets.
M'arrête en rentrant à Ropraz, avec l’intention de réorganiser ces notes ; une dame d'un certain âge m'aborde, c'est vous l'artiste qui exposez à l'Estrée? Non? Vous lui ressemblez!
Il s'appelle Edmond Angel. Bientôt 80 ans, retiré de sa famille et placé entre 9 et 16 ans comme valet de ferme, autodidacte. Il peint des personnages en noir et blanc ou en couleurs, il a les cheveux gris et porte une moustache. Engel? C’est le nom de famille de sa mère, morte jeune, elle jouait du violon.
Jean Prod’hom
Ciel tendu et froid sec

Cher Pierre,
Ciel tendu et froid sec. Arthur a rendez-vous devant la Grande Salle de Mézières à 8 heures 30, on fait une halte au Denner pour qu’il achète un peu de jambon et du thé froid. Je continue jusqu’à Oron, fais les courses du week-end, commande les chroniques de Peter Bichsel et bois une verveine au café de l’Union.

J’apprends en rentrant, par la radio, que les bulldozers se sont attaqués un peu après la prière de midi aux lions et aux taureaux androcéphales qui gardent l’entrée des palais de Nimrud. Pourquoi cet acharnement contre des bêtes qui n’opposaient aucune résistance? Les images du saccage des statues du musée de Mossoul inquiètent, ce sont en effet des armes rustiques, masses, marteaux-piqueurs, scies circulaires, tronçonneuses que les auteurs utilisent pour faire trembler le monde, habillés comme vous et moi, débonnaires, salopette et chemise à carreaux.
Je taille les rosiers et bine la plate-bande avant de terminer Les Neiges de Damas. Nous sommes le 6, c’était le 5, voici les crocus avec un jour de retard. En ce qui concerne les perce-neige, qui sont aux premiers jours comme des perles alourdies, je les ai aperçues hier au pied des noyers, dans le virage qui remonte Vers-chez-les-Rod, j’ai fait quelques photos.
Mange à midi avec les filles, fais à 14 heures la causette avec Sandra qui s’endort dans le hamac avec Oscar à ses côtés. Trie les dernières photos, récupère Arthur à 17 heures 30, enchanté de sa journée de ski.
Je quitte le Riau à un peu plus de 18 heures. Croise L. dans le hall du CHUV ; elle vient du treizième, me fait comprendre qu'il est déconseillé que je monte. Je l'embarque, on échange nos impressions dans un bistrot indien près de la gare, sans vouloir réparer ce qui ne se peut pas : c’est mieux ainsi.
Elisabeth et Françoise sont assises à l'une des tables rondes de L'Esprit frappeur, mais Graeme Allwright s'est excusé, sa santé ne lui permet pas de monter sur scène. On en profite pour babiller, ça doit être la première fois depuis Riant-Mont qu'on se retrouve tous les trois, que les trois.
Les animateurs de la salle projettent quelques images du spectacle de l’homme aux pieds nus ; un contrebassiste et un guitariste couvrent le grain de sa voix. C'est ailleurs qu'il me faudra tourner la tête pour retrouver les airs d’autrefois, en regardant du côté les fêtes votives dans les patelins du Gard, des longues nuits, des grandes tablées et de tous ces matins où l’on dormait sans se soucier du lendemain.
Jean Prod’hom
Evaluer la santé et la vitalité d’une institution

Cher Pierre,
S’il est correct d’évaluer la santé et la vitalité d’une institution à ses capacités de ne pas exclure les plus faibles de ses éléments, l’établissement dans lequel je travaille est sur la bonne voie.

C’est ce que je me suis dit cet après-midi en voyant dans une salle de dégagement, la porte vitrée grand ouverte, ensemble le doyen accaparé par ses tâches et un gamin de quatorze ans dormant profondément à la table voisine, son manuel de français en guise d’oreiller et le soleil pour le réchauffer.
J’ai cru distinguer dans les sourires échangés par certains d’entre nous une espèce de satisfaction, celle d’avoir été capable de laisser la priorité au bon sens, d’avoir eu le courage d’ignorer la logique institutionnelle et d’accepter nos limites, faisant voir à qui ouvre les yeux que l’école constitue, dans une société spécialisée dans l’aménagement des aires de repos et de dépose, le dernier des refuges.
Il me faut boucler avant 16 heures la journée et la semaine, je repars en effet lundi prochain pour Crans-Montana, cherche l’efficacité à outrance. C’est d’ailleurs ce qu’on devrait enseigner dès le premier âge, apprendre à mettre en oeuvre un minimum d’efforts pour un maximum de résultats, ne recourir qu’à des bouts de chandelle pour donner à voir l’essentiel, bref retrouver l'idéal des Lumières et des poètes.
Me lance à 16 heures 30 dans la valse du jeudi : Riau, Ropraz, Thierrens, Ropraz Riau. La musique s’arrête à 20 heures devant un vacherin et des pommes de terre en robe des champs. Chacun remonte ensuite dans sa chambre ; Louise m’appelle pour lui lire le trentième et dernier chapitre du livre qu’elle a commencé en début de semaine :
Devant moi, sur le chemin, gît une petite plume blanche, aussi douce et pure que si elle était tombée des ailes d’un ange. je la ramasse en souriant, puis je rentre dans la maison. (Aux Délices des anges)
Je fais un saut au jardin, cherche la lune ; elle était au-dessus des Gibloux à 7 heures, de la Dent de Lys à 8 ; la voilà à 10 au sommet de l’un des deux chênes du jardin. Elle demeurera, décidément, l’être le plus imprévisible que je connaisse.
Jean Prod’hom
Reçois un coup de téléphone d’une dame de Peney

Cher Pierre,
Reçois un coup de téléphone d’une dame de Peney, elle me confie avoir été emballée par Tessons, je souris d’aise, Elle précise aussi qu’elle fait partie d’un groupe de lecture constitué d’une petite dizaine de personnes qui se retrouvent régulièrement pour parler littérature. Chacune d’elles choisit à son tour un livre qu’elle a aimé et qu’elle propose aux autres. Je devine la suite et l’émotion me gagne.

Elle me rappelle en effet que, il y a un peu plus de dix ans, ma mère faisait partie de leur groupe. Elle me demande si je serais d’accord de les rejoindre au printemps, lorsque elles auraient lu ce petit livre et que le soleil aurait réchauffé la maison de Peney. Le rendez-vous est pris.
Elle aimerait savoir encore si je préfère leur vendre quelques exemplaires, ou si je ne trouverais pas judicieux qu’elles en acquièrent sept ou huit à Echallens, dans la librairie Infiniment plus où elles font habituellement leurs emplettes. J’y suis entré il y a peu, un coin chaleureux avec une table, un canapé et des fauteuils, et des gens qui riaient. Promis, je m’y arrêterai la prochaine fois.
Je me souviens avoir dit, à l’occasion du vernissage de l’Estrée, qu’il était fort probable qu’on écrivait des livres, d’abord, pour ceux qui ne les liraient pas ; je pensais naturellement aux morts. Mais en se retrouvant entre les mains de ses amies, c’est un peu de ce que ma mère aurait dit de ce livre que j’entendrai au printemps prochain.
Aide Lili en fin d’après-midi dans l’apprentissage d’une centaine de mots d’allemand qu’elle prononce avec la plus grande des peines, interroge Louise qui ressasse pour la dixième fois les formes d’une trentaine de verbes qu’elle a écrits à tous les temps, pour la troisième fois au moins, dans un cahier ligné margé. Comme toujours, me garde de leur dire quoi que ce soit de ce que je pense de tout cela.
Jean Prod’hom
Le vendeur de reblochons et de Mont-d’Or

Cher Pierre,
Le vendeur de reblochons et de Mont-d’Or a ouvert la porte du printemps au café d’Oron. Je lui prends un reblochon qui a la couleur du soleil, il ajoute deux tomes, un peu pâles. Je bois une verveine en lisant l’article du docteur Barras sur l’histoire des sanatoria de Montana-Vermala, en rêvassant, une héliothérapie me ferait du bien, à moi aussi, allongé sur une paillasse, caché sous des couvertures, avec en face le vallon de Réchy et à côté le Théoda de Corinna Bille.

Traverse la journée sans m’arrêter, mets de côté une cinquantaine de photos. File, en fin d’après-midi, récupérer Lili à Saint-Martin, Arthur à Ropraz. Le mousse a pu parler avec Jean-Daniel des objectifs qu’il s’est fixés cette année.
A Crans-Montana, j’y serai la semaine prochaine, avec une quarantaine de bambins ; pas sûr que j’aie le temps de faire autre chose que de les tenir en laisse. Me souviens pourtant avoir passé, il y a deux ans, une belle heure dans le salon de l’hôtel du Parc, perché sur la butte de Montana.
J’essaierai de m’y attarder une nouvelle fois, dans le souvenir de ces pâturages et de leurs plis que rappellent les photos en noir et blanc de la construction de l’hôtel du Parc. Et ce quelque chose que je percevais dans le silence de cet après-midi de janvier, dans ce salon, je le devais à Théoda que je venais de lire, ce récit que Corinna Bille fait naître sur le plateau, avant que le promoteur Louis Antille et le docteur Théodore Stephani ne mettent la main dessus.
C’est toujours ainsi que la vie prend corps, les yeux fermés et la porte entrouverte. On s’avise alors que ce qu’on a vécu autrefois reste collé à la rétine et qu’il n’y a aucune raison de l’ignorer.
De porte entrouverte en porte entrouverte on traverse des pays qui s’emboîtent et où les vies se croisent, et le temps qui filait entre nos doigts revient chargé de ce qu’on croyait perdu, et le passé se met à battre au coeur du présent, sans nostalgie.
Il est 10 heures et demie, plus un bruit dans la maison.
Jean Prod’hom
La pluie a creusé des ombres pleines de noirceurs

Cher Pierre,
La pluie a creusé des ombres pleines de noirceurs tout autour des arbres et des arbustes du jardin. Je l’ai entendue à minuit, puis à un peu plus de trois heures, enfin lorsque le jour s’est levé. Il fait moins froid ce matin, mais cette tiédeur humide ne m’empêche pas de faire du feu. La journée sera longue, je me promets, lorsque je quitte le Riau, de faire les efforts nécessaires pour ne pas dilapider mes forces dans des tâches inutiles. Sans y croire vraiment. Louise, c’est promis, je te lirai ce soir, le chapitre 12 d’Aux délices des anges.

Ce soir, il ne me reste rien, ou presque rien – la force peut-être d’écrire ces mots. Et je me demande si je n’ai pas agi, tout le jour, dans la seule intention que quelque chose demeure encore possible, sans que je sache exactement quoi. Et que ce quelque chose indéfiniment différé me condamne à reconduire l’opération demain et après-demain.
Il aura suffi pourtant que le soleil écarte les nuages et les brumes dans lesquelles s’engluait ma raison pour que je baisse la garde et que l’âcre fumée de mes ratiocinations disparaisse comme ces rubans de fumée dans le ciel blanc de l’hiver.
Et que, par un renversement dont j’ignore tout, ce manque que j’espérais voir comblé au terme de la journée est tout entier là, m’a vidé et ramené là où je ne pèse plus rien, un rien sans bord que les rayons du soleil réchauffent, pointe émoussée siégeant sur toute la surface du corps et se confondant aux courbes des alentours.
J’ai la certitude qu’il n’existe aucun chemin calculé pour parvenir à ce qu’on voudrait atteindre, ou plutôt que ce chemin sur lequel on va et vient sans répit conduit inéluctablement à l’épuisement ; il convient alors d’accueillir, loin de toute raison, le mot vertical, celui qui s’ouvre comme une fleur à autre chose que le langage, renverse les ombres et les noirceurs sur un chemin qui a la forme d’une clairière. Pour une réconciliation.
Sandra, Louis et Lili vont rentrer d’Oron, Arthur est allé promener Oscar. Je descends de la bibliothèque à la cuisine. Vais casser des oeufs, hacher des épinards et rôtir des galettes de pommes de terre, ils ont faim. Ce soir Louise égrènera peut-être quelques notes de guitare, Lili de piano.

Jean Prod’hom
Découper quelques motifs

Cher Pierre,
Découper quelques motifs dans certains des morceaux de terre cuite n’est peut-être pas aussi idiot qu’il n’y paraît au premier abord. M’exécute sitôt que je suis debout. Envoie un mail à Anne-Hélène.

Trie ensuite des photos aussi longtemps que mes yeux me le permettent. En mets 300 de côté. L’opération n’aura pas été inutile, mais il me semble que je n’ai fait, durant ces années, que répéter les mêmes photos, une quinzaine peut-être. Il faudrait maintenant que, pour chaque gruppetto, une photo s’impose et mène la danse. Je liste sans méthode ces têtes de variation : la lézarde de Terres d’écriture, le vase du MUDAC, le boeuf sur le mur de la remise, des laisses de mer, des tôles colorées ou le plat de tomates et d’aubergines, des andins ou des vagues, la flaque à la veste bleue, Louise au mariage de Yann, le chemin de traverse en direction de Ropraz, un détail du portail peint de la cathédrale, l’ouverture sur le Lez, les arrosoirs de Vulliens, les vieux morceaux de molasse de l’église du Mont, la maison éventrée de Charleroi, une lessive qui sèche, l’ombre d’Arthur... M’en restent un peu plus de 20 000 à trier, la moitié du boulot est faite.
Le brouillard ne se sera pas levé de la journée, les filles ont fait leurs devoirs, Louise s’est occupée des lessives. Le mois de mai est bientôt là, Sandra travaille d’arrache-pied à côté du poêle : menuise pour le premier volume du manuel de physique, grosserie pour le second.
Descends à la cuisine faire rôtir un poulet, peler des pommes de terre et rincer des fenouils. Demain c’est la reprise.
Je lis à Louise, avant qu'elle ne s'endorme, deux pages de son roman ; elle voudrait qu’on réitère l’opération demain. Lili me demande ensuite si je vais travailler ce soir à la bibliothèque. Elle m’explique que, dans le noir, elle écoute mes doigts sur le clavier, elle m’entend même, de temps en temps, monter les escaliers. Je n’y avais jamais pensé sous cet angle-là : on écrit parfois pour les autres autrement qu’on ne le croit.
Jean Prod’hom
Cueille un tweet ce matin

Cueille un tweet ce matin, Roland Barthes y affirme (Collège de France, 1979) : Et peut-être que la seule justification de la poésie, très paradoxalement, c'est la vérité. Pas besoin donc de broderies ou de ronds de jambes, de rimaille ou de rhétorique, pas besoin non plus que cette quête soit indigeste.

Les oiseaux chantent au Riau comme hier aux Rasses, ils devront patienter encore. Tout est blanc, les arbres ont de la neige jusque sous les bras. Rien ne bouge mis à part les rubans de fumée qui se perdent dans le ciel. Les vergers se font petits.
Sandra et Louise sont descendues au marché, Arthur a rejoint Johann. Lili se penche sur sa vie, entourée de ses vieux agendas scolaires. Je lis une nouvelle de BC, essaie plutôt, par deux fois, avant d’en être définitivement chassé. Je parcours rapidement une histoire de Crans-Montana.
Je file à la COOP d’Epalinges où je fais les emplettes du week-end avant de me rendre à Bremblens, dans un immense magasin de sport d’où je ressors avec une paire de skis de marque allemande, une paire de chaussures, une paire de lunettes, un casque bleu pour donner l’exemple et faire rire la maisonnée. Je téléphone à C qui m’attend pour boire un café, cela fait quelques jours que j’y songeais.
Je peine à atteindre Vufflens-la-Ville, descends jusqu’à Monnaz, remonte à Bussy-Chardonney pour enfin trouver un passage sur la Morges. Seul à la maison, avec son chien, il fait des paiements. Le temps a passé, c’est un peu à son père que je m’adresse, on parle de sa soeur et de la chaîne de solidarité qui s’est formée autour d’elle, on parle de son frère, de sa mère, des misères qu’il nous faut bien accepter ; on ralentit, on se racornit, c’est ainsi.
J’embarque Arthur au Tunnel, avec Johann que je dépose à Ropraz. On s’arrête à la laiterie de Corcelles pour acheter du pain et du fromage.
Belle surprise se soir, Graça qui partage sa vie au Portugal entre Braga et Sines et avec laquelle j’ai échangé quelques mots en novembre dernier, au moment de la parution de Tessons, m’a fait parvenir quelques photos de ce petit livre sur la plage de São Torpes près de Sines. J’aurais aimé lui dire le plaisir que cela m’a fait.






Jean Prod’hom
La neige tombe lourde et déterminée

Cher Pierre,
La neige tombe lourde et déterminée ; elle donnera du fil à retordre à certains d’entre nous pour rejoindre la route cantonale, deux pelles pourtant en viendront à bout. On a déjeuné une dernière fois ensemble, vidé le chalet et chargé les voitures. Ils seront plusieurs à faire une halte aux Bains d’Yverdon. Sans moi, je rentre avec Oscar par Donneloye et Saint-Cierges, comme à l’aller. Fais un saut à la déchèterie où je me débarrasse de restes de papier, de carton et de plastique, photographie la maison aux sabots. Michel est venu de Froidevillle faire du feu dans le poêle, il a laissé 5 pains au chocolat et une baguette, cet homme est une perle.

J’ai eu ce matin une belle surprise, Noëlle Rollet a en effet consacré dans ses Glossolalies un billet qui présente ma correspondance avec Pierre. M’y penche au milieu de l’après-midi et me réjouis, avec l’impression qu’elle relève précisément les points auxquels je suis attaché et qui m’encouragent à continuer : mon souci de suspendre les explications, qui tendent trop souvent à devenir des justifications ; et à cet égard, Pierre est essentiel, fictif à demi, il en sait assez sur ce qui m’arrive pour que je n’aie pas besoin de tout dire. Au contraire il m’oblige à abréger et à passer, comme chaque jour nous le faisons chacun, des tâches ménagères aux réflexions philosophiques, du temps qu’il fait à une décision qu’on est amené à prendre, du coq à l’âne.
Et toutes ces choses juxtaposées, nobles ou quelconques, pénibles ou heureuses, font voir qu’elles ont ont bien à plus à faire les unes avec les autres, ne serait-ce que parce qu’elles sont comme les cartes du joueur dans la main du même sujet. Et ce sujet – qu’il convient de supposer – il lui faut bien accepter cette donne, et tant qu’à faire l’aimer, faire tenir cette donne qui nous constitue sans dédaigner une miette.
Philosopher n’occupe pas toute l’étendue de nos jours, il s’agit donc ne pas trop demander à la pensée pour lui laisser enfin la place qu’elle mérite, entre une vaisselle et une balade sur les rives de l’Aar, successivement, sans en faire trop et vouloir en tirer des leçons, sans exténuer chacun de ces moments, mais passer quand même.
Un mot suffit, avec dessous quelque chose qui les lie plus solidement qu’on ne l’imagine, une virgule pour les abouter sans les plier aux raisons, une couleur, une syllabe, un accident comme souvent lorsque nous bifurquons. Et si nous sommes capables de vivre, c’est parce que nous sommes capables de faire tenir ensemble le disparate, avec des blancs, avec des silences, ce sont nos journées. Elles ne sont pas loin de ressembler, au fond, aux plus invraisemblables de nos poèmes.
Descends à la cuisine remettre une bûche dans le feu, y reste.
Jean Prod’hom
Sonneries de natel

Cher Pierre,
Sonneries de natel, claquements de portes, eau dans les éviers, chasses d’eau, on se croise dans les couloirs. Bruits de fermetures éclair, une pomme et une poire dans la poche, les raquettes au pied. Il est 6 heures, le jour se lève, on descend à la queue leu leu jusqu’à la station, dont on s’écarte pour emprunter une piste, modeste, qui monte au plus droit jusqu’à 1400 mètres.

Oscar prend les devants, trois quarts d’heure de peine ; on quitte les sapins sous le Crêt des Gouilles, Arthur fournit son effort, on ne le reverra pas avant le sommet, les derniers auront mis une grosse heure pour avaler les 420 mètres qui nous séparaient du Chasseron. On boit un coup.
C’était un peu la fête tout à l’heure, drapeau et discours ont honoré une cinquantaine de jeunes soldats promus sous-officiers après une épreuve que seuls les militaires sont capables d’organiser. Ils sont partis hier à 18 heures de Valeyres-sous-Rances, au nord d’Orbe, chargés comme des mules, trente kilos sur le dos de l’artilleur qui m’a fait le compte-rendu de leur expédition : pause à Vuiteboeuf autour de minuit, puis montée jusqu’au sommet. Ils n’ont pas dormi, ils attendent l’arrivée des deux Super Pumas qui doivent les ramener jusqu’à Bière. C’est une récompense, me dit fièrement l’artilleur.
On marche plus léger que des soldats, si bien qu’on rentre par nos propres moyens, par la crête des Petites Roches et les Avattes. Les sapins font une ombre bleue, presque violette, autour du chalet du Sollier ; de l’autre côté du Buttes, la commune de la Côte-aux-Fées, son village blanc et ses hameaux qu’occupaient plus de mille personnes à la fin du XIXème siècle. Rien ne bouge aujourd’hui, la Côte-aux-Fées, moins de cinq cents habitants aujourd’hui, semble de là-haut abandonnée, comme une mariée.
Je perds de vue ceux qui me précèdent ; personne à La Casba, je continue pour mon compte jusqu’à la gare de Saint-Croix, par les Praises, un bus me ramène aux Genêts ; Arthur et Johann, sitôt arrivés, sont partis sur les pistes de ski, les autres chantent à tue-tête Cabrel, Dassin, Bruel avant d’aller louer des skis de fond pour l’après-midi. Oscar me tient compagnie. Retour du silence.
Que se passe-il ? Au-delà des conventions qui assurent jour après jour notre survie, derrière ou avant, mais aussi dedans le langage pousse un silence qui nous invite à remettre du jeu dans nos assurances, déverrouiller nos peurs, restituer aux choses leurs coudées franches, les espacer pour leur redonner la place qu’elles méritent sur cet étrange damier.
Lorsqu'on me parle de poème, je pense à la brièveté, et dans cette brièveté à la place que celle-ci offre au silence, sachant qu’il peut habiter n'importe quelle page, quel que soit leur nombre. Deux ou trois mots mis ensemble, deux ou trois phrases, deux ou trois pages, trois coups de pinceau, des vides et des pleins, de quoi respirer : le blanc, celui qui les hante et qui les porte, celui qui les habite et auquel ils puisent, Thierry Metz a su le faire mieux que tout autre.
Il est temps, avant le retour de la petite troupe de fondeurs, de me mettre au travail, ajouter quelques photos aux 169 placées dans le dossier Yves / Anne-Hélène. Sans savoir encore ce qui commande mon choix, avec la crainte donc, que tout soit à recommencer.
Jean Prod’hom
Nuit interrompue par une arythmie

Cher Pierre,
Nuit interrompue par une arythmie qui m’inquiète, cela m’est déjà arrivé ; la vie de sédentaire que je mène ces derniers temps doit y être pour quelque chose ; veille une paire d’heures, sur le qui vive ; cède au sommeil, me réveille le coeur à sa place.

Le soleil pousse la petite troupe sur les pistes, je reste avec Lili et quelques autres aux Genêts, bien décidé à passer en revue quelques centaines de photographies. Termine d’abord la vaisselle, avec ce plaisir qui envahit parfois celui qui se sent utile, mais aussi en compagnie du silence, qui se réinstalle à mesure que les skieurs s’éloignent. Et soudain on se rend compte que les portes même fermées demeurent ouvertes.
Oscar se baigne sur le vieux linoléum rouge de la véranda, dans une flaque de soleil. On fait un mikado avec Lili, elle dessine un peu, lit. Je renvoie le tri des photos à l’après-midi.
Qu’il existe quelque chose à explorer, le soir, lorsqu’on a terminé de verser notre contribution au grand marché de l’espèce, oblige celui qui le veut bien à lui aménager un espace ; cet espace aura été pour moi celui de l’écriture, quotidienne, quelle que soit la forme de celle-ci, qui emprunte – qu’on le veuille ou non – à la langue de tous les jours son lexique et sa grammaire : recette de cuisine, brimborion, récit, poème ou journal.
C'est dire qu’à ceux qui m’ont demandé de dégager les caractéristiques de la poésie, j'aurais tendance à répondre comme certains interprètes du corpus aristotélicien qui affirmaient que la métaphysique est constituée des textes que la physique a repoussé à l’extrémité de ses rayonnages, textes qui ne trouvaient place dans aucune de ses sections, dont elle ne savait que faire et qu’il fallait pourtant bien placer quelque part.
Cette extrémité des rayonnages, c’est aussi le territoire de l’écriture, il contient ce qui ne trouve pas place dans l’une ou l’autre des niches des innombrables encyclopédies. Ce qui reste lorsque chaque chose a trouvé sa place dans la grande arborescence, lorsque ce qui devait être fait est fait, le soir, alors qu’on ferme son agenda. Avec la conviction cependant qu’il reste encore quelque chose d’intouché, à écrire dans une forme qu’il faut bien bricoler puisque c’est ce dont manque ce qui reste.
J’aurais tendance à appeler poésie ces au-delà qui apparaissent lorsqu’on en a terminé avec nos écritures, petits morceaux qui échappent un instant aux genres, avant d’être digérés dans des classifications réaménagées, repris dans les filets des commentaires et des interprétations, rapatriés dans le giron des habitudes, étudiés à l'école.
L’écriture qui m’arrête est celle qui me donne à voir ce qui reste lorsqu’on croit en avoir fini, poésie donc, pourquoi pas, si on prend garde que celle-ci avance très souvent déguisée. Et que ce qui reste, s’il ne se laisse souvent deviner qu’à la fin, hante nos parages, nos gestes et nos dires, même les plus convenus.
En ce sens, Robert Walser, Henri Calet, André Dhôtel, et Louis-René des Forêts, je les ai lus comme des poètes, au même titre que Jean Follain, Nicolas Bouvier, Philippe Jaccottet ou Thierry Metz.
Cette définition est très discutable, elle me va.
Je réponds à Karim, il m’a proposé de rencontrer en avril (Librairie l’étage à Yverdon) Aude Seigne, auteure des Neiges de Damas. Je bloque les dates des 1 et 22 avril. Petit tour ensuite dans les bois, avec Lili et Oscar. Les beaux jours font un peu de place sous les taillis, juste de quoi s’étendre et attendre. Les cris des enfants.
Jean Prod’hom
Quatre garçons se lèvent avant les autres

Cher Pierre,
Quatre garçons se lèvent avant les autres, ils seront les premiers sur la piste ; le gros de la troupe les rejoint peu après 9 heures. Je reste avec les mêmes que la veille, à peu de choses près, et termine la vaisselle avec leur aide. Tri de photos ensuite, jusqu’à plus de 13 heures. Le soleil va et vient, on aperçoit par moments le Léman et les cris des trois enfants qui bobent devant le chalet avec Oscar.

Avant de dire deux mots sur les liens qui unissent le numérique, sans lequel je n'aurais jamais écrit, avec la poésie telle qu'elle m'est apparue dans le commerce épisodique que j'ai avec elle, il me faudra dire quelques mots à son propos ; dire que je me suis mis à écrire tard, d'abord parce que le travail auquel j'ai dû faire face pour payer mon passage, et celui des miens, ne m'en a longtemps pas laissé le temps. Mais aussi parce qu'il aura fallu que ce travail me fasse voir ses apories, aux confins des questions auxquelles il ne répond plus, pour que je m'avise qu'il existe quelque chose d’autre à explorer, et que la région qui l’abrite peut seule m'apporter la paix que je recherche, à condition que je puisse lui donner une forme, une allure, un rythme, c'est à dire un langage, guère différent de celui de nos contrats et de nos arrangements, au silence et à l'attente près : l’écriture.
Une heure avec la nuit qui tombe, dans les sapins et la neige, pour rejoindre la Casba et ses nouveaux tenanciers, à la queue leu leu. Descente par le même chemin pour quelques-uns d’entre nous, à la frontale ; les enfants et quelques adultes descendent par les pistes, assiettes, sacs à poubelle ou bobs. Il est plus de minuit lorsqu’on va se coucher.
Jean Prod’hom
Du noir et du blanc

Cher Pierre,
Du noir et du blanc, de la neige mêlée d’eau fouettée par le vent ; quelques trouées seulement, au sud, et le souvenir consolant des prés de mai et de juin, des scabieuses et des centaurées. Tout est encore bien loin.

Le gros de la troupe se rend à la patinoire couverte de Fleurier pour une partie de hockey. Je reste au chalet avec une blessée, une malade, une maman et Oscar. En profite pour me mettre au travail, j’extrais 75 photos des 3500 faites entre septembre 2010 et février 2011. Réponds ensuite à deux des questions que les animateurs de la revue numérique, Littérature romande, m’ont envoyées à propos de Tessons ; à moi, si je le veux, de réorganiser leur ordre : l’idée est séduisante.
Elles me permettront de faire le point :
- opposer collecte à collection,
- rappeler la beauté de ces morceaux de terre cuite découverts chemin faisant,
- évoquer les leçons qu’ils ne manquent pas de nous délivrer lorsqu’on se penche sur les circonstances de leur existence,
- dire quelques mots de la nostalgie, et de la mélancolie,
- situer ces objets dans la double perspective de l’art et de l’archéologie, qui les a conduits à trouver place dans les vestibules d’un musée archéologique aujourd’hui (Musée romain de Vidy-Lausanne), d’une galerie d’art demain (Terres d’Ecritures à Grignan),
- avancer l’idée que l’écriture quotidienne d’un billet relève de la même inquiétude que celle du Poucet qui s’est donné les moyens de revenir sur ses pas, mais aussi, et Poucet ne le dit pas, d’aller de l’avant, penser, explorer, marcher là où l’on est jamais allé, comme sur un gué, de proche en proche. La marche étant, à cet égard, la seule méthode philosophique adéquate pour ne pas être tenté de brûler des étapes,
- réaffirmer que la cinquantaine de tessons, dont les photographies rythment l’ouvrage, font partie d’un ensemble qui s’est imposé au cours des années et qui occupe, tout simplement, le premier tiroir d’un meuble d’imprimerie. Les textes qu’ils encadrent ont pour tâche de déplier certaines des raisons pour lesquelles ils tiennent depuis si longtemps le haut du pavé,
- accorder que ce livre aura été important, puisqu’il m’aura permis de me retourner et de découvrir, écrivant, ce que je ne soupçonnais pas.
- ajouter que l’écriture quotidienne sur lesmarges.net est de même nature, elle cueille avant la nuit ce quelque chose que seule l’écriture est apte à sauver de l’oubli en lui donnant forme et motif,
- insister sur le fait que la publication dans les semaines qui viennent, aux Editions Antipodes, d’un recueil de billets écrits entre 2008 et 2014, n’aura pas l’effet de clôture que Tessons a produit, mais fera voir un certain nombre de balises le long d’un chemin qui continue.
Jean Prod’hom
L’hiver en a remis une couche

Cher Pierre,
La nuit passée, l’hiver en a remis une couche, lourde, avec le soleil ce matin qui appuie dessus. Sandra et les filles sont descendues chez Marinette et remontent avec un tapuscrit, près de 300 pages de poèmes sur lequel on demande mon avis ; pas vraiment de mon ressort. Passe à la déchèterie, maigre récolte, bois une verveine à la Croix d’or, y parcours le journal. La neige a tué quatre fois dans la combe des Morts au Grand-Saint-Bernard, l’ignoraient-ils?

Cher Pierre,
Beaucoup de mouvements dans la maison, on part tout à l’heure pour les Rasses. Je liste ce qu’il est important que je fasse pendant que les autres iront skier : passer en revue les photos faites entre 2007 et 2015, en extraire une centaine pour Grignan ; répondre aux questions que m’a fait parvenir la rédactrice de Littérature romande et à la proposition de Vincent M-A ; réaliser quelques images qui pourraient annoncer la parution de Marges ; songer au voyage de fin d’année à Naples. Pas certain que ces jours suffisent.
Sandra part avec les filles, Arthur et son copain dans la Nissan, je ferme la maison pour les rejoindre aux Rasses avec la Yaris. Par Peney, Saint-Cierges, Donneloye et Yverdon. Le soleil et les nuages font des leurs avec la nuit qui tombe, m’arrête pour faire quelques photos d’un nuage qui laisse son empreinte dans le ciel en s’y dégageant, jamais vu ça. Jamais entendu ce que je crois entendre à la radio, j’y souscris ; ils sont rares ceux qui meurent encore vivants. Encore plus rares dans la force de l’âge.
Nous nous retrouvons à 23 plus Oscar au chalet des Genêts, 10 adultes et 13 enfants durant 5 jours. Rien d’inquiétant.
Jean Prod’hom
Jour épagomène

Cher Pierre,
L’homme ajoute périodiquement à son calendrier un jour supplémentaire pour faire coller la durée de son année sur terre avec celle, dans le ciel, du soleil ; pour permettre à celui-ci de finir ses tours et rejoindre sa positon initiale. Et ainsi remettre les compteurs à zéro.

Cher Pierre,
Il en va de même avec nos travaux et nos jours, on en écarte périodiquement un, qui ne comptera pas, dont on ne retiendra rien sinon qu’il aura permis de remettre un peu de jeu dans une partie qui commençait à singulièrement en manquer.
Congé donc, au lit et sous la neige à reposer un corps incapable de suivre le rythme imprimé par les événements ; à la bibliothèque ensuite pour refaire des piles de livres et de papiers, déplacer des objets et mettre à jour les billets hâtivement rédigés à Berne. Jour épagomène donc, chômé, comme au temps béni du calendrier républicain et de l’Union soviétique.
Et tant qu’à faire, vais prolonger mon jour de congé en lisant les pages que Rober Walser consacre à Berne, la plus belle de nos cités.
Jean Prod’hom
(Ecoles à Berne 5) L'Aar

Cher Pierre,
Les oiseaux chantent le long de l'Aar, ils prennent garde de ne toucher à rien. L’Aar lisse et glisse sous les ponts, mutité large et mate gorgée de soleil, avec au fond une partie du ciel et l’or qui entoure la ville. Deux cygnes noirs, un verdier sur la berge, des corneilles qui prennent un bain. Ici, c’est tous les jours dimanche, et c’est pour cela que j’aime les dimanches.

Si on entend, lointaines, les cloches du Münster, ici en-bas on ne se sent pas concernés, on passe. D’ailleurs les bancs publics sont rares ; j’en trouve finalement un devant le Stürlerspital des Diakonissenhauses, là où l’Aar termine sa boucle, c'est-à-dire son travail, et se lance en direction du lac de Bienne. Je reste pour la voir passer, sans regret, le soleil nous a manqué au début de la semaine. Bien sûr, c'est difficile de dire ce que la ville doit à l'Aar, plus facile de dire ce que l'Aar doit à la ville, pas grand chose, l'impression d’avoir été utile en la bordant. Il faudrait rester ou revenir, refaire, reprendre à la même place pour mieux comprendre la confiance qui habite les cours d’eau et reconnaître tout ce qu’on leur doit. L’Aar n’appartient pas à la ville, elle est l’envers de sa légende. Qu’on lui laisse son lit.
Porte fermée au centre Rober Walser où sont exposés quelques-uns de ses microgrammes, me rabats sur Nakis Panayotidis au Kunst Museum. Du monde dans les rues de Berne, c'est carnaval avec la nouvelle question qui l'accompagne, celle du seuil. Les déguisements ne se distinguent guère de nos habillement quotidiens. Il y a un continuum, et cette absence de coupure inquiète au même titre que toutes les manifestations qui ont voulu ou dû s’en passer.
Passe en rentrant par le CHUV. F cherche quelque chose de plus solide que la barrière du lit à laquelle elle s’accroche. Je discute à la cafète avec Valérie.
Jean Prod’hom
(Ecoles à Berne 4) Samuel

Cher Pierre,
Les moments passés entre nous lorsqu’on en a fini avec nos adolescents, qui se prolongent sans qu’on s’en aperçoive, pèsent sur ma volonté ce matin à 6 heures 30. Prendre un peu l’air en haut du tunnel de la Zivilschutzanlage ne suffit pas, une lourde fatigue colonise mon corps qui se raidit et raccourcit ma respiration. Si bien que j’ai tôt fait de rentrer.
Le hasard a voulu que je dispose d’une heure, je l’emploie sur une paillasse militaire à lire une nouvelle de Bernard Comment avant de céder au sommeil.

Le soleil s’est installé sur Berne et chacun a le sourire quand on monte dans le tram. Il y a du monde sur la Place fédérale, les nôtres portent leurs habits de gala. C’est pas pas tous les jours qu’on a quinze ans, qu’on parle à la tribune de la salle du Conseil national, devant plus de deux cents personnes. Première fois que ces gamins vivent en démocratie en y participant vraiment, en réalisant ce gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ils ont accepté les règles dont l’établissement les précède, et c’est de ce consentement-là, initial, qu’il exercent leur liberté. Ils ont accepté le principe, avant d’agir pour changer ce qui peut l’être, de se ranger à l’avis de la majorité. A moi de leur rappeler qu’il convient parfois de désobéir aux règles, on ne le dit pas assez, si la folie s’empare des hommes.
De ces cinq heures de délibérations, votations, recommandations, il faudrait évidemment tout dire. Mais si tout m’était enlevé à l’exception d’une seule chose, c’est de l’histoire de Samuel tout au long de cette semaine que je me souviendrais, et d’un moment très singulier, lorsque ce gamin, traversé par le syndrome d’Asperger, a décidé de se lancer et de lire à la tribune ce qu’il avait rédigé la veille.
Ce qu’il voulait dire est resté bloqué un long moment dans sa poitrine, il a respiré profondément, à plusieurs reprises, avant de se lancer enfin. Ça a duré 2 minutes 50, il s’est arrêté une ou deux fois, là où il avait placé des points à ligne, avant de rejoindre le dernier mot. Il lui a fallu réitérer le même effort, respirer profondément, allumer sa voix, avec les mots loin dans la poitrine, en crue, qu’il lui a fallu remettre en file indienne.
On en avait parlé la veille, je lui avais raconté l’écriture boustrophédon, il savait que s’il ne parvenait pas à enchainer les parties de son texte sur un seul sillon, il aurait à engager toutes ses forces pour redémarrer. Il a préféré honorer les différentes parties de son discours sans lesquelles celui-ci aurait été comme un ensemble de membres disjoints. Il a choisi le sens contre son handicap, les autres en lieu et place de son confort. Cet enfant a une force extraordinaire, il est allé jusqu’au bout.
Pour le reste, cette session à Berne m’aura confirmé dans l’idée que les adolescents sont très conservateurs, et que s’ils veulent que les règles en usage perdurent, c’est pour prolonger la possibilité de leur désobéir, les transgresser et, ce faisant, différer l’âge des responsabilités.
On se couche encore une fois trop tard. Mais ces rencontres entre personnes régies par les mêmes règles, sans rien avoir d’autre de commun que la proximité ou le voisinage, ont quelque chose de miraculeux. Nous ne parlons pas la même langue, vivons dans des régions géographiquement très différentes, partageons quelques-unes de nos infrastructures. La Suisse? Ni une patrie ni une nation, mais une société en acte.
Cérémonie de clôture d’Ecoles à Berne. Quelques élèves improvisent une chanson qu’ils chanteront tout au long du trajet du retour :

Discours de Samuel
Tram numéro 9
jeux électroniques
discours de Samuel
la nourriture chers cuisiniers c’était très bon
Ambassade de Colombie
sucettes à la pomme et au coca-cola
on s’est éclatés durant cette semaine
en participant à Ecoles à Berne
Tram numéro 9
jeux électroniques
discours de Samuel
la nourriture chers cuisiniers c’était très bon
La chancellerie fédérale
nous a fait attendre trop longtemps dans le froid
il fallait récolter cent signatures
on a même fait du sport le lundi soir
Tram numéro 9
jeux électroniques
discours de Samuel
la nourriture chers cuisiniers c’était très bon
On voulait jouer une dernière fois au jeu des fondations, Schwytz, Berne, Grisons et Vaud, au bar du Novotel. Fermé. On s’est rabattus sur le bar voisin, bondé. Les supporters d’Everton fêtaient la victoire de leur club contre l’équipe bernoise. Impossible de s’entendre, c’était le moment de se quitter.
Jean Prod’hom
(Ecoles à Berne 3) Il y a un chasseur parmi nous

Cher Pierre,
Le groupe se retrouve dans la salle 3, travaille entre 7 heures 30 et 9 heures 15. Visite ensuite du Palais fédéral ; la guide, italophone et pleine d’entrain, pleine aussi d'idées préconçues sur les adolescents, ce qu’ils sont, font, et pensent, les rend muets ; elle s’en étonne. L’enthousiasme et la passion tuent, c’est bien connu, ses interlocuteurs ont baissé les bras, baissent les yeux, elle se plaint, le malentendu est installé, chacun se méfie. Tout ça donne envie de fuir.

Cher Pierre,
Jacques Neyrinck nous a fait faux bond, personne dans la salle 287. Les 24 adolescents s'étaient intéressés à la vie et à la carrière de cet imprévisible ludion du landerneau politique vaudois, démocrate et catholique, ingénieur et romancier, vieil homme de plus de 80 ans. Ils avaient préparé cette rencontre, les voilà déçus, déçus d’une absence dont ils ne s’attendaient pas. Je lui téléphone, il a effectivement oublié. S’est ajoutée, dit-il, une urgence. A moi de l’excuser. On ne peut s’empêcher de repenser au film de Bron, à certains mots à son propos : Neyrinck? Personne ne sait ce qu’il va dire, faire ou voter. S’il va changer de position au dernier moment.
En rentrant en tram à l’Arena, je suis frappé du nombre d’anneaux que filles et garçons se sont fixés sur le visage, anneaux qu'on ne voyait autrefois qu'au museau des bovins et qui ornent aujourd’hui d’innombrables visages : nez, lèvre, joue, front, paupière, sourcil. Cette ferraille inquiète, comme si leurs porteurs, attachés à rien, cherchaient quelque chose à quoi s’accrocher. On aimerait qu’ils en prennent conscience et s’en débarrassent, comme on se débarrasse discrètement d’une miette de pain restée sur la lèvre ou une coulée de rimmel au coin de l’oeil. Mais on n’ose leur en parler de peur de les gêner.
Le ministre de l'ambassade de Colombie a séduit l'auditoire dans ses bureaux du deuxième étage de la rue Dufour. Un immeuble locatif des années 70 que l’ambassadeur partage avec ceux de Slovénie et des Philippines. Le ministre offre à l’un participant qui lui en demandait les références un exemplaire en français de Cent ans de ans de solitude. D’autres auraient sans doute eux aussi aimé recevoir un cadeau, mais tant qu’à faire, ils auraient préféré le dernier disque de Shakira. On rentre avec la nuit, les premiers masques du carnaval guignent au coin des rues. On se hâte, souper à 18 heures. Les orateurs de demain préparent jusqu’à plus de 22 heures, sous les néons de la Zivilschutzanlage, leurs interventions de demain.
On se retrouve une nouvelle fois dans le bar du Novitel : Bernois de Bienne et de Berne, Schwytzois de Pfäffikon, Grisons de Cazis, Vaudois de Corcelles et de Baulmes. Il y a un chasseur parmi nous, grison. Il nous raconte la chasse haute dans ses montagnes, le profusion des cerfs, la rareté des chamois, l’arrivée des loups, ses rencontres avec les bêtes, ses trophées. Il nous fait part de cette paradoxale conviction selon laquelle une bête que le chasseur tire a donné préalablement son consentement. Lorsque je lui oppose qu’en tuant l’animal, le chasseur s’interdit tout accès non seulement à ce qu’il n’est pas mais encore à ce qu’il est lui-même, il me rétorque que l’animal mort emporte non seulement son secret mais aussi celui du chasseur. Pourquoi dès lors ne pas les laisser fuir tous les deux?
Lis très tard les dernières lignes de l’Abrégé du monde. Pour la première fois. Reprendrai une seconde fois la semaine prochaine, pour y voir clair.
Jean Prod’hom
(Ecoles à Berne 2) Bars de l'Eleven et du Novitel

Cher Pierre,
Nuit courte. Je me retrouve au déjeuner, bancal, face au Grison que les hurlement de sa fille ont ramené à la vie. L'impression qu'il m'a faite hier se confirme ; tout en lui rappelle les caprinés qui habitent les montagnes au-dessus de Cazis : yeux tombants, longs cils, nuque osseuse, pattes arrière résistantes, jarrets fins, jusqu'à sa voix de fumeur, rauque : entre le brame du cerf et le bêlement de la chèvre. Son insouciance aussi.

À la table siègent encore un hibou, un phasme, un paresseux, une musaraigne, un moineau, une perruche, un renard, une autruche, non deux autruches, une oie, un mustang, un fourmilier. Tous semi-domestiqués, ou croisés avec un humain, demi-dieux.
Il fait un froid de canard, les trois ours de la fosse hibernent ; j’en aperçois un respirer sur l'écran de télévision placé sur le chemin du bord de l'Aar. Froid polaire devant Erlacherhof, devant le Münster, la Banque nationale et le Palais fédéral. La chancellerie nous fait poireauter un bon quart d’heure avant qu’un de ses employés montre son nez du bout des doigts, à peine deux mots, il a froid. Se retire aussitôt avec la liste des signatures de tous ceux qui qui veulent un Mariage et famille pour tous.
Les commissions de l’après-midi réchauffent les esprits et l’atmosphère. Les adolescents n'ont plus besoin de moi, je vais m'étendre sur une paillasse militaire, lis quelques lignes de l’Abrégé du monde. Elles me suffisent.
Longue séance de discussions le soir au sein du groupe parlementaire, jusqu'à dix heures. Les adultes sortent ensuite : bar de l’Eleven au Wankdorf, celui du Novitel ensuite, on ne compte plus les heures, la nuit sera une seconde fois courte, très courte.
Jean Prod’hom
Gif | 16 février 2014

Cher Jean,
Je me disais, dans ma grande banlieue, qu'avec la neige qui couvre les hauteurs, partout, mon petit envoi n'atteindrait jamais le Jorat ou alors, peut-être, au printemps, vers le début de l'été. Une vision bien localisée, très étriquée, très timorée du train dont va le monde. Je vois parfaitement l'attrait qui s'attache aux tessons pour avoir collecté, ma vie durant, des cailloux, des insectes, des plantes, des bouts de métal, le tout sous les lazzi ou les sourires sardoniques, plus ou moins rentrés, de certains proches.

En pj, Chrysotribax hispanicus, par exemple, dont la rencontre m'a exalté, il y a très longtemps.
Cordiales pensées.
Pierre Bergounioux

(Ecoles à Berne 1) Lausanne-Berne

Cher Pierre,
Purée de pois au Riau, la batterie de la Yaris ne répond pas ; la lance sur le chemin, elle consent à démarrer avant le tilleul. Je respire enfin lorsque le soleil fait son apparition à la Marjolatte.

Bois un chocolat chaud au buffet de la gare, croise une foule de gens décidés, trop. La ville, le matin, m’inquiète ; elle réveille quelques mauvais souvenirs, Bruxelles, Rome, Paris. Et je retrouve cette peur sourde qui me raidissait, la sensation d’être enveloppé par quelque chose qui est plus que la ville, la déborde et en fait un bateau ivre, agité, sans capitaine sur le pont ; monstre ravitaillé par de fragiles embarcations sur un océan sans continent.
Les 24 adolescents que je vais accompagner à Berne tout au long de cette semaine sont à pied d'œuvre dans le hall central de la gare. Le candidat, que le groupe parlementaire a choisi pour la présidence du Conseil national, traduit en allemand le discours qui devrait convaincre les conseillers des cantons de Berne, de Schwyz et des Grisons ; la présidente du groupe traduit de son côté la présentation qu'elle fera, cet après-midi, de son parti : leur combat pour le droit au mariage de chacun avec chacun, quel que soit son sexe, et des droits que cette institution induit ; leur volonté d’accroître le contrôle de l'expérimentation animale et d’abaisser les prix des transports publics, leur désir d’améliorer la situation des demandeurs d'asile et de responsabiliser les jeunes au volant.
La train rentre à nouveau dans la brouille sitôt qu'on a tourné le dos au Léman, Fribourg remue dans le coton, Berne ne fait pas mieux. Tram jusqu'à l'Arena ; une étudiante, charmante, accueille notre groupe et nous fait découvrir les locaux ; le béton triple couche des abris PC n'a pas bougé depuis l’année dernière : couleurs fades et glacées, odeurs visqueuses.
Impossible d’éviter la litanie qui assure la bonne marche de la session : information, concertation ; bientôt élection, commission ; puis discussion et votation. Jusqu'à 21 heures 30.
Termine la journée dans une halle de curling, puis la soirée au bar du Novotel avec deux enseignants des Grisons. L’un d’eux raconte l'avalanche qu’il a déclenchée, il y a quelques semaines. Il était avec son jeune fils et sa fille qui les a sauvés en hurlant, au dernier moment, alors que l’avalanche fondait sur eux. Sans quoi ils auraient été perdus. La fille a pu rester au-dessus de la coulée, le père et le fils fuir sur les côtés. Le père se félicite aujourd’hui, – que peut-il dire d’autre de son inconscience ? – qu’ils sont vraiment de bons skieurs. Je pense en m’endormant au père d’Arthur qui a eu bien moins de chance.
Jean Prod’hom
Abrégé du jour

Cher Pierre,
Le soleil ne nous a pas lâchés. Sandra est allée à Ferlens récupérer Arthur, elle s’en va avec les filles chez Marinette. Je rédige le billet de la veille avant de m’atteler, si j’en ai le temps, à la lecture d’Un Abrégé du monde, car j’ai à préparer ma semaine à Berne, et c’est moi qui suis au fourneau ce soir. Françoise et Lucie nous rendent visite au milieu de l’après-midi, on fait les quatre heures, on va faire le petit tour, on mange ; Lucie nous raconte Cuba. Entasse dans une valise le nécessaire pour ma semaine à Berne.
Jean Prod’hom
Aller au menu avec Bergounioux et Montebello

Cher Pierre,
Sandra et les enfants prennent la cabine pour Vounetz ; je monte de mon côté en pente douce jusqu’aux Ciernes et continue sur la route des Revers. Renonce à passer par les hauts, il y a trop de neige. Les remises et les cabanons, à l’arrière des fermes, ont un matelas épais sur leurs toits à faible pente, la neige roule sur les plus pentus et l’eau de la fonte nettoie en se gargarisant le lit des fossés.

Pas grand monde sur le chemin ; je n’aurai à la fin rencontré qu’un couple d’amoureux pressés d’arriver avant midi à Charmey pour acheter du fromage, un jeune premier ripolinant devant son écurie une voiture de sport, une vieille enfin, à la fontaine de Précornes, l’oeil triste, l’autre vitreux, égarée; elle me dit quelques mots en patois, tout en rinçant une patte crasseuse dans un saut jaune. Je crois comprendre qu’elle me parle d’enfants morts ; elle frappe avec son bâton le tas de neige qui est amassé sur le rebord de la fontaine, avant de disparaître sur un fil dans sa trop grande maison.
Les cloches sonnent tous les quarts d’heures à l’église de Cerniat ; je n’entends plus celles de Charmey, pas encore celles de la Valsainte. C’est un peu avant les Reposoirs qu’un chemin à double ornière, qu’on devine à peine, plonge en deux longs virages sur le Javro, un pont couvert le franchit avant de remonter jusqu’au Tioleyre. On se retrouve alors, un peu plus loin, avec pour seul horizon le mur d’enceinte au beau crépi de la chartreuse de la Valsainte. Je fais quelques photos, entre dans la chapelle, dedans, dehors c’est le désert.
J’en aurais bien vu un ou deux de Chartreux, avec leur cape de bure, comme il y a une vingtaine d’années ; ils gambadaient comme des cabris, pieds nus dans leurs sandales, sur le chemin qui monte en direction du Lac Noir, c’était l’été. Avec la neige et le vieux crépi des murs d’enceinte, la bure aurait eu fière – une journée comme un abrégé du temps, une promenade comme un abrégé du monde. Je les imagine pensifs et apaisés.

Je ne m’attarde pas, redescends rive droite jusqu’à Cerniat, en passant par les Riaux où je fais la causette avec un ancien des lieux qui y réinstalle ses pénates après avoir tenté de vivre ailleurs. Passe le pont qui cambe le ruisseau de la Joux Derrey descendu tout droit de la Berra, pensote, tricote des bouts d’envie qui pourraient à la fin faire un film, avec des voix, la mienne et celle des autres. Ecoute craquer les feuilles de glace grumeleuse, broderies bordant la chaussée ; elles craquent sous mes pas comme des bricelets.
Verveine à l'hôtel de la Berra ; les photos du massif de l’Himalaya accrochées aux murs du chalet Jugendstil, ne sont pas celles de Loretan, mais celles du tenancier qui y est monté, lui aussi, jusqu’à 7700 mètre. Causette avec deux clients de la région. Ils m’apprennent que si Cerniat a accepté la fusion avec Charmey, Châtel et Crésus l’on refusée, pour des questions d’argent. Charmey vit, disent-ils, sous perfusion ; et les bains, s’ils ont relancé la station, ne ramèneront pas la neige.
Peu après l’église de Cerniat, le chemin plonge une nouvelle fois sur le Javro, je fais la causette avec trois mésanges qui prennent rapidement leur distance, les fontaines débordent, les akènes des érables attendent leur tour. C’est cette abondance qui étonne.
Lis au restaurant de la Poya, à Charmey, deux nouvelles de Bernard Comment. Tout passe en effet.
Je m’arrête à la boucherie, un sms de Sandra : les enfants ont été agréables, la journée de ski s’est bien passée. On la termine aux Bains avant de rentrer au Riau en passant par Ferlens où on dépose Arthur pour une fête qui nous le ramènera demain matin.

Découvre au retour, avec reconnaissance, le travail de la poste. Dans la boîte aux lettres un gentil mot de Pierre Bergounioux à propos de Tessons, et son Abrégé du monde dans lequel je guigne :
Ce qui se donne pour la réalité peut inspirer d’emblée d’importantes réserves. On n’y saurait souscrire sans dommages ni pertes. Un travail s’impose, qui consiste à extraire du tout-venant et à serrer à part, dans une boîte en carton, par exemple, les choses qui sont bonnes. On aura alors un monde et la sorte de vie, parcellaire, confinée mais, somme toute, acceptable, qui va de pair.
Même s’il n’est pas temps de m’attendrir, l’envoi de cet inventaire des biens sans maître et sans valeur, la lecture hier d’un extrait du Sombre Abîme du temps de Laurent Olivier, l’annonce enfin du titre du prochain livre de Denis Montebello : Aller au menu tendent à me donner un peu de cette confiance qui me manque.
Mais il faut encore nourrir la marmaille avant le couvre-feu : une poignée de pâtes et du gruyère, quelques tomates, un concombre et une salade de fruits. Au lit. Me relève pourtant dans la nuit, parcours une dizaine de pages d’Un abrégé du monde, prises au hasard. Pas trace de point-virgule!
Jean Prod’hom
Des tomates et des babybels

Cher Pierre,
Soleil encore ce matin, j’en profite pour faire un peu d’ordre dans la bibliothèque. Rédige le procès-verbal de la séance de lundi, mets à la poste trois lettres, file à Mézières faire quelques courses. Ramène une mousse à la framboise en forme de coeur pour Louise. Lili est chez une amie, Arthur et Sandra à l’école. On mange tous les deux des tomates et des babybels, une salade de fruits.

Je descends au CHUV entre deux et trois. F. aimerait sortir de sa chambre, mais deux bandes d’aluminium, de celles qu’on place dans les arbres pour empêcher les merles et les moineaux de mettre à sac les cerisiers, l’en empêchent. Elle est encore faible, mais les morceaux de langage qu’elles lançaient dimanche devant elles, et qu’elle ne pouvait suivre, elle semble être en mesure de les retenir par moments, et les morceaux semblent se rapprocher les uns des autres, et il y a comme un chemin qui se dessine. On n’en finit pas avec le Petit Poucet.
On ramasse Arthur à l’arrêt de bus : Mézières, Oron, Bulle et Charmey. Cinq ou six chamois fouissent les prés enneigés au-dessus du lac de Montsalvens, ma journée est sauvée. Pour toujours.
Jean Prod’hom
Gif | 12 février 2014

Cher Jean,
Merci pour ces Tessons. Ils sont beaux comme tout, belles et justes les pensées qu’ils vous dictent, tout bas. On pourrait leur appliquer la maxime que Linné a mise en exergue de l’entomologie : "Natura maxima miranda in minimis". Combien peu suffit, tout compte fait, à notre joie. Vous le dites d’ailleurs. Le bonheur peut résider dans un cabanon.
Gratitude et cordiales pensées.
Pierre Bergounioux

Vénus et Pluton qui ne jurent que par lui

Cher Pierre,
Ce devait être en 1982, Jean-Claude Piguet avait invité un astrophysicien pour débattre avec nous des problèmes généraux de la connaissance, de la méthodologie des sciences et des caractéristiques de leurs discours. A l’un des étudiants qui l’avait interrogé sur la consistance des propositions de l’astrologie, il avait répondu que, si les planètes jouaient bel et bien un rôle physique évident dans l’équilibre du système solaire, les masses réunies de Pluton, Mars, et Vénus jouaient sur nos vies un rôle bien moins important que celle du bâtiment principal du Centre hospitalier universitaire vaudois alors en construction. La réponse avait fait sourire l’auditoire.

Si cette anecdote me revient aujourd’hui, c’est parce que les planètes sont aussi des dieux. On pourrait alors se demander si ce ne sont pas nos divinités qu’on se préparait à enfermer, en 1982, dans cet Olympe qui domine la ville et autour duquel gravitent nos vies. Et que s’il exerce une attraction aussi importante, c’est d’abord parce que le CHUV héberge dans ses couloirs Mars, Vénus et Pluton qui ne jurent désormais que par lui.
Quatre jours que le soleil brille, quatre jours que quelque chose se défait dans un ciel dégagé et se refait dans le même ciel, peur informulable qui se dépose tout autour comme une poignée de sable dans la mer.
Je ramasse Arthur à l’arrêt de bus, note ce que je dois faire demain, c’est jour de congé. Conduis le mousse à Ropraz, file à Fey rejoindre les filles. Elles discutent avec deux responsables, dans l’annexe, du futur déménagement de l’écurie Takhi à Thierrens. Elles ont toutes les quatre le sourire, des projets pleins les yeux.
Jean Prod’hom
Errant à bord d’une coque de noix

Les hommes marchent à sec parce que les eaux qui les menacent forment une double muraille qui les en protège. Miracle.
Mais ils avancent talonnés par la peur et la mer qui se referme derrière eux. Le chemin étroit qu’ils empruntent est sans issue et se prolonge aussi longtemps qu’ils parviennent à distinguer la mer de la mer, la terre de la terre, l’ici de l’ailleurs, les mots des choses.

Lorsque le lien casse, on retrouve certains d’entre eux prostrés sous la double muraille qui les submerge, ou errant à bord d’une coque de noix, ubiquitaires, égarés, réunissant dans un imprévisible poème les mots et les choses.
Passe une petite heure avec F. et deux de ses visites dans une chambre du 13ème. Elle reconnaît la dent de Jaman, je reconnais les autres: la Dent de Lys, le Vanil des Artses, le col de Pierra Perchia, la Cape au Moine, le col de Jaman, les Rochers-de-Naye. On y est allés naguère ensemble. Mais la tour des infirmières verrouille l’échappée vers le Valais.
Jean Prod’hom
L'ici touche à l’ailleurs

Cher Pierre,
On a entendu en début d’après-midi le chant d’une mésange et d’un premier printemps, une espèce de renaissance d’avant la Renaissance, pleine de promesses. Pas étonnant que j’aie ouvert le Décaméron et relu L’Ascension du Mont Ventoux.

Les fenêtres sont ouvertes, les gens sont bavards, trop ; on rêve d’ailleurs : d’être dans les Franches Montagnes, en haut d’une vallée alpine ou à Château-d’Oex, le long du Doubs ou dans le silence du Niremont, n’importe où. Si bien qu’on ne souhaite rien d’autre que de rester là où on est, on se met à rêver consciencieusement à l’un ou l’autre de ces lieux éloignés pour s’y installer un instant, débarrassé de ce qui nous attache ici ; un instant encore lorsqu’on en revient, sans bagage, tel qu’on était là-bas.
C’est à ce jeu de l’ici et de l’ailleurs que je songe lorsque je prends l’ascenseur pour la section de neurologie, salle des soins continus. Parfois les règles du jeu cèdent, l’ici touche à l’ailleurs, l’un à l’autre, l’un dans l’autre.
Je file à Saint-Martin, songeur, ramasse Lili et son amie que je dépose à Carrouge, reprends Arthur à Ropraz. Jean-Daniel me dit son intérêt pour Marges, mais Ulule plombe l’ambiance. Je lui propose de transmettre sa demande aux éditions Antipodes qui feront le nécessaire. C’est fait.
Jean Prod’hom
Ce rien qui distingue leurre et lyre

Cher Pierre,
Cinq heures, ciel bleu, et blanc sans limite. Je me suis tourné toute la journée, à intervalles réguliers, en direction du treizième étage de d’hôpital ; je l’imagine cherchant à offrir à sa raison un point d’appui et un lieu où se reposer. Il se dérobe, et l’infatigable reprend l’inventaire de son semainier, dont les tiroirs ne semblent s’ouvrir que du dedans. Me suis senti hier incapable ni d’y entrer ni de l’en faire sortir.

La raison qui fait tenir ensemble le langage et le monde est un lien fragile, miraculeux. Il laisse entrevoir, lorsqu’il cède chez celui dont on a été si proche, l’étendue de notre ignorance. Et on se réjouit que ce lien qui s’est défait puisse se refaire.
Cette fragilité, je crois l’avoir évoquée ce matin à la mine, en parlant de la figure de Nicolaï Troubetzkoy, ou plutôt en faisant voir sa découverte à de très jeunes élèves, le ce à quoi peut se réduire notre langue, à ce rien qui distingue père et mère, mort et sort, leurre et lyre, et du monde qui s’en suit.
Je récupère Arthur à l’arrêt de bus, mets une bûche dans le poêle, fais de l’ordre dans la paperasse concernant la course de Ropraz : ce soir il y a séance de comité. Le jour poussé par la nuit s’en est allé voir ailleurs.
Jean Prod’hom
On a souri tous les trois

Cher Pierre,
Le soleil est revenu, plusieurs jours qu’on ne l’avait pas vu. Sandra et les filles descendent chez Marinette, Arthur rentre du bois, à moi la déchèterie ; pousse jusqu’au motel des Fleurs où je lis le journal et la seconde partie d’Aline. Il y a bien sûr la tragédie, mais il y a surtout la beauté sur la terre, les carrés jamais carrés, froment ou avoine, vergers ou bois, posés les uns à coté des autres, faufilés par les hommes.

Il est 16 heures, je ramène May à Servion, reprends Louise qui a fait des pâtisseries avec Elsa. Elle m’aide à verser la monnaie du repas de soutien dans le bancomat de Mézières. Y retourne seul pour verser les billets, courageusement. Je n’y parviens pas et l’appareil avale ma carte. J’ai trop tardé, paralysé par un mail que j’avais cru pouvoir lire en vitesse : F. est hospitalisée depuis dimanche passé, elle a dû rentrer précipitamment d’Inde. Quelque chose s’effondre, la vie est sans prix.
Je vais la voir entre 6 heures et 7 heures et demie, mets un masque, des gants et une blouse verte. Il faut prendre des précautions, personne ne connaît les causes de son état, l’infirmière m’indique que les investigations continuent.
F. n’a pas l’air malheureuse, mais inquiète, lointainement inquiète, elle souhaiterait aussi que la ceinture qui la retient ne la retienne plus. On a parlé par petits bouts, passé du coq à l’âne, et puis les petits bouts sont partis en morceaux, son attention s’est fixée ailleurs. On s’est croisés plus loin, On a ri de ces petits riens qui ne sont attachés à aucune ancre, je ne crois pas qu’on parlait à chaque coup de la même chose. Tout cela n’inquiéterait pas si le monde était autrement, si nous n’avions pas à nous plier à ses lois.
La télévision va toute seule : Questions pour un champion, Hélène Segara, les résultats sportifs. L’infirmière lui a amené à manger, mais F, n’a pas le coeur à ça, pas même à boire. L’infirmière essaie de la convaincre, elle est faible. F. a quand même fini son verre d’eau, un peu pour nous faire plaisir. On a souri tous les trois.
La nuit est tombée, le lac qu’on aperçoit du 13ème étage a disparu dedans. On se quitte, je souffre de la laisser seule, elle pas, comme si elle avait à faire avec une autre solitude, une solitude où on est vraiment seul.
Jean Prod’hom
Corcelles-le-Jorat | 2 février 2014

Cher Pierre,
Coup de téléphone à 7 heures 20, c'est le mousse, il a peu dormi : Sandra va le chercher à Ferlens. Me rendors comme jamais, épuisé par la semaine qui se termine. A midi, Sandra et les filles partent pour Payerne ; s’y déroule la finale régionale de l’UBS Kids Cup team. Profite de faire les comptes du repas de soutien de la veille avant de relire la première partie d’Aline. Pousse Arthur jusqu’à Epalinges. Courses à Oron. Passe un moment heureux à parler du Portugal avec le tenancier du Restaurant de la Croix d’Or, né en Angola, originaire de Guarda, sise à plus de 1000 mètres sur les contreforts de la Serra da Estrela. Il me raconte ses premiers pas en Suisse, dans les années 80 ; ceux de ses enfants dont il est fier : un garçon ingénieur en informatique, une fille bientôt médecin.
Ce restaurant, son nom, son tenancier et sa famille, le carrefour auquel il est lié, la zone industrielle d’Ussières toute proche, mais aussi la Bressonne qui traverse ce morceau de plaine, me font inévitablement penser aux récits d’André Dhôtel. S’y déroulent mille aventures invisibles que lui seul savait raconter.

Essaie d’écrire quelque chose à propos du repas de soutien de la veille, de ce moment qui a réuni les parents, les enfants et les enseignants. Des bénéfices de ces aventures lorsqu’elles ne sont pas prises en charge et en otage par ceux qui sont supposés savoir, ceux qui feignent d’ignorer que l’avenir est du côté des nouveaux-venus. Il nous faut jouer petit si nous voulons obliger les élèves à prendre la main sans la lever, à grandir et à cesser de parler pour ne rien dire. Nous devons renoncer à faire la loi, nous satisfaire d’en être les garants.
Cher Pierre, j’ai lu votre mot en fin de soirée, il m’a fait grand plaisir. Que vous ayez eu vous aussi des démêlés avec les taupes ne doit pas nous empêcher, ni vous ni moi, d’admirer leur obstination. Nous leur en voulons d’ailleurs moins qu’à ceux de notre espèce, si souvent ingrats ; vous l’écrivez, c’est l’ingratitude des hommes qui nous condamne à nous sentir seul. Moins seul pourtant lorsqu’on s’avise que « d’autres ne s'en accommodent pas non plus, se donnent de la peine pour y remédier, persévèrent dans l'effort, la volonté bonne, la fidélité à soi».
Et il nous restera, longtemps encore je veux l’espérer, «des bêtes, des arbres, des pierres, du ciel.» Et la «prose des jours» pour les dire. Vous enverrai à Gif-Sur-Yvette, à l’adresse que vous m’avez indiquée, le recueil de quelques-unes de ces notes, lorsqu’elles seront imprimées. Avec ma gratitude.
Jean Prod’hom
Gif | 7 février 2014

Cher Collègue,
Bien reçu vos notes, dont je vous remercie. Heureux d'y retrouver les soucis d'un enseignant, d'un père soucieux, d'un citoyen du monde, fût-il de nationalité helvétique puisqu'il existe encore des nations, d'un homme que la vie des bêtes, des arbres, des pierres, du ciel ne laissent pas indifférent. J'ai, moi aussi, des démêlés avec les taupes. On se sent un peu seul, parfois, face aux difficultés du métier, de la vie, à l'ingratitude du genre humain ( la serveuse du terminal de paiement, les mangeurs de priorité, etc.) et on constate que non, que d'autres ne s'en accommodent pas non plus, se donnent de la peine pour y remédier, persévèrent dans l'effort, la volonté bonne, la fidélité à soi.
Un écho vivifiant en provenance de votre pays de neige. Les photographies ajoutent encore à l'effet de réel. On voit.
Merci d'avoir eu la pensée de m'adresser cette prose des jours dans vos montagnes.
Cordiales pensées.
Pierre Bergounioux
Les Marges

Cher Pierre,
Une bonne nouvelle d'abord, la première édition de "Tessons" est épuisée, la seconde est dans les bacs; les « vraies" pierres sont dans le vestibule au Musée Romain de Lausanne-Vidy jusqu’en avril; avant de rejoindre, avec des photographies, Grignan et la galerie "Terres d'écritures" que fait vivre Christine Macé.

Il y a quelque temps déjà, Claude Pahud m’a proposé de réunir certains textes écrits entre 2008 et 2014 sur ce site. Pour en faire un livre. Il est fait, avec une belle postface de François Bon.
Il y est question d'école, du gros Georges, de rivières, du Jorat, des saisons, du Riau, de quelques élèves. Mais aussi de ce qui nous rend meilleurs, de ce qui nous rend pires, de ce qui nous fait tenir debout, des livres, du Rôtillon, mais aussi du ciel et de la Broye, de la bêtise, de la pluie, de la salle des maîtres, d’André Dhôtel, de l’art du porte-à-faux, d’Edith et de Michel, de balades, de Naples. De l’imprévu. Il y a même des photographies.
Vous le savez, les petites éditions n'ont pas la vie facile, et les facéties de l'euro et du franc ne les aident pas. Claude Pahud a souhaité prendre quelques précautions avant de s'engager dans l'impression de ce livre.
Il y a une quinzaine de jour, il a proposé une espèce de souscription. On peut penser que l’objectif sera atteint bientôt. Voici le lien qui permet à qui le veut de manifester sa confiance : Edition de "Les Marges", de Jean Prod'hom - Ulule (http://fr.ulule.com/les-marges/).
Si le coeur vous en dit, n’hésitez pas à rejoindre le rang des soutiens de la première heure. Bien à vous.
Jean
PS
Si vous pensez que ce livre vaut la peine de voir le jour, n’hésitez pas à encourager vos amis. Faites voir cette lettre.
Réunion syndicale

Cher Pierre,
On courbe l’échine de Corcelles à Peney. Pierrot et Jean-Jacques font ce qu’ils peuvent pour contenir la neige ramenée sans cesse par la bise sur les routes communales. Ils se lèvent avant l’aube; on aperçoit loin dans la nuit les phares de l’attelage, le bruit du moteur qui grossit, la lame blanche qui écarte les congères ; je fais un signe, Pierrot ou Jean-Jacques, lui seul le sait.

Non, j’ai appris qu’un homme au coeur plein d’angles avait barré l’accès de sa cour libre de neige, interdisant ainsi aux conducteurs qui auraient souhaité rebrousser chemin de manoeuvrer sur ses terres. La bise, par bonheur, a renversé son dispositif. S’il y a beaucoup de Charlies, il y a aussi quelques Charlots qu’il est préférable de garder à distance. Je m’inquiète et ris jaune : il y a tant de caméras sur les façades des maisons.
Réunion syndicale en fin de journée : les conditions de vie de certains enseignants sont devenues tout à fait impossibles, des conditions dues en partie à l'intégration, dans les groupes, d'enfants difficiles, très difficiles, voire impossibles. Les aides sont insuffisantes. Notre établissement n'y coupe pas. J’imagine les années qui viennent, il n'y a pas besoin d'être voyant pour se faire du mauvais sang.
L'être, voyant, conduirait à ne voir que du noir, ne percevoir que des craintes et des tremblements, chacun s’essayant à sauver sa peau et à réparer héroïquement l'irréparable, alors qu’il conviendrait de tout recommencer depuis le commencement, là où nous sommes, avec ceux qui sont là, en désobéissant, en inventant, avec élégance, discrètement.
Jean Prod’hom
Premier polyptyque

Cher Pierre,
La bise s’est levée et des congères ont rendu la route dangereuse. Ma journée commencée avant six heures se termine à l’instant. Par la corniche, Chexbres et Mézières.

La fatigue m’oblige à ne pas tout dire, à peine l’essentiel. Disons pour faire bref que je suis allé faire des courses avec deux des organisatrices du repas de soutien de vendredi prochain, dans la bonne humeur. Près de trois heures auront été nécessaires pour ramener plus de 600 francs de marchandises.
Je suis arrivé à Treytorrens alors qu’Yves était sur le point de s’en aller. C’est donc avec Anne-Hélène que nous avons discuté, dans la chambre que Ramuz a occupé en 1914, puis dans son atelier. Elle aura été assez enthousiaste pour que mon inquiétude lève un instant le camp, et que nous puissions réaliser un premier polyptyque. Il y a un immense travail, mais j’ai le sentiment ce soir que ni Anne-Hélène ni Yves ne me lâcheront. Nous nous quittons à près de 23 heures.
Au-dessous de nous, il y avait les étages du jardin, un grand beau vieux jardin qui descend jusqu’au lac...; au-dessus de nous, il y avait les étages, bien autrement nombreux et autrement superposés, bien autrement raides des parchets de vignes, qui montent là jusqu’au plein ciel.
Sur le chemin du retour, les idées ne m’ont pas laissé tranquille.
Jean Prod’hom
Ecrire et lire ne font qu'un

Cher Pierre,
« Belle journée! » à la pompe à essence d’Epalinges, « Belle journée! » à la salle des maîtres, « Belle journée! » à la Châtaigne : personne n’en est revenu, c’est à cause du soleil qui occupe tout le ciel, de la neige qui occupe tout l’espace. Où qu’on soit règne un peu de ce désoeuvrement qu’on rencontre à Gstaad, à Crans-Montana ou à Saint-Moritz : voitures rares, bruits étouffés, congères qui font obstacle aux riches comme au pauvres si bien que chacun est logé à la même enseigne : nous sommes tous privés de golf. Les barres ont des allures de sanatoriums, les écoles de palaces. On rêve, le bonnet sur les oreilles, à l’Engadine, aux lacs de Sils et de Silvaplana, aux mélèzes.

Je revois avec les grands le film que Stéphane Bron à consacré à la commission parlementaire chargée d’élaborer en 2002 à Berne, salle 87 du Palais fédéral, une loi sur le génie génétique. Je ne m’en lasse pas, pas sûr qu’il en soit allé de même pour ceux à qui je l’avais destiné.
Surprise avec les petits lors du conseil hebdomadaire, quatre d’entre eux se sont opposés à la proposition d’une camarade de partir deux jours et demi en fin d’année faire du camping, au prétexte que dormir à la dur est inutile, d’autant plus que chacun d’entre eux dispose, en principe, d’un lit à la maison, tendre et moelleux ; un autre réfractaire ajoute qu’il n’y a strictement rien à faire sous une tente. J’ai dû me retenir pour ne pas demander la parole et avertir mes futurs concitoyens du danger que nous font courir les plus jeunes ; j’en aurais appelé à la résistance de ceux qui rêvent encore d’aventures et ne craignent pas les petits matins. Avant ce coup de théâtre, le président a proposé aux membres du conseil d’y réfléchir encore, aux partisans d’affûter leurs arguments, aux opposants d’amener de nouvelles idées.
Les heures qui suivent me permettent d’entamer cette brève réflexion qui m’a été demandée sur une question dont l’intitulé même m’embarrasse : les liens de la poésie et d’internet ; mais qui devrait permettre d’y voir un peu plus clair sur ce que le numérique m’a apporté, des premiers mots dactylographiés sur une page blog de Rapidweaver aux va-et-vient du texte naissant – d’éditeur à aperçu –, jusqu’à sa publication sur internet par l’entremise d’un hébergeur et sa propulsion sur les réseaux sociaux.
RapidWeaver est un éditeur de site extrêmement simple, bon marché, dont j’ai appris le fonctionnement en quelques heures, c’était en 2008, au moment même de la naissance des marges.net. J’ai choisi l’un des thèmes les plus sobres que cet éditeur met à la disposition de ses utilisateurs : Aqualicieux ; je n’en ai pas changé. Je note au passage que si les amateurs peuvent accéder au code source, je ne m’y suis jamais risqué.
Il me serait difficile aujourd’hui de m’en passer, alors même qu’il y a certainement mieux ailleurs. Ce logiciel permet en effet, d’un seul clic, d’obtenir l’aperçu du texte dactylographié au kilomètre, tel qu’il apparaîtra lorsqu’il sera publié.
C’est dire que je peux à tout ajout, suppression ou modification sur l’éditeur, faire correspondre d’un seul clic l’aperçu du texte que chaque lecteur, et celui que je suis, aura sous les yeux.
Ces aller-retours continuels – longues stations sur l’éditeur au commencement, sur l’aperçu à la fin – sont devenus consubstantiels à mon mode d’écriture : double regard, double perspective. L’écrire n’est rien sans le lire, celui-ci conduit à un récrire aussi longtemps que l’un est l’autre ne font pas qu’un. J’écris donc lentement et peu. Disons même que je n’aurais jamais écrit sans un tel dispositif qui dédouble très concrètement deux instances que je n’aurais pas eu la force de maintenir distinctes. Les deux états du texte mis à disposition par ce logiciel me permettent de rendre presque simultanés l’écrire et le lire, de les rapprocher jusqu’à n’en faire plus qu’un.
A l’éditeur l’écriture, les mots nouveaux nés, verbes et noms issus du magma langagier et cervical, en lien avec la mémoire et nos diverses facultés mentales, coulées et noyaux durs en-deçà parfois de toute lisibilité, rebuts, signes nés dans la précipitation, éclairs cherchant leurs mises à terre, noeud tellurique, formules incantatoires.
A l’aperçu la lecture, exercice articulatoire et rythmique, physique, lèvres et mains, le dos qui pèse, l’oeil qui suit l’organisation du monde, s’assure que ça tient, s’interrompt, clique, renvoie à l’écrire parce que ça ne tient pas : recommence regroupe, déplace, supprime, modifie,...
Le lire renvoie à l’écrire, au récrire et au relire aussi longtemps que l’imprévu, en direction duquel tout tend, ne s’est pas imposé et n’a pas pris en main l’affaire. Il suffit alors de s’en approcher, d’en libérer l’accès et de corriger une dernière fois la partition.
Je suis divisé, je suis cet être double, tête et corps, qui lit et écrit pour à la fin ne faire qu’un, devant un texte dont j’aimerais croire qu’il tienne debout et qu’il puisse aller pour son compte. Je publie pour me débarrasser de ce qui ne m’appartient plus.
Reste à entamer la question de la poésie. Un autre jour. Il me faut aller chercher Lili à Sain-Martin et Arthur à Ropraz.
Jean Prod’hom
Le soleil cessera de tirer ses longues courbes

Cher Pierre,
Le vent, la neige et le froid ont à nouveau eu raison d’un vieux pommier. Le premier des trois derniers est tombé l’hiver passé. Le troisième s’accroche. Mais il faudra s’y faire, ce n’est plus un verger.

Ils auront porté leurs fruits jusqu’au dernier, ils feront même des fleurs l’an prochain; quelqu’un les tronçonnera au printemps et on les oubliera.
Surtout n’en vouloir à personne; les pommes, les poires, les cerises ne font plus vivre, les domaines familiaux se sont mécanisés aux dépens de la variété de leurs produits. Plus guère de place aujourd’hui pour les vergers, pour les plantages, les jardins, pour les allées et les haies. La professionnalisation, c’est-à-dire la division des tâches – liées à ces lieux : taille, greffe, désherbage, labour, cueillette, sarclage, arrosage,... – ont fait taire leur respiration, nos attentes, les grands vides qui les séparent. Les saisons tendent à disparaître, se fondent en un flux continu de données chiffrées qui ne rythment plus nos vies, la lune ne nous accompagnera plus, ne jouera plus à cache-cache et le soleil cessera de tirer ses longues courbes. On se prépare à tourner une page.
La chaine industrielle, en se constituant par le rassemblement du même et la mise à ban du disparate, aura eu raison de la syntaxe saisonnière. Et c’est du dehors que les archéologues de demain identifieront dans notre langue et dans nos gestes les traces de l’automne et de l’hiver, comprenant mieux que nous ne le faisions lorsque nous y croyions, comment printemps et été s’aboutaient l’un à l’autre dans une apparente facilité ; ils analyseront les facultés que les hommes avaient développées pour en déceler ce qu’ils appelaient les signes avant-coureurs. Et des poètes chanteront la succession des jours, le lever et le coucher du soleil, l’héroïsme des hommes, le dimanche, lorsque leurs tâches leur en laissaient le temps, les nuages, le jeu des saisons.
Jean Prod’hom
Que font les riches de leur argent

Cher Pierre,
Lili, Louise et Arthur sont sortis tôt ce matin, cagoulés et gantés, un bob sous le bras. Au Riau on a resserré les rangs, c’est l’économie de subsistance. Je rejoins à mes risques et périls Olivier en fin de matinée. On ne s'était pas revus depuis novembre. Il m’a envoyé une invitation pour le vernissage de l'exposition dont il a été le concepteur, aux archives cantonales. Le vernissage a eu lieu le 23 janvier, je n'y suis pas allé, je m'en veux, il ne m'en veut pas, j’irai voir.

On a parlé de nos enfants, de leurs peines et de leurs pannes, sans nous plaindre. Leur temps a rejoint si rapidement le nôtre que nous avons été obligés de songer à des aires de repos, d’où il nous est loisible de considérer le trafic. C’est ce que nous avons fait de Paudex à Lutry, une fois encore. Et nous avons souri, sans nous en réjouir, à l’idée de quitter la partie. Ces petits suicides dominicaux ne sont pas désagréables, ils nous apprennent à raccourcir nos pas.
On a évoqué quelques-uns de nos contemporains ; on s’en est amusés, on ne leur en veut pas, on ne s’en moque pas, ils ont fait leur temps. Mais certains d’entre eux sont si imbus d’eux-mêmes qu’ils ont déjà construit leur tombeau et aménagé la salle de leurs archives. Ils hurlent une fois encore pour se faire entendre, garder auprès d’eux leurs courtisans : petite frappes littéraires auxquelles s'accrochent des brochettes d’égarés sans conséquence, repoussant une mélancolie qui les ronge, à deux pas d'un désespoir qui les rattrape.
On s’est inquiétés de la fragilité du marché, du train de vie des barons de notre temps, on s’est demandé ce que font les riches de leur argent, on a cru entendre une révolte qui grondait.
Nous avons été, ce dimanche, comme des quidams du 17ème siècle prenant acte du panthéisme de Spinoza ; à la différence près que le nôtre est numérique. Avec un vent d’ouest qui creusait les reins du lac et des cygnes. Là, rien n’avait changé.
Jean Prod’hom
Lorsqu’il en va de notre vie

Cher Pierre,
Alexandre est mal fichu, on renvoie notre rendez-vous à des jours meilleurs. Mon séjour en ville n'aura donc duré qu'un matin, mais les deux heures passées en compagnie de Romain et de Geoffrey m’auront permis de me débarrasser de certaines idées, d’en concevoir d’autres, plus précisément trois, et d’imaginer quelques repères dans ce qui s’annonce tout de même assez délicat.

Car c’est de cela dont nous avons parlé, Romain, Geoffrey et moi. Avant de mettre en route, sur des bases un peu solides, sans précipitation, ce que j'appellerai désormais, faute de mieux, le chantier Terres d'écritures, du nom de cette galerie que Christine anime à Grignan depuis plusieurs années et dans laquelle elle m'a proposé d’exposer, en septembre prochain, un ensemble de tessons et une série de photographies, événement à l’occasion duquel seraient faites quelques lectures.
Nous nous sommes rencontrés à Noël, Christine et moi, dans sa belle maison de Chamaret. Nous avons convenu que les photographies présentées, si la chose se faisait, ne seraient pas celles des tessons mises en page dans le livre, mais quelques-unes de celles que j'ai faites en marge de leur collecte, en noir et blanc, et qui s'y rapportent d’une certaine manière : grèves, brise-lames, ciels, laisses, vagues, casses, rebuts, galets,... Nous nous sommes séparés avec le sourire et la conviction que la chose se ferait. Je demeure confiant même si bien des événements et des obstacles peuvent se mettre encore sur notre chemin. Quoi qu'il advienne, que cet événement ait lieu ou pas, ce que je démarre aujourd’hui aura un sens, ne serait ce que d'avoir été pensé, les photos choisies et tirées, collées. L'attention que m’ont prêtée Geoffrey et Romain m'en aura convaincu.
Cette discussion, avec le lac dans le dos, m’aura en effet encouragé d’abord, et c’est peut-être l’essentiel, à ne pas me focaliser sur la qualité technique des photographies, à ne pas me mettre dans l’obligation d’en faire de nouvelles pour annuler les défauts des premières, mais de composer avec celles qui existent, parce que elles sont justement ce qu’elles sont.
La résolution faible de certaines d’entre elles ne devrait pas me conduire à les écarter ou à les refaire avec du matériel de plus haute qualité, mais à en réduire le format ou à en accepter les limites. Je ne vais évidemment pas m'interdire d’acquérir un nouvel appareil, mais les conséquences de cet achat devraient demeurer secondaires, le nouveau venu rapidement mis au diapason.
Le second élément que Geoffrey et Romain m’ont fait voir, c'est que les 365 brimborions écrits pendant la rédaction de Tessons pourraient jouer un rôle important : eux, ou des extraits du livre – les titres pourquoi pas. Ces textes, comme les photographies que je prends quotidiennement déclinent à leur manière, mais toujours fragmentairement, les choses qui me travaillent depuis toujours et qui dépassent de beaucoup la collecte de ces pierres.
Il s’agirait donc de réunir en un même lieu, comme sur un autel, quelques-uns de ces fragments qui n’ont jamais partagé un espace commun, les rapprocher comme dans un polyptyque sans articulation apparente ; et réitérer cette opération autant de fois qu’il existe de murs pour supporter leur nombre, textes et images, en prenant garde que jamais ces regroupements n’entament l’individualité de leurs parties (ce serait prendre congé de l’idée de fragment) et ne laissent supposer qu’ils constituent une totalité close et suffisante à elle-même, un puzzle.
A cet égard, ce qu’a montré Anne-Hélène Darbellay à Vevey pourrait croiser ce qui m’attend. Elle avait su faire vivre ensemble des photographies indépendantes les unes des autres, sans que l’une subordonne l’autre à ses vues : elle avait résolument penché pour une syntaxe de la juxtaposition, interdisant toute idée d’intégration, faisant naître des idées concrètes d’avant les images, voir et entendre ce qui relie le lointain avec le proche, le coq et l'âne, Paul et Jean.
Geoffrey et Romain n’ont pas manqué de me rappeler le coût d'une telle entreprise et de ses aspects techniques : impression, support, cadre. Ils m’ont même montré les prix. Mais j'ai eu l'impression que si cette question est très souvent le nerf de la guerre lorsqu’on veut vivre de l’art, elle demeure secondaire lorsqu’il en va de notre vie.
C’est au café du Pont que je rédige ces lignes. Le patron veut encaisser 5 francs pour une verveine, je tique, il consulte sa liste de prix, ce sera 4 francs. Halte à Epalinges où j’achète deux litres de lait, la neige redouble. Je me hâte d’écrire un mail à Anne-Hélène. Réfléchis de tout cela à la cuisine; ce soir, c’est pommes, nouilles et boudin.
Jean Prod’hom
On mange un hot-dog et des merveilles

Cher Pierre,
Le feu a pris, la machine à laver est vide, la vaisselle rangée, l’évier propre, la neige déblayée, le chien sorti; j’ai discuté le coup avec Maurice, les enfants et Sandra sont partis à l’école. C’est vendredi.

Je fais la liste des courses du week-end en buvant un café, grignote quelques cacahuètes, croque une pomme. Je gratte le pare-brise de la Yaris, descends au village, fais quelques photos de la neige soufflée aux extrémités des pannes et à l’intérieur des profils des lambris, déposée sur les pachons des échelles ou accrochée au flanc de ce qu’on remise à l’arrière des bâtiments.
Je m’arrête au village pour photographier la maison aux sabots, son crépi, le vert de ses volets, le tas de paille, le râteau, le bois. Je roule au pas, les routes sont mauvaises ; je m’arrête au Petit Magaz de Mézières où j’achète des boscops, continue jusqu’à la COOP d’Oron : une mangue, deux grenades, des poires, des pommes, des bananes, des yoghourts ; des merveilles, deux pâtes feuilletées, trois baguettes, des épinards, un concombre.
La librairie du Midi est fermée, la boucherie ouverte, j’en ressors avec du boudin, quatre saucisses de Vienne et un poulet nourri au grain près de Châtel-Saint-Denis. Verveine à Châtillens où des retraités regardent un match de tennis. Détour par le Pacoton au-dessus de l’Ecorcheboeuf où je fais quelques photos des façades de deux fermes inhabitées, d’un rural et d’une annexe. Sous la neige. Les fontaines ne coulent plus.
Je me retrouve à un peu plus de 11 heures au Riau, le temps de ranger les courses, mettre la table, préparer un bircher pour ce soir. Relever mon courrier, couper en quartiers trois pommes et deux poires pour faire patienter Louise, Lili et sa camarade qui déboulent à midi. Je n’ai rien vu passer. On mange un hot-dog et des merveilles.
L’après-midi est à moi mais je suis fatigué ; pas envie de lire ni d’aller me promener. J’écris ces mots en espérant que l’un d’eux fasse office de clé. C’est finalement Sandra qui me réveillera de ma torpeur, instant trop bref. Elle se rend chez le vétérinaire avec Oscar, je descends à Morges retrouver Dominique que je n’ai pas vu depuis cinquante ans. Jette en passant un coup d’oeil à La Librairie, Tessons a fait son temps, place à d’autres.
C’est sur le parking du nouveau port qu’on se retrouve. A la seconde je ne le reconnais pas, je fais un pas en arrière comme pour me défier de cet inconnu. Mais c’est plutôt, à la réflexion, pour que nous puissions, lui comme moi, nous assurer que nous ne nous trompons pas et disposer d’assez de recul pour faire se correspondre l’image de ce ce nous avons été avec celle de ce que nous sommes devenus. Quelques secondes suffisent, ce qu’il a été réapparait sur son visage, bientôt sa démarche, ses longues foulées, sa voix, son rire.
Quelque chose n’a pas changé sans que je sois en mesure d’en dire quoi que ce soit. Il nous faudra deux belles heures au bord du lac puis autour d’une verveine pour regrouper la dispersion des années en deux ou trois moments. Avec l’impression qu’on aurait tort d’accorder trop d’importance aux cinquante ans qui nous séparent.
Et je crois comprendre, lorsqu’on se quitte sur le parking, dans la nuit et sous la neige, que notre vie se réduit à une portée sur laquelle la voix de chacun d’entre nous cherche à retrouver ce qui se répète depuis le début et à le dire avant la fin.
Jean Prod’hom
Il faut se lever tôt et se coucher tard

Cher Pierre,
Le temps s’est adouci, la neige a fondu, mais ce matin le froid a tendu un piège : les imprudents paient leur insouciance ; appuyés à la tôle de leur voiture, gants de cuir, ils téléphonent, répètent qu’ils sont détenteurs d’une casco complète. Leur suffisance en dit long. Le jour se lève, on souhaiterait au fond de soi que les dépanneurs tardent ; je les imagine assis sur le talus, frigorifiés, condamnés à réchauffer leurs mains au feu de leur agenda.

La vie, marquée par le travail et sa division, m’oblige à désobéir à ceux de mon espèce, en me détournant de leurs attentes et de mes convictions. Il faut se lever tôt et se coucher tard si on veut se défaire à temps et être au rendez-vous ; retrouver, ne serait-ce qu’un instant chaque jour, un horizon, et des nuages, et le soleil.
Je ne sais qui a mis à ma disposition cet espace, que ne mentionne aucun cadastre, d’où il m’est possible de reprendre le dessus sans prendre la main ; me réorienter dans le sens du jour sans y toucher et le laisser venir. Je lui en sais gré. C’est dans l’attente de ce court instant que je mets toutes mes forces, pour rejoindre une vacance dont il n’y a rien à tirer, sinon un motif, une mélodie une inflexion qui en rappelle le pouvoir d’illumination et d’apaisement.
Sylvie m’a envoyé ce soir trois poignées de tessons qui m’ont ravi avant de me conduire, de fil en aiguille, à une boîte de craies.
Jean Prod’hom
Le préau

Cher Pierre,
La gamine n’est pas allée à l’école, elle est restée cachée dans sa chambre ; elle se promènera tout l’après-midi dans la neige autour de chez elle. A ses parents qui lui demandent le soir, fâchés, ce qu’elle a fait, elle ne pipe mot. Elle leur confie pourtant, à la fin, qu’elle a aperçu trois chevreuils. Son père lui rappelle ses obligations ; sa mère lui sourit.

Position haute, debout derrière le cadre d’une fenêtre au deuxième étage du collège : dehors le froid, la neige et le noir du bitume, l’immobilité des enfants, les arbres et la forme du préau, les bonnets rouges, verts, les bonnets jaunes et le ciel bleu, les bâtiments qui bordent le haut de la scène, tout ça mis ensemble me rappelle un tableau qu’aurait pu réaliser un Flamand du XVIème siècle ; regard en pente descendants, plongée comparable à celle qui fait voir les paysages hivernaux qu’a peints Pieter Brueghel l'Ancien (ou l’un de ses admirateurs) : L'Adoration des mages, Le Dénombrement de Bethléem ou Le Massacre des Innocents, Les Chasseurs dans la neige ou Les patineurs et la trappe aux oiseaux.
Pourtant, c’est à une autre représentation signée du maître flamand que j’ai songé de là-haut, celle dont l’impression au format mondial orne les classes des tout petits avant qu’on ne la retire de chez les grands, au prétexte que les choses sont désormais sérieuses : Les Jeux d'enfants.
Mais dans le tableau que j’ai sous les yeux, aucun signe du monde joyeux qui agite la place d’Anvers, pas trace des corps dansants et gesticulants, des jeux d’équilibre. Mais des corps disciplinés plus tout à fait innocents, les enfants y sont rares, une vingtaine seulement contre plus de deux cents chez le Flamand.
On ne joue pas, on ne joue plus ; pas trace de cerceau, de bille ou de poupée, de dés ; pas d’échasses, pas de saute-mouton ou de culbute : bien sûr c’est l’hiver ; mais pas d’igloo non plus, de glissades, de bonhommes de neige, de pierres qui curlent ou de palets. Ici, il est interdit de jeter des boules de neige, c’était écrit mais on a corrigé, il est interdit d’en lancer. Il sera bientôt interdit de toucher à la neige.
Le préau ressemble à la cour d’un hospice sans vice ni vertu. Mais on devine derrière le calme apparent de ces statues frigorifiées – derrière les obligations qui vertèbrent leur vie – une eau qui frémit, un pays d’où tout adulte est banni, une folie printanière.
Jean Prod’hom
Ceux à qui on aura discrètement appris à désobéir

Cher Pierre,
Retirer les cendres du poêle, fendre trois morceaux de sapin de la Branche, ajouter une buchette du tilleul, un morceau de foyard de chez Francis, froisser la page des morts et frotter une allumette.

C'est mardi, Lucette et Michel viennent nourrir nos enfants. Me décide, pour leur faciliter la tâche, de peller la neige. Traverse le jardin jusqu'au hangar, les empreintes de mes bottes croisent celles de celui qui pourrait bien être un chevreuil ; elles s'arrêtent à la fontaine, je m'éloigne, il est reparti dans les bois. Même si on ne mène pas la même vie, on se croise parfois.
Je ferai le nécessaire pour que Michel et Lucette atteignent sans difficulté la main courante des escaliers, dégage l'accès à la boîte aux lettres et le compas du portail. Qu'on puisse sortir et entrer, pas plus ; et laisser opérer les charmes du recroquevillement de la maison et de ses habitants sur eux-mêmes. Laisser faire l’hiver, y toucher à peine, du bout des doigts ; le palais fondra comme neige au soleil quand les jours s'allongeront. Sans laisser de cendres.
Nos journées de servitude laissent, à ceux qui ne sauraient vivre sans, une paire d'heures en marge du courant. Mais il faut mettre la main dessus à la force du poignet, en usant du vilebrequin, en les arrachant au forceps du ventre social. Ce qu'on se garde bien de raconter à nos enfants, pas le temps, il faut les éduquer. Mais ceux à qui on aura discrètement appris à désobéir, sans heurter les gardiens de leur prison, comprendront qu'il est urgent de sortir la tête pour respirer ; ils verront alors, de là-haut, ce dont manquent ceux qui sont restés la tête en-bas.
On voudrait à la fois que chacun obéisse et désobéisse, se satisfasse des sentiers battus et réponde aux promesses des friches ; on voudrait simultanément que chacun accepte les circonstances de sa naissance et s’en arrache : c’est le jeu.
Ce soir, le ciel s'enflamme à l'ouest, le soleil est sur le point de recommencer son tour ; je m'étonne que personne ne s'en soit encore plaint, c’est le signe que tout est encore possible.
Jean Prod’hom
Des gamins qui lèvent la main pour en être

Cher Pierre,
La neige et le froid auraient eu raison de moi si Arthur ne m’avait donné un coup de main pour sortir la Yaris du chemin des ruches. Il y avait du verglas ce matin. J’ai roulé prudemment jusqu’au Mont, traînant derrière moi un cortège de plusieurs dizaines de véhicules qui ont eu la sagesse de ne pas me dépasser. J’ai vu juste, nous avons en effet rejoint, puis dépassé un peu avant la bifurcation du Chalet-des-Enfants, deux imprudents dans le fossé, ils attendaient des renforts.

Nous vivons au Mont la semaine des conseils de classe, à l’occasion desquels je constate, chaque année davantage, que l’administration scolaire a progressé dans son effort de gestion et de centralisation, avec ses effets collatéraux.
Les obstacles qu’elle a placés sur notre chemin, un peu à son insu, pour baliser et assurer son contrôle, m'auront fait grogner une bonne partie de la matinée, en me laissant l’impression que chacun d'entre nous collabore désormais au verrouillage de nos généreuses entreprises, participe d’un formalisme frileux, prend des précautions excessives générées par la peur ; on se méfie, avec derrière nous les priorités que les notables évoquent dans les dîners mais auxquelles on ne croit plus guère : elles sont devenues secondaires.
Nos élèves ont pris le sillage et nous avons intégré, les uns et les autres, l’idée qu’il est impossible de revenir en arrière ou d’infléchir les trajectoires, interdit de prendre un peu de temps, de nous tromper ou de nous égarer. C'est bien à une voix venue de nulle part que nous obéissons, sourde à ce qui est en jeu, prête à nous laisser en paix pour autant qu’on respecte les procédures, les délais, les habitudes. L’esprit a quitté la partie ; il se réfugie, j’ose l’espérer, dans les préaux.
Un ami m’a montré hier une photographie sur laquelle on pouvait apercevoir des notables de l’Etat islamiste, très affairés, souriants, occupés à soulever à Racca une armée de petits soldats. Des gamins de 10 ou 12 ans, enthousiastes, qui lèvent tous la main pour en être. Je me suis dit aujourd’hui que si les nôtres maintiennent la leur baissée, il ne faut pas nous en plaindre mais nous en réjouir. Nos gamins résistent.
Pour autant qu’ils soient amenés, de l’autre côté, loin des mirages relationnels, à creuser une galerie dont on ne voit rien en surface, leur chemin de taupe, et dont ils ressortiront plus tard éblouis. La pédagogie n’a pas pour tâche de réunir les collectifs autour de réponses communes, mais à faire en sorte que chacun s’essaie à un questionnement sans réponse immédiate.
Tout faire donc pour qu’en certaines circonstances – elles sont nombreuses – personne ne lève la main.
Jean Prod’hom
Le bleu, le rouge le vert des ruches

Pour Dli Dli

Cher Pierre,
On a ouvert les yeux, ce matin, avec la sonnerie d’un réveil, le bruit d’une douche, celui d’une hache, le claquement d’une porte ; c’était Arthur, il a fait du feu dans le poêle avant de partir skier avec Johann et sa mère ; on s’est levés plus tard, alors que le ciel était déjà haut et bleu ; Sandra et les filles sont allées chez Marinette soigner l’âne et le poney, comme chaque dimanche, avec Oscar ; c’était préférable si je voulais avoir une chance de croiser des chevreuils.
Avant même de m’enfoncer dans les bois, au bas de la Mussilly, deux jeunes ont franchi d’un bond le sentier de traverse ; ils ressemblaient à ceux d’hier, êtres singuliers qui ne se confondent à nul autre, mais aussi représentants d’une espèce, peuplement ; assez familiers pour que je sois en mesure de concevoir leur individualité, pas assez pour que je les tutoie. Les chevreuils se dissimulent derrière leur ressemblance pour mieux se cacher, garder leur secret, leur mystère, et ainsi nous ramener aux nôtres ; il y a de l’autre du côté des bêtes.
Personne ne connaît le nombre des chevreuils, personne ne veut d’ailleurs le savoir ; je ne sais si le couple qui s’est enfui à l’instant et que je croiserai peut-être demain, après un long détour, est celui que j’ai aperçu hier. Les innombrables traces sur la neige déroutent les avenues de la raison et rendent vaines toute prédiction.
Au-delà de la route du refuge de Ropraz, j’ai bataillé ferme pour rejoindre le chemin aux copeaux, en brassant la neige jusqu’au genou. Un troisième chevreuil, ou était-ce l’un de ceux que je venais de voir, s’est extrait d’un bosquet pour disparaître derrière les troncs noirs des sapins.
Les bêtes n’hésitent pas à emprunter les tracés de l’homme, ils facilitent leur déplacement mais les bêtes n’en abusent pas ; les traces font soudain une courbe, reviennent sur leurs pas et disparaissent dans les ronciers, deux ou trois sauts, où l’homme n’ira pas.

J’aperçois un quatrième chevreuil qui traverse le chemin du refuge de Corcelles, tandis que la bise fait tomber de la cime des sapins une averse de flocons qui noient les boulevards et les sentes des bêtes, les ouvertures qui se referment derrière leur passage, les sentiers qui bifurquent ou disparaissent dans la rivière, delta dans une clairière.
Les traces laissées par les hommes et les bêtes ne durent pas ; au poète de saisir dans le creux de ses mains cette absence qui se confond à notre présent ; au poème d’en creuser l’empreinte dans le tout venant de nos jours. Quelques taches de couleur, le bleu, le rouge, le vert des ruches dans le noir, le blanc de nos hivers.
Le soleil a chauffé la véranda, Sandra travaille, je lis une centaine de pages du récit qu’a écrit la maman d’un élève. Il est temps de me remettre au fourneau, Arthur est rentré des Rochers-de-Naye, les filles ont faim.
Jean Prod’hom
C’est le secret des bêtes

Cher Pierre,
On a croisé ce matin un couple de chevreuils. Oscar a tiré sur sa laisse, les chevreuils se sont enfilés dans les bois. J’ai dit que la non-pensée ne contaminait pas la pensée, Oscar n’a pas compris.

Nous n’avons au fond guère le choix : tourner la tête par-dessus notre épaule, du côté de ce qui n’a que partiellement été ; ou nous projeter au-delà des montagnes, du côté de ce qui ne sera peut-être pas. Impossible d’être à notre place, nous n’en sortirions pas. C’est le secret des bêtes – chevreuils, renards, moineaux –, c’est le secret qu’elle emportent lorsqu’elles nous tournent le dos. Alors ?
Alors peut-être, en usant de ce que mettent à notre disposition notre mémoire et nos prévisions, ramener l’effroi et la confiance qui animent les bêtes ; en usant de tout : nos mains, les jeux de hasard, l’égarement, la foi et l’espérance, l’amour, le mensonge, l’ignorance, le travail, tout.
Voilà ce que je me suis dit ce matin, et puis cet après-midi, après avoir entendu les gesticulations d’un enseignant sourd et envieux, m’être endormi à Lausanne devant un film qui n’aurait jamais dû voir le jour, après avoir croisé des amis qui s’épuisaient à ménager la chèvre et le chou.
Pour me réconcilier avec les bêtes et les hommes, j’ai préparé ce soir des oeufs au plat et des épinards à la crème, coupé quelques quartiers de pomme et taillé des allumettes de gruyère, roulé des feuilles de lard fumé, mélangé des oeillets de bananes avec des arilles de grenade et de la chair de kiwi arrosés de jus de citron.
A la Mussilly, la neige a recouvert les traces des chevreuils. Demain on reprend là où on a laissé. Mais où ?
Jean Prod’hom
Bienfaits des modèles de financement participatif

Cher Pierre,
La parution de Tessons et la recherche de soutiens pour financer l’édition des Marges m’auront permis de retrouver un très ancien camarade. Nous nous sommes rencontrés la première fois au printemps 1965, à l’Elysée, nous entrions au collège. Nous avons passé deux années dans la classe de Madame Hürlimann et de Monsieur Cordey.

Dominique avait une tignasse d’enfer, trois fossettes – joues et menton –, des yeux de Chinois et un sourire canaille. Il avait surtout l’insigne honneur d’être un proche de Tab, l’incontestable figure du collège, grand Meaulnes arrivé de nulle part et qui m’a fait rêver. Je n’ai jamais vraiment été accepté dans son cercle ; je me rappelle pourtant être allé une fois, avec Dominique, rejoindre Tab, un jour de printemps ou d’été, ce devait être midi ou après l’école, dans le jardin situé derrière l’église de la Croix d’Ouchy. Tab portait une lourde serviette de cuir clair de laquelle il avait extrait deux ou trois revues en papier glacé contenant les corps de femmes nues, ou presque nues. Je me souviens de la décharge que ces corps avaient provoquée en moi et des forces qu’il m’avait fallu puiser pour faire bonne figure devant ces deux gaillards qui semblaient considérer ces corps glorieux comme de vieux professionnels.
On raconta plus tard, lorsque Tab nous eut quittés, qu’il s’était fait expulser du collège le jour où le rabat de sa serviette avait cédé devant le bureau du directeur. J’ai toujours pensé qu’il était parti en emportant un secret, mais aussi parce qu’il avait trouvé mieux ailleurs.
Une année plus tard, Dominique a choisi une filière scientifique tandis que je rejoignais le groupe des latinistes. Nos chemins se sont séparés pour toujours, c’est ainsi, le croyait-on.
Mais on vient de se retrouver. Il m’a reconnu, écrit-il, au sourire que j’esquissais sur la photo d’un quotidien lausannois. Pour le reste, il m’avoue avoir, lui aussi, pris un coup de vieux. Il m’a envoyé, il y a une semaine, des gentils mots à propos de Tessons. Et puis il y a deux jours, un mot encore dans lequel il m’apprend qu’il va soutenir l’édition des Marges.
C’est à cela que servent aussi les livres. Et les réticences que j’éprouvais hier à l’égard de ces modèles de financement participatif en plein éclosion, s’atténuent. Ces modèles sont peut-être, écrit François Bon, l’occasion de recomposer nos relations parce que les modèles industriels ne sont plus en état d'accomplir leur tâche – l'édition y compris. Ces alternatives sont devenues nécessaires, au nom même de notre indépendance ou notre résistance.
Je me réjouis de rencontrer Dominique.
Jean Prod’hom
J’ulule une dernière fois dans la nuit

Cher Pierre,
Le fallait-il, je n’en sais rien ; mais j’y suis engagé et j’irai jusqu’au bout. Avec le sentiment d’agir comme un marchand de soupe, de racoler, en proposant à des gens qui n’ont rien demandé, de participer à quelque chose d’inachevé, qui semble induire que ce projet ne pourrait ne jamais aboutir s’ils n’y répondaient favorablement. C’est faux.

J’ai pensé ce matin qu’il aurait mieux fallu que je me rende, pendant les vacances, à la rizière ou à la plonge, pour m’éviter une situation dans laquelle je suis mal à l’aise. Drôle d’impression, celle de devoir m’excuser auprès de ceux que je connais et que j’aime, mais aussi auprès de ceux qui ont manifesté de l’intérêt pour ce que j’écris ; de devoir m’excuser parce que je publie un livre ; de les déranger, eux qui n’avaient rien demandé ; d’user de procédés qui relèvent, quoi qu’on en dise, de l’art de la persuasion.
Le financement proposé par l’éditeur implique le lecteur d’une manière étrange, il conviendrait de l’analyser, je m’en sens incapable ; tout juste bon à signaler la chicane qu’abritent de tels procédés : personne ne sait plus où est l’offre, où est la demande, à tel point que l’on pourrait être amené à penser qu’écrire un livre est un honneur, et qu’il serait en définitive plus juste que l’auteur paye son lecteur pour le dédommager de sa générosité. Toute l’industrie du livre pousse celui qui écrit à capituler, à écrire sans s’occuper des livres.
Il n’empêche que tous ces jours, j’ai eu le sentiment de ne pas être en mesure de répondre à la confiance que l’éditeur a placée en moi, incapable de lui amener d’un coup tous les soutiens qu’il mérite.
Je suis tout neuf mais assez vieux et sage pour ne pas vouloir vivre de l’écriture ; je commence à y voir un peu clair, assez pour rester libre. La publication de Tessons et bientôt des Marges m’auront amené à faire quelques pas dans le champ littéraire. Ces deux livres auront joué en effet le rôle d’analyseurs, au sens où l’entendaient Oury et Guattary, des événements qui m’auront permis d’évaluer comment le monde cristallisé du livre répond à de telles apparitions, et par là révèle son organisation, ses habitudes, ses partis-pris ; ses hiérarchies ; ses peurs, ses défenses; ses aveuglements, ses ombres : bref ses contradictions.
Plus vite ce sera fini, mieux ça vaudra. Alors je racole, j’ulule une dernière fois dans la nuit, en murmurant à l’oreille de ceux qui hésitent : abrégez mon calvaire, soutenez et que l’on n’en parle plus.
Jean Prod’hom
Arrêts du mercredi après-midi

Cher Pierre,
Du mouvement il n'y en a presque pas derrière les baies vitrées : les fumées avalées sitôt échappées du conduit des cheminées, trois drapeaux qui sèchent ; passent entre deux villas un bus et sa remorque, un scooter, plus haut dans le ciel une corneille en coup de vent.
Au premier étage du Mottier quelques soupirs, l'aiguille des secondes, une main qui se soulève, le froissement d'une feuille ; par la porte entrouverte le bruit tranchant d’un massicot, le ronflement d’une machine à café, un concierge qui chantonne. On se regarde en souriant, aucun d’entre nous n’a choisi d’être là.

Huit élèves ont été convoqués aujourd’hui, 13 ou 14 ans, pour des devoirs non faits, des violences, des oublis, des impolitesses, des indisciplines, pour une boule de neige.
Ils sont là, dit-on, pour remettre les compteurs à zéro ; mais je soupçonne, à les voir souriants et dociles, qu’ils sont là pour goûter au calme de ces mercredis après-midi d’hiver. Certains rêvassent, le collège est vide ; d’autres se lancent à corps perdu dans le travail qui leur a été imposé.
Les traits détendus, ils n’ont plus besoin de répondre de leur rang, des actes héroïques ou désespérés qui les ont conduits jusqu’ici. La désobéissance est derrière eux, plus besoin de faire la preuve de quoi que ce soit, réjouis seulement qu'on leur foute la paix. Certains ont à rester trois quarts-d’heure, d'autres une heure et demie.
La qualité de ce moment me pousse à demander à ceux qui en ont terminé, s'ils veulent rester une période supplémentaire, arguant qu'il fait bon être ainsi ensemble, chacun pour soi, à sa tâche, sans que personne ne vienne nous déranger. Ma proposition les fait sourire, pensez donc, l'un d'eux a 36 heures d’arrêt en suspens. On se salue.
Les deux élèves qui n’ont pas fini de purger leur peine reprennent leur tâche. Mais l’un d'eux s'endort, il en est à son vingtième devoir non fait, je ne le réveillerai pas. L'autre bute sur le poème que l’institution lui a commandé de rédiger : un poème sur la vie. Il me demande de l’aider, c’est quoi les rimes, à quoi ça sert, on discute. Nous sommes bientôt interrompus par le retour d’un de ceux qui viennent de nous quitter, il voudrait rester avec nous, et faire ses devoirs d'anglais.
L’après-midi se termine comme elle a commencé, sans bruit, avec à la fin un poème que l’auteur me fait lire.
La vie n'est pas toujours facile
Il y a parfois des choses difficiles
Des malheureux qui n'ont plus de famille
Plus de fils ni de fille
Comme en Syrie
Il a accepté que je le publie ici ; ces gamins qui n’aiment pas l’école sont décidément tout à fait fréquentables, ils méritent mieux. D’un peu d’attention, et peut-être, d’un lieu où on leur foutrait la paix.
Jean Prod’hom
Célestin Freinet veillait sur nous

Cher Pierre,
La neige est tombée cette nuit sans compter ; mais Pierrot a passé la lame bien avant que les habitants du quartier ne s’en rendent compte, si bien que nous avons tous pu nous rendre à notre travail. J’ai rêvé toutefois, un bref instant, comme un enfant, que la neige et son allié le vent avaient formé des congères si imposantes qu’elles nous avaient, Sandra, les enfants et moi, empêchés de quitter la maison. Nous avions dû évidemment avertir les autorités scolaires de ce contretemps, feignant que c’était à contre coeur, tout heureux en réalité de rester près du poêle, à jouer, lire, Louise à la guitare, Lili au piano.

C’est en cherchant la route dans le brouillard, entre le Riau et la Marjolatte, que le souvenir d’un livre m’est revenu, titre et auteur m’échappent ; un livre lu au temps où le débat pédagogique avait sa place à l’école ; Célestin Freinet et la pédagogie institutionnelle veillaient sur nous et nous invitaient à concevoir une école vivante et efficace.
C’est à cet homme – dont je possède une photographie – et à ce livre que je songe ce soir, en relisant les trois courts paragraphes que j’avais écrits alors pour résumer sa vie, sur un carnet de moleskine noire, et qui disent mieux que je ne saurais le faire aujourd’hui ce que j’aurais voulu dire du métier que j’exerce depuis plus de 25 ans.
L’auteur raconte en substance que, au début de sa carrière, il ne quittait pas des yeux l’objet qu’il avait à faire passer de l’autre côté, du côté de ses élèves. Mais il avait beau s’agiter, parler, imaginer des dispositifs, exemplifier, schématiser, rien n’y faisait, l’objet ne transitait pas, il ne parvenait pas à s’en défaire, l’objet demeurait en carafe dans ses mains, loin de ses destinataires.
Le maître d’école prend conscience, beaucoup plus tard, que le langage est, en ce domaine, de trop, la simplification un obstacle, les explications un voile. Il se donne désormais pour unique tâche, celle de trouver où poser l’objet, à bonne distance de l’élève, de s’éloigner et de les laisser à leur mystère.
Le maître passera le reste de sa vie à se débarrasser de ce qui faisait de lui une singularité, deviendra à la fin assez vide pour recueillir les eaux de pluie et le jeu des ombres, si lisse que les rugosités ne s’attarderont plus sur son front, si transparent que les attaques seront sans effet. Lointain comme sur une photographie, détenteur de la confiance qui manquait à l’enfant, débordant de tranquillité, déporté dans les nuages.
Jean Prod’hom
Mais on croyait au progrès et à l’avenir de l’espèce

Cher Pierre,
Ce que j’ai envie de dire aujourd’hui vient de la seconde moitié du XXème siècle, j’en viens. On y racontait la réalité en usant d’une langue gros grain et d’outils rustiques, masse et coin ; nous étions les héritiers des Lumières et notre crainte était philosophique.

On craignait que les égoïsmes nourris par le libéralisme ne conduisent à la marchandisation du lien social, à sa fragilisation, à sa rupture même. On abhorrait l’idée que chacun puisse se retirer dans son coin et fabriquer un futur à ses dimensions. On combattait l’égoïsme qui donne le ton non pas seulement à la vie économique mais à tous les aspects de la vie personnelle. On était confiant, la conviction philosophique que la ruse de la raison transformerait les dégâts provoqués par l’aveuglement des individus en plus-value du collectif nous donnait de l’assurance.
On voyait pourtant que l’égalitarisme formel ou nominal, la description conventionnelle des faits et la normalisation des énoncés – sans lesquelles la mainmise du juridique ne pouvait s’exercer –, la lenteur des décisions administratives, le règne sourcilleux du détail et la preuve qui reste par définition toujours à faire étaient en train de creuse une fosse dont on ne voulait pas : mais on croyait au progrès et à l’avenir de l’espèce.
Aujourd’hui cette fosse est à nos pieds, on l’a faite nôtre, elle est comme une promesse dont on veut espérer qu’elle demeurera vide. Nous nous sommes mis à prier.
Voilà ce que je me suis dit cette après-midi sur le chemin de l’école.
Jean Prod’hom
Les montagnes ont elles aussi plusieurs vies

Cher Pierre,
Ce matin, le soleil ramène l’autre hiver, l’hiver dans ce qu'il a de plus paisible et de plus doux : bruits du dedans, ciel bleu, tapis épais. Ça n’empêche pas que les conversations de la veille ont repris à la salle à manger : celles des hommes tournent autour de l'agent et des voitures ; celles des femmes autour des enfants et de la nourriture. Parfois elles se croisent, souffle alors un petit air de liberté, sans filet.

Sandra ne le reconnait pas, moi non plus mais je le sais, il s’agit bel et bien du Moléson, celui qu’on aperçoit du Riau chaque matin et qui organise notre orient. Aujourd’hui, de Charmey, on se dit qu'il devrait porter un autre nom ; Moléson a le dos rond et ne convient pas à cette face ravinée, à ces pentes abruptes et tourmentées ; Pleureur lui conviendrait mieux de ce côté-ci, avec sa crête de gallinacée et ses coulées d'ombres.
Le Moléson? Non! on n’y croit tellement pas qu’on est amené à se dire que les montagnes ont elles aussi plusieurs vies, qu’elles ne sont une qu’administrativement, qu'elles appartiennent en réalité à différents espaces dans lesquels non seulement elles mènent des vies très différentes mais encore organisent sur des modes variés celle des autres.
On décide de faire un saut, avant de redescendre, au cimetière de Jaun, sur la route de Boltingen ; les morts habitent ici un village. Chacun d’eux a en effet droit à un petit chalet en bois, un toit à deux pans soutenu par une croix qu’occupe, comme il se doit, le crucifié. Sur l’arrière, de chaque côté, un panneau fait voir un ou deux aspects de la vie du mort : son portrait ou l’un des ses attributs, son métier, sa passion, le décor de sa vie, des fleurs.

De grands nappes viennent se fixer au flanc des montagnes lorsqu’on redescend sur Châtel-Saint-Denis, elles colonisent discrètement le bleu qui les sépare. Tout s'embue bientôt, on ne verra pas le soleil se coucher.
On reprend Oscar à Tatroz, les enfants à Corsier. Demain c'est pour tous retour à la mine, sauf Lili qui monte aux Crosets pour une semaine de ski.
Jean Prod’hom


















La tragédie n’a plus le pouvoir de nous réunir

Cher Pierre,
On est arrivé à Charmey hier soir autour de 21 heures, après avoir déposé les enfants à Vevey. Première fois que nous empruntions la route de contournement de Bulle ; elle nous a jetés d'un coup au sud de la Tour-de-Trême avec, sous les projecteurs, le château de Gruyère et celui de Montsalvens – le second plus discret, plus secret. On a discuté un peu d'école, de nos arrangements respectifs avec l'institution, des années qui viennent. Sandra parle de son livre, moi du mien. La route est dangereuse, recouverte d'un mélange de pluie et de neige. L'hôtel Cailler a pris un sacré coup de vieux, mais la salle à manger est tout de même bondée ; des habitués, quelques touristes de passage et des gens de la vallée sont venus profiter du buffet fraîcheur : huîtres, meringues, charcuterie, crème glacée, fromage, pâtisseries : le tout à volonté. On mangera plus modeste, un seul café, nos paupières se ferment.

J'entends sonner 6 heures à l'église paroissiale ; puis le préposé au ramassage des poubelles fera entendre en les heurtant, les toupins d’une improbable désalpe. Plus rien ensuite, sinon le froissement des draps et une chasse d'eau. Le jour frissonne, on traîne, la neige tombe derrière les rideaux.
On retrouve dans la salle à manger certains des commensaux de la veille, ils ont repris là où ils les on laissés les excès de la veille, assis à la même table. On rejoint la nôtre c’est un nouveau jour. La neige n'a pas cessé de tomber et fait comme un écran aux souvenirs.
Lorsque l'hôtel a été inauguré en 1981, et dans les année qui ont suivi, je suis passé plus d'une fois à pied dans ces pâturages à gruyère. Sur le chemin de Château-d’Oex par le chalet du Régiment, ou dans la vallée du Javroz, de Cerniaz à la Valsainte, du lac à la cime de la Berra ; chasseur cueilleur autour du Lac Noir et à Plaffaion, le long de la Jogne, au fond des Motélons, sur la Dent de Brenleire par le lac de Tissiniva.
Pas sûr que je refasse ces traversées de plusieurs jours, la famille et le travail m'ont sédentarisé. Pas exclu cependant, à moindre échelle, que je m’autorise dans quelques années de telles escapades, en plus modeste.
Un tunnel permet de rejoindre directement les bassins du centre thermal en peignoir et en tongs, avec un linge sur l’épaule, c'est pas ce que je préfère. Mais goger dans de l'eau chaude sans faire autre chose que goger dans de l'eau chaude n'est pas désagréable, quoique j'en sorte courbaturé ; la balade au village sous la neige ne me remettra pas debout.
Deux heures donc, couché devant le téléviseur de l'hôtel, à me réjouir du sourire et du fairplay des joueurs de midi et de minuit, à suivre dans un demi-sommeil les aventures réconfortantes des héros en séries, dont les voix recouvrent un bref instant notre désarroi et jettent un voile sur une réalité désemparée.
Pas de honte à consacrer tout ce temps aux images que nos élites disqualifient, à ces dorures, ces devinettes et ces chansons qui peinent à faire barrage à la violence et à la corruption. Les représentations qui nous gardaient des excès individuels semblent nous avoir lâchés et chacun rêve de refaire pour soi et pour les autres les nœuds qui manquent, en usant de la violence, juste une dernière fois pour le bien de tous.
Renoncer à la violence sans mièvrerie ni naïveté, c’est le plus dur. Et ne rien attendre, la tragédie n’a plus le pouvoir de nous réunir.
Jean Prod’hom
Il y a un peu plus de 15 ans

Cher Pierre,
Panne de chauffage ce matin ; je parviens à atteindre le service de dépannage à 6 heures, un réparateur sera là à 9. En attendant je bourre la gueule du poêle. Oscar n’a pas la mine des grands jours, fronce la truffe sur le perron, content mais bien peu décidé à aller au-delà. Il fait demi-tour, saute sur le fauteuil près du feu, se met en boule avec un gros soupir. Il fera le mort jusqu’au retour des filles à midi.

Le dépanneur habite Ballaigues, de piquet toute la nuit depuis sept jours. Il se réjouit du week-end et de la balade qu’il va faire à vélo du côté de Provence. Je lui fais un café, il m’offre un des deux croissants qu’il a achetés ce matin, j’ouvre un paquet de biscuits. Il a bientôt cinquante ans et les semaines de travail de nuit commencent à lui peser, mais il préfère cette activité à l’usine ; il ne reviendrait pour rien au monde en arrière : l’indépendance et le contact avec les gens lui manqueraient.
Descends de la bibliothèque lorsque j’entends les filles ; elles parlent de tout, de rien, balancent leurs chaussures dans le hall, balancent leur veste dans le vestibule, me regardent à peine, feuillètent le journal, frottent les oreilles d’Oscar. Une demi-heure de pause pour manger des pommes Duchesse et des délices au fromage, respirer, boire un verre d’eau, parler de leur matinée, se laver les dents, c’est peu ; je les accompagne à pied jusqu’au tilleul.
Une heure me suffira cet après-midi pour venir à bout de la paperasse liée à la course de trial du 3 mai : annonce en ligne sur le portail cantonal des manifestations, contact avec le commandant des pompiers de la région d’Oron et avec l’association cantonale des samaritains de Mézières. Une autre pour mener Oscar au chenil de Tatroz et rentrer par Oron où je bois une verveine. Nous restera alors à conduire Lili, Louise et Arthur chez leur tante pour que nous disposions, Sandra et moi, du second week-end prolongé depuis qu’Arthur est né, il y a un peu plus de 15 ans.
Jean Prod’hom
Chose belle

Cher Pierre,
Sortie d’une grosse 4x4 stationnée de travers devant la BP, une femme d’un certain âge, bien mise, se plaint ; une heure qu’elle roule, de la gare à Epalinges, d’Echallens à Cugy : rien. Le Mont maintenant, néant ! six kiosques et aucun Charlie Hebdo, on se fout d’elle, c’est un vrai scandale. Je me hâte de payer mon dû et lui tourne le dos.

Charlie a-t-il eu des effets sur le comportement de mes concitoyens ? j’en aurai bientôt le coeur net.
En descendant au Mont ce matin, une grosse cylindrée est sur le point de me griller la priorité ; je freine en klaxonnant, la conductrice stoppe son véhicule en me faisant signe de passer, sans me regarder, avec un sourire de façade qui sous-entend qu’il suffisait que je m’arrête, que sa vie est au fond plus importante que la mienne. Je dois avouer que j’ai été incapable de lui rendre son sourire si bien que je l’ai gardé pour une autre occasion.
Celle-ci se présente au bout de Sainte-Catherine ; de nombreuses voitures venant de Peney et de Froideville piétinent au carrefour et n’en finissent pas de céder le passage. Je décide alors de freiner et de le leur céder à mon tour, avec sur les lèvres le sourire que j’ai mis de côté tout à l’heure ; je fonde tous mes espoirs sur le fait que la conductrice va l’accepter dans un premier temps, m’en rendre ensuite la moitié et garder l’autre pour plus tard ; c’est une variante de l’effet Charlie.
Je dois vite déchanter lorsque le conducteur d’une camionnette de produits surgelés, qui me talonne, lance dans le rétroviseur les feux d’une terreur qui m’aveugle. Mon rêve s’obscurcit. La bienveillance qui m’habitait cède la place à une sourde malveillance, je lui souhaite les pires maux.
J’écoute la leçon, le bien et le mal hantent les mêmes quartiers et ont une frontière commune, assez importante je le crains.
Le semestre se termine pour les grands du Mont qui s’inquiètent de leurs prochains examens et de l’avenir qui en dépendrait ; les naïfs passent gaiement des imprécations à la calculette, de l’autel à la petite cuisine. Impossible de changer quoi que ce soit à cette situation sans toucher au fond de l’affaire, sans ouvrir les yeux et calculer l’efficacité réelle du temps passé aujourd’hui sur les bancs d’école. A moins que l’ensemble du dispositif cède, ce qui est plus probable, et que la formation se replonge dans les eaux vives.
Chose belle :
Un enfant qui, doutant de ses capacités, descend dans un puits de difficultés dont il sait qu’il ne viendra pas à bout.
Lecture du journal à la Châtaigne, où surgit une lézarde dans l’édifice de mon imaginaire ; une image se met à vaciller, celle de Burtigny, un village qui campait solidement au milieu de mes représentations du canton – avec Pampigny au-dessus de Cossonay – un bourg imprenable, un nom promis à l’éternité. Village rugueux à deux pas des lotissements du bord du lac, riches et défaits ; nom solide aux fenêtres rares et au vieux crépi, avec ses rues et ses fontaines, sa campagne nue, ses fermes et ses coqs, son église et son bétail, ses chats, ses fins d’après-midi, son café, sa cochonnaille et son abbaye.
J’apprends aujourd’hui que Burtigny va mal, ses habitants promis au pain sec : les employés communaux vont voir leur temps de travail diminuer, les impôts augmenter ; les politiques ont accepté de travailler plus et de recevoir moins.
L’histoire de Burtigny est emblématique de ce qui se passe dans nos campagnes ; les villages qui ont voulu retenir leur âme en résistant à l'arrivée massive de citadins riches et sans enfants sont obligés aujourd'hui, pour compenser le report des charges du canton sur les communes, d'ouvrir les bras aux contribuables sans enfants ; aujourd’hui cette commune de moins de 400 habitants a trop de gamins et pas assez de gens aisés. T’as beau faire, ce que tu croyais pouvoir tenir éloigné te rattrape, la mise en charpies de l'ancien tissu rural est inexorable, Burtigny va rejoindre les grandes quincailleries de pavillons et de villas, les tuyas remplaceront les haies vives, les trottoirs les talus, les potins le chant du coq. Et on fera des misères aux enfants qui viennent de loin.
Au Riau, quelque chose demeure indépendant du temps qui fuit sur le dos des nuages, quelque chose qui se balance dans les branches des arbres nus, quelque chose qui refuse d’aller de l’avant, à l’image du château des Jaunins qui respire à peine, immobile.
Jean Prod’hom
J'ai reçu la postface de François

Cher Pierre,
Lorsque ce matin, dans la nuit, au croisement des routes des Paysans et de Berne, chacune des voitures a cédé à son tour la priorité à celle qui se présentait, à gauche puis à droite, j’ai pensé un instant que c’était Charlie qui était à l’origine de cet arrangement souriant des volontés individuelles. Si le miracle avait duré, je l’aurais baptisé effet Charlie.
Je déchante dans les heures qui suivent et retrouve la vieille évidence : les bonnes résolutions nées dans le désarroi ne tiennent pas leurs promesses ; elles naissent et ne peuvent tenir la longueur que si elles marcottent avant les tragédies.

Aucun brimborion aujourd’hui, la portée de mon engagement du 13 janvier 2014 est à son terme : il s’agissait alors d’assurer la survie de ce blogue pendant la rédaction de Tessons, trois lignes quotidiennes pour le maintenir vivant. J’avais pensé naïvement que l’entreprise serait aisée et me laisserait ainsi un peu de temps. C’était sans compter ce que cet exercice allait me faire voir ; j’y reviendrai, mais autrement, en les laissant s’imposer, sans ruser comme j’ai été amené à le faire parfois en allumant des petits feux dans les coulisses de mes jours. Quant aux 365 brimborions existants, je les laisse reposer.
Retour aux anciennes habitudes, au jour qui se lève et au crépuscule, aux alentours, mais goûter aussi à mes dernières années d’enseignement en prenant garde de ne pas m’épuiser. Il ne me reste en effet que deux ans et demi au service de l’Etat ; je laisserai alors la tâche à laquelle je me suis consacré, j’aurai à participer plus simplement à la loi des échanges et disposerai d’un peu plus de temps pour le reste.
Et puis il y a, dans ces prochains jours cet autre livre, tôt annoncé – trop peut- – commencé bien avant Tessons, mais sans vrai commencement ; cet autre livre est presque prêt, les photos sont choisies, j’ai reçu il y a quelques jours la postface de François Bon – belle, très belle ! Claude l’a placée à la fin des 160 pages de ce recueil de textes et de photographies, il prépare l’édition. C’est donc le moment ; il m’a annoncé que sa maison a reçu, il y a peu, une jolie somme d’argent de la ville de Lausanne et de la coopérative Migros, mais il souhaiterait un peu plus encore pour ne pas prendre le risque de mettre sur la paille ses collaborateurs. On peut le comprendre, mais les gens le comprendront-ils ? Il s’agit en définitive, si j’ai bien compris, d’une espèce de souscription, à options. A suivre.
J’ai fait aujourd’hui le nécessaire pour abattre le gros du boulot de la semaine. Il me reste à rédiger ce soir le procès-verbal de la séance du comité pour l’organisation de la course de trial du 3 mai. On annonce le froid pour les jours prochains, l’hiver, la neige. Et ce fléau qu’est la bise.
Jean Prod’hom
Tirer du jour

Tirer du jour
quelque chose
à quoi l’accrocher
un épi
une gerbe
un baiser
une fleur
un dessin
Jean Prod’hom
Il est urgent de réinjecter de l’autre

Il est urgent de réinjecter de l’autre
mais l’autre – pour rester autre –
doit rester ailleurs
Jean Prod’hom
Laisser aux mains de nos enfants

Laisser aux mains de nos enfants
du temps à perdre
et le temps de s’égarer
des friches
des casse-tête
des minutes creuses
les petites rivières
des chansonnettes
et la pâte à mots
avant qu’ils n’étouffent
et ne nourrissent la croissance
la croissance des hommes dangereux
Jean Prod’hom
Suis né dans le ventre d’une langue

Concerto pour piano et orchestre No. 5 in F mineur, BWV 1056: II. Largo
Johann Sebastian Bach
Columbia Symphony
Glenn Gould

Suis né dans le ventre d’une langue. Ne me souviens de rien, ni de l’instant ni du passage de celui de ma mère à ce ventre-là, rien. Je regarde par la fenêtre de la bibliothèque défiler le paysage, ce à côté de quoi j’ai passé en coup de vent ce matin-là.
Dans ce ventre-là, quelqu’un a crié la petite enfance, bégayé l’adolescence, parlé, parlé. Parlé avant qu’une voix venue de je ne sais où, l’oblige à se taire. Je suis allé visiter alors les recoins des langues mortes qui sont comme des portes entrouvertes sur nos négligences, je lève la tête aujourd’hui et regarde par la fenêtre le vieux verger qui jamais ne m’a fait faux bond.

Ne suis jamais parvenu à m’installer dans une autre langue, me suis attardé dans la mienne, pour ne pas la trahir peut-être, ou ne pas l’oublier. Je suis resté en arrière, dans ce coin de pays, inquiet à l’idée de me retrouver loin de chez moi sans passe-partout, pierre lourde dans l’ombre de celui ou celle que j’aurais accompagné et du pays qui m’aurait accueilli, un goût d’assisté sous le palais, les épaules dociles de l’enfant sage qui aurait voulu rentrer à la maison.

Les rares fois où je me suis aventuré loin d’ici, chez eux, c’est dans ma langue qu’ils m’ont accueilli à leur table, chez moi chez eux, avec le sentiment désagréable d’occuper leur maison. Si bien que je n’ai guère voyagé, franchi aucun océan. Quelques fleuves, le Tage près de Cascais, le Tibre à Ostie, la Trave à Lübeck, le Danube à Vienne. C’est tout, tandis que d’autres bivouaquaient sur les terres de l’Anglais ou de l’Espagnol, jonglaient avec le suédois et le portugais, allaient et venaient comme des pendulaires sur le tablier d’un pont polyglotte, dans des mondes qui se croisent mais ne se touchent pas.

Alors je reste, rêve, me contente d’un jardin étroit, des bois de hêtres et de sapins, des voix qu’on y entend. Y marche en ne m’éloignant que peu, ou à une vitesse qui me permet de ne rien brusquer et d’accéder mine de rien à une autre langue, celle de mon voisin, de proche en proche, sans heurt. L’histoire qu’on raconte à propos de Friedrich Heinze de Rendsburg, je l’ai faite mienne.

De n’avoir jamais disposé d’une langue autre que celle dans laquelle je suis né m’y a retenu, corps-langue dans laquelle je me suis enfoncé, perdu et reperdu avant de pouvoir sortir la tête, non pas par les côtés mais par l’autre bout, en passant par les fonds.

Ne pas dételer avant que ça se desserre, en n’usant que d’une seule main, par secousses et mouvements du poignet, car manque l’autre langue, celle qui m’aurait permis de sectionner ou dénouer les noeuds de la première. Avec, main droite, la gauche qui fouille le ventre de la terre. Marcher aussi longtemps que le silence qui pousse dessous la langue et les choses ne leur a pas permis de mêler leurs eaux. Je voudrais les faire entendre tous les trois, mais souvent l’un d’eux manque.

Je veux sortir du ventre de ma langue, livre bataille avec de l’encre et un bambou, par les fonds où scintille ce qui nous fait vivre et sur lequel sont nées les architectures de nos langues.

Disposer d’une autre langue m’aurait permis de faire halte, reprendre un peu d’air, trouver des appuis et des relais, avoir quelque chose à quoi m’accrocher. Au lieu de cela j’ai dû faire de ma propre langue une autre langue, suis devenu celui qui écrit et celui qui lit, poussant la ligne d’horizon aussi loin qu’il se peut, jusqu’à espérer toucher à l’ensemble simple et transparent de ce qui est, la mer et ses vaisseaux, le nom et le verbe, les maigres moyens de la langue, les prépositions qui racontent notre intimité et la négation notre insuffisance, le jeu des surbordinations et des connexions, quelques enclaves, guère plus.

Aiguiser les bords de la langue, la court-circuiter, réveiller ses morts, la tordre délicatement et dégager l’escalier à vis par où nous parvient l’écho de son mystère.
Le pont n’est qu’un raccourci. Et la vitesse ne nous aide pas en la matière Nous avançons sans bien savoir, faisons de la lumière avec de la nuit dans la nuit, comme la taupe : s’enfoncer, ressortir et replonger, ouvrir une voie, travailler une passe en évitant tout coup d’état.

Deux langues dans la même langue, celle qui vous porte et vous emporte, celle sur laquelle la première se penche. Avant qu’elles n’échangent leur place, sans jamais pourtant savoir sur le dos de laquelle celui qui est voyage ou demeure.
Un peu d’eau et un rais de lumière suffisent à lever le linceul qui recouvre le monde. Il respire, je devine ce à côté de quoi j’ai passé au jour de ma naissance, en coup de vent, sans être en mesure de le retenir, là où je retournerai, sans me retourner, dans le ventre mou de la terre.

La même langue deux fois, sans quoi personne n’aurait peint d’aurochs dans la grotte Chauvet, n’aurait mis du bleu dessous le ciel, ou suivi du bout des doigts le milan qui tourne, tourne tourne, immobile au-dessus du vieux verger.
Jean Prod’hom

Publié le 5 novembre 2014 dans le cadre du projet des vases communicants chez Justine Neubach (Silencieuse.net)
Dans ce désert

Dans ce désert
sans image
sans voix
dans ce désert
sans musique
entendez-vous le bruit du vent ?
Jean Prod’hom
Des certitudes en rafale avec sirènes et gyrophares

Des certitudes en rafale avec sirènes et gyrophares, des trous sur les capots et des minutes de silence ; nos deux yeux n’en font qu’un et l’ancienne profondeur nous manque.

On voudrait dire halte; trop tard, le vacarme a pris, tout s’accélère, puis cale. Quelqu’un dit « la guerre », et c’est la guerre ; quelque chose de très ancien s’est installé dont on se croyait à l’abri ; quoi ? Impossible de le dire, c’est d’avant le langage et les mots ne lui font plus barrage.
Rien ne bouge plus sinon l’attente.
La double vue nous préservait de l’aveuglement, les deux images qu’on maintenait à distance l’une de l’autre se superposent et ne nous laissent qu’un réel sans profondeur, on se met à loucher, on dirait une caricature dont le sang serait monté jusqu’à nos tempes.
Les démons sont revenus, sans père et sans tête, traqués, sur le qui vive ; ils se dépatouillent sans les victimes qu’ils ont envoyées au ciel. Nous voici les figurants incrédules de ce gâchis, au cours duquel les orphelins de la terreur, mains moites, vont laisser leur peau. Pas même le temps de se demander s’il ne conviendrait pas de dire halte plutôt que de prolonger le film.
On leur a dit de mourir en martyr, ce sont des mots : la mort ils n’en savent rien, ne veulent rien en savoir, eux qui n’ont pas demandé de naître et à qui personne n’a offert la possibilité ni de vivre ni de mourir.
On en est là, avec le ciel imperturbable sur la tête et les nuages qui foutent le camp. Mais ici les choses se remettent à trembler avec leur nom ; elles reprennent leur place et redonnent un peu de profondeur à nos vies : il existe une autre nuit.
Jean Prod’hom
S'il était clé d’évasion

S'il était clé d’évasion
un seul livre suffirait
non non – les livres ramènent à la maison
Jean Prod’hom
Les certitudes de l’homme tombé du nid

Les certitudes de l’homme tombé du nid
ange ou démon
donnent le vertige
dans un jardin – à l’écart –
une vieille
arrose ses fleurs
Jean Prod’hom
Jusqu’à l’évidence

Jusqu’à l’évidence
malgré l’épuisement
et puis reprendre des forces
Jean Prod’hom
Les dimensions de nos vies

Les dimensions de nos vies se réduisent trop souvent
à celles d’une conduite dans laquelle il nous suffirait de faire transiter
ce qui est à faire – en direction de ce qui ne le sera bientôt plus
Jean Prod’hom
Au premier signe du printemps

Au premier signe du printemps
l’enfant regardait les pâturages enneigés
de l’autre côté de la vallée
pressé qu’apparaisse du fond de la terre
le mot qui lui assurerait qu’il n’était pas seul
et qu’il était compris des dieux
Jean Prod’hom
Sur un fil

Sur un fil
côte à côte
aussi fragile que solide
Jean Prod’hom
Le long des haies

Pour Kurt von Ballmoos
Le long des haies
dessous les jupes ou sur le chemin
les yeux fermés
Jean Prod’hom
C’est à la fin que l’esprit s’avise physiquement

C’est à la fin que l’esprit s’avise physiquement
qu’une seule et même chose peut demeurer
et revenir multiple et immobile – lorsque la mémoire vacille
Jean Prod’hom
Voeux brefs

Voeux brefs
ni ajout ni mise à ban
allons faire la fête
les ruines se referont un visage
fleurs et crépis
au jardin d’hiver
je jouerai au tiercé
tu chanteras
nous ralentirons ce qui fuit
Jean Prod’hom