Bailly, Emaz, Follain, Thomas

Après avoir lu à goulées lentes l'un des chapitres du Dépaysement de Jean-Christophe Bailly, je picore quelques miettes de la Cuisine d'Antoine Emaz qui évoque à plusieurs reprises Jean Follain. Je ne résiste pas à faire une petite place ce matin au poète d'Exister. Ce n'est pas un hasard, il y a un peu de Jean-Christophe Bailly chez Jean Follain par l'écriture duquel l'abstraction, dit justement Henri Thomas, s'éveille étrangement à même le réel.

Mais ce que le premier aboute sur le fil de sa pelote (qu'il dévide dans le quatrième chapitre d'Arles à Srasbourg – avec en guise de fermoir une fève, celle qui l'a fait roi la veille et qu'il caresse au fond de sa poche), c'est ce qu'il collecte de proche en proche le long de ses voyages en France, le disparate faufilé que le second rassemble au pied de la barrière, dans l'instant, à même cette étrange terre où l'on est seul :
Parler seul
Il arrive que pour soi
l'on prononce quelques mots
seul sur cette étrange terre
alors la fleurette blanche
le caillou semblable à tous ceux du passé
la brindille de chaume
se trouvent réunis
au pied de la barrière
que l'on ouvre avec lenteur
pour rentrer dans la maison d'argile
tandis que chaises, table, armoire
s'embrasent d'un soleil de gloire.
Quand à la France que le premier traverse et dont il s'est donné pour tâche de saisir le sens, le monde, la ville étrangère, l'histoire, les deux hémisphères, l'hiver occidental, le vieux continent, les innombrables pays que bâtit le second pour abriter l'éclosion de ce qui est, ils sont bien plus une absence qu'une présence, l'expression d'une énigme et l'aveu des faibles pouvoirs dont nous disposons pour offrir un toit à ce presque rien qui pousse depuis l'arrière, ce à quoi on n'a pas assez pris garde et qui nous constitue par en-dessous bien plus que ce qu'on rabâche jusqu'aux poncifs. Pour instituer l'introuvable identité frémissant d'être effleurée, portée par la vertu d'un égarement méthodique – d'un bégaiement – qui pousse à l'avant de lui les traces de ce qui existait en dormance depuis longtemps déjà, les rassemble en prenant garde de les tenir à l'écart de toute comparaison, en accueillant le vent qui n'a pas cessé de souffler et le flottement qui sied à leur improbable apparition.
Jean Prod’hom
43

Si la phrase te file entre les doigts, c'est peut-être parce que que tu as ferré du gros. Mais ne te réjouis pas trop vite, il est peut-être trop gros pour toi.
Jean Prod’hom
Il y a les cahiers de planification

Il y a les cahiers de planification
les doutes qui subsistent
les rôdeurs
il y a la tête des clous
les mariages au printemps
il y a la salade à tondre
l'autre versant de ceux qu'on aime
la toque des cuisiniers
le bruit du râteau dans la plate-bande
Jean Prod’hom
Dimanche 25 décembre 2011

Ecrire l'ombre des choses portée sur ce qu'on ne retient pas.

Jean Prod’hom
A.16

L'homme d'autrefois – j'entends celui du paléolithique – ne disposait d'aucune des voies du réseau actuel de communication qui, concédons-le, lui auraient facilité la tâche lors de ses pérégrinations le long des saisons. Condamné à aller de l'avant, il entamait chaque jour la plante de ses pieds sur le silex mélangé à la terre, se déchirait les mains pour saisir les mûres dont le sang se mélangeait au sien. Aucun talus pour s'asseoir, goûter aux baies et reprendre son souffle, aucune saignée à travers bois pour intercepter le gibier. Je l'imagine un bref instant, exténué, rêver à ce peu de temps qui indubitablement lui manquait pour rêver un peu de sédentarité.

Voici qu'aujourd'hui l'homme dispose d'un réseau illimité de routes et de chemins, sur mer, sur terre et dans le ciel, qu'il utilise pour prolonger sa vie chez soi avec les siens, près du feu, domestication et clos, réserves et provisions qui lui assurent sa subsistance. Il rêve pourtant aujourd'hui encore au temps qui lui fait défaut pour quitter vraiment sa demeure et vivre ce que ses ancêtres sans attache devaient à la fin avoir en horreur. Lorsqu'il part, c'est aller-retour.
Les choses sont ainsi faites que l'homme du néolithique – c'est-à-dire l'homme d'aujourd'hui – emprunte pour quitter sa demeure les chemins qui le ramènent irrémédiablement chez lui, il n'en sort pas. Il lui faut désormais, autant pour demeurer dans sa demeure que s'en aller, faire d'autres rêves qui ne relèvent ni de l'aménagement du temps ni de celui de l'espace. Ces rêves n'ont qu'à peine commencé, mais on peut cependant déjà prendre acte du fait que la terre que l'on habite en la parcourant en tous sens et le temps qui nous est octroyé nous laissent la bride sur le cou : notre demeure est peut-être celle qu'on rejoint en la quittant, celle qui ne nous retient pas et dont on se rapproche un peu en la ressaisissant depuis l'ouverture de là-bas.
Jean Prod’hom
Eclairer le ventre de la nuit

Elle me dit alors qu'une seule ambition l'habitait encore, celle d'allumer les modestes feux qui éclaireront demain, peut-être un peu, le ventre de la nuit, celle d'y avancer sans avoir été l'obligée de personne, comme nous le faisions autrefois, Michel, François et moi sur le gué que nous établissions par-dessus l'été, celle de fournir une ancre aux récits dont nous sommes les passants hébétés. La nuit se refermait à chaque pas derrière elle et l'océan demeurait inentamé à l'avant de sa coque. Elle naviguait avec l'assurance qu'elle buterait un jour contre un de ces hauts-fonds cachés dans la nuit – qui sont autant d'appels – et sur lesquels l'un de ses proches, elle l'espérait, aurait à préparer le feu qu'un autre allumerait pour éclairer ceux qui viendront après nous.
Jean Prod’hom
Il y a la paresse des rivières et celle des diamants

Il y a la paresse des rivières et celle des diamants
les pelotes de laine
la brutalité des circonstances
le chant du rossignol
il y a la terre que se partagent l'abandon et la résistance
l'annulaire
l'exportation des savoirs-faire
la journée des fonctionnaires consciencieux
l'inavouable
Jean Prod’hom
Dimanche 18 décembre 2011

Le froid et l'obscurité à même la rue, les lèvres bleues, tombeau usé ceint d'un vilain tablier, c'est une mauvaise journée pour ceux qui n'ont plus rien, bien froide et bien misérable, la faim creuse leur mine. Pauvre petite ! La neige aux belles boucles virevolte autour de son cou depuis la veille, elle est assise dans un coin, immobile et affaissée sur elle-même, le froid l'a saisie et accompagne ses mauvais rêves. Elle ne bouge pas sous l'avant-toit, au travers duquel souffle le vent, paille et chiffons inutiles, elle regarde les gouttières. A côté un grand poêle de fer blanc abandonné, orné de boules de fer et surmonté d’un couvercle, une boîte d'allumettes vide. Mais qu’y a-t-il donc ! Une lueur s'effondre, l’oie de glace saute de son plat et roule sur le plancher, des images montent, montent le long des vitres épaisses, ce ne sont que des étoiles qui tombent en gesticulant.
Plus loin, entre deux maisons aux façades aveugles se faufile une nouvelle et froide matinée. On a retiré les échelles du ciel, le froid et l'obscurité s'avancent sourire aux lèvres… Sur le muret un tas, morte, morte de froid à l'aube. Petit cadavre en paquet posé sur le muret.

La Petite Fille aux allumettes, Hans Christian Andersen
Théâtre du Jorat
Mise en scène : Gérard Demierre
Jean Prod’hom
Tempête à Treyvaux

Dieu, ce beau mirage, écrit Michel Bavaud dans un ouvrage que je n'ai pas lu, récemment paru aux Editions de l'Aire. Le vieil homme précise sur les ondes qu'il l'a aimé et qu'il a servi son église de tout son coeur. Il proclame aussi dans les quotidiens locaux que Dieu n'existe pas. Ça me dit naturellement quelque chose, mais quoi exactement ?
Son intelligence préoccupée n'en pouvait plus de faire le grand écart avec Rome et ses sacrements, trop c'est trop, Michel Bavaud a décidé de rapatrier sa foi attachée à une figure de papier. La confiance qu'il avait placée crédule en Dieu, il la place désormais en l'homme seul. Difficile pourtant de faire sans la figure à laquelle l'homme est resté fidèle tant d'années, alors il s'indigne, se met en colère, exprime une rage qu'il a tôt fait de regretter, oh la solitude. D'avoir brisé la sainte alliance sans être un militant du grand soir n'est pas sans dangers : Michel Bavaud est rejeté tout autant par les athées – pourquoi tant de temps ? – que par ses compagnons de route qui le condamnent aux enfers.
Dieu, ce beau mirage est la confession d'un laïque engagé au service de Rome, l'histoire de la conversion d'un déçu de Vatican II, modérateur du synode diocésain chargé de mettre en oeuvre les décisions du Concile : rien, aucune avancée, un recul plutôt. Cessons donc de prier, agissons et mettons notre foi en l'homme : liberté, égalité, fraternité en lieu et place des trois vertus théologales. La raison a définitivement gagné la partie. La Bible ne tient pas debout. Vive la République !

Si les conversions (comme les dépressions) sont de petites tempêtes individuelles qui inquiètent toujours un peu les proches – comment nos amis se remetteront-ils de la négation et nieront-ils cette négation ? – ce sont elles également qui conduisent les hommes à reconsidérer les vertus de l'agnosticisme – seul mot qui supporte les affixes de la folie –, à suspendre leurs certitudes, à mettre entre parenthèse les dichotomies pour guetter ce qui s'établit loin des principes, dans la traîne qui glisse sur les choses comme la neige de la mariée, là où persiste l'hérésie, mystère auquel il est inutile de demander grâce. Ne pas choisir, ou choisir à peine, en guettant ce qui est sans le saisir autrement qu'avec les noms qui passent et qui vous emmènent parfois à la verticale du paysage.
Jean Prod’hom
Il neige même dedans

Les chutes abondantes de la nuit ont rejointoyé les pentes du ravin, le barbelé des clôtures a disparu, les pièges se dérobent, on oublie même les morts. Un bruit d'étoffe fait taire toute velléité de sortir dans cette copie flamboyante du sommeil, il neige dedans. Les récits se sont tus, l'avant et l'après recouverts par une épaisse couche de neige. Il faudrait peut-être faire un pas dehors, mais que feras-tu dans cette immense salle d'attente ? Pas bouger, maintenir le pouls au ralenti jusqu'à la nuit que tu aperçois, trou noir autour du filet d'eau et le merle près de la haie. Tu rêves alors, pour durer encore un peu, à la rose de novembre et aux fruits du sorbier.
Jean Prod’hom
A égale distance les uns des autres

En marchant sans but, on côtoie parfois à deux pas l'intérieur des choses dont on a l'impression soudain de partager le sort, sans y voir très clair, mais avec la certitude d'en être, grand visage tourné vers le ciel, visage immense, immense comme l'oeil de la bête croisée l'autre jour à la patte d'oie. Mais là ce sont des arbres.
Ils sont à leur place, ensemble sans être contemporains, à bonne distance les uns des autres, vicaires dans un espace désencombré des trajectoires qui superposent les temps, hors du labyrinthe qui nous tient en laisse, en un carrefour où il n'y a plus rien à décider, carrefour sans route, sans croix – plus donc de regret – et où se manifeste le dedans dans le dehors qui se dérobe. Les arbres ne font rien pour durer, ils en sont revenus, rien sur les lèvres, les yeux ouverts seulement jour et nuit. Et la promesse qu'ils demeureront lorsqu'on s'éloignera, c'est tout ce qu'on sait, comme des figurants qui n'ont rien demandé. Les vertus ont leur temps propre, la scène émeut, quelque chose monte depuis le dedans, comme la sève, c'est un peu de vertu. Ils ne s'en attristent ni ne s'en réjouissent, pas de quoi s'apitoyer, c'est ainsi depuis toujours.
L'autre monde est sans doute dedans le nôtre, hésitation sans fin pour deux fois rien au regard des anciennes croyances, appelé à disparaître à midi lorsque les enfants rentrent de l'école. En attendant la partie d'échecs est suspendue et, tandis que les arbres enfoncent leurs épaules dans la terre, le sursis se prolonge en une éternité sans couvercle, le ciel.

Jean Prod’hom
Les poissons dans l'épuisette

... même paradoxe d'un parallélisme convergent, même volonté d'emprise, même jeu de cache-cache, même espoir de saisie.
Jean-Christophe Bailly, Le Dépaysement, Seuil, 2011
![]()
Les poissons dans l'épuisette, le paysage sous cadre, le visible dans la boîte, tes mots dans le récepteur, le démon aux chicanes, le gavage des oies, les papillons dans le filet… Et tandis que tu déclines l'universel, immobile derrière une clôture aux larges mailles, les choses vont et viennent sans laisse, vivantes, mourantes. L'eau de la fontaine file entre tes doigts et tu entends l'appeau qui appelle la grive, l'appeau qui appelle le chevreuil, et la grive dans le ciel et le lièvre dans le pré sans personne pour les arraisonner, la mer, l'écume de mer et la silhouette du vagabond qui fend l'air poussé par le vent.

Jean Prod’hom
il y a la fève qui voyage au fond d'une poche

Il y a la fève qui voyage au fond d'une poche
les limites de la raison
les châtaigneraies
il y a les divagations
les demis-vérités
le jeudi saint
les subordonnées relatives
les zones franches
il y a les bonnes nouvelles
Jean Prod’hom
Dimanche 11 décembre 2011

Musée romain de Lausanne Vidy
Dernier coup de balai sur le linoléum de la chapelle mortuaire, c'est l'heure, on ferme. Le tombeau est vide, où donc est passé le rédempteur ? Seule la pierre veille, calcaire liquide, pierre au gros grain, fontaine de patience où se désaltère, assis sur une chaise vide, celui qui ne sait plus.

Jean Prod’hom
Dans les parages

Dans les parages de celui qui avance en pays familier et que semblent accompagner l'assurance, la belle allure et les mots attendus, se tient en équilibre l'ombre d'un laissé pour compte, égaré dans un pays qu'il n'a jamais quitté, cherchant les mots qui le rapatrieraient. Il ne trouve que le syllabaire de son premier livre de lecture, sonore et incomplet. Il marche au-delà de la ville qu'il a rêvée, c'est un soir d'hiver dans les ruelles sans éclat d'une banlieue qu'il ne connaît pas, fait halte dans un hôtel. Il regarde longuement les trophées alignés sous la corniche de stuc de la salle à manger déserte, des trophées de chasse. Et il aperçoit sur une des tables un livre plongé dans l'ombre, qui témoigne des gouffres qui nous menacent.
Jean Prod’hom
Les communautés de l'arbitraire

Éric Chevillard aura été l'un des premiers héros des pelouses à succomber à son charme, Roger Federer rejoindra la communauté peu après. Mais ne nous méprenons pas, d'autres avant eux y avaient succombé, d'autres après eux y succomberont. Autour du nombre sacré s'étaient en effet donné rendez-vous le corps et l'esprit, les poètes et les jongleurs, les pelouses et le bitume, le tout et le rien, les riches et les pauvres, Dubaï, Rome, Jérusalem et Toulouse, ce qui avait commencé depuis toujours et ce qui viendrait plus tard. C'est ainsi qu'est née, succombant à son charme, la première des communautés de l'arbitraire qui ont été appelées à fleurir dans les siècles à venir.
Jean Prod’hom
Attelages

J'ai toujours été frappé par le phénomène de dédoublement qui s'opérait en moi au cours de mon travail : je suis mon propre lecteur par lequel l'auteur en moi est sans cesse tenu en bride. C'est un phénomène qui doit être commun à beaucoup de gens qui écrivent : chacun de nous est en même temps les deux membres du couple. Tout écrivain, et même tout lecteur, chez qui le souci de l'art s'unit à une grande méfiance des moyens de l'art, passe par ce double mouvement : mouvement inspiré, mouvement critique. En ce sens je dirai qu'écrire est l'acte de quelqu'un en moi qui parle en vue de quelqu'un en moi qui l'écoute.
Louis-René des Forêts, Voies et détours de la fiction, Fata morgana, 1985
![]()
Si deux voix habitent le même corps – celui de l'auteur – dans l'espace du langage, il n'est pas aisé d'imaginer que la première, inspirée, puisse surprendre la seconde qui la tient en bride, dans un univers et des logiques qui précisément les apparentent. Il m'est plus aisé de penser qu'elles tiennent ensemble les brides d'une monture aveugle qui les mène en des lieux dont elles ignorent presque tout. L'une, critique, soufflant à l'autre, inspirée, qu'elle devrait aller plus loin, plus loin encore, en bridant et débridant ce qu'elles ne conçoivent qu'imparfaitement et qu'elles tentent pourtant de mener ensemble au seuil de celui qui lira.
Il en irait de même pour le lecteur qui, dans un mouvement analogue, s'engagerait par l'autre versant, irait d'un pas inspiré et critique dans les parages de la même aventure dont il n'aurait de cesse de repousser le terme, plus loin encore, plus haut, et ainsi n'en viendrait pas à bout.
Ce faisant, chacun d'eux porterait devant lui ce que l'autre vise avec les plus hautes exigences, présentant ainsi à quatre mains sur les fonds baptismaux ce qui n'est pas encore dit, à la manière des contreforts sans lesquels la lumière qui traverse les grandes rosaces de nos cathédrales ne nous serait pas connue.
On se partage la part inédite des choses, ce qu'on n'a pas encore vu et qu'on ne dira pas, ce qu'on devine, ce dont on croit distinguer le murmure et qu'on porte à l'existence par l'écriture et la lecture silencieuses, à petits pas inspirés et critiques.
Jean Prod’hom
Dimanche 4 décembre 2011

Nos vies sont semblables aux frontispices des vieux livres, nos journées sont des peaux tendues par-dessus le jour dont on aperçoit les feux au crépuscule, bien haut, par-dessus l'ouverture qui bâille entre les épaules de l'horizon, des milliers d'étoiles et la lune à l'air libre qui font entendre le silence et ses soupirs pincés sur les cordes de la nuit.

Je ramène de la Fondation Verdan une plume d'ange – ou était-ce le samare d'un érable de bronze ? – et des babioles : quelques cheveux de la Baigneuse de Valpinçon, les petits récits de Cristina Zilioli, les minuties de notre passage sur terre qui s'inscriront tout à l'heure dans la neige : pont, crochet, îlot ou lac, delta, bifurcation, intersection, terminaison ou tourbillon.
Avant de remonter la vallée du Flon dont on suture les lèvres, je respire au compte-gouttes, les yeux vers le dehors, la tête hors d'elle dans le ciel avec dessous la peau tendue de la ville qui se pelotonne une bouillotte aux pieds, poussé par le flux des crêtes dans le parking désert.










Jean Prod’hom
Il y a ceux devant lesquels on ne pèse pas lourd

Il y a ceux devant lesquels on ne pèse pas lourd
les bons payeurs
l'eau des gouttières
la solidarité des marins
il y a les années décisives s'il y en eût
la loi du moindre effort
la naïveté des oracles
il y a la désobéissance lorsqu'elle est taillée à la hache
les filets de perche
Jean Prod’hom
Tu marches sous la pluie

Tu marches sous la pluie avec pour seuls repères les feux tremblants des réverbères qui bordent la route cantonale et les lacets qu'empruntent quelques voitures pressées, qui se croisent et s'entrecroisent dans la nuit. Tu vois juste assez pour distinguer, loin devant, ton domicile, quelque chose de sombre qui ne bouge pas, quelque chose qui est en lien avec le sol sur lequel tu poses les pieds et que tu n'entames pas. Tu as beau faire aller tes jambes, tu n'avances pas, ton buste demeure immobile, la bête est silencieuse.
Tu ne feras pas long feu sur le dos de cette immense baleine qui tourne lentement sur elle-même avant de replonger dans la nuit d'huile sans provoquer le moindre remous. Tu sens bien que le temps ne se mesure pas à l'espace parcouru, mais est l'effet d'un battement obstiné, celui de tes jambes qui vont et viennent autour de tes hanches dans un vide sidéral. Oui, tu es vivant et tu pédales bien droit sur le dos de Moby Dick.
Jean Prod’hom
De l'alibi

S'en remettre aux justifications et aux tours de passe-passe qui les épaulent pour méconnaître ce qui fut, c'est renoncer aux maigres pouvoirs mis à notre disposition pour avancer dans la lumière de ce qui fait de nous des passagers nus, et en découdre. Je vous le demande, comment ne pas se détourner de ces gens qui condamnent ainsi la liberté et le courage en idolâtrant la silhouette de ce qui aurait été si les circonstances avaient soigneusement suivi leurs exigences ?
Quelle peine pour ces usagers du juste monde, ces justiciers oublieux des vertus, prudence et tempérance, courage et justice ? Il y a du parjure chez ces gens-là, et violation des plus vieux serments. Ils tentent de faire main basse sur le réel en punaisant son reflet sur l'envers d'un décor dans une pièce de circonstance aux accents du cinéma-vérité.
J'envie pourtant parfois ces habiles prestidigitateurs qui vont d'un pied assuré, affranchis bercés par les raisons et les chants paresseux, héros qui échangent délires contre dédires. Je voudrais qu'à leur aveuglement puisse répondre mon pardon.
Jean Prod’hom
Refrain

Au bout des jours
encore des jours
il pleut enfin
mais pourquoi est-ce si long ?
solitude légère
à l'aube blanche
qui nous tient ?
qui nous guette et s'accroche ?
rien au bout
une image
le grain d'une consolation
et la poussière d'une voix
La Ligne droite | Georges Moustaki / Barbara
Jean Prod’hom
Dimanche 27 novembre 2011

Il y avait foule le vendredi et le samedi soir : maoïstes, trotskistes, anarchistes de gauche ou de droite, situationnistes, hardis et souriants au Jour et nuit, au Mao ou au Tunisien, jusqu'à point d'heure, structuralistes, lacaniens ou deleuziens, disciples d'Hermès, cinéastes à la petite semaine, insatisfaits, girardiens agnostiques, écrivaillons pêle-mêle, vendeuses de fleurs, comédiens ou amateurs de LSD. En me rendant ce matin à la cinémathèque de Lausanne, j'ai repensé à cette foule de la ville ouverte des années 70. On s'est retrouvés plus tard dans le café jouxtant la salle où Freddy Buache organisait ses projections après qu'il nous eut déplacés de l'Aula du Collège de Béthusy à l'aile est du Casino de Montbenon. Après on s'est perdus de vue.
Le café est désert aujourd'hui, mais on y projette dans les sous-sols L'Autre côté du monde. C'est l'histoire de la Suisse humanitaire, celle de l'aide d'urgence et de la coopération, du CICR et de la DDC, Médecins sans frontières, Amnesty, Helvetas, Chaîne du bonheur, Caritas,... Les 80 acteurs choisis témoignent de ce que fut leur engagement, ils évoquent les blessures, les difficultés, les doutes, l'excitation, le courage, l'épuisement, les réussites, les révoltes, les malversations, les échecs, les joies, la perte des amis.
On doit cette manifestation à l'association Humem (humanitarian memory) qui l'a organisée à l'occasion des 50 ans de la Direction du développement et de la Coopération du Département fédéral des affaires étrangères. Ce film qu'on a pu déjà voir à Berne, à Genève et Zurich va voyager dès la fin de la semaine prochaine à Bâle, Saint-Gall, Lucerne, puis dans le reste de la Suisse en 2012 et 2013.
Ce projet soutenu par la Confédération – le budget de la DDC en 2008 s'élevait à 1,57 Millards de francs – l'est également par les cantons et de nombreuses organisations d'entraide suisse.

J'ai retrouvé ce matin quelques-uns des acteurs du vendredi et du samedi soir des années 70 à Lausanne, bien vivants à l'écran. Les associations d'entraide ont été pour eux comme des refuges, évitant ainsi le désespoir ou les combats extrêmes sans entamer leur volonté de changer le monde. L'un d'eux dit du CICR qu'il a été l'occasion d'une rédemption. C'est dire que l'aide d'urgence n'a pas seulement eu des effets à l'extérieur au lendemain de catastrophes sociales ou environnementales, mais aussi à l'intérieur des âmes rongées par l'insatisfaction, parfois la frustration et l'appréhension d'avoir devant elles un monde toujours plus vide, déserté par les idées qui les avaient nourries. Avant de succomber à l'abandon, ils ont décidé de ne pas abandonner ceux qui manquaient de tout.
Ces entretiens sont passionnants, c'est jusqu'au 2 décembre à Lausanne, ailleurs ensuite. Nous étions 3 dimanche matin : un enfant une vieille dame et moi. C'est trop peu.

Jean Prod’hom
Il y a le pendant des mauvais jours

Il y a le pendant des mauvais jours
les toits de chaume
les facilités de paiements
il y a le visage dans tes mains
la sagesse des idiots
la grammaire générative
il y a la grammaire dégénérative
les départs différés
il y a que la poésie entière est préposition
Jean Prod’hom
A.15

L'amélioration de l'état général de notre santé et les progrès dans le domaine des traitements comme dans celui de la prévention ont permis de différer substantiellement l'heure de notre mort. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, car ce laps de temps supplémentaire a été mis également à la disposition de la démence qui a multiplié ses chances de nous rattraper. Consolons-nous toutefois, le dément n'en saura rien.
L'amélioration de l'état général de notre santé et les progrès dans le domaine des traitements comme dans celui de la prévention ont permis de différer substantiellement l'heure de notre mort. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, ce laps de temps supplémentaire a été mis également à la disposition de la démence qui a multiplié ses chances de nous rattraper, et l'espoir que le dément n'en saura rien est bien vite déçu. Car la démence s'installe sans égards, elle ne referme aucune porte derrière elle.
Jean Prod’hom
Anniversaire

Toutes nos entreprises, vaines ou essentielles, croisent un jour celles que d'autres ont initiées dans le passé ou initieront dans l'avenir, petites ou grandes, c'est l'un des corollaires de l'effet papillon. Ainsi, la petite affaire qui a démarré au Riau le 29 octobre 2008 croise aujourd'hui l'aventure à laquelle Franck Garot, avec la complicité d'Eric Chevillard, a donné le coup d'envoi le 20 janvier 2009, et croisera demain ou après-demain celle qu'a mise en route Roger Federer le 30 septembre 1998 à Toulouse aux dépens de Guillaume Raoux. Et tandis que le roi du gazon songe secrètement au déclin et que le logicien fanatique de la Roche-sur-Yon s'incline une fois encore sur les brins d'herbe de son jardin, je dépose ce billet et m'envole, tourne le dos à ce petit monde, cueille quelques fleurs et m'éloigne de ce point de conspiration, inexorablement, heureux d'en avoir été.

Jean Prod’hom
Les enfants

Arthur peine ces jours à se lever parce que, dit-il, la lumière violente du spot – ou celle du jour – l'éblouit si fort qu'elle l'oblige à maintenir les yeux fermés ; il ajoute qu'il ne voit aucun intérêt à les ouvrir s'il fait encore nuit. Je crains qu'Arthur, comme l'Ernesto de Marguerite Duras, ne refuse sous peu d'aller à l'école, parce que l’on y apprend ce que l’on ne sait pas.
Jean Prod’hom
Dimanche 20 novembre 2011

Discussion ce matin avec Louise qui me confie en des mots crus qu'elle trouve tout particulièrement débile l'exercice qu'elle a dû se coltiner il y a peu, visant à distinguer les différentes catégories que la langue met à notre disposition pour organiser le désordre apparent du monde. Le mot gourmand est-il un nom ou un adjectif ? Et le mot marcher ? Et le mot ridicule ? Elle me convainc assez rapidement que cet exercice l'était bel et bien. Elle me raconte alors la visite que son école a organisé au Musée des Beaux-Arts de Lausanne qui présente une exposition : Incongru. Quand l'art fait rire. A nouveau elle ne ménage pas ses mots et s'emporte, révoltée. Un des travaux présentés l'a particulièrement scandalisée : Le monsieur écrit sur tout le mur la même phrase, comme une punition, "je ne ferai plus jamais de l'art ennuyeux". C'est ridicule, tu trouves pas ?
Les frondaisons des arbres du verger ont fini de brûler, leurs cendres se sont mêlées aux lichens des vieilles branches, l'eau manque dans la souille des sangliers. A la lisière, deux feuillus et un mélèze jettent les dernières hautes flammes, cela fait quelques semaines déjà qu'on attend les mauvais jours qui ne viennent pas, je le dis tout bas, on n'est pas pressés, c'est tout ça de gagné sur l'hiver, sots de s'en attrister, tard pour s'en inquiéter.




On entend les rires du refuge des Censières jusqu'à la Moille Saugeon. C'est une clairière au milieu de laquelle on a construit, dispersés de tout, une habitation et un rural qui ont flambé une nuit de l'hiver 1941. Il reste l'essentiel, une fontaine et un abri. Dès cet instant, on croise l'avant-garde de la foule multicolore qui s'extrait chaque dimanche de la ville.
En attendant le bus, je fais la connaissance de l'héritier d'une famille de propriétaires d'hôtels en Tunisie, d'un Noir qui loge depuis longtemps déjà dans un téléphone portable et d'un adolescent qui a laissé l'avenir derrière lui et qui chante à tue-tête. On prendra ensemble le bus, puis le métro avant d'aller chacun de son côté, les pieds en captivité dans nos baskets.




Et bien, chère Louise, je suis d'accord avec toi, quand un musée décide de nous faire découvrir l'incongru et nous invite à rire, il vaut mieux serrer les dents. J'ai passé ce soir au mcb-a de Lausanne. Je ne sais pas exactement si c'est l'art qui est ridicule ou si ce sont les musées. Je penche pour la seconde solution. Comme toi, j'ai trouvé la paroi de John Baldessari ridicule. J'ai visité chacune des autres salles, croisé des gens malheureux à l'affût de ce qui pourrait les détendre un peu, rien. Pendant ce temps les gardiens du musée me surveillaient, j'étais à l'évidence un suspect, surtout que je ne fasse pas de photographies. Car personne ne doit savoir, rien ne doit sortir de ces lieux qui ne soit contrôlé. Les gardiens semblaient entraînés à défendre une ville assiégée et prêts à donner leur vie. Mais ils allaient voir ce qu'ils allaient voir, j'en ai semé un dans la grande salle, un sombre et retors, pâle comme la mort. Me suis caché derrière la foule des 25 rieurs au garde-à-vous de Yue Min Yun avec l'ambition de photographier le croque-mort au moment même où il passerait entre les Chinois, ni vu ni connu. Il a surpris mon manège et ne m'a pas lâché d'une semelle. Trop risqué, trop entraîné pour moi, trop fort, trop froid. J'ai pris peur, m'est resté que le courage de fuir.
Voilà, chère Louise, une exposition qui montre encore une fois que l'art est grave et que son idéal est le beau. La bienséance est sauve, tout est sous contrôle, le rire est sérieux, le diable aussi, l'ironie sous cadre et la subversion au vestiaire. En rentrant, j'ai regardé pour rire les photos du vernissage que le site du mcb-a met à disposition. Ah ça c'est sûr, on s'est marré ce jour-là.



Jean Prod’hom
Il y a les semaines sans brainstorming

Il y a les semaines sans brainstorming
l'anneau de fer devant l'auberge
l'intrication quantique
le lamellé-collé
il y a les fourches télescopiques
la considération de ses moyens
l'envers des tapis
il y a le plumet des fifres et tambours
le biais de tes réponses
Jean Prod’hom
Ça tient comme une fleur

C'est un pays sombre et triste ; la route d'E. vous guide par des courbes douces au regard dans une auberge ravernie. O le vin aigre, les cigares étouffants ! Mais il y a un beau ciel clair et gris sur les collines. L'église aiguë de Cossonay crève le moutonnement des verdures bleuâtres. Tout près de moi bouillonne une source de lait dans le canal. Perrette Perrette, je suis heureux et triste à la fois. Ma fuite n'est pas que folie, et Dieu, malgré l'affreux spectacle de ce coeur empoisonné me rendra peut-être la voix que j'ai perdue.
S'il regarde ainsi dehors, ce n'est pas tant qu'il rêve avec dans son dos les tâches qui l'étranglent et ceux qui s'affairent chevillés à leur quant à soi, c'est qu'il fait son école buissonnière, vole debout par-dessus la butte et les branches couleur de cendre des feuillus nus du préau. Il a l'esprit loin à l'horizontale, au-dessus des moilles et de l'étang du Sepey, au pied de l'horizon, à L'Isle et Montricher. Ce serait peut-être bien que ceux d'en face en fassent autant, un jour les hommes laisseront tout ça en plan.
Non non, il ne rêve pas, ne conçoit aucun lieu secret, ne creuse aucune tanière, ne ramènera aucun galet, ni la baguette du sourcier. Son esprit vagabonde dans le vent, l'infatigable vent, ajuste de mémoire les parties du paysage qu'il a parcourues, les habitants qu'il y a croisés et les fontaines qui chantent sur la place des villages déserts, maisons agglutinées, vides, fenêtre fermées, portes murées, dépenses condamnées, plus d'épicier, mais des vieux, les derniers vieux.
Il colle tout ça ensemble avec le ciel désintéressé en-dessus qui écarte les murs qui le soutiennent, ça tient comme une fleur. Tout est à sa place, en-deça de l'obligatoire et du facultatif, les choses sont là, pour tout le monde, avec l'évidence qui sied à ce qui est.
Il ramasse en un seul geste les prés et les bois, les lisières, les chemins, les faufile et les pend par d'invisibles fils aux bords du ciel. De là-haut, il en voit plus qu'il ne l'imaginait, mais il s'agit de tout prendre. On perçoit alors quelque chose comme une poussée qui dure intacte, un appel malgré le détournement que chacun fait de soi-même. Et le zénith s'installe au coeur de chaque chose, et rampe, il n'y a personne devant la grande fenêtre, ne le cherchez pas au pied du Jura terme du contrat. Pour traverser le creux que rien ne remplit, il lui avait fallu autrefois un permis de voyageur de commerce, hier un traité de marche en plaine. Besoin de rien aujourd'hui, plus rien à faire ici.
Jean Prod’hom
Le fil ténu qui me fait tenir debout

Pour Floriane
Méditation de Thaïs | New Philharmonia Orchestra / Lorin Maazel violon & direction
Tous les enseignants en convenaient, elle était douée de telles qualités qu'aucun obstacle ne lui résistait quels que soient les domaines, si bien que nous redoutions que nos besaces manquent un jour de ce qui la rassasiait. Vaine inquiétude, elle se montra toujours à même, en puisant je ne sais où, de distinguer un frémissement dans les coins délaissés et les matières les plus inertes. Elle rendait notre métier facile et agréable, on en aurait aimé une demi-douzaine comme elle dans nos classes, brillantes et vivantes.
Nos craintes ne se dissipaient pas complètement cependant – c'est ainsi dans nos métiers – et revenaient par une porte dérobée. Ignorant le chemin que la jeune fille empruntait pour faire tenir ensemble ce qu'elle embrassait, je me mis à craindre sottement qu'elle ajoutât un jour à son menu, sans en connaître les conséquences, l'ultime tâche qui lui eût fait baisser les bras, placer sur le bûcher et brûler ce qu'elle avant engrangé.
Un jour je la vis triste, elle m'apprit qu'une blessure l'empêchait pour quelque temps de se livrer à une passion dont elle ne parlait pas, j'en fus réconforté. Je me mis à soupçonner que la musique avait quelque chose à faire avec la grande santé qui l'animait et mes craintes qu'elle en portât trop s'éloignèrent.
C'est de ce jour que date au fond, je crois, ma certitude que tout ce qu'elle avait fait jusqu'ici avec un réel plaisir ne l'auraient pas comblée si le vide creusé sur les bancs d'école n'avait pas accueilli dans le même temps, là-bas, la musique dont elle charriait l'instrument dans une boîte noire, son violon. Les derniers mois passèrent, elle me sembla s'éloigner toujours plus des lieux qu'on partageait.
Arriva enfin le jour des promotions, à l'occasion duquel il est convenu qu'on se dise au revoir, elle monta sur scène. J'entendis alors un peu de ce qui l'animait et qui lui donnait la force de changer en or ce qu'elle touchait. J'entendis distinctement ce que je n'avais pas imaginé tout au long des années. Elle n'était plus assise tête penchée sur ses devoirs, mais debout devant un lutrin, la tête dans les étoiles. Elle n'était plus l'élève de tête écoutant parmi les autres la parole du maître, mais seule, ou presque seule, faisait entendre par l'une des petites fenêtres de la cellule de sa passion la voix de son violon. Elle me livra le fil ondoyant d'une méditation, fragile et courtoise, et j'acquiesçai à ce qu'elle ne disait pas, écoutez-moi maintenant, écoutez le fil ténu qui me fait tenir debout et qui allège la charge de ce que je sais, écoutez le souffle de ma passion, je m'éloigne, libre enfin.
P.S.
Avertissement
Jean Prod’hom
Dimanche 13 novembre 2011

J'aurais préféré l'emporter cette boîte en bois exposée au Musée d'éthnographie de Neuchâtel, sombre, patinée, ramenée vide d'Angola. Au moins la tenir un instant dans les mains ou, à défaut, placer ici son image. Impossible de remettre la main dessus malgré le moteur de recherche mis à la disposition du visiteur. Etait-ce une boîte, un pot ? Quelle langue parler avec les bases de données ?
Au rez, une douzaine d'artistes régionaux ont donné une chance à des objets enkystés dans les collections, en en faisant ou en en disant n'importe quoi, mais au moins quelque chose, en les installant dans un espace dont ces objets semblent s'étonner eux-mêmes avant de retourner dans la nuit.
Je sors du Musée avec l'impression désagréable que leur avenir est de moins en moins assuré, affiches géantes pour expositions réduites, on y met tout on y met rien.
J'apprends près de la sortie que Jeanne Favret-Saada sera là le 22 novembre 2011 à 20h15 pour faire la sorcière. Son ouvrage paru en 1977, Les mots, la mort, les sorts : la sorcellerie dans le bocage, m'avait bien remué. Je serais bien allé la semaine prochaine l'écouter pour savoir sans la lire ce qu'elle devenait. Comment vieillissent les bonnes idées ? Que sont devenues celles de Francis Jacques, de René Girard,... ? Je n'irai pas. C'est ainsi peut-être que les idées prennent de l'âge.

Dans la ville couleur curry, le dimanche, il y a toujours quelque chose à voir en automne : et par-dessus tout, la traversée des jardins de la Collégiale avec le lac en contrebas. Toute la placidité de la Suisse est là présente d'un seul coup. (...) nulle part ailleurs, à seulement sentir s'écouler les heures au bord d'un lac ou devant la draperie des hautes neiges, on n'atteint à une volupté aussi sensuelle et aussi légère. Les eaux du Léthé de l'Europe se rassemblent là, dans ces lacs au bord desquels le troisième âge attend la fin aussi paisiblement que l'appesantissement sans drame d'une dernière morte-saison. (Julien Gracq)
Lui, il a le courage et la droiture des poètes, des immigrés, des ouvriers, des artisans, ceux qui nous obligent à ne pas succomber au charme délétère du cosy. Il a l'allure de ces hommes qui sont venus d'Italie ou d'Espagne prêter main forte à la réalisation des grands chantiers du nord de l'Europe, autour des années 60. Il est d'Agen. Je l'ai rencontré dimanche au Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel. Il portait une chemise blanche, manches retroussées et la moustache au vent.
Il essaie de décrire le monde avec une économie de moyens admirable, il n'en démord pas, en usant d'un langage qui l'oblige à ne plus être tout à fait d'accord avec le monde réel. Tout ses mots sont pesés pour penser l'impensable. Je ne comprends pas tout. Ses paupières sont un peu lourdes. L'homme finit chacune des phrases qu'il a commencées, on distingue même parfois l'esquisse de formes fixes. Il nous interdit au détour d'en faire trop, car il ne faut pas exagérer, garder la tête froide et se satisfaire du fait qu'il y a toutes les chances que le soleil revienne demain, c'est déjà pas mal. Vous pouvez l'entendre au Museum d'histoire naturelle jusqu'au 21 décembre 2011, dans le cadre d'une exposition – Sacrée Science ! croire ou savoir. . . – qui présente la messe épistémologique des années 60.
Au milieu de la rumeur, c'est beau, c'est précis, sans ambiguïté. Assez pour retourner la tête pleine au pays de la molasse. Il s'appelle Alain Aspect, c'est un poète tout à fait sérieux, un poète qui ne se paie pas de mots, un physicien.

Jean Prod’hom
Il y a les livres qu'on ne lira pas

Il y a les livres qu'on ne lira pas
les dogmes religieux
les manches retroussées
il y a cette valise abandonnée sur le quai de la gare
les approximations
les signes du zodiaque
le dédoublement du temps
les petits répertoires
les journées sans privation
Jean Prod’hom
Paroles de meunier

Oh! du monde on en a vu. Au moulin toute la journée, aux fourneaux du café le soir. Comprenez, c'était pas assez pour un et trop pour deux. Alors on est allés ainsi de fil en aiguille. Depuis plus de trente ans. C'est allé vite et fort, vous verrez. Aujourd'hui on est moulus, on remonte à Villarzel.
Jean Prod’hom
De quel droit est-ce que j'ose appeler demain ?

Cette soirée que j'avais voulu escamoter me pèse étrangement. Tandis que l'heure avance, que ce jour-là va bientôt finir et que déjà je le voudrais fini, il y a des hommes qui lui ont confié tout leur espoir, tout leur amour et leurs dernières forces. Il y a des hommes mourants, d'autres qui attendent une échéance, et qui voudraient que ce ne soit jamais demain. Il y en a d'autres pour qui demain pointera comme un remords. D'autres qui sont fatigués, et cette nuit ne sera jamais assez longue pour leur donner tout le repos qu'il faudrait. Et moi, moi qui ai perdu ma journée, de quel droit est-ce que j'ose appeler demain ?
Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes, III, 14
Erhard, Georges et moi

On était finalement arrivés entre ciel et terre, Erhard, Georges et moi. On n'aurait jamais cru pouvoir y arriver.
C'était dingue, on avait grimpé sur des séracs en habits de carnaval, croisé dès l'aube des longs-courriers et les derniers oiseaux migrateurs pour finir là, sans y croire, frigorifiés. Au sommet, on est restés quelques minutes à peine à nous demander chacun pour soi comment bon dieu fallait faire pour qu'il nous reste quelque chose de tout ça. Le temps passait et rendait notre départ urgent et improbable. On a fini par redescendre, je ne sais pas comment, on n'a rien ramené.
On est là aujourd'hui sans Erhard, mais on est restés lucides tous les trois.

On disait qu'on pourrait toujours revenir et qu'on ne faisait que passer, seule l'étendue nous comblait, on manoeuvrait pour rester vivants, vraiment vivants. Erhard est rentré plus tôt. Comment avons-nous fait pour nous séparer ?
Ce n'est pas le sommet qu'on visait, qu'y fait-on sinon y laisser sa peau. Non, on voulait rentrer sans dépasser les bornes, et s'il y avait un sommet, c'était tant mieux, mais un col souvent suffisait. Pourquoi je dis ça, je ne sais pas, c'est quoi la question ?
Ce qui nous aurait arrangés, c'était de ne pas avoir à repartir, mais on n'avait pas d'excuse, fallait y aller, et puis on se serait mordu les doigts. Faut savoir qu'on marche pour soi, c'est-à-dire pour rester vivant et pour revenir, ou ne jamais revenir, c'est la même chose. C'est pour ça que des fois tu n'as pas envie de redescendre, t’es ailleurs. Et tu sais que bientôt tu donneras cher pour revivre cet instant, alors tu restes au sommet, parce que tu n'es pas loin d'être un autre homme, c'est difficile à dire, un autre homme dans un autre monde. T’as le pied dans l’au-delà, à la merci de tant de choses, t’es mort, t'es aux anges. Les sages disent qu'il faut continuer à grimper quand t'es au sommet. Foutaises, descendre suffit bien.
Quand tu rentres t'as pas l'air d'un survivant, mais tu l'es, ça tu le sais, non, un revenant, nettoyé comme un galet roulé dans un torrent. Erhard, tu le disais, de tout ça vaut mieux en rire.
Toute les souffrances, les égarements, les doutes valent pour cette minute-là, tout est fini, t'as la peau du visage tendue comme une baudruche, t'as la pupille qui éclaire comme un spot la muraille des questions, tu n'as plus qu'une seconde sur l'arrête, insignifiant, pas le temps de prier, rouler suffit jusqu'au camp de base. Marcher ne sert à rien, tais-toi, t'occupe, il est inutile de parler ou d'écrire, il est temps de faire autre chose qu’écrire avec l’écriture, endosse ce qui est sans remise.
Jean Prod’hom
Parabole

Si ce qui est dit est bel et bien ce quelque chose qui s'ajoute en supplément à ce qui est sans jamais en faire partie, on ne pourra faire mieux que parler en paraboles, et ce que tu entends ne saurait être autre chose que ce qui vient de l'autre rive. Nous aurions pour tâche de faire coïncider, par-dessus l'abîme, le réel avec ce qu'on en dit, en aménageant des gués, en multipliant les métaphores, en inventant des langues qui se chevauchent, en creusant en chacune d'elles la place de ce qui leur manque, en mêlant l'eau et le feu, sans jamais y parvenir, avec le souci de demeurer sur le qui vive, c'est-à-dire à côté, ébloui par ce qui se déroule de l'autre côté : le coq et l'âne.
Jean Prod’hom
Il y a les semaines sans powerpoint

Il y a les semaines sans powerpoint
les saltimbanques
leur insouciance feinte
il y a la grammaire lorsqu'elle se montre dans son modeste appareil
le battant des cloches
les choses reléguées à la périphérie
les passes
les laisses
ce qui ne nous retient pas
Jean Prod’hom
Dimanche 6 novembre 2011

Pour Christine Jeanney
Le vide s'associe au calcaire pour offrir parfois à celui qui n'en demandait pas tant des corps de pierre gorgés d'eau. Pas touche, ou avec les lèvres au creux de ton bras. Vase égaré qui ne sert plus, mis au ban de ce qui passe et chute, tenant enclos ce quelque chose qu'on aperçoit dans les yeux du captif, persistant lorsque la partie est perdue. On ne l'imaginait même pas. Rien en lui, pas plus hors de lui, l'impair solaire qui brille et manque de rien. S'il est amputé, ce n'est pas tant de ce qu'il retenait dans son ventre, mais des mains sur ses flancs. Le jour creuse les reins, on ferme les portes, sens-tu ton corps qui s'ourle et roule dans la nuit.

Vase funéraire, haut d'une trentaine de centimètres, égyptien, Ve ou VIe dynastie, sous-sol du MUDAC, cote Ber0457 de la collection Berger. Vide.
Le vase tient l'avenir entre ses mains comme les pivoines et, tandis que le vent dépose ses grains de braise sur le sable, il reste en arrière, intouchable, tenu par rien, vieilli dès le premier jour, sans jamais avoir à songer revenir en arrière. Il médite sous cloche, la durée finira le travail entrepris jadis, lento, lento, ça bouge à peine, mais la pierre fond, coule, fait tenir ensemble l'interminable disparition de ce qui était et sera avant et après nous.
Jean Prod’hom
XCIX

L'été se prolonge une fois encore, Patricia et Jean-Rémy se promènent sur la route qui mène au cimetière, affairés à polir leur amitié naissante. Chacun parle à son tour, il lui fait part de ses sottes convictions, elle lui raconte ses assurances morbides, mais l'enflure de leur moi les rend sourds une fois encore. La vérité et la mort ont bel et bien un mur mitoyen.
Jean Prod’hom
Rolex Learning Center






Vous pénétrez dans ces lieux avec l'étrange sentiment que, sitôt arrivé, il sera déjà temps de les quitter. Alors vous ne vous y installez pas, vous faites quelques pas qui ne vous rapprochent et ne vous éloignent de rien. Vous avez beau chercher, personne ne se dresse nulle part dans ce bâtiment à l'ancre. Les préposés au nettoyage sont vraisemblablement sur le qui vive, mais ils se font invisibles en attendant leur heure. Vous êtes bel et bien en transit, dans un espace sans loi apparente où l'on entend bruire la rumeur d'une autorité, en transit entre rien et rien, c'est ce qui fait le charme des lieux. Les individus que vous croisez sont là depuis toujours, comme des statues de sel dans un décor de papier mâché.
Le désordre et les accidents ont été éradiqués, il ne peut rien arriver, il n'est jamais rien arrivé dans ces lieux hormis quelques dépressions, des accidents cérébraux, des révolutions intellectuelles, des conversions idéologiques, bref rien de bien visible.



Aucune plaque commémorative, on les installera plus tard, lorsqu'on en aura terminé avec ce qui n'a pas commencé. Entre temps on vient prendre un rendez-vous ou un verre, faire une sieste entre deux trains, parcourir un livre. Avec le souci bien compris que tout soit comme au premier jour pour que demain se prolonge comme hier, pour de bon, à moins qu’on ne continue ainsi. Personne n'est surpris de ne pas s'étonner de l'état des choses, on s’habitue vite, sans compter qu'il n’est pas désagréable qu’on vous ignore comme si vous n'étiez pas, qu'on ne vous demande rien. Vous ne savez pas vous-mêmes ce que vous pourriez bien demander, et à qui. Vous vous asseyez pourtant, le temps se glisse à vos côtés et tout s'écarte d'un bon mètre : l'air libre circule au pas.
Les flux pourtant sont si tendus qu’il est déjà trop tard. Vous vous levez, minuit est là, ou midi. Vous constatez qu'on a fermé le bâtiment avant qu’il n’ouvre, avant même qu’il ne ferme, vous ne saisissez plus exactement le sens de ces expressions. Mais vous comprenez soudain que, si les chaises ne sont pas déjà sur les tables, c'est parce que les tables sont sens dessus dessous. Alors vous décidez de rester encore un moment, un moment dont vous n'imaginez pas la fin, mais vous y restez adossé à l'archaïque conviction qu'il vous a toujours suffi de faire un pas pour en sortir.

Jean Prod’hom
Il y a les idées mal ficelées

Il y a les idées mal ficelées
le riz casimir
la sagesse des stoïciens
il y a le martin-pêcheur
la tempérance lorsqu’elle est sans retenue
les sursauts de l’été
il y a les sols détrempés
l'eau d'huile sous l'écume de la mer
le toc de l'autre côté du miroir
Jean Prod’hom
XCVIII

La locataire du duplex que les autorités ont mis en location dans la villa communale au centre du village est une vieille amie de Jean-Rémy qui a quitté il y a peu la ville pour la campagne. Mais c'est dans la banlieue voisine qu'elle enseigne pour quelques années encore. Elle apprend aux plus petits des choses auxquelles personne ne croit plus mais qui ne font pas de vagues. Elle dit aujourd'hui qu'elle souhaite quitter la vie avant que celle-ci ne la quitte. Les mauvaises langues corrigent en disant qu'elle l'aurait souhaité. Trop tard, Patricia est sur la voie du déclin.
Jean Prod’hom
Dimanche 30 octobre 2011

Au-dessus de l'interminable allée de bouleaux qui bordent la Broye sous Lucens, à côté de la route qui mène à Dompierre se dresse un clocher-arcade, c'est celui de l'église de Curtilles perchée sur une butte. Trop d'agitation ce matin pour que les enfants et leurs parents entendent les deux cloches nichées dans le mur appeler les fidèles. Car il y a fête de l'autre côté, au Centre équestre de Curtilles. Les étrilles d'argent des armoiries du village, emmanchées d'or, posées deux et une, le manche en bas dans l'azur ne servent plus depuis un moment déjà, elles reposent dans une vielle caisse en bois au fond de l'écurie, dehors le cul des poneys brille.






C'est la fête au soleil, on se régale, des couleurs et du sérieux de partout, mais surtout chez ces jeunes cavaliers en équilibre précaire sur les flancs de leur poney. Ils jouent avec les soudures comme les pétales des pavots au sommet de leur tige Pas d'orgueil chez eux, mais une ambition calibrée, celle de garder le contact en parlant à demi-mots le langage fruste de ces bêtes qui les visitent parfois la nuit et auxquelles ils confient leur peine.






Nos enfants ne sont pas des héros, mais ils sont aujourd'hui les indiens de notre temps, perchés sur le dos d'êtres étranges qui n'ont pas domestiqué leur sauvagerie, qui ont appris au contact des hommes à tout faire pour en faire le moins possible, à moins qu'ils ne fassent la paire et réalisent avec leur cavalier quelque chose de beau, quelque chose de simple, quelque chose d'élégant. Alors leurs yeux noirs cessent de buter sur l'ombre qui renouvelle leur peur ancestrale, leurs yeux deviennent myrtilles et ceux des enfants se mettent au galop. Ni l'un ni l'autre n'entend plus les décibels de nos voix, le poney galope, le poney trotte, le poney que l'enfant tient par la bride marche, il hoche du bonnet, l'autre sourit. Chacun retourne à ses affaires, l'animal à sa faim et sa peur, l'enfant à sa soif et son inquiétude.

Nus dans les prés, sans mors, loin des propriétaires qui viendront en fin de semaine réclamer leur dû, les rescapés du dimanche désoeuvrent entre rêves et chimères, oubliés dans l'herbe alourdie par la rosée, à laquelle les feuilles mortes vont se mêler, et tout effacer.
Jean Prod’hom
Sans couture

Une bouffée sans couture poussée par le vent, plus réelle que le réel, une chose vive, dense, sans mesure passe aujourd’hui en coup de vent, amenant au pied des montagnes les échos de la mer haute, laquelle reprendra, lorsqu’elle se retirera, ce dans quoi nous sommes tout entiers et dont nous nous sommes éloignés pour boire et manger, mais aussi, je crois, pour en attester.
C’est ainsi qu’elle se fait oublier, comme si elle avait pris un peu de retard, alors qu’elle va pour son compte, c’est ainsi qu’elle revient loin de l’arrière d’où elle prend son envol, c’est ainsi qu’elle nous rejoint et nous enveloppe, nous pousse nulle part, là où elle et nous sommes seuls.
On a tous dû débarquer un jour, certains l’ont fait pour toujours, d’autres se sont postés aux détours, dans les dévers, un peu à côté pour saluer, sans se retourner, cette bouffée sans couture qui vient de l’arrière, sans personne pour la chevaucher et qui irait sans nous si nous ne nous ouvrions à son passage : quelques mots, le mouvement d’une phrase, une petite ivresse, une ondulation avec au bout un instant qui dure tenu par un fil à ce qui nous effleure.
Nous savons désormais n’avoir pas complètement perdu ce qui ne nous appartient pas, nous le savons en bonnes mains. Il est inutile de vouloir tenir captif ce qui reviendra en coup de vent et qui laissera, après son passage, un peu de regret et la nuit venteuse qui enveloppe la succession de nos jours.
Jean Prod’hom
Friedrichshafen

Lorsque Adolf Hitler est porté en 1921 à la tête du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, mon père a 2 ans; sa mère Anna est originaire de Gottmadingen, petite ville de l’Hegau près de Singen. Adolf Hitler devient chancelier du Reich alors que mon père a 14 ans, il vit avec les siens sur les rives du lac Léman. Ma grand-mère, qui a épousé mon grand-père bien avant la première guerre mondiale, ne nous parlera plus tard que fort peu de son exil, de Gottmadingen, de Schaffhouse et de Winterthur où elle a laissé sa famille. Mon père a 20 ans lorsque l’Autriche choisit, par référendum, le IIIème Reich, il en a 21 lorsque l’Allemagne envahit la Pologne. Depuis là tout se brouille.
Je ne suis allé qu’une fois à Gottmadingen, je n’avais pas dix ans. Je me souviens d’un jeune homme solitaire aux cheveux courts qui m’avait montré un pistolet, un vrai, le sien, il s’appelait Andreas et c’était un petit-petit-petit cousin à l’allure d’orphelin. Je me souviens de vieilles dames qui parlaient bas, de leurs maris, ou était-ce leurs frères – il y avait une odeur d’inceste à Gottmadingen. Je me souviens d’une avenue bordée de villas à l’entrée de la petite ville, Andreas habitait l’une d’elle. Avait-il un père ? une mère ? Je me souviens l’avoir accompagné le temps d’une admiration.
On nous a raconté plus tard, sans qu’on songe ma foi poser de questions, les exploits des cousins, des grands-oncles, soldats fidèles ou résistants, traîtres libres ou prisonniers, fuyards, permissionnaires, déserteurs ou croix de fer, soldats d’abord, hommes courageux surtout, hommes enfin, seuls dans le no man’s land de mes représentations. C’est aux désastres de la guerre que j’ai pensé, samedi passé, en me promenant avec Arthur dans le centre ville de Friedrichshafen, ville voisine de plus de 50’000 habitants qui borde le lac de Constance.

Photo : site de la ville de Friedrichshafen
Friedrichshafen abrite aujourd’hui des sociétés prospères, filles et héritières de celles qui lui valurent sa ruine. C’est en effet à cause des Zeppelin, Dornier, Maybach,... que l’aviation alliée pilonna la ville de Friedrichshafen lors de la seconde guerre mondiale.
Les ventres ronds des Zeppelin sont de vrais arsenaux. L’usine Maybach armait les chars allemands de moteurs dont elle avait le secret; les Panzer, les Elefant, les Panther, les Tigre, c’est elle. Quant à l’usine Dornier, elle livrait ses avions à la Luftwaffe : pour de la reconnaissance, le transport de soldats et de matériel, bombardiers ou chasseurs. Le centre historique de Friedrichshafen n’a pas résisté aux représailles. De centre il n’y en a plus.

La ville a été bombardée à onze reprises, nous apprend la section historique du site officielle de Friedrichshafen, du 21 juin 1943 au 25 février 1943. La zone industrielle a été la première visée, mais les zones résidentielles et le centre historique n’ont pas tardé à essuyer les plâtres, tout particulièrement le 28 avril 1945. En moins d’une heure la ville ne fut qu’un brasier; au bilan plus de 1000 morts, 1000 blessés et un nombre incalculable de personnes sans abri qui vivront désormais dans des refuges d’urgence.
Les bâtiments ne furent pas reconstruits à l’image de ce qu’il étaient, si bien que le visage de la vieille ville a disparu aujourd’hui, avec le passé dans son sillage.
Le centre de Friedrichshafen n’a pas d’histoire, c’est un centre à l’allure d’une banlieue, c’est ce qui qui rend cette ville étrange, ville nue, comme ces innombrables villes d’Allemagne détruites et reconstruites à la hâte loin des théories historicisantes, condamnées à un avenir dans un contexte qui ne s’y prête guère.
Comme coupée d’un avenir qui n’existe pas et d’un passé qui n’est plus, Friedrichshafen est retournée à l’état sauvage. Hors de l’histoire comme Stein am Rhein. Mais si le désir semble ne plus circuler dans celle-ci, murée dans des interdits que scandent les façades historiées de ses maisons de poupées, il en va tout autrement sur la place du marché de Friedrichshafen : le désir circule en tous sens, plus de Troupes d’occupation pour gâcher la fête, et depuis 1991 le gros des Forces françaises en Allemagne est rentré. On est entre nous, la mère n’y reconnaît plus ses petits, on ne voit plus qu’une seule génération spontanée sortie la veille des refuges d’urgence, asphyxiée par l’air libre, suroxygénée. En guise de décor des bâtisses vite construites, bâclées, rondeurs, couleurs et fers forgés aux balcons. On se réveille comme d’un mauvais rêve pour plonger son nez dans un espace vide. Ville invivable, condamnée à être continûment présente à elle-même, sans repos. Impossible de s’absenter dans la considération de ce qui fut ou rêver à ce qui sera, une ville sans liens, juxtaposition de niches dans un espace à pente nulle, ville inondée.
L’eau monte, l’inquiétude aussi, le mélange n’est pas bon. Pas d’air à Stein am Rhein, trop à Friedrichshafen.




Jean Prod’hom
Une paire qui faisait la paire

Il y avait un sacré bout de temps qu’on ne les avait pas revus au village. Faut dire que c’était une paire qui faisait bien la paire. Alors personne ne s’en est inquiété outre mesure. Pas même l’Emile qui s’en explique à l’auberge.
- Faut bien comprendre qu’ils étaient bien incapables de demander de l’aide. Pensez, là-haut c’est là-haut, et lui, l’Armand, il avait la jambe qui traînait trop sérieusement la jambe pour oser par ce froid s’embarquer en-bas la dérupe et laisser la Capucine toute seule aux Chênes, surtout qu’elle avait la tête qui avait complètement perdu la tête. Cessez donc de pleurnicher, ça sert à rien que notre sang se fasse du mauvais sang, c’est ainsi, faut pas croire qu’on peut faire changer à l’avenir son fusil d’épaule.
Jean Prod’hom
Il y a la pédagogie institutionnelle

Il y a la pédagogie institutionnelle
l’éclat cireux des vieux planchers
l’étagement des forêts
il y a la chute des corps
tes mains autour du bol de thé
la triple crème
l’entêtement de la pluie d’automne
il y a les rêves qui ne veulent pas finir
les ruisseaux dont on a oublié le nom
Jean Prod’hom
Dimanche 23 octobre 2011

Les heureuses perspectives promises à la fin du XIXème siècle – transports et industries – ne se sont pas réalisées dans ce coin de pays, si bien que Schaffhouse et Constance n’ont pas attendu, Stein am Rhein est restée en arrière, délaissée et respectée comme une veuve.
Petite ville sise au bord du Rhin, à l’ouest du lac de Constance, elle n’est pas sans rappeler d’autres petites villes demeurées en marge de l’histoire, soigneusement conservées, semées à assez bonne distance les unes des autres pour ne pas se faire d’ombre. Elles exhibent chacune leurs particularités et celles que leur ont confiées – en échange de leur protection – leurs fières voisines qui ont continué leur route sans craindre de toucher aux héritages : l’Histoire se détourne des coquetteries. Stein am Rhein s’est fixée pour toujours sur les rives du Rhin à la fin du Moyen Âge.

Stein am Rhein autour de 1900
Stein am Rhein est à l’image de ces blocs erratiques, amenés là on ne sait pas très bien comment, denses, compacts. Il suffit de s’y pencher, d’examiner un fossile ou de tirer un fil pour que, si nous en étions capables, l’histoire de la terre ou celle des hommes se déroule sous nos yeux : on y rencontre des seigneurs fonciers, un maître du marché, l’évêque, l’avoyer, des abbés, un Conseil et des bourgeois, des baillis épiscopaux, des barons et des fonctionnaires impériaux, des corporations, bras mort à l’écart du lit de l’histoire, morceaux de mémoire qu’une mauvaise conscience a décidé de conserver forclos en un même lieu, palimpseste illisible dont on renonce à séparer les couches. Faudra-t-il revenir les mains vides ? On se résout à acheter quelque chose, une carte postale colorisée comme les murs de cette cité de cire.
Protégé par la grâce des lieux qui n’existent pas, le centre historique de Stein am Rhein est aussi indestructible qu’un souvenir. Un seul bombardement en 1945, le 22 février, quelques dommages qu’on s’empresse de réparer. Hier les voyageurs du Royaume-Uni, aujourd’hui ceux du Japon la sauvent de l’oubli.
Ajoutons pour conclure que Stein am Rhein est le premier lauréat du prix Wakker en 1972. Ce prix récompense les villes et les communes suisses qui se sont distinguées dans la préservation exemplaire de leur site. Rien à signaler depuis 1972, aucune pierre n’a bougé, sur les murs tatoués de la ville plus de place pour écrire.




Jean Prod’hom
Un trou au vilebrequin dans le tohu-bohu

Les menaces dont on perçoit chaque matin les échos inquiets, à la radio, au supermarché ou au café pèsent sur notre société et hypothèquent la possibilité même d’un avenir à qui on donnerait autre chose que ce à quoi on l’a condamné, quelque chose comme une chance. Les dettes que les plus pauvres ont dû contracter dans les sous-sols pour assurer leur survie sur des paillassons, celles que les plus riches ont été amenés à effacer pour jouir encore un instant d’un balcon surplombant l’horizon, les intérêts de ces dettes dont nous avons à payer les traites chaque jour aiguisent et apaisent le jeu en rassemblant des adversaires que rien ne distingue pour nous faire patienter et nous consoler en arguant qu’il nous reste de la marge encore avant de devoir plonger vaillants dans la tempête. Les digues sont exténuées, la poussée est continue, il n’y a plus aucun répit, les remèdes sont des poisons, les nuits chevauchent les jours si bien qu’il nous reste bien peu de place et de force pour imaginer ne serait-ce qu’un instant un morceau d’avenir libre d’hypothèques, de dettes et d’intérêts. Certains d’entre nous devront, c’est sûr, demander un crédit pour passer la saison, impossible de faire autrement, mais il convient malgré tout de se réserver une possibilité, tandis que nous parvient de la terre, lointain, un tohu-bohu sans queue ni tête, la possibilité de creuser sur les rives du fleuve qui roule ses eaux puissantes, au vilebrequin, un trou où loger le rien, et d’y écouter la mer comme dans un coquillage.
Jean Prod’hom
Tyrannie de la page A4

Le générateur Van-de-Graaff est naturellement l’un des clous de la visite du Technorama, il produit un courant continu de près de 500’000 volts qui dessine sous vos yeux un arc électrique – ou vous fait littéralement dresser les cheveux sur la tête. A côté de ce monstre la plus grande machine de Wimshurst au monde, avec un diamètre supérieur à deux mètres et des tensions encore de plusieurs centaines de milliers de volts. On rencontre cependant à Winterthur également des choses moins aveuglantes et plus apaisantes : un ballon rouge qui flotte sur un lac de carbone, des arrosoirs d’azote liquide qui traversent des chapeaux de feutre comme s’il s’agissait de vieilles passoires, des faux-semblants, des casse-tête, la solitude des habitants d’une bande de Moebius, les leçons du miroir, la carte de votre visage, l’histoire accélérée de la terre, le carrousel de Coriolis, l’assurance des toupies, l’huile magnétique...
Mais au Technorama de Winterthur, il y a surtout une machine, une machine diabolique qui ramène chacun d’entre nous à sa vérité et à la tyrannie d’une époque, notre apparence mesurée au nombre de pages A4 vierges qui suffisent pour que, enroulés dans ce suaire, nous ne soyons décidément plus rien.

Jean Prod’hom
Elles avaient beau secouer leur crinière

Elles avaient beau secouer leur crinière, les mauvaises herbes et les linaigrettes sauvages du jardin du palais n’avaient pas été en mesure de faire plier la volonté des fils des derniers princes, éduqués dans le culte de la réussite. La force impérieuse qui les poussait s’était installée en eux alors qu’ils n’avaient pas encore les yeux secs. Sans l’avoir réellement choisi, leur chemin grimpait vers un autre ciel, il était trop tard pour qu’ils reviennent sur leurs pas. L’estime qu’ils avaient d’eux-mêmes les faisait espérer, prêts à en découdre pour se partager les honneurs d’autrefois. Mais, comme chacun d’eux était par distinction assujetti à lui-même, ils ne formèrent au bout du compte qu’un seul être à têtes multiples. On les entendait hurler de dépit à la nuit tombante, rien à se mettre sous la dent, les greniers étaient vides et personne n’était enclin à les nourrir. Ils cherchaient dans leur sommeil les traces d’un exploit qu’ils auraient pu déterrer, ou au moins raconter. Mais à mesure que la gangrène faisait tomber chacune des parties de l’ensemble, il fallait bien constater que la boue avait la partie facile et qu’elle engloutissait tout autant leurs rêves que ceux que ces présomptueux nous avaient affermés, en échange de l’exploitation d’une parcelle de terre chiche située au fond de l’ancien jardin de l’avoué.
On ne signalait aucune vague depuis quelques mois, et des douze fonctionnaires de la cité responsables du réseau des inclinations et des haines, un seul était désormais nécessaire pour mettre à jour le plan des affects de la communauté. Rien n’était laissé au hasard, on avait placé à l’angle de l’hôtel de ville un récipient de fer blanc dans lequel on déposait les dernières prérogatives, les chiffres de ce qu’on ne retrouvait pas, les impairs. On le vidait chaque soir sans qu’il y eût de cérémonie, le vent d’est faisait voler les noms des disparus et les mélangeait à la poussière qu’on stockait avec les cendres dans de grandes bassines d’étain, pour si jamais.
Cette déréliction avait du bon aux yeux de certains parce qu’elle obligeait, disaient-ils, les survivants à penser jusqu’où une communauté pouvait désespérer. On égalisa, on égalisa, la température se maintint stable. Pourtant, aux grandes marées de printemps, le ciel s’abaissa d’un cran. La mer ne parvint pas à remonter son attirail, ni à descendre jusqu’au grand chenal. Il fallut soudain songer à prendre de nouvelles mesures.
Jean Prod’hom
Dimanche 16 octobre 2011

Fondation réelle ou légendaire de Rome, 900, 753, les Etrusques, 616, la République et l’Empire, 509 et 27, Théodose et les Barbares, 395, 476, tant qu’à faire et avant qu’on n’impose à Arthur d’autres dates pour son édification, on file jusqu’à Avenches.

La campagne est presque déserte, les champs de maïs rétrécissent, une charrue va et vient dans la terre noire, les hérons se sont installés dans les prés. On a oublié au milieu une récolteuse à tabac, elle a quelques chose de la mante religieuse. Plus loin des camions à l’arrêt, chargés des feuilles de burley en balles, qui pendaient comme des harengs dans les hauts hangars qui bordent la Broye. La campagne s’endort.
Pas mieux dans le Musée romain, pas un chat mais des bris de marbre froids, vivants comme nos visages en hiver. Et des babioles en veux-tu en voilà tirées des tombeaux profanés. Le temps s’est arrêté, mais on ne sait pas très bien sur qui, sur quoi. Et si rien ne meurt, rien n’est à proprement parler vivant.

Dehors c’est dimanche et les ruines sont sous contrôle. Les thermes du forum sont protégées par un toit immense, on a coiffé la tête de la colonne du Cigognier d’un bonnet imperméable, le buste en or de Marc-Aurèle est dans un coffre de la Banque cantonale vaudoise, les pierres du théâtre ont été rejointées. Tout là-bas le mur d’enceinte de l’ancienne capitale romaine se confond avec l’horizon. Désormais les ruines font partie des meubles.

Pourtant quelque chose respire, les amoncèlements de vieilles pierres aussi hauts que des tas de betteraves bougent, on se balade sur les chemins de dévestiture. On attend quelque chose, quelqu’un, des Barbares, un nouvel Hannibal, la bulle d’un pape ou les crues de la Broye, n’importe qui, n’importe quoi, mais quelque chose, quelque chose ou rien, et le silence pousse par en-dessous, les fondations tremblent, la terre brûle sans couvre-chef.
Jean Prod’hom
Il y a les pommes de terre en robe des champs

Il y a les pommes de terre en robe des champs
les peuples orphelins
il y a l’abîme qui sépare l’indéchiffré de l’indéchiffrable
les fêtes foraines sur les rives du Vidourle
ton corps caché dans la laine
il y a le linge sur le fil
il y a les rues sans grâce
les infractions aux lois militaires
il y a les diseuses de bonne aventure
Jean Prod’hom
41

Que nous acceptions de payer pour mieux comprendre qui nous sommes et d’où nous venons fait bien voir l’idée que notre société se fait de son avenir. Il faudrait exiger, à côté de la gratuité de la formation, la gratuité des musées.
Jean Prod’hom
Dimanche 9 octobre 2011

En face du musée de l’Art Brut
Fernando Oreste Nannetti est né à Rome en 1927, abandonné dans le quartier de Saint’Anna, accueilli dans une maison de charité, déplacé dans un asile. Son internement quelques années plus tard dans l’hôpital psychiatrique Santa Maria della Pietà l’atteste : des vertus aux neuroleptiques il n’y a qu’un pas. Un autre le conduit des collines du Latium à celles de Toscane au coeur desquelles l’administration psychiatrico-pénitentiaire le mute, avec son dossier de schizophrène sous le bras. Il passera plusieurs années dans l’hôpital de Volterra, de 1959 à 1961 et de 1968 à 1973. La documentation mise à la disposition du visiteur de la Collection de l’Art Brut ne dit rien de ce qu’il advint de Nannetti entre 61 et 68, un silence convenu dont tout le monde semble se satisfaire. C’est dans le préau de cet asile qu’il entame, avec l’ardillon de son gilet, la rédaction d’un long texte qu’il rive dans le ciment, à raison d’une heure par jour, un mètre courant de pages volantes en 4 jours.
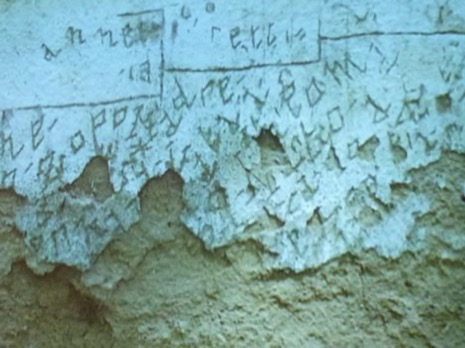



Copies d’écran du film de Pier Nello Manoni et Erika Manoni (détails)
Il grave dans le dur les morceaux de sa vie et des fragments des nouvelles du monde, qui lui parviennent sur les fil tendus de ses jours. On dirait des empreintes de pattes de moineaux dans la neige.
Cette heure quotidienne lui aura peut-être permis – oh ! comme je l’espère ! – de goûter un peu aux beaux jours et de déposer un instant les souffrances que la solitude, l’hérédité peut-être, les circonstances et les pas cloutés de son siècle ont placées sur son chemin. Geste d’une épopée mystérieuse aux dimensions de celle de Bayeux. Combien d’ardillons l’homme aura-t-il usés pour lister les étapes de son calvaire, les paraboles de son incompréhensible aventure, battus par la brise dans le cagnar d’août, lavés par les averses de douleurs les jours de pluie ? Personne hormis les psychiatres et les procès-verbistes de l’art ne liront ce texte illisible. Nannetti accastille un langage neuf pour traverser des jours sans queue ni tête, trapèzes en équilibre, une cour en guise de vie intérieure qu’il déroule comme un ruban punaisé dans le ciel tandis que sa détention continue à le creuser jusqu’à l’os. Nannetti donne une réponse à la question que l’écriture ne cesse de poser, l’écriture pend comme une guirlande aux fenêtres des plaies.


Pier Nello Manoni (détails)
Le crépi lâche, les aliénistes réforment leurs principes, les façades cèdent. Il n’y a plus de pilote sur la nef des fous, on a renvoyé les locataires, qu’ils aillent voir ailleurs. Que penser de la décision du Parlement italien de fermer en 1978 tous les hôpitaux psychiatriques ?
On ramasse les vieux paquets de nazionali sans filtre qui traînent dans les préaux, les fenêtre sans carreaux sont ouvertes, le temps fait le reste, décolle les murs que rongent les lamentations de la mauvaise conscience. Nannetti s’en fout, personne n’est jamais venu lui rendre visite, personne ne viendra, et Nannetti n’est pas rancunier, il a laissé à d’autres le soin ridicule de s’occuper de son destin. Son corps d’albâtre s’appuie aux ornements d’autres palais, les pans de leur mémoire s’effritent à l’ombre d’un pin solitaire témoin muet de la vie des emmurés. Ils tombent ensemble à l’abandon.


Mario Del Curto (dans la cour du Musée de l’Art Brut)

Fernando Oreste Nannetti par Pier Nello Manoni
L’hôpital de Volterra est fermé en 1978 suite à l’application de la loi Basaglia. La folie et la maladie qu’on ne retient pas sont allées se loger ailleurs, loin de l’inadmissible misère. Les carrières d’albâtre sont pour la plupart abandonnées, les folies douces errent dans les villes entre coques et châtaignes, pourrissement, feuilles mortes et macération. Les murs qui branlent, le texte qui s’enruine, Nanetti tombe à la renverse et meurt seul en 1994.

Copie d’écran du film de Pier Nello Manoni et Erika Manoni (détail)
Faut-il aller jeter un dernier coup d’oeil à ce livre de sable qui part en poussière et tenter une ultime réhabilitation ? Je n’irai pas à Volterra. je ne secouerai pas la tête, ne reviendrai pas en arrière, n’irai pas de l’avant, me laisserai rejoindre et dépasser par l’ombre de cet homme, de cette bâtisse et de son préau, qui vont d’un pas lent dedans leur néantissement, beauté qui se détourne, se retourne comme la mer. Cette aventure témoigne de ce à côté de quoi les vivants passent en tentant de lire l’illisible, nos odyssées ne nous mènent nulle part, on peut au mieux espérer un chien pour nous reconnaître.

Jean Prod’hom
Naissance du père

Pour Romain Rousset
Ondine est née mardi passé, le père s’y attendait, il a quand même été un peu surpris, Ondine pas du tout. Le père se porte bien. faut dire que l’enfant a débarqué à la dernière minute, les yeux grands ouverts, au moment même où personne ne l’attendait, si bien que le père n’a pas eu le temps d’être pris de court. Il a toutefois été suffisamment remué pour penser qu’il avait passé un peu à côté. Lui, au fond, il aurait bien voulu qu’on recommence tout, pour tout voir et se souvenir, ou qu’on diffère un tout petit peu le moment de cette naissance, oh ! à peine une ou deux minutes, l’histoire d’avoir les yeux bien ouverts, et d’être bien prêt du commencement à la fin. Ça n’a pas été le cas, tant mieux pour Ondine et sa maman.
Faut dire que le père ne pensait sincèrement pas que la naissance c’était ça, on l’aurait dite naturelle, naturelle et imprévue. Mais les choses auraient-elles pu se passer autrement ? L’enfant comme tous les enfants venait de nulle part et le père n’a pas tout saisi, Ondine a glissé d’entre les jambes de la mère, a crié deux fois avant de s’endormir sur ce ventre dont on l’avait tirée. C’était un peu comme de la science-fiction, c’est ce qu’il se disait sans y croire, car il ne savait pas exactement ce qu’était la science-fiction. Il a regardé Ondine avant de quitter l’hôpital et il a eu l’impression qu’Ondine lui ressemblait.
Il rentre à la maison, seul, se couche en chien de fusil songeant à cette autre qui dort ainsi à l’instant ailleurs, il se tient dans son lit comme elle dans le sien. Il ne peut aller au-delà et témoigner de ce qu’il n’a vraisemblablement pas tout à fait cessé d’éprouver mais qu’il imagine avec peine, qu’il n’imagine pas, parce que ce n’est pas une image, il a beau chercher un accès, la raison qui lui a permis d’embrasser le monde et de l’attacher d’un brin de langage le fait buter sur un seuil, six ou sept ans, les choses tenaient toutes seules et lui dedans avec elles, ensemble pour la dernière fois, tout lui revient mais sans rien au bout, payant aujourd’hui le prix fort d’avoir lâché l’étendue pour le repérage... Quelque chose d’essentiel, l’atmosphère intérieure, un je-ne-sais-quoi qui liait tout, a disparu et tout le monde de l’enfance avec lui, ainsi qu’un port de pêche entrevu et qu’une odeur de goudron et de calfatage seule liait dans notre mémoire et seule peu ressusciter ; mais l’« odeur » de l’enfance en nous est autrement enfouie et irretrouvable (Henri Michaux, Verve,1938).
Ondine est née, Alice aussi.
Jean Prod’hom
Honoré par une inconnue et par Eric Chevillard

Je lis avec intérêt la présentation qu’une journaliste de la région fait d’une potière et de son travail dans le journal local. J’ai assez vite le sentiment pourtant, non pas d’avoir déjà lu cet article mais qu’un autre que moi a eu accès aux doutes et aux pensées secrets qui m’ont assailli et dans lesquels j’ai dû mettre bon ordre avant de rédiger, il y a quelques semaines, la note que j’ai consacrée à cette même potière et à son travail exposé dans une galerie du coin.
J’éprouve sur le champ un double sentiment contradictoire : de satisfaction d’abord, en songeant à l’honneur que me fait cette personne inconnue en se servant d’un texte laborieusement écrit, en empruntant à celui-ci quelque chose comme son allure générale et sa pigmentation lexicale, son rythme, son mouvement, bref, ce quelque chose d’impalpable qu’on dépose à notre insu sur la page et sur lequel on n’a plus barre lorsqu’on décide de la tourner. L’effarement ensuite à l’idée que de telles pratiques existent hors des écoles et des universités, mettant en péril la loi qui assure la propriété intellectuelle de chacun.
N'aurait-il pas été plus élégant que cette journaliste me demande l'autorisation – que je lui aurais à coup sûr accordée – de publier mon texte dans l’honorable journal dont elle est l’un des piliers, en ajoutant en bas de page, comme il se doit, mon nom et pas le sien ? Cela lui aurait épargné un travail douteux qui relève de la pire des espèces, celui de la dissimulation. Serais-je au coeur d’une histoire de plagiat, héros et victime ?
Je le lui dis par écrit en lui demandant pour conclure comment elle compte réparer son forfait, la voie de la justice ou le duel ? Elle me téléphone étonnée. Car enfin, elle s’est informée auprès de la potière qui lui a vraisemblablement communiqué les mêmes informations qu’à moi. D’ailleurs certains mots ne sont pas les mêmes. J’essaie de lui expliquer qu’il s’agit d’autre chose, du mouvement même de ce texte, de ses parties, de ses hésitations, de ses ruptures et de ses enchaînements par lesquels on essaie de tenir, chacun à sa manière, un propos et retenir un sens. Elle n’en démord pas et chemin faisant finit par me faire douter. Je décide donc de reprendre mon texte et de le placer en regard du sien transcrit en italique.
Elle participe enfant aux ateliers de poterie que Simone M. offre aux élèves de Moudon lorsque l’école est finie. Cette rencontre avec la terre sera décisive et ses effets ne la lâcheront pas.
Une rencontre avec la terre sera décisive dans son parcours.
Mais c’est en marge de son activité professionnelle que Laurence P. se formera, dans la vertu du compagnonnage et des ateliers où la transmission se fait de main à main, hors l’institution où la norme se raidit, dans ces marges que nos sociétés ont laissées en friche pour que le passionné indépendant puisse aller de son pas, loin des pressions, et trouver cette confiance qui croît de l’intérieur.
En marge de son activité professionnelle, elle se sent à l’aise dans les ateliers où le savoir se transmet de main à main, légèrement en marge du conformisme et des cours traditionnels.
Laurence P. rendra ce qu’elle a reçu aux enfants, à ceux de Lucens et de Moudon d’abord, à ceux des alentours de Vulliens ensuite où elle vit avec sa famille. C’est au geste libre et au regard appliqué des enfants que va tout particulièrement son attention, et c’est pour eux qu’elle a suivi en 1991 l’enseignement d’Arno Stern. Il lui a permis de mieux définir sa place, non plus évaluer l’adéquation des productions des enfants à des modèles, mais les accompagner autant que faire se peut dans l’exploration de ce qu’ils sont, sans que jamais leurs réalisations ne constituent la fin dernière de leur aventure. Un vent d’est souffle à Vulliens où sont mises à l’honneur des techniques qui ne tournent pas rond : modelage, colombins, plaques.
Dans le petit village de Vulliens, où elle vit entourée de sa famille, elle offre aux enfants cet environnement propice à la créativité. Elle accompagne, encourage, guide sans imposer.
Être au service de l’enfant soit, puisqu’il en a besoin, mais être à soi-même son propre servant, explorer l’histoire, les techniques et découvrir les variations des formes primitives, bol, assiette ou plat, préparer méticuleusement la rencontre de la terre et du feu, partager avec d’autres son savoir-faire, n’est-ce pas essentiel aussi ? A cet égard le stage auquel participe Laurence P. en 2009 à Saint-Quentin-la-Poterie est crucial.
Les formes primitives la séduisent et le stage auquel elle participe à Saint-Quentin-la-Poterie est le pas décisif.
Elle s’y familiarise avec les techniques des cuissons primitives, celle du raku et de l’enfumage qui vont infléchir ses réalisations. Elle en revient pleine d’idées.
Dès lors elle se familiarise avec les techniques dites de cuissons primitives. Son jardin devient l’atelier en plein air. Près de la roulotte, le feu et la volonté de réaliser des pièces selon la technique du raku et de l’enfumoir.
Demandez ! Elle vous racontera la chamotte et son grain, le galet pour polir avant la première cuisson, les petites inventions qui font sourire, la vieille lessiveuse, le biscuit, le lit de sciure de sapin ou de chêne mêlée à la paille et le foin, la cire d’abeille et le bas de laine avec lesquels elle lustre les pièces enfumées, la fabrication des émaux, les étonnements lorsqu’on défourne.
Le matériel utilisé, elle en parle avec l’enthousiasme de la découverte. Galet, sciure, paille, chêne, vieille lessiveuse, biscuit, cire d’abeille ou bas de laine,...
Voyez les rejetons de cette mystérieuse cuisine conçue dans l’atelier, répétée, hautement technique, jointe au savoir-faire des anciens !
... l’univers de cette artiste est d’un autre temps. Les anciens, comme elle dit, nous ont tout appris !
C’est l’écho d’un événement soigneusement préparé que le feu dans le four prend soudain en main, un bref instant, livrant aux circonstances et aux hasards les mauvais plis de la terre, récipients aux bords ronds, indécis, peau lisse ou craquelée, enfumés ou émaillés, grands signes de fumée noire, dentelles de l’émail qui se rétracte.
La terre livrée au feu se modèle au gré du hasard. Parfois craquelée ou lisse, la boule ronde fait son nid, ses trous et ses plis se nuancent de gris, perle ou noir
On n’y est pour rien, ni les dieux ni les anciens ne sont jamais entrés dans le four, pas plus qu’ils ne sont entrés dans la tête des enfants. Pas besoin d’aller bien loin pour voyager, une roulotte prise dans les hautes herbes suffit.
Le voyage se poursuit, Laurence P. est une nomade, sa roulotte l’attend au fond du jardin.
Mon enquête s’achève, et c’est vrai, je le concède volontiers, il y a beaucoup de mots différents dans nos deux textes. A la réflexion, il est même plutôt curieux que nos textes ne soient pas exactement les mêmes. Car enfin, tous deux tentent de saisir une seule et même réalité, n’est-ce pas ?
Pour conclure cette journée qui aurait pu se terminer là, dans le confit ou l’eau de boudin, je fais une virée sur l’Autofictif d’Eric Chevillard. J’y lis les trois épisodes d’une étrange aventure que je ne peux m’empêcher de mettre en relation à une autre aventure publiée le jour précédent chez moi, dans lesmarges.net. Voici :
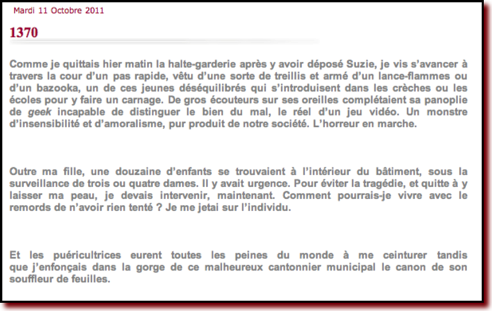
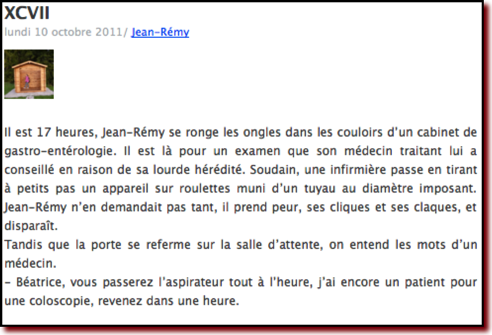
Me faut-il goûter à la satisfaction d’avoir été à nouveau honoré par un emprunt ou, scandalisé pour la seconde fois aujourd’hui, intenter un procès à ce roi de Minuit qui ne pouvait pas ignorer la présence de mon billet sur la toile, son contenu et sa forme solaire. Et offrir à la vindicte populaire ce plagiaire qui, en usant sur l’axe syntagmatique et paradigmatique des transformations et des permutations dont Claude Lévi-Strauss nous a enseigné le fonctionnement, a tiré de mon billet réalisé au burin un billet aérien découpé du bout des doigts, mais qui dans son essence ne recèle rien de plus que le mien. Il me faut me résigner, nous vivons le règne des inventions simultanées.
Une consolation ce soir, la lecture vertigineuse de Pierre Ménard, auteur du Quichotte, et reprendre tout à zéro, Jorge Luis Borges, encore et toujours, qui a fait mieux que nous tous réunis.
Jean Prod’hom
Il y a l’honnêteté tardive

Il y a l’honnêteté tardive
l’acoustique des manèges
les vieilles flemmes
il y a la raideur des roses trémières
il y a le froissement du merle dans les feuilles mortes
ta mandoline pendue à un clou
la vitesse de cicatrisation
celle de sédimentation
il y a l’épilobe altier
Jean Prod’hom
XCVII

Il est 17 heures, Jean-Rémy se ronge les ongles dans les couloirs d’un cabinet de gastro-entérologie. Il est là pour un examen que son médecin traitant lui a conseillé en raison de sa lourde hérédité. Soudain, une infirmière passe en tirant à petits pas un appareil sur roulettes muni d’un tuyau au diamètre imposant. Jean-Rémy n’en demandait pas tant, il prend peur, ses cliques et ses claques, et disparaît.
Tandis que la porte se referme sur la salle d’attente, on entend les mots d’un médecin.
- Béatrice, vous passerez l’aspirateur tout à l’heure, j’ai encore un patient pour une coloscopie, revenez dans une heure.
Jean Prod’hom
S'en débarrasser

Bien des gens le pensaient mais personne n’osait le lui dire, ni la fuir, elle faisait peur. Elle ressemblait à un pou râblé et torturé, la langue bleue et le courage divisé. Le sens interdit qui lui barrait le front avait obligé son âme à vivre sur le qui vive dans un réduit. Les gloussements suffisants de la donzelle rameutaient les geais, elle aimait surtout l’éclat des séries télévisées, appréciait les chefs de rayon, les seconds couteaux et les conducteurs de corbillards dont elle goûtait la conversation pleine de retenue. On l'aurait dite traditionnelle, coiffée de zinc, mais sa toiture était déformée et on aurait eu du mal à reconstituer son histoire. On l’aurait dite aveugle avec ses catadioptres fixés à l’angle de ses paupières, mais elle profitait ainsi des lumières de ceux dont elle suçait le sang. Pour ne pas se perdre quand l’horizon est couleur corneille, elle s’était fait tatouer autour de la cheville une chaîne sans maillon faible.
Elle était en devenir, sur le point de finir sa dernière métamorphose, naine, boulotte, bourrée de ces vaccins qui font gonfler. Touchée par tout, touchée par rien, elle allait d’avant en arrière comme une vieille bielle huilée par la crasse. Le soir elle guettait le troupeau, se dandinait comme une hyène, son pelage suait, si médiocre qu’aucune réputation n’osait traîner derrière elle. Elle roulait des hanches le dimanche sur le boulevard, montrait son autre cheville tatouée d’un bouquet de ronces, elle hochait du bonnet de haut en bas ou de gauche à droite, ça dépendait. Un simple coup d’oeil et elle faisait du bruit, parfois un oeuf si la demande était expresse, elle pensait sur signe et rappelait en notes les pensées d’une vie d’un seul tenant dont la légende, s’il y en eût, eût été de la taille d’un tweet. Je l’aurais préférée officier incognito dans le noman’sland de vos cauchemars ou assoiffée dans le désert de Gobi, elle vivait dans mon enclosure, se nourrissait des baies de mes haies et se tenait menaçante sur le seuil de mes jours, sur le seuil de mes nuits.
Jean Prod’hom
XCVI

Il était prof de philo, inusable lecteur d’Husserl, interprète amusé de l’oeuvre de Marx, enseignant de premier ordre, un carnet de moleskine noire toujours à portée de la main dans lequel il écrivait à journée faite, pendant les cours, hors des cours. Le voici aujourd’hui sur la terrasse du Bristol, digne et âgé, il écrit encore, j’en souris. Sa main droite n’a jamais cessé d’aller et de venir. Mais quand donc s’arrêtera-t-il ? Et quand donc pourra-t-on lire ses notes secrètes, son journal, ce qu’il a noté et dont il ne nous a jamais parlé ? Bonjour ! Il semble ne pas entendre, immobile et concentré. Bonjour ! Je m’approche encore, pas un geste, pas un mouvement. Seule sa main droite s’agite sur le quadrillage de la nappe.
– Cela ne sert à rien Monsieur, Monsieur ne vous entend pas, et puis, Monsieur souffre de la maladie de Parkinson.
Je jette un coup d’oeil à la main de l’homme à la tête usée, avant de m’en aller, sans un mot pour la personne qui l’accompagne, ruminer ce qu’il appelait, en souriant de nulle part, l’inéluctable.
Jean Prod’hom
Dimanche 2 octobre 2011

MITCH EPSTEIN, AMERICAN POWER, GAVIN COAL POWER PLANT, SHESHIRE, OHIO 2003
L’avait-il bien entendue cette phrase dite par un homme à la fois lisse et rugueux, dite d’une voix hésitante, tremblante, de celle qu’on s’autorise lorsqu’on a cessé de guigner vers les conquêtes, voix d’idiot, bégayant ce qu’on ne dit pas, ce qu’on ne comprend pas, le disant dans un creux et un peu par hasard, sur un ton tel qu’il faut le croire sans toutefois prendre à la lettre ce que l’homme ne comprend pas lui-même et qu’il devine à peine.
Il y a quelque chose de tout à fait beau dans la terreur.
Non pas que la terreur fût belle, mais parce que la beauté – comme la terreur – touche du doigt les bords de l’autre, la désignant tout à la fois comme l’oubliée et la toute proche. Ce qu’on jette au ciel roule sur la terre, et c’est à elle, la beauté, qu’il revient de faire entendre les visages abandonnés, les jardinets de fortune; c’est à elle, la terreur, qu’il revient d’annoncer ce qui sera malgré tout sauvé du naufrage. Il y a quelque chose de tout à fait terrifiant dans la beauté.
Il y a la beauté, il y a la terreur, et il y a ce mot “dans“ qui rapproche les mots de la démesure, deux mots que tout éloigne, coup de force sans lequel l’autre mot n’aurait aucun sens. Personne n’a jamais bien compris la terreur, jamais bien compris la beauté, qu’il faudra bégayer encore, sachant qu’elles sont toujours au rendez-vous, chacune sur sa pente, son ciel, son seuil et ses apories, l’une dans l’autre, l’une à côté de l’autre.

Jean Prod’hom
Il y a ceux qui rient d’avoir été embarqués si loin

Il y a ceux qui rient d’avoir été embarqués si loin
il y a les enfants qui auraient pu mal tourner
le foutripi sur les rebords de fenêtre
les allées piétonnes
le bowling
il y a la lecture du journal sur une terrasse lorsque le soleil se lève
l’utile
il y a ce qui ne sert à rien
ton bazar
Jean Prod’hom
A.14

A peine avions-nous atteint le boyau peu profond que le premier tir groupé de shrapnells éclatait parmi nous. Une balle traversa le poignet de mon homme de devant : le sang en jaillit avec impétuosité.
Ensuite le fils de Pélée perce la main de Deucalion, et la pointe d’airain pénètre jusqu’à l’endroit où se réunissent tous les nerfs du coude. Deucalion, la main appesantie, reste immobile en voyant la mort devant lui : aussitôt Achille lui tranche le cou avec son épée, et fait voler au loin la tête avec son casque ; la moelle jaillit des os, tandis que le corps gît étendu sur la terre.

La Grande Guerre n’est pas si différente de celle de Troie. Les éclats d’obus voltigent et les hommes sont soulevés de terre, le sang et les boyaux. Le vin coule à flots sous les tentes et redonne après l’assaut des couleurs aux survivants. Moins bruyants que l’artillerie, à l’arrière, les éclats de rire embellissent Paris, on se promène sur les boulevards, les femmes voltigent sur la couche des grands. A Athènes, on discute sur la colline qui accueillera bientôt le Parthénon.
C’est ainsi qu’on a assuré, de guerre en guerre, la continuité de notre espèce, en maintenant à bonne distance le da et le fort, les intouchables débordant de présomption et les vies minuscules. Avec chaque jour cependant davantage de peine : il n’est pas simple en effet d’élever un soldat inconnu en héros de la nation, et de l’y maintenir parmi les corps glorieux.
Jean Prod’hom
Laurence Probst | Céramique

Elle participe enfant aux ateliers de poterie que Simone Mayor offre aux élèves de Moudon lorsque l’école est finie. Cette rencontre avec la terre sera décisive et ses effets ne la lâcheront pas. Mais c’est en marge de son activité professionnelle que Laurence Probst se formera, dans la vertu du compagnonnage et des ateliers où la transmission se fait de main à main, hors l’institution où la norme se raidit, dans ces marges que nos sociétés ont laissées en friche pour que le passionné indépendant puisse aller de son pas, loin des pressions, et trouver cette confiance qui croît de l’intérieur.
Laurence Probst rendra ce qu’elle a reçu aux enfants, à ceux de Lucens et de Moudon d’abord, à ceux des alentours de Vulliens ensuite où elle vit avec sa famille. C’est au geste libre et au regard appliqué des enfants que va tout particulièrement son attention, et c’est pour eux qu’elle a suivi en 1991 l’enseignement d’Arno Stern. Il lui a permis de mieux définir sa place, non plus évaluer l’adéquation des productions des enfants à des modèles, mais les accompagner autant que faire se peut dans l’exploration de ce qu’ils sont, sans que jamais leurs réalisations ne constituent la fin dernière de leur aventure. Un vent d’est souffle à Vulliens où sont mises à l’honneur des techniques qui ne tournent pas rond : modelage, colombins, plaques.



Être au service de l’enfant soit, puisqu’il en a besoin, mais être à soi-même son propre servant, explorer l’histoire, les techniques et découvrir les variations des formes primitives, bol, assiette ou plat, préparer méticuleusement la rencontre de la terre et du feu, partager avec d’autres son savoir-faire, n’est-ce pas essentiel aussi ? A cet égard le stage auquel participe Laurence Probst en 2009 à Saint-Quentin-la-Poterie est crucial. Elle s’y familiarise avec les techniques des cuissons primitives, celle du raku et de l’enfumage qui vont infléchir ses réalisations. Elle en revient pleine d’idées.
Demandez ! Elle vous racontera la chamotte et son grain, le galet pour polir avant la première cuisson, les petites inventions qui font sourire, la vieille lessiveuse, le biscuit, le lit de sciure de sapin ou de chêne mêlée à la paille et le foin, la cire d’abeille et le bas de laine avec lesquels elle lustre les pièces enfumées, la fabrication des émaux, les étonnements lorsqu’on défourne. Voyez les rejetons de cette mystérieuse cuisine conçue dans l’atelier, répétée, hautement technique, jointe au savoir-faire des anciens ! C’est l’écho d’un événement soigneusement préparé que le feu dans le four prend soudain en main, un bref instant, livrant aux circonstances et aux hasards les mauvais plis de la terre, récipients aux bords ronds, indécis, peau lisse ou craquelée, enfumés ou émaillés, grands signes de fumée noire, dentelles de l’émail qui se rétracte. On n’y est pour rien, ni les dieux ni les anciens ne sont jamais entrés dans le four, pas plus qu’ils ne sont entrés dans la tête des enfants. Pas besoin d’aller bien loin pour voyager, une roulotte prise dans les hautes herbes suffit.

Travaux actuels de Laurence Probst
Exposition du 1 octobre au 13 novembre 2011
Horaires d'ouverture
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h00
Jean Prod’hom
A.13

Pourquoi un tel empressement, une telle agitation, joyeuse, autour d’une découverte qui pourrait tous nous mettre dans de beaux draps ? Car enfin, que des particules subatomiques puissent faire la pige à la vitesse de la lumière, c’est vraiment bien le pire qui puisse nous arriver. Et que ces neutrinos dissimulent leur nocivité derrière l’innocence d’un nom doit nous convaincre de l’importance de l’événement dont l’effet délétère s’est produit, quoi qu’il en soit, bien avant que celui-là ait eu lieu.
Entre le CERN et le Gran Sasso court une rumeur, c’est par Facebook que plusieurs physiciens ont appris la nouvelle, à cause de Twitter que les rêveurs se sont levés, simultanément, mêlant aux jours tristes du travail à la mine un enthousiasme incompréhensible, analogue à celui qui brûla l’âme des intellectuels d’il y a quelques décennies devant des structures et des courbes, dissipatives d’abord, fractales ensuite. J’en étais, gourmand et hébété.

Me voici aujourd’hui saisi par deux curieux sentiments. Je me réjouis d’une découverte qui pourrait mettre dans le pétrin la superbe des bien-pensants – avec la conviction pourtant qu’une couche supplémentaire, coûteuse, constituée de roues dentées et de cycles, épicycles, épicycles d’épicycles, rendra toujours plus improbable la mise au rebut des théories existantes. Je me réjouis ensuite à l’idée qu’on va enfin bazarder cette théorie de la relativité restreinte à laquelle je n’ai jamais rien compris, que je vais pouvoir enfin m’acheter un cahier neuf dans lequel je noterai les postulats et les théorèmes de la nouvelle théorie, enfin à ma portée, que je me promets de suivre pas à pas jusqu’à la nouvelle alliance.
Je m’emporte, je m’emporte, mais rien ne me console. Et je crains que la vérité ne s’éloigne encore un peu, avec le repos qui aurait dû l’accompagner, un peu parce que c’est de son ressort à la vérité de demeurer hors de nous, dans un monde qui ne demande rien d’autre qu’on y persévère. Je sens mon enthousiasme fléchir comme devant ces livres qu’on ne terminera pas et une fatigue radieuse se réjouir de la nuit qui tombe.
Jean Prod’hom
Dimanche 27 septembre 2011

Au printemps 1916, Ernst Jünger quitte la première ligne. Il est détaché à Croisilles, une petite ville près d’Arras, pour suivre un cours d’officier. Il prend conscience alors du travail qui se fait à l’arrière : les ateliers de réparation de l’artillerie, la fabrication du pain, l’élevage des porcs, la traite des vaches, les abattoirs, les parcs d’aviation... Mais aussi de la vie qui continue sans lui : avril, les coussins de trèfle, mai, les prunelliers blancs, les marronniers en fleur, début juin, les étangs et les collines. J’aurais aimé, tout au long de cet après-midi dans le Pays-d’Enhaut, que son récit s’arrêtât là, qu’il demeure captif de ce no man’s land, qu’il m’en parle encore, et que la guerre oublie ce jeune officier.



Mais Jünger est rappelé sur le front en juin où se dessinent les premières ombres de la bataille de la Somme. Il faut recommencer, préparer les attaques, faire des prisonniers, soigner les blessés, franchir le double réseau de barbelés, enterrer ses morts, se traîner sur le ventre pour aller écouter l’ennemi devant sa tranchée, essuyer des salves de mitrailleuse. La liste est longue, aussi longue que celle des choses qui se déroulent à l’arrière. Et c’est au coeur même de cet enfer que la vie renaît, et la paix avec, lorsque les hommes épuisés se mettent à réparer leurs barbelés, sans apercevoir ni entendre leurs ennemis qui reculent en rampant. C’est le crépuscule et la mort, qui se dressait déjà, aux aguets, entre les deux partis, s’enfuit désappointée...

Dire que nos vies sont à l’image de celles des soldats de la Grande Guerre, c’est beaucoup dire. Mais nous disposons parfois, comme eux, d’un peu de répit, au coeur de nos petites guerres ou en leurs marges, dans ces mondes inhabités qui font bande à part, campagne d’automne ou no man’s land. En ces lieux où nous ne sommes que par hasard – ou contraints, c’est la même chose –, munis d’un peu de ce rien qui nous unit, dans les parages d’une obsession mortelle à laquelle il convient de renoncer un jour. Et nous voilà d’un coup libres, laissant comme seule empreinte de notre passage, celle d’un corps dans l’herbe de Gérignoz. La main coupée et dépositaires du tout.
Jean Prod’hom
Il y a les fripons qu’on croit sorciers

Il y a les fripons qu’on croit sorciers
les histoires courtes
le revers des talus
il y a l’ivresse rétrospective
les champs de lavande après la moisson
le doute lorsqu’il reste décent
le départ des hirondelles
les travaux pratiques
il y a ce qu’on appelle musique
Jean Prod’hom
Labours

Sous le Chauderonnet Daniel retourne le champ qui se laisse aimablement faire, les glèbes noires s’ajustent derrière sans déborder du sillon. Une nuit suffira pour que tout se tasse. Et à l’aube la terre aura retrouvé son ventre rond.
Jean Prod’hom
Edouard Monot | Opus incertum

Lorsque nous nous sommes acquittés de nos dettes et de l’inévitable, lorsque nous en avons fini avec la pile des affaires courantes, les peines, les été pourris et l’hiver qui se prolonge, les longs couloirs, les sales affaires, la file des obligations, les salons, les successions, les petits plaisirs et les jours les plus longs, bref, lorsqu’on en a fini avec ce qui assure l’équilibre de nos vies précaires et de leurs saisons, n’est-il pas heureux de disposer d’un peu de temps, hors tout, pour retourner au monde qui nous était promis – ou dont on avait rêvé – et dont nous nous sommes tenus éloignés, silencieux, en pliant l’échine parfois ?
Il est de ceux qui ont su aménager le recoin d’une cuisine pour mettre bout à bout les morceaux d’une aventure esthétique singulière, aux contours indéterminés, une de ces aventures qu’on poursuit sans trop savoir pourquoi, avec le souci de la mener à bien, la conviction qu’on n’y parviendra qu’imparfaitement et l’assurance qu’elle nous laissera au mieux les mains vides.
Pas besoin d’un palais pour cela, ni année sabbatique ni résidence d’artiste, une antichambre, l’ombre d’une arrière-boutique, un atelier d’occasion et un peu de temps arraché chaque jour lui ont suffi pour rassembler au moment voulu une trentaine d’objets qui tiennent circonscrit l’incertain, saisi à peine entre ombre et lumière, offert à ceux des passants qui veulent bien renouer un bref instant avec la construction de ces châteaux de sable qui, l’été, irriguaient leur enfance et retrouver le sérieux qui les habitait, l’hiver, devant des puzzles géants.


Des petites fenêtres, rien d’autre que des petites fenêtres en trompe-l’oeil, et dedans une durée, une durée qui dure, un temps qui ne file pas droit, c’est-à-dire du temps roulé comme de la pâte, avec dedans la possibilité que quelque chose survienne.
Mais nous avions beau faire, notre reflet se mêlait à ce que nous croyions voir. Où que nous soyons, nous apercevions le reflet d’un visage captif et le milieu dans lequel il se complaisait, la silhouette d’un inconnu qui nous tenait éloignés de ce que nous étions venus chercher. Tout se passait à notre insu, dans un dialogue organisé hors de nous par la lumière, entre le monde qui va pour son compte dans les pièges d’un miroir sans tain et l’immobilité absorbante de ce qui reste de la représentation derrière les battants d’une fenêtre.
Il y avait pourtant dans ce mariage quelque chose à saisir, les ailes de feu d’un papillon exposé dans une vitrine, derrière ou devant un visage égaré. Mais qui du papillon ou du visage était le suaire, et pour quelle histoire ? 

Le soleil déclinait lentement vers l’horizon. Au ras de l’amoncellement rocheux couronnant l’île, la grotte ouvrait sa gueule noire qui s’arrondissait comme un gros oeil étonné, braqué sur le large. Dans peu de temps la trajectoire du soleil le placerait dans l’axe exact du tunnel. le fond de la grotte se trouverait-il éclairé ? Pour combien de temps ? Robinson ne tarderait pas à le savoir, et sans pouvoir se donner aucune raison il attachait une grande importance à cette rencontre.
L’événement fut si rapide qu’il se demanda s’il n’avait pas été victime d’une illusion d’optique. Un simple phosphène avait peut-être fulguré derrière ses paupières, ou bien était-ce vraiment un éclair qui avait traversé l’obscurité sans la blesser ? Il avait attendu le lever d’un rideau, une aurore triomphante. cela n’avait été qu’un coup d’épingle de lumière dans la masse ténébreuse où il baignait. le tunnel devait être plus long ou moins rectiligne qu’il n’avait cru. Mais qu’importait ? Les deux regards s’étaient heurtés, le regard lumineux et le regard ténébreux. Une flèche solaire avait percé l’âme tellurique de Speranza.
Le lendemain le même éclair se produisit, puis douze heures passèrent de nouveau. L’obscurité tenait toujours, bien qu’elle eût tout à fait cessé de créer autour de lui ce léger vertige qui fait chanceler le marcheur privé de points de repères visuels![]() Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, 1967 (Folio 2008, 104)
Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, 1967 (Folio 2008, 104)
![]()

![]()
![]()
![]()

On ouvrit donc les fenêtres et on mit l’île autrefois sous cloche au vent. La Verzasca déboulait sous nos pieds, elle avait mis en pièces la montagne, creusait son lit dans un bruit assourdissant. L’eau insaisissable chantournait les éboulis et polissait les fragments d’un puzzle aux motifs inconnus. Elle écrivait de haut en bas un récit immobile qui se poursuivait et que rien ne pouvait arrêter. Les pierres s’arrondissaient, l’eau multipliait ses passages, modelait des réduits, creusait des poches, dessinait des avenues, dévalait la pente entre les cimes et le lac, aménageait les ruines de la montagne en d’innombrables petits chaos irrigués dessus dessous par l’eau qui tenait ensemble l’ensemble qu’elle faisait briller et chanter.![]()

![]()
![]()
![]()

Qu’avions-nous donc à faire de notre côté ? Reprendre une à une les choses mises en pièces en prenant à son compte la part laissée au hasard, reprendre une préhistoire dont on ne sait rien, dessus dessous, la recommencer comme un tavillonneur sous un ciel bleu, refaire ce dont le hasard n’aura été que la réponse paresseuse et immédiate à ce qu’on ne sait voir, reprendre pierre à pierre depuis le dedans, de proche en proche, différant le nom de ce qui commande l’aventure. Aucune appellation ne viendra donc boucler l’ouvrage, ou sans titre, une expression qui n’assure de rien. ![]()

![]()
![]()
![]()

Opus incertum, une manière de sonder latéralement l’insaisissable, de reconstruire solidement le précaire en lui offrant un fond, une coque pour autre chose. Ici pour rien ou pour elle-même, un ouvrage détaché de sa fin.
Les petits accidents jouent des coudes, la main écarte deux pièces pour rectifier l’équilibre, demi-tour, reculer ou avancer d’un plan, fort, da, les doigts reprennent des pièces, les refaçonnent, dessus dessous, établissent des ponts, creusent des galeries, collent et recollent, tout recommencer parfois.
Ça va tenir, ça va tenir sans titre, et si ça ne tient pas, on recommencera la partie. Mais sans laisser la main à celui qui n’en a nul besoin et qui fait vivre le monde comme un marionnettiste connaissant le fin mot de l’histoire, mais en prenant cette fois l’affaire sur soi et d’en-bas, comme un insomniaque qui guetterait le lever du jour, avec les mains qui retrouvent leurs fonctions ouvrières, à hauteur des pierres.
Les doigts se méfient des figures et des désignations qu’il tiennent prudemment à distance, ils exigent le silence et se taisent aussitôt que la représentation guigne avant de fondre sur leur attention et les détourner de ce qui est pour les enrôler dans ce qu’ils pourraient dire. Ça va tenir, ça va tenir donc en-deça de la représentation. Ça va tenir en équilibre, par la grâce d’une syntaxe élémentaire de formes rudimentaires, de formes concrètes tenues en un équilibre dont il faudrait faire le récit épique, du déséquilibre initial qui lui donne la chance unique d’aller au-delà de la nature morte au déséquilibre final qui en fait un tableau vivant, tiré à quatre épingles, debout et fragile, sans pierre d’angle ni clef de voûte.![]()

![]()
![]()
![]()

Mais on a beau dire au diable les maîtres signifiants, ils demeurent sur le qui vive. C’est l’eau qui sourd du chaos des rives de la Verzasca qui rend notre monde vivable, si bien que toute nature morte bien comprise n’a de sens que si elle reste vivante. La vie, je dis bien la vie, se fraie un passage dans le chaos auquel elle donne vie, l’aventure des coquelicots et de la camomille se prépare dans les interstices des pavés. C’est dire qu’une nature morte – et toute l’histoire de l’art n’est peut-être que l’histoire mouvementées de la nature morte – si elle ne raconte rien, n’en est pas moins le lieu même où se raconte la possibilité que quelque chose peut advenir.
L’un dira le berger, l’autre l’orage, un troisième la maison, bien-sûr personne n’y croit vraiment, mais chacun est assuré que quelque chose va se lever dans ce rien en équilibre précaire, quand bien même ce rien ne se lèvera pas, demeurera en retrait sur le mode de ce qui n’est pas encore.
Car au-delà du blanc sur fond blanc – ou en-deça – on est embarqué, avec le sens qui nous pousse de l’arrière et les choses qui nous attendent au contour. Papillons, coquelicots, mues de serpents ramassés au bord des routes, rouge sang, rouge pourpre, écriture enfin. Voici une macédoine, voici un banc de melons et de pastèques, voilà un jaune d’oeuf et une ribambelle de tessons usés par la mer. Malaxe, malaxe.![]()
Travaux actuels d’Edouard Monot
Exposition du 6 septembre au 5 octobre 2011
Horaires d'ouverture
Mardi au vendredi de 14h à 18h30
Samedi de 10h à 17h
Jean Prod’hom
XCV

La patronne du café est bloquée chez elle à cause d'un lumbago. C'est donc sa nièce qui donne un coup de main, elle s'appelle Betty et a le béguin pour Monsieur Paul, le commercial de chez Progel qui loue depuis quelques semaine une chambre à l'étage. Mais Betty a juré fidélité à Roger, un copain de catéchisme couronné roi de l'abbaye l'année dernière avec lequel elle sort depuis deux ans.
Monsieur Paul surfe bruyamment sur le net, consulte ses mails et met de l'ordre dans ses affaires tout en jetant régulièrement un coup d'oeil du côté du bar, le corps de Betty frémit et son coeur tangue. Roger et ses potes de la Jeunesse sont partis en début de semaine faire de la plongée sous-marine dans la Mer Rouge, mais il pourrait refaire surface à tout moment. Betty a les boules car Roger a l'alcool de palme méchant, elle ne voudrait pas que son retour se termine pour elle en brasse coulée dans le caniveau.
C'est l'heure de la fermeture, Betty tremble, tire les rideaux et ferme le bistrot. Betty mollit, elle finit par suivre Monsieur Paul à l'étage, bien décidée de plonger pour une fois la tête la première dans le stupre, d’y nager une nuit au moins. S’il faut se noyer, que ce soit au moins dans la luxure plutôt que dans le caniveau.
Jean Prod’hom
Dimanche 18 septembre 2011

Les citoyens ont le droit de former des associations pourvu qu'il n'y ait, dans le but de ces associations ou dans les moyens qu'elles emploient, rien d'illicite ou de dangereux pour l'État. Les lois cantonales statuent les mesures nécessaires à la répression des abus.
Cet article 46 de la Constitution fédérale de 1848 est à l’origine de l’épanouissement du buffet de la gare d’Olten.

Personne dans les rues, on a arrosé hier soir sous les cantines la fin de l’été, on cuve ce matin son vin sur les rives de l’Aar, il pleut. La plus grand ville du canton de Soleure n’est décidément plus au centre de l’histoire. Olten ressemble soudain à n’importe quelle autre petite ville. D’ailleurs que reste-t-il à fonder qui n’ait été fondé dans ce buffet calé entre les quais 4 et 7 de la gare ?
Fondé déjà le Club Alpin Suisse, le 19 avril 1863 lorsque des alpinistes venus de toute la Suisse se rencontrèrent ici. Idem pour l’Union ouvrière suisse en 1873, première organisation faîtière des associations du monde du travail, remplacée en 1880, dans ce même buffet, par l’Union syndicale suisse. Conçus ici aussi, devant une bière, le Parti radical-démocratique suisse en 1894, l’Association Suisse de Football en 1895, la Fédération des Églises protestantes de Suisse en 1920. C’est dans ce café encore que des universitaires décidèrent en 1935 d’inventorier les dialectes parlés en Suisse allemande et que, dans les années 1970, un groupe d’écrivains sécessionnistes se réunissaient : Max Frisch, Nicolas Bouvier, Daniel de Roulet qui avaient pour but la réalisation d'une société socialiste et démocratique.

C’est encore à Olten, mais contrairement à ce qu’on croit, de l’autre côté de l’Aar, qu’a été fondé en 1918 le Comité d’Olten, dans une Maison du Peuple dont on ne trouve aucune trace dans la vieille ville. Aucune rue qui rappellerait son oeuvre, aucun monument, aucune plaque commémorative. Pas trace non plus de son président fondateur, Robert Grimm. On va devoir se faire son propre cinéma...
La gauche et la droite ont voté les pleins pouvoirs au Conseil fédéral en 1914, mais les conditions économiques et sociales qui se sont imposées pendant les années de guerre ont conduit la gauche et les syndicats à durcir leur position. Les effets de la guerre aux frontières et les tensions sociales sévissent donc aussi en Suisse. Le 4 février 1918, à Olten donc, dans la Volkhaus, Robert Grimm, conseiller national, réunit autour de lui un groupe constitué de syndicalistes et de socialistes qui s’engagent à défendre les intérêts des ouvriers. Le Comité d'Olten présidé par Grimm menace le Conseil fédéral d’en appeler à la grève si des mesures politiques, économiques et sociales ne sont pas prises contre la hausse des prix. Il s’indigne en outre du fait que le Conseil fédéral enfreint l’article 48 de la Constitution en autorisant les polices cantonales à surveiller les rassemblements publics.

La droite s’inquiète sérieusement lorsque des employés de banque, le 7 novembre 1918, font grève à Zurich pour demander une augmentation de salaire et prie le Conseil fédéral d’envoyer des troupes. C’est chose faite, si bien qu’en réponse le Comité d'Olten appelle à une grève de protestation le samedi 9 novembre. Tout se déroule dans le calme, mais le dimanche, des affrontements entre manifestants et soldats ont lieu à Zurich. Le Comité d'Olten appelle alors à une grève générale dans l'ensemble du pays, assortie de revendications. Plus de 300 000 ouvriers – sur 800 000 – se rassemblent le 12 novembre, au lendemain de l’armistice. Des trains sont bloqués, l’alimentation de certaines entreprises sont coupées.
Le 13, le Conseil fédéral adresse à Grimm un ultimatum, exigeant une reddition sans condition. Les soldats reçoivent l'ordre de tirer pour disperser les manifestants : une personne est blessée. Le jour même, le Comité d’Olten, refusant de livrer les masses sans défense aux mitrailleuses, cède et vote la reprise du travail. Cette décision est proclamée le 14.

A la sortie de ce bras de fer, une partie de la gauche du parti socialiste fonde le Parti communiste suisse qui va adhérer à l'Internationale communiste. L'aile droite de la droite crée de son côté la Fédération patriotique suisse – au buffet de la gare d’Olten évidemment – et durcit ses positions. Celle du parti radical fait sécession et se constitue en Parti des paysans, artisans et bourgeois, qui deviendra Union démocratique du centre en 1971.
Quant à Grimm, il est condamné à 6 mois de prison. Pourtant, certaines des revendications du Comité d’Olten sont immédiatement acceptées : en 1919, l'élection du Conseil national au scrutin proportionnel permettra une progression du nombre de parlementaires de gauche et l’accession d’un second socialiste au Conseil fédéral. La semaine de 48 heures est acceptée cette même année dans toutes les entreprises publiques ou privées.
La grève générale de 18 aura eu également des conséquences à long terme : la création d'une assurance-vieillesse et survivants sera acceptée en 1947, l’assurance invalidité en 1960, le droit de vote et d'éligibilité des femmes enfin, mais seulement hier, en 1971.

Le souvenir de ces événements, la crise des années 30 et la menace des dictatures conduisirent les partenaires sociaux à signer en 1937 la Convention de Paix, c’est-à-dire à se retrouver au buffet de la gare d’Olten autour d’une bière plutôt que de recourir à des moyens violents pour résoudre les problèmes sociaux.
Jean Prod’hom
Il y a les branches alourdies des pommiers

Il y a les branches alourdies des pommiers
la reconstruction des contextes
il y a l’union syndicale
les oiseaux migrateurs
les librairies de province
il y a le chemin qui disparaît derrière la colline
les cartes postales colorisées
les buffets de gare
les mots sans suite
Jean Prod’hom
Portes d'automne

C’est le dernier moment pour ramasser ce qui traîne dans le jardin, avant que les feuilles du tilleul, celles de l’érable, des foyards et des chênes ne les ensevelissent : la brouette, les outils laissés devant l’atelier, la trottinette de Lili... et la neige finira le travail. Dans quelques jours on aura tout juste le courage d’aller chercher les derniers oeufs au fond du jardin. Il nous faudra attendre le printemps pour aller au bout du monde.
Les enfants jouent au lit et leur mère dort. Leurs chicanes étouffées, le silence et la pluie sur les tuiles molletonnent ce premier des mauvais jour. On voyait hier soir sur le Jura les nuages dans le ciel annoncer la nouvelle et emmener la belle saison. Ce matin, en lançant le premier feu dans le poêle, j’ai donné mon accord à ce contre quoi il ne sert à rien de s’opposer. C’est fait, il convient désormais de s’y faire : les poules se réjouissent de la terre meuble, on devine la couleur d’or et l’odeur de miel des chanterelles d’automne.
Et puis il suffira de laisser l’échelle dans le verger pour aider les saisons à tourner rond.
Jean Prod’hom
Arasement

Les événements étaient bien trop rares pour que les notables désignent un fonctionnaire préposé à leur collecte et à l’organisation de leur succession, bien trop rares pour qu’on imagine la poursuite d’une histoire qui se désagrégeait aux abords de la ville, si bien que les employés communaux, à la tombée du jour, n’en faisaient que des petits tas gris qu’on escamotait dans des containers au cours de la nuit.
Des mèches de cheveux jonchaient les devantures des barbiers et les bordels n’avaient plus ouvert leurs portes depuis que les derniers clients avaient trouvé la porte close, mais les échelles demeuraient appuyées aux ruines – il faut dire que les pachons tenaient encore bon.
Conservées au centre de la place les cendres autour desquelles s’était tenu il y a longtemps le dernier conseil des guerriers. On avait placé sous les chenaux rudimentaires de l’hôtel de ville de vieux casques rongés par le vert-de-gris pour récupérer l’eau des averses destinée à nourrir les anciens faits d’arme enterrés dans le jardinet jouxtant le cimetière désaffecté, mais personne n’avait eu le courage de tenir cet engagement. Rien ne poussait plus sur les rebords des fenêtres des petites maisons de la place, ni coton brodé ni clochettes domestiques.
Plus rien à distribuer et aucun ennemi à houspiller. On parlait pourtant, mais la peine ouverte et à voix si basse que les intentions anciennes, encalminées dans les boîtes crâniennes, n’ensemençaient plus que des terre-pleins sur lesquels on marchait avec la crainte de se faire remarquer. Parfois pourtant, un vent de folie soufflait, et l’on assistait craintif au spectacle de l’un d’entre nous traversant les vieilles dalles de la place de l’église sans toucher ni aux joints ni au lézardes. C’était le seul plaisir qu’on s’octroyait, à tour de rôle. Car plus personne ne se rendait plus jusqu’au front de mer pour noyer son désarroi dans le fracas et l’écume des vagues, trop risqué.
On avait renoncé depuis longtemps à devenir l’égal des dieux qui désertèrent un beau matin l’île qu’ils avaient honorées, un peu par ennui. Qui se souvient des aigles et des tigres ? On fait disparaître aujourd’hui à grands frais les plumes des grands oiseaux voiliers apportées par le vent dont on garnissait autrefois les coiffes de nos enfants. Oubliés les pagnes, oubliés les glaives. Nos ruminations bavent sur les saisons et les colonnes brisées ont perdu de vue leur chapiteau. La descente aux enfers des collectivités est aussi longue que leur éclosion.
Jean Prod’hom
Une seule journée

« Ce qui a le plus changé dans ma vie, c’est l’écoulement du temps, sa vitesse et même son orientation. Jadis chaque journée, chaque heure, chaque minute était inclinée en quelque sorte vers la journée, l’heure ou la minute suivante, et toutes ensemble étaient aspirées par le dessein du moment dont l’inexistence provisoire créait comme un vacuum. Ainsi le temps passait vite et utilement, d’autant plus vite qu’il était plus utilement employé, et il laissait derrière lui un amas de monuments et de détritus qui s’appelait mon histoire. (...) Peut-être cette chronique dans laquelle j’étais embarqué aurait-elle fini après des millénaires de péripéties par « boucler » et revenir à son origine. Mais cette circularité du temps demeurait le secret des dieux, et ma courte vie était pour moi un segment rectiligne dont les deux bouts pointaient absurdement vers l’infini, de même que rien dans un jardin de quelques arpents ne révèle la sphéricité de la terre. Pourtant certains insignes nous enseignent qu’il y a des clefs pour l’éternité : l’almanach, par exemple, dont les saisons sont un éternel retour à l’échelle humaine, et même la modeste ronde des heures.
Pour moi désormais, le cercle s’est rétréci au point qu’il se confond avec l’instant. Le mouvement circulaire est devenu si rapide qu’il ne se distingue plus de l’immobilité. On dirait, par suite, que mes journées se sont redressées. Elles ne basculent plus les unes sur les autres. Elles se tiennent debout, verticales, et s’affirment fièrement dans leur valeur intrinsèque. Et comme elles ne sont plus différenciées par les étapes successives d’un plan en voie d’exécution, elles se ressemblent au point qu’elles se superposent exactement dans ma mémoire et qu’il me semble revivre sans cesse la même journée. »
Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, 1967 (Folio 2008, 218-219)
Dimanche 11 septembre 2011

Muet, immense et vide, le ciel éponge chacun des douze coups de midi. Puis plus rien ou pas grand chose, la journée va s’étaler ainsi tout le jour. Pourtant on entend sur le gravier de la terrasse du restaurant des pas hésitants qui se rapprochent. C’est une vieille que son fils suit à contre coeur. Il a quitté son appartement cossu du centre-ville, a bu l’apéro avec des amis, a réveillé sa langue pâteuse et fielleuse avant de frapper à la porte de l’établissement médico-social situé à la lisière du bois d’où l’on voit le clocher de l’église. Il y a placé sa mère avec son consentement, comme il dit à chaque coup d’un air entendu. Ils se rendent comme chaque dimanche dans la grande salle de l’unique restaurant de la région, ou dehors si le temps le permet. Plus de deux ans qu’il se livre à ce manège, il aimerait tant s’en débarrasser une bonne fois, il étouffe mais elle respire.
Ils ne se sont encore adressé aucun mot. Elle lui demande pourtant à voix basse un coup de main pour s’asseoir, mais il n’entend pas. Elle ne peut rien faire sans lui, il se décide enfin à la débarrasser de ses cannes, il déplace même la chaise d’osier. Bien sûr il voudrait s’en débarrasser mais pas comme ça, ça ferait mauvaise façon. Tant qu’il y aura du monde il ne le fera pas. Et il y a toujours du monde, il a peur seul avec sa mère.
Elle, elle le comprend, le fils, mais elle s’en fout, tellement il est loin d’elle. D’être traitée comme du bétail ne l’offusque pas, elle ne lui en veut même pas, mais comprendra-t-il un jour, l’idiot. Elle préfère la belle brise et le soleil de septembre lorsqu’ils font la pair. Il y a tant de place sous le soleil.
Il n’a plus besoin d’elle, ça elle le sait, et il le vérifie chaque dimanche, ces dimanches il en a besoin pour le vérifier. Que fera-t-il de ses dimanches lorsqu’elle sera morte ? Ça, il ne le se demande pas, il n’ose pas le penser. Elle, quoi qu’il en soit, vivante ou morte elle l’aime comme un fils. Et s’il mourait, elle serait un peu triste, c’est sûr, mais elle n’y pense même pas.
Le fils a une quarantaine d’années et une petite entreprise, il ne fait l’impasse sur aucune des odieuses remarques qui lui viennent à l’esprit, pour qu’elle se rende compte qu’elle est cette charge qu’elle pourrait lui éviter. Il voudrait sincèrement qu’elle comprenne qu’elle est de trop. Elle, elle entend bien mais ne veut rien savoir. Il y a quelque chose entre eux qui les sépare, quelque chose qui n’est pas la même chose, si bien qu’aucun d’eux ne comprend ce que l’autre dit, ils parlent une autre langue, chacun sur son île.
Il pense aux tâches qui l’attendent, elle est déjà un peu dans l’éternité, c’est comme si elle s’en foutait de tout, elle le laisse dire, ne l’écoute pas vraiment, ou d’une oreille, lui pose de temps en temps une question venue de nulle part, que satisfait n’importe quelle réponse, des questions et des réponses blanches pour l’apaiser parce qu’il ne supporte pas leur silence. Quant à elle, ce qui est sûr et ça lui suffit, c’est qu’il paiera l’addition du menu qu’elle a choisi, sa retraite est si maigre.
Regardez-les sur sur la terrasse, ils ont tous les deux les mains vides, mais écoutez, ce n’est pas le même vide. Que se passera-t-il lorsqu’il s’apercevra, l’âne, qu’il n’aura pas été de n’être pas encore et qu’il n’a jamais connu sa mère ? Il ne sait rien de la suite. Elle, elle est d’après la fin, c’est une revenante, il y a longtemps qu’elle a accepté de voir filer le train, mais elle revient chaque dimanche sur le quai, grâce à son fils, goûter un peu de l’éternité.
Jean Prod’hom
Il y a les poignées de main

Il y a les poignées de main
l’orage quand il s’éloigne
les lézards
il y a les récolteuses de tabac autochargeuses
le bleu du ciel
les fagots
tes rondeurs
il y la sobriété des armoires vaudoises
les tas de briques
Jean Prod’hom
Lutte contre la terreur

C’était un samedi soir, un soir de fête et de commémorations. Ils mangeaient et buvaient sous la tonnelle, grisés par une brise de septembre.
On leur annonça pourtant vers minuit que des hommes ivres et violents rôdaient dans la région et s’approchaient dangereusement des lieux de leurs festivités. Ils décidèrent alors, par précaution, de se retirer à l’intérieur et de fermer toutes les issues, les portes, les fenêtres, les stores, les volets, pour maintenir la violence de ces individus à bonne distance.
Par prudence ils avaient renoncé à faire la lumière sur quoi que ce soit de crainte d’être vus, de parler par crainte d’être entendus. Ils avaient entamé une guerre à durée indéterminée contre un ennemi inconnu, personne n’ouvrait lorsqu’on frappait à la porte. Le temps passa et les suspects s’éloignèrent, ils l’ignorèrent.
En fermant leurs vies à double tour, les pauvres avaient ouvert une brèche à une autre violence, brute, sans fond. Dans la petite propriété, seul un poirier japonais avait fait bande à part dans un clos en ruines.





Jean Prod’hom
A.12

Il y a peu, les services juridiques des officines de gardiennage de la bienséance publique ont demandé aux commissaires d’une exposition consacrée à Jacques Tati d’effacer la pipe de Monsieur Hulot de leurs affiches promotionnelles au motif qu’elles contrevenaient aux dispositions d’une loi sur l’incitation au tabagisme.
Faut-il s’attendre désormais à ce que les conservateurs de nos musées se débarrassent des toiles de Matisse et de Bonnard qui présentent, plein février, des battants de fenêtres largement ouverts sur la campagne ou l’océan sans personne alentour pour les fermer, au motif qu’elles contreviennent au principe d’économie ? Car enfin, s’il est opportun, pour des raisons d’hygiène et de santé d’aérer régulièrement nos locaux, il est contraire au principe de précaution, largement partagé aujourd’hui, de laisser à journée faite les fenêtres de nos maisons grandes ouvertes.
Jean Prod’hom
Il y a la fronde des innocents

Il y a la fronde des innocents
le formica
les boutons d’or
il y a la vigne qui pleure
la métamorphose des sentiments
les longues balades d’arrière-saison
il y a les mots-sentinelles
le pain et le chocolat
le grincement des portails la nuit
il y a ce qu’on ne saurait oublier tracé dans la poussière des établis
Jean Prod’hom
XCIV

Ils sont une ribambelle, Eliott, Jérôme, Louise et les autres, affairés au centre de la place sur laquelle s’arrêtent les bus scolaires. Accroupis, ils grattent consciencieusement le terre-plein, ils ne m’ont pas vu. Mais lorsque je m’approche pour les embarquer à la maison, ils se relèvent précipitamment, un silex tranchant à la main. Quel mauvais coup préparent-il ?
- Que faites-vous Louise ?
- Papa, on libère les cailloux.
Jean Prod’hom
Dimanche 4 septembre 2011

Ils ont l’un et l’autre le teint des Burgondes et l’embonpoint des laissés pour compte, gros et gras, une crevette rose à leurs pieds. Ils ne sont presque rien et le savent, ni ne le crient ni ne s’en plaignent, à peine surpris d’être là comme la plupart d’entre nous. Coudes croisés on babille maigre, filet d’eau et rouge de banquet, avec la certitude qu’elle et lui seront bientôt chez eux. Plus tôt que prévu car, de fil en aiguille, ils ont passé en revue les reliefs de leur coin de pays, un fond de vallée où il n’y a rien et d’où on ne sort pas. Pour aller où ? Des lentes ont recouvert leur enfance, l’histoire s’affiche sur les lambris des écuries.

J’imagine la carcasse de leurs rêves, les sillons nés de leurs caresses, leurs amours copieuses. Pas une fleur sur la table, leurs mains qui froissent la nappe rugueuse, un imperceptible empressement pour tout et pour rien.
Les deux ménagent dans le tableau qu’ils me destinent de grands vides, si bien que je distingue le froissement des feuilles des aulnes, le tremblement de celles des bouleaux, vois les tourbières et les deux ponts sur le ruisseau. La rondeur de leur vie ne connaît pas la presse, ce sont des fidèles, héros qui s’ignorent, des presque rien au mot bref. Ils ont endigué les vagues menaçantes de leur rêves d’enfant, ils croquent aujourd’hui à pleines dents une pâtisserie qui étouffe leurs envies. Pas de recette pour un telle vie, ils la tiennent de qui la tient de qui l’avait.

Nés là ils ont commencé à sécréter dès le berceau l’histoire simple qu’ils emmènent où qu’ils aillent sur la terre inondée. Au mur de la chambre une bibliothèque avec les mémoires d’un octogénaire, un recueil de poèmes, un ouvrage sur la faune et la flore, de la place encore pour un livre de sermons et un mot sur la tombe. Le temps ne passe plus dans ces villages, on y vit dans des maisons cossues d’où l’on voit les roues immobiles des vieux moulins, les étalons courent dans les pâturages, les fous de la région tentent de revenir sur leurs pas dans les cloîtres des anciens couvents. Plus personne n’a droit au chapitre, le colporteur qui devient notaire n’est plus qu’un rêve.
Les rivières filent à ciel ouvert dans les village, sans s’arrêter, avant de s’abandonner dans les prés, avec des méandres et de petites cascades qui réjouissent, les dimanches après-midi, ceux qui vivent et vont mourir dans les montagnes du Jura.
Jean Prod’hom
Faire voir l’île derrière l’île

Le poème maintient hors de lui ce qu’il a en vue, le repousse au large lorsqu’il croit le toucher, c’est ainsi qu’il l’accueille. Il a, on le devine, des affinités secrètes avec la théologie négative, mais son tracé s’interdit toute négation quand bien même il en use parfois. Il s’écrit dans la nuit qu’il grave les yeux grand ouverts.
Sa tâche se révèle impossible, c’est pour cela qu’il se satisfait si souvent de la brièveté qui abandonne l’évidence, trop à l’étroit, sur son chemin d’erre. C’est dire que le poème ne touche à rien : il a les mailles si larges qu’il laisse tout passer, et s’il faut recommencer, il recommence parce qu’il lui appartient de faire voir l’île derrière l’île.
Jean Prod’hom
L'autre île

« ... quand il comprit soudain la cause de son éveil tardif : il avait oublié de regarnir la clepsydre la veille, et elle venait de s’arrêter. A vrai dire le silence insolite qui régnait dans la pièce venait de lui être révélé par le bruit de la dernière goutte tombant dans le bassin de cuivre. En tournant la tête, il constata que la goutte suivante, apparaissait timidement sous la bonbonne vide, s’étirait, adoptait un profil piriforme, hésitait puis, comme découragée, reprenait sa forme sphérique, remontait même vers sa source, renonçant décidément à tomber, et même amorçant une inversion du cours du temps.
Robinson s’étendit voluptueusement sur sa couche. C’était la première fois depuis des mois que le rythme obsédant des gouttes s’écrasant une à une dans le bac cessait de commander ses moindres gestes avec une rigueur de métronome. Le temps était suspendu. Robinson était en vacances. Il s’assit au bord de sa couche. Tenn vint poser amoureusement son museau sur son genou. Ainsi donc la toute-puissance de Robinson sur l’ile – fille de son absolue solitude – allait jusqu’à une maîtrise du temps ! Il supputait avec ravissement qu’il ne tenait qu’à lui désormais de boucher la clepsydre, et ainsi de suspendre le vol des heures...
Il se leva et alla s’encadrer dans la porte. L’éblouissement heureux qui l’enveloppa le fit chanceler et l’obligea à s’appuyer de l’épaule au chambranle. Plus tard, réfléchissant sur cette sorte d’extase qui l’avait saisi et cherchant à lui donner un nom, il l’appela moment d’innocence. Il avait d’abord cru que l’arrêt de la clepsydre n’avait fait que desserrer les mailles de son emploi du temps et suspendre l’urgence de ses travaux. Or il s’apercevait que cette pause était moins son fait que celui de l’île tout entière. On aurait dit que cessant soudain de s’incliner les unes vers les autres dans le sens de leur usage – ou de leur usure – les choses étaient retombées chacune de son essence, épanouissaient tous leurs attributs, existaient pour elles-mêmes, naïvement, sans chercher d’autre justification que leur propre perfection.. Une grande douceur tombait du ciel, comme si Dieu s’était avisé dans un soudain élan de tendresse de bénir toutes ses créatures. Il y avait quelque chose d’heureux suspendu dans l’air, et, pendant un bref instant d’indicible allégresse, Robinson crut découvrir une autre île derrière celle où il peinait solitairement depuis si longtemps, plus fraîche, plus chaude, plus fraternelle, et que lui masquait ordinairement la médiocrité de ses préoccupations.
Découverte merveilleuse : il était donc possible d’échapper à l’implacable discipline de l’emploi du temps et des cérémonies sans pour autant retomber dans la souille ! Il était possible de changer sans déchoir. Il pouvait rompre l’équilibre si laborieusement acquis, et s’élever, au lieu de dégénérer à nouveau. Indiscutablement il venait de gravir un degré dans la métamorphose qui travaillait le plus secret de lui-même. Mais ce n’était qu’un éclair passager. la larve avait pressenti dans une brève extase qu’elle volerait un jour. Enivrante, mais passagère vision. »
Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, 1967 (Folio 2008, 93-94)
Dimanche 28 août 2011

C’est à Biasca que le Brenno cesse de sautiller sur le granite qu’il a chantourné pour disparaître dans les vieilles eaux du Ticino. Fini son travail de creuse commencé au Lukmanier. C’est à Biasca que les chansons du val Blenio prolongent un peu leur vie, c’est à Biasca que Vittorio Rè, Ezio Rossetti, Guido Pellanda, Esmeralda Guidotti, Giuseppina Delmuè, Enrica Zanga, Laura Jradi, Pietro Monighetti, Olindo Rodono, Lorenzo Carobbio les ont remises, avant qu’elles ne disparaissent, à Remo Gandolfi, Luisa Poggi, Aurelio Beretta, Gianni Guidicelli et Francesco Toschini. Dans l’ancien cimetière les visages bientôt effacés des ouvriers du Gothard et de leur veuve fondent dans la pierre comme des osties. Plus personne sur les chemins des Grisons, le silence y pâture, on n’y mâche plus guère les vieux noms au goût âpre.
Vox Blenii, Il prigionero, A dieci ore, 1994




Les enfants allaient autrefois se baigner au Ri della Froda qui descend de la Cima di Biasca, dans une baignoire qu’on peut rejoindre en longeant les 14 stations du chemin de croix. Je m’y rends aujourd’hui, caracolant sur un sentier qu’éclairent les châtaigniers, un peu au-dessous de l’ancien aqueduc tracé dans la pierre.
Les pieds dans l’eau, la tête dans les mains, les odeurs confondues de la transparence et du fer, les tourbillons assourdissants, le vent dans le dos, j’imagine absent le ciel à l’envers.
Vox Blenii, Son deciso di montare, Polenta gialda, 1997




Jean Prod’hom
Il paraît qu’il faut rentrer

Il paraît qu’il faut rentrer, mais rentrer où ? Restés dedans auprès des nôtres le temps des vacances, il est plutôt temps, grand temps de sortir, sortir au grand air de l’autre temps, celui qui dure, où se déroule ce à quoi on ne songeait pas et avec lequel on va avec soi hors de soi
De l’air, de l’air, de la légèreté. Mais comment sortir où que ce soit avec sur le dos de tels fardeaux ? Combien de livres inutiles, lourds à crever et qui durent, des livres pour sauver l’apparence ou fédérer nos appartenances, des livres-musées sur lesquels on émousse ses dents, des livres-signes. Personne n’y est jamais entré, rien n’en est sorti. Où êtes-vous puissants récits écrits sur les ailes du papillon ?

Jean Prod’hom
Il y a la retenue

Il y a la retenue
les coups du sort
le lent épanouissement des combes alpines
les nuits éclairées par nos lampes de chevet
les choses qui vont par deux
il y a les galets
il y a les cloîtres
il y a les cols
il y a le corset des conventions lorsque son laçage mollit
Jean Prod’hom
XCIII

- Maman ! c’est vraiment énervant, c’est comme si j’avais du caca de nez dans les oreilles.
- Mais non Lili ! c’est là pression, ça va passer. Essaie de bâiller, ça ira mieux.
- J’arrive pas.
- Alors fais bouger ta mâchoire inférieure horizontalement.
- Horizontalement ? Comprends pas ! Et ça devient vraiment énervant, très énervant, de plus en plus énervant ! tu n’aurais pas des cure-dents pour les oreilles ?
Jean Prod’hom
Quitter le giron

Pour Marine H
Il était midi sous un soleil de plomb. On grimpait à flanc de coteau au sommet du Kahlenberg, pas loin du Leopoldsberg d’où Charles V de Lorraine, le roi de Pologne – Jean Sobieski – et leurs 20 000 cavaliers étaient descendus au galop pour mettre fin, en 1683, à la seconde occupation de Vienne par les Turcs. Ce n’est pas sans mal que nous avions quitté le centre ville où nous logions pour la semaine. Il avait fallu s’orienter dans la complexité du centre historique sur lequel la rose des vents ne règne plus, choisir celui des nombreux bus qui passaient au pied de notre hôtel, enfiler le Ring dans le bon sens, ne pas se tromper dans les correspondances successives, monter dans le tram dans le sens qui convenait, pour atteindre enfin le pied du Kahlenberg.
Les difficultés qu’on éprouva pour nous arracher du centre de la ville impériale sans nous égarer fut d’un autre type que celles qu’on endura pour parvenir au sommet de la mémorable colline. Je songeai, chemin faisant, à l’aisance avec laquelle Charles de Lorraine et Jean Sobieski avaient fondu sur leurs ennemis, empruntant les premières sentes à peine visibles, tout en haut, qui conduisaient à des chemins plus bas un peu plus larges, à double ornière bientôt, route puis boulevard menant au camp des Ottomans.
Tous les chemins en effet mènent à Rome. Mais comment quitter Rome ? Et où aller ? S’il y a identité formelle entre les trajets qui quittent le centre ville et ceux qui y ramènent, il n’en va pas de même pour nous les vivants. Si les centres villes attirent ceux qui orbitent à leur périphérie, il est bien difficile de s’en éloigner et de vivre loin de leurs séductions.
Je pris un certain retard et me retrouvai en queue de peloton, rejoint bientôt par une demi-douzaine de filles qui ralentissaient le pas et accéléraient leurs rires pour réduire leur peine. J’y allai de ma contribution.
- Est-il plus aisé de rejoindre le centre-ville depuis un point quelconque de sa périphérie, ou de le quitter pour atteindre un point défini de ses faubourgs ?
Elles sourirent, était-ce pour me faire plaisir ? Le silence s’installa et on marcha quelques minutes. L’une d’elles s’immobilisa enfin et, les mains sur les hanches, répondit.
- Il est évidemment bien plus facile de réjoindre le centre que de le quitter.
Ses camarades partagèrent unanimement son avis. Je leur demandai pourquoi. L’une d’elle me répondit par une formule oubliée mais cousine de l’idée selon laquelle il est plus simple d’aller du simple au complexe, du rare au dense que l’inverse. Je n’osai pas le mot d’anisotropique, mais il me semblait en effet que les propriétés du réseau des chemins dessinés par le pied des piétons changeaient selon la direction du flux.
On se réjouit de cette étrange trouvaille et des corolaires qui fleurissaient. Je leur demandai alors ce qu’une telle réflexion éclairait de leur vie aujourd’hui, elles avaient 15 ans et tout l’avenir devant. L’une d’elles me répondit.
- C’est plus facile de rentrer à la maison que de quitter sa famille.
Je méditai jusqu’au sommet du Kahlenberg, devenu soudain tout proche.
P.S.
Avertissement
Jean Prod’hom
Il y a l’écrin de nos amours enfantines

Il y a l’écrin de nos amours enfantines
les faubourgs
l’oscillation ample du fil à plomb
il y a les poupées de porcelaine
la pénombre des arrière-boutiques
la cueillette des petits fruits
le torchis
il y a les fissures de notre volonté
la création continuée
les vieux établis recouverts de poussière
Jean Prod’hom
Dimanche 21 août 2011

Mégots rivés dans les interstices des pavés, confettis décolorés, ketchup coagulé, le poisseux qui colonise la pagaille, bouteilles vides, couverts enmoutardés, traces de doigt, verres brisés, des rêves en morceaux débordant des sacs à ordures, des odeurs de chair à saucisse. Pourtant le soleil se glisse dans ce saint désordre et éclaire les restes de pain. C’est toujours ainsi que se présentent les lendemains des jeudis saints, lorsque les convives abandonnent tard dans la nuit, dans l’oubli d’eux-mêmes et de l’avenir, la table du festin. Souvenez-vous ! On a beau chercher, on se ne souvient de rien.
De quoi ce matin prendre les jambes à son cou, se saisir de la clef des champs et rejoindre le vallon de la Carrouge ou de la Bressonnaz qui se sont levées sur un autre pied.

On reste pourtant, avec ceux qui sont arrivés il y a peu, silencieux, un peu hagards de ne pas savoir par où commencer dans la moiteur estivale. Ça démarre curieusement, par rien ou presque rien, on déplace une ou deux choses, on empile deux chaises, cherche de l’aide, personne, aucune voix pour diriger le chantier. On reprend, il faut s’y faire et commencer par rien, tiens un gobelet fendu, un autre à demi-plein, là-bas un autre encore. Ensemble ils font une petite pile, avec les autres une grande. Il aura fallu prendre par un petit bout pour sortir du fond et faire une saignée dans la débâcle, les assiettes en carton puis les couverts, les sets de table. Luc recueille les bouteilles vides dans des caisses, un balai émerge, c’est Marc qui s’en empare. Tiens les tables sont libres, Line porte un seau d’eau chaude qu’elle ne lâche pas et frotte les tables de bois. Justine se baisse avec une balayette et une ramassoire. A la cuisine, on fait des sandwiches et la vaisselle.
On a l’impression soudain d’avoir la tête hors de l’eau et la place a bonne façon lorsque les premiers campeurs s’approchent du bar, un café et un croissant, ils soulèvent une paupière, trois thés et deux limonades, tout le monde lève son verre : Donnez-nous, Seigneur, encore de ce pain-là !
La fête peut recommencer, benevolente.







Jean Prod’hom
De l'obscur à l'obscur

Ce que nous enseignent la lecture jointe à l’écriture, c’est l’usage modeste de nos deux mains sans lequel personne n’aurait la possibilité d’avancer, bancal et désorienté, et de passer, gauche et droit, de l’obscur à l’obscur. Le courage aussi de ne pas nous reposer sur l’idée qu’une voix autorisée viendra nous livrer un jour le fin mot de ce quelque chose sans nom qui élargit son empire, s’ouvre comme une fleur en se fragmentant dans un silence assourdissant, rythmant l’étendue de son insubordination en la communiquant à l’innocence du monde qui nous happe et nous enjoint de le servir.
Nous ne pourrons naturellement exclure que nous avons été victimes d’un quiproquo ou le jouet d’un plan divin compatible avec notre folie, et que tout s’effondre. Mais qui nous le dira ? Et cette parole nous délivrera-t-elle du désastre ? Soyons donc assurés que l’entreprise n’a pas été vaine, et que nous avons, les bras au large, frôlé et longé plus d’une fois ce qui aurait pu être s’il en avait été comme nous avons tenté de le dire.
Jean Prod’hom
Lire désorienté

Le temps passe mais, après avoir lu les trente premières pages d’Un peu plus loin sur la droite de Fred Vargas, je me souviens ce soir d’une conférence d’Antoine Compagnon qui développait l'idée, somme toute assez classique, qu'on entre dans un roman désorienté, comme dans un espace jusque-là inconnu. Le lecteur avance, hésitant, dans un monde dont les règles qui président à son organisation et à sa compréhension demeurent obscures d'abord, s'éclaircissent le plus souvent ensuite. La cohérence du roman – l'ensemble des actions qui s'y succèdent et l'espace dans lequel celles-ci s'inscrivent – n'est pas donnée au lecteur dès le commencement; celui-ci y accède au fil des pages, après quelques lignes souvent, parfois jamais. Antoine Compagnon dit le bonheur de cette désorientation initiale et l’avancée stupéfaite du lecteur, s'il y consent, dans un monde sans ordre apparent.
Lire n'est donc peut-être que l'histoire mouvementée d'une conquête, celle d'une cohérence qui n’a jamais été, que postule celui qui écrit ou qu’il diffère sans fin. Il en irait de même de nos vies éclairées par la littérature : protégées contre vents et marées par une cohérence supposée, ou interminablement exposées à la désorientation, en tous les cas jusqu’à la fin, comme Kehlweiler, entre méthode et cafouillis.
Jean Prod’hom
En danger critique d'extinction

L’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) lance un cri d’alarme : la BO7 sauvage est en voie d’extinction. On n’en dénombrait plus que quelques-unes sur l’ensemble du territoire vaudois en 2010. On tente le tout pour le tout avec les derniers spécimens nés en captivité.

Jean Prod’hom
8 juillet 2011
Open space

Dix heures ce matin, vent d’ouest et ciel dégagé, c’est un temps à faire le tour du lac de Sauvabelin : pas un chat, ses poissons rouges et ses ânes, ses biches, ses chèvres, sa barque et sa terrasse. Mais il y a, à deux pas, une maison de maître qui accueille jusqu’à l’automne quelques-unes des peintures acquises par Arthur et Hedy Hahnloser pour leur villa Flora à Winterthur. Je renonce au menu fretin du lac pour le gros poisson de l’Hermitage.

Henri Matisse, Nice cahier noir, 1918, huile sur toile, 33 x 40,7
Le linge pend aux balcons et les peintures des grands maîtres sèchent, il ne faut pas les toucher. Toutes les fenêtres sont ouvertes ; les cadres imposants, souvenirs d’une autre époque, obligent le regard à se porter dedans, empêchent de déborder sur les côtés. On est soudain dehors, les rideaux frémissent ; dans le parc un ou deux visiteurs ont cédé au charmes d’août, les essences rares mêlent leur frondaison au bleu du ciel ; au-delà le haut de la cathédrale qui surplombe la ville, derrière le pigeonnier et l'orangerie, la ferme, la pelouse pour les maîtres de maison et dans leurs souvenirs une plage, c’est un matin frais d'août ou les premières chaleurs de février, la porte en bas qu'on laisse ouverte, et le bleu qui vire au turquoise. Je m’assieds sur l’un de ces bancs qu’on met à la disposition du visiteur, si inconfortable qu’il n’y reste que le temps de noter dans son carnet ce qui ne cesse de s’échapper.
Pour le reste des merveilles, les intérieurs de Bonnard qui m'ont rappelé l'univers disparu de mes grandes-tantes, Lucie et Augusta : les tapis sur le plancher encaustiqué, les passementeries, le velours des fauteuils, leurs regard sur les choses et le mien, les nappes à carreaux, les fruits et les fleurs, la lumière, les tapisseries, la lumière surtout. Elles vivaient elles aussi dans un cadre doré, à Villarzel, en un lieu où le temps ne passe pas, avec leur nécessaire de couture, un tub et de l’osier, un fourneau à pierres ollaires et des livres à dessus de cuir. Mais en voyant les jarretières rouges dune femme qui s’éveille dans une chambre en désordre, je me prends à penser que derrière leurs allures de vieilles filles accomplies se cachaient de vives envies.
Rien ne bouge dans ce sous-marin, les tableaux et les fenêtres hermétiquement closes se succèdent, le temps reste pris dans le filet des natures mortes, à l’intérieur, à l’extérieur, sur le seuil et derrière les visages. Pour les voir il faut sortir.
Accoudé sur le muret qui borde le lac j’aperçois des iris d’eau, personne.
Jean Prod’hom
Il a la 807

Il a la 807
les filets de pêche qui sèchent au soleil
la santé des finances publiques
il y a la parabole du fils prodigue
la boussole
il y a le poing dans dans ta poche
le ciel qui laisse passer l’orage
la débâcle
il y a les balivernes de mon pote
Jean Prod’hom
Dimanche 14 août 2011

Il est temps de reprendre les quelques notes prises il y a deux semaines dans l'atelier de Florence, déposées à la va-vite dans un carnet de moleskine noire et de les verser, avant qu'elles ne prennent la consistance du cuir, sur la page blanche d'un traitement de texte, comme des morceaux de glaise humide sur un châssis, d'en modifier l'ordre si une nécessité de premier ordre s'en fait sentir et de les fixer avec le pouce en deux ensembles distincts de part et d'autre d'un point de tangence énigmatique qui doit piloter l'entreprise de l'arrière. Un point que je devine, chargé de promesses, mais qui ne les aura tenues que lorsqu'il aura fixé, à la fin, le sens de l'entreprise et son allure.

S'ébauche alors une forme compacte à double foyer, sans porte ni fenêtre, deux sphères posées côte à côte, étrangères l'une à l'autre. Cette forme devrait à la fin s'approcher d'une ellipsoïde de révolution parcourue, sans que le lecteur ne s'en avise vraiment, d'un réseau de relations liquides qui assureront l'équilibre et le clapotement de la signification.
Enlever, ajouter, battre, pétrir, creuser, vider, associer, lisser, intercaler, détailler, éliminer, retourner, couper, rassembler, permuter, affiner, répéter, pousser, enrouler, soulever, glisser, emboîter, consolider, entailler, éloigner, rapprocher, détacher, pincer. guillocher, modeler, rapatrier, affermir, éliminer, griffer, inciser, souder, mêler, apprêter, mesurer, compter et toujours éviter la casse.
Rédiger donc, à cheval sur midi, la vingtaine de lignes demandées qui présenteront les travaux d'une potière de la région exposés à Mézières à la fin du mois. Ça en fera une quarantaine, impossible de faire mieux, c'est à prendre ou à laisser.
Jean Prod’hom
Combe de l'A

Un courant d’air
écarte les hauts de pierres
c’est un aigle
qui remonte à grand coups d’ailes
la combe de l’A
il te frôle
immense et discret
à la verticale du disparate

adossé au mur de pierres sèches
du refuge au toit de lauzes
tu existes un peu
comme lui à peine
Jean Prod’hom
Le Toûno

Dans le val d’Anniviers, les mélèzes renoncent à leur ascension au-delà de 2400 mètres. Ne survit alors qu’un immense chantier au-dessus duquel traînent parfois des lambeaux de nuages qui s’évanouissent sitôt qu’ils touchent la poussière de la terre maigre que de rares sentiers griffent, déchirent, et que taconnent des lacs solitaires et pensifs, c’est un chantier de vieilles moraines que noircissent des torrents plus durs et noirs que l’ivoire.

Pourtant là-haut on vient de loin. Deux bonnes heures séparent l’Hôtel du Weisshorn du lac Toûno, bonnes et belles heures qui, remontant le torrent des Moulins, vous rapprochent du bas du ciel. Sous les collets rongés des Pointes de Nava, le vert maigrit et colle à l’ocre, je marche soudain dans les mousses, sur un tapis lunaire tendre comme un pubis. Les fleurs ont la tête en l’air, les joubarbes, les raiponces et les linaigrettes, les roches la tête dure, gros dés de granit, restes d’un repas céleste.
On arrive là aux marches de ce qui s’habite, lichens, coraux, couronnes, bris et miettes, chardons inhospitaliers, monde illisible en marge de ce qui se raconte, pas même un puzzle, mais un saint désordre de pierres sèches que fait tenir ensemble un silence sans attache.

Il faut compter une heure encore avant d’atteindre le sommet du Toûno. Et là, à 3000 mètres, tout en haut de l’échine de l’endormie une pointe émoussée, la roche à vif, il n’y a plus rien, à peine une place pour se reposer et un cairn qui vous rappelle que d’autres ont passé avant vous. Un peu plus loin on aperçoit le blanc sale de la langue des glaciers, plus haut encore les abîmes et le bleu chirurgical des crocs des séracs.


On verra au retour des papillons, un faucon crécerelle et une marmotte. Tout en bas dans l’étroite vallée l’autre chantier, le petit, en sursis.
Jean Prod’hom
Il y a les nuages quand ils s’emportent

Il y a les nuages quand ils s’emportent
les linaigrettes
les roues de charrette abandonnées
il y a la couleur des fruits du sorbier
les conversations de part et d’autre des clôtures
l’austère vie des marmottes
il y a la mutité des chats
les chèvres de partage
le temps qu’il fait
Jean Prod’hom
Un bouquet de coquelicots

Si Claude Monet a beaucoup voyagé – l’Algérie, l’Italie, la Hollande, la Norvège... –, les peintures que Pierre Gianadda propose à Martigny du 17 juin au 20 novembre 2011 ne nous font guère aller au-delà du clos : Vétheuil, Argenteuil, Londres à peine et un peu de Provence... Elles font voir la maison du peintre, l’allée, une gare, une barque. Et dans le jardin les images premières de mon abécédaire : l’étang, les nénuphars, le peuplier et le saule, l’olivier et le palmier, la rose et l’iris, le chrysanthème, le pont et l’allée. Le peintre les explore matin et soir, été comme hiver, sans fin. Les choses bougent, l’ombre voisine avec le scintillement, les miroitements et l’irisation, et puis il y a la débâcle et l’inondation qui recouvrent tout. Impossible de mettre la main sur rien, alors Claude Monet recommence, que peut-il bien faire d’autre ?

Le Champ de coquelicots près de Vétheuil, peint en 1879 et figurant sur la première page du catalogue et les innombrables affiches de l’exposition nous offre une belle leçon d’histoire : cette peinture, volée au printemps 2008 et retrouvée quelques jours plus tard sur le siège arrière d'une voiture stationnée dans le parking de la clinique psychiatrique de Burghölzli, est invendable, aussi invendable que les improbables bouquets de coquelicots que préparent les quatre femmes près de Vétheuil, fanés sitôt faits. N’en tireront fortune que les fabricants de puzzles et les empailleurs d’éphémères, les vendeurs de sandwichs, les assureurs, les bouchers. La campagne publicitaire bat son plein à Martigny, tous les commerçants se sont donné la main.












Jean Prod’hom
Dimanche 7 août 2011

Il se confectionne des chewing-gums avec des grains de blé, de la salive et un peu d’ivraie. Il sait qu’on ne sait jamais exactement où l’on est, mais ne s’en inquiète pas outre mesure, ou juste ce qu’il faut. Arthur ne connaissait pas Etagnières mais a repéré le château-d’eau de Goumoens d’où rayonnent bien des choses du canton, n’est pas mécontent qu’on ne fasse pas un détour pour jeter un coup d’oeil au retable de l’église d’Assens, n’hésite pas à couper à travers les champs moissonnés ou les prés fauchés. Arthur évalue curieusement les distances et le temps, goûte aux équilibres précaires, débusque les grenouilles au bord de l’étang. Il aime jouer à l’aveugle, démêler les pas des chevaux pour connaître leur nombre et imaginer le visage de leur cavalière. S’en fout cordialement du tumulus celte du bois des Allemands, imagine les églises bien plus grandes qu’elles ne le sont, va nus-pieds sur le bitume. Il se demande jusqu’où se prolonge la mine à Nichet creusée dans la molasse près de Malapalud, planifie son retour dans le coin, avec une lampe de poche, le plus tôt possible lorsque je lui apprends que Nichet a creusé cette grotte pour récupérer le trésor de l’ancien château de Bottens.






Arthur se prend d’amitié pour un cheval à la sortie de Bottens, qui la lui rend bien, n’est jamais effrayé par l’idée de quatre heures de marche, regrette comme moi les bistrots fermés le dimanche, les terrasses désertes du Gros-de-Vaud au mois d’août, aime les chemins de terre, à l’ombre lorsque le soleil tape, désespère autant du silence des fontaines que de la qualité douteuse de leur eau quand elle coule. Saute de pierre en pierre dans le Talent en espérant un faux pas, et son ombre qui s’amuse le tire vers le haut.
Jean Prod’hom
Sébastien Chabal et moi on se ressemble

C’était samedi soir la fin du stage de préparation du Racing Metro 92, une équipe dont j’ignorais tout jusque-là, comme du rugby dont ces grands gaillards passionnés ont fait leur gagne-pain. Non, je ne connaissais pas Sébastien Chabal, sportif préféré des Français que les journaux locaux nous ont fait connaître les jours passés.

L’équipe s’est en effet arrêtée dans la région pendant une semaine et, pour la soirée d’au-revoir, à Ropraz chez Jean-Daniel. A cette occasion, Arthur et Yann avaient été invités à faire une démonstration de trial. Mais les sportifs, qui avaient déjà commencé à fêter la fin de leur séjour dans la grande salle de Corcelles-le-Jorat, n’avaient pas fini leur bière si bien qu’ils sont arrivés avec du retard, beaucoup de retard, alors que la nuit tombait déjà. Il a fallu s’y faire et comprendre encore une fois qu’on n’est pas le centre du monde. Arthur et Yann ont finalement fait leur démonstration dans la pénombre, éclairée par les encouragements, les rires et les rengaines. Tout le monde était je crois aux anges, ils étaient une bonne soixantaine, joueurs et membres de l’encadrement. Je suis sûr qu’Arthur se souviendra de cette soirée, de ces grands gaillards insouciants, rigolant comme des enfants.

Et puis Sébastien Chabal et moi, je crois qu’on se ressemble. C’est un passionné, moi aussi ; il a une fille qui s’appelle Lily Rose, moi aussi... enfin Lili tout court. On a tous les deux des carrières professionnelles qui s’achèvent, Sébastien Chabal n’a pas de regret, il a un compte twitter et une page facebook. Je ne vois qu’une seule grosse différence, il a accepté de figurer au musée Grévin ; vous allez me dire que les choses peuvent encore changer, c’est vrai. J’ai dit à Louise que j’étais content de l’avoir rencontré, alors on a fait une photo. Quand on les a tous quittés tout à l’heure, ils chantaient à tue-tête, s’amusaient et buvaient. La fête risque d’être longue. Pourvu qu’ils ne cassent rien, le monde est si fragile.
En rentrant j’ai lu les twitts de Sébastien Chabal pour savoir comment il voyait le coin. Ça fait un joli texte je trouve.
Direction Lausanne, stage d'avant saison avec le Racing
Lausanne aussi c'est valonné
Et ne venez pas me dire que je ne suis pas affûté
La montagne ça nous gagne
Après un bivouac d'une journee en montagne
Après les sprints en côte dans les bois, la récompense
J’aime bien Sébastien Chabal, il me donne envie, ce soir, de lire quelques pages de Robert Walser.
Jean Prod’hom
Léviathan

« Attends ! » chuchota Louise en se dirigeant vers le salon dont elle ferma délicatement la porte. La chère enfant avait-elle deviné les sombres pensées qui m’agitaient ce soir-là ? Délaissé sans raison par l’inspiration, je souffrais en effet depuis quelques jours mille maux. Et, tandis que j’entendis grincer les tiroirs du meuble de typographe dans lequel je conserve d’inutiles trésors, je songeai à la mort. Je m’étais approché tout près de la nuit qui ne finit pas lorsque Louise réapparut. M’étais-je assoupi ?
– C’est pour toi papa, et pour Franck, Joël, Hélène, Joachim, Myriam, Estelle, Michel, Camille et les autres.
– Mais qu’est-ce que c’est ?
– La bête qui vous dévore.

Jean Prod’hom
11 juin 2011
Il y a la demi-lune

Il y a la demi-lune
les chambres d’hôtel
la respiration des gros actionnaires
il y a le thym
la neige qui épaissit le silence
les vieux qui tiennent inexplicablement debout
il y a les fourrés
la nuit la nuit
le jour le jour
Jean Prod’hom
Lundi 1 août 2011

En revenant cette nuit de la fête du premier août organisée à la Moille-aux-Frênes, on voyait les étoiles et ça sentait le foin. Mais parce que la fête nationale tombe cette année un lundi et en raison de décisions administratives, j’ai vécu dimanche comme un samedi et pris lundi pour un dimanche.
Je suis à la Mussilly lorsque le soleil se glisse dans les allées creusées par les chemins, et de fines poussières d’or piquent de gros grains le vert encore sombre des bois. J’avance comme un grand, fier même, heureux d’être accueilli par les oiseaux tandis que le gros de l’espèce fermente dans son clos. Vanité des vanités, un peu trop fier si bien que les choses se retournent et que je me sens soudain incapable de me glisser dans le lit du jour, inquiet de ne pas être à la hauteur et mis en demeure de répondre de ma présence. Devenu d’un coup petit parmi les grands, fautif et présomptueux, je réplique, balbutie. Que dire à celui qui m’interroge et qui avance dos au mur des origines, sans avance et sans retard, sans lassitude, au tempo de l’eau et du vent ? Pourquoi ai-je donc hier soir tourné le dos à la nuit ? Puis-je saisir quoi que ce soit du jour en gardant les yeux ouverts et de la nuit en dormant ? Serais-je donc de ceux que la nuit lasse ?
Cette voix n’avait pas tout à fait tort de m’interroger de la sorte mais je ne la suivis pas et pris un chemin de traverse qui suffit à me mettre à bonne distance d’une discussion juste mais sans fin.

Pendant ce temps le jour s’était installé, j’ai longé l’allée qui conduit au cimetière où l’on avait préparé une nouvelle fosse, poursuivi ma promenade en me réjouissant de ces paysages d’un seul tenant dont on fait, pour passer le temps, des puzzles de 1000 pièces. En remontant du Torel, la pirouette et l’andéneuse avaient préparé les lignes d’une page sur laquelle, comme d’habitude, rien ne serait écrit.
Jean Prod’hom
XCII

L’affaire eut lieu, dit-on, le premier août 1291 sur les rives du Lac des Quatre-Cantons et, comme chaque année, on s’est tous retrouvés hier soir autour d'un feu de joie pour commémorer les miracles de cette vieille alliance. On a chanté à tue-tête l'Hymne national, je me suis enflammé, à mes côté Jean-Rémy chantait en playback.

Sur nos monts, quand le soleil
Annonce un brillant réveil,
Et prédit d'un plus beau jour le retour,
Les beautés de la patrie
Parlent à l'âme attendrie;
Au ciel montent plus joyeux
Les accents d'un coeur pieux,
Les accents émus d'un coeur pieux...
C’est à cet instant précis que j’ai eu la malencontreuse idée de marcher sur le lacet de la chaussure de Jean-Rémy qui m’a lancé un regard noir en serrant les dents. Ça y est, j’étais fait, j’allais devoir répondre de cette incivilité. Par bonheur je dispose d'une excellente assurance juridique. Ainsi ici, ainsi ce pays...

Jean Prod’hom
De ma lucarne

Laisse dériver les lambris vernissés, les rouleaux de bande à masquer, les plinthes et les baguettes d’angle, laisse les choses se défaire, cale le safran et tourne l’espagnolette vers le large. Car ce matin on se baigne dans les plis d’août que dénoue la brise, nus dans le jour bleu qu’accueillent les ébrasures de la fenêtre taillées dans l’épais. Ecoute en-bas le claquement des sabots du cheval sans son maître, ce matin le jour est à marée basse.
Jean Prod’hom
Où poser la tête

Le temps le plus propice pour naître
n’était plus
n’est pas aujourd’hui
La Tour de la Mort s’élève
se voit déjà de partout
n’aura pas sa pareille
En un cercle, un cercle immensément large
des cycles s’achèvent
Des victimes sans tarder, seront là, présentes.
Simultanéité toujours si remarquable
des sacrifiés et des armés

Namur, Place de l’Ange 50
Qu’inventer demain pour s’excentrer avec l’élégance qui sied, l’oeil fixé sur la paix vivace qui attend celui qui aura épuisé toutes les directions, tous les cantons, tous les rêves, ceux du dedans comme ceux du dehors, lorsqu’il sera revenu enfin dans l’improbable prairie où s’efface l’empreinte du pas suivant, d’où il est parti et où les sensations se rassemblent, large, toujours plus large d’allonge en allonge.
Plus besoin de te déplacer, de te dégager, parce que le secret ne se referme pas avec la nuit, je suis voyage en tous sens dans un espace exhaustif. Tu as écrit, traversé le pays des porte-à-faux. Et revenu là où tu ne laisseras pas de trace, dans ce chantier de l’incertain et du contradictoire que survole ton ombre immense, en-deçà des fausses-pistes et des chausse-trappes d’un langage que tu as tordu comme un torchon, tu nous livres aujourd’hui l’autre pays. Là, d’innombrables canaux et maisons si différentes comme aussi l’habillement et l’allure des habitants, appelant l’attention vers d’autres dehors, se structurèrent pour composer un peuple, un pays... se substituant de la sorte à la grande ville borgne d’hier.
Jean Prod’hom
Tout recommencer

Après des ans
des ans comme des jours
l’examen d’admission reprend
Le Gouverneur après ce temps
nouvelle cérémonie est élu commis,
valet ensuite
à présent reçu balayeur
Ainsi de rang en rang abaissé
un jour sera retrouvé aux étables, à la porcherie
Descendra-t-il plus bas ?
On l’y portera...

Second d’une liste de passage qui comprend également ceux à qui j’ai remis il y a un mois à peine une attestation de fin de scolarité obligatoire, j’attends agité. Nous sommes quelques-uns à battre le pavé de la cour qui longe le bâtiment d’en-haut, long et vitré, au pied de la classe du rez-de-chaussée que nous avons occupée trois ans durant, moi comme enseignant et eux comme élèves, vide encore à cette heure, et fermée à clé. Aucune indication sur la porte, personne à l’horizon, ni l’expert ni Monsieur D. – prof de latin au gymnase – qui doivent évaluer notre travail.
Agité, agité plus que les autres, je n’ai en effet pas relu les livres sur lesquels portera l’épreuve, par insouciance ou inconscience, m’en souviens peu ou pas et m’inquiète Et puis ces livres, je ne les ai pas emportés, ignorant où ils se trouvent, disséminés dans la classe ou à la maison. Panique. Je demande à A. de me prêter les siens lorsqu’il aura passé l’épreuve. Cet élève brillant sur lequel j’ai pu autrefois compter fronce les sourcils, froissé, gêné, mais il ne peut rien pour moi, il doit rentrer à la maison sitôt l’examen terminé et remettre ses livres à sa mère. Je désespère de trouver une bonne âme. Planté au milieu de la cour, je mets au point une stratégie pour franchir l’obstacle : choisir une page au hasard et entreprendre consciencieusement le commentaire suivi de ce qui y est écrit, objectivement, l’honneur sera sauf. Une phrase de Michaux citée par Maulpoix me revient à l’esprit : Je ne comprends rien de ce que disent les gens, les auteurs. Il faut que je refasse tout dans la tête. C’est pénible mais c’est peut-être cela l’invention et l’originalité.
Lorsque je relève la tête, plus personne dans le préau, mais des élèves inconnus qui rient aux éclats derrière les fenêtres du rez. Aurais-je dormi tout ce temps ? L’examen se passe ailleurs, Monsieur D. nous avait prévenus, mais j’ai écouté de travers, je n’en souviens maintenant, l’examen a lieu à l’Ancienne Académie, dans le bureau de Monsieur C. dont j’ai suivi les cours de philosophie. Sera-t-il là lui aussi ? Il me faut m’y rendre au plus vite. Je parque mon karting au bas du Valentin, une petite place suffit, la maniabilité de l’engin est extraordinaire, je m’en réjouis, c’est tout ça de gagné. Mais le temps a passé, c’est évidemment trop tard, tant pis, je laisse tout tomber. Il vaut mieux renoncer que de faire piètre figure. Alors tout s’éclaire et s’allège, les nuages s’éloignent, je sors vivant de ce cul-de sac.
Pourtant il me faut du temps pour sortir de cette vilaine nuit et m’assurer que ces examens qui n’auront jamais lieu sont derrière moi. Quelque chose de pénible, d’incompréhensible, de lourd, d’incontournable me poursuit. Et si je constate que ce rêve s’est bel et bien éloigné, il n’en va pas de même de la peur panique qui me suit au-delà du réveil et me pousse dans le voisinage des deux passes qui bornent nos vies, celle que nous noyons dans les cris et les larmes, celle qui nous attend à l’autre bout et dont nous sortirons, je l’espère, moins que rien et silencieux.
Jean Prod’hom
Brève apparition

La scène a lieu dans un préau au centre duquel je donne des consignes à une vingtaines d’élèves, lorsque survient ma mère, morte le 18 juillet 2003, les yeux fixés sur moi, pas revue de la sorte depuis plus de 10 ans. Elle sait, avant même de m’apercevoir, que ce n’est pas exactement le bon moment. Elle en semble pourtant affectée. Son visage muet ajoute qu’elle n’a rien de particulier à me dire et qu’il n’est pas urgent que je la rejoigne, plus tard, lorsque j’aurai un peu de temps et si je le veux bien. Elle s’éclipse discrètement, le dos voûté, baisse la tête pour disparaître dans le tunnel menant au sous-sol de ce qui doit être un stade vide.
Jean Prod’hom
Dimanche 24 juillet 2011

Jusqu’à Namur sous la pluie et sans carte, mais avec le soleil au couchant et la Meuse à l’arrivée, avec la voix du système de positionnement global qui a déroulé ses calculs tout au long du voyage, sans s’interrompre, c’était la première fois. Etrange comme cette voix aplatit le paysage, l’étend en tous sens, pâte fine urbi et orbi. Tu ne roules plus désormais sur du papier, mais du numérique sans pagination, plus besoin de plier les cartes, rien ne dépasse, aucun faux pli, ni amertume ni regrets. Tu empruntes des chemins tracés par Euclide dans un brouillard de pixels, tu y es, mais où es-tu, dans quel imaginaire ?


Il te faut réapprendre à marcher comme il te faut réapprendre à lire, longer la Meuse à pied jusqu’à Namur, retourner à Jambes. Suivre un bout du chemin de halage qui court jusqu’à Charleroi au coeur du Pays Noir que traverse la Sambre. T'imaginais pas, n’est-ce pas ? Il aura fallu que la voix du système de positionnement global te jette là, au coeur de la ville basse de Charleroi, pour que tu comprennes enfin qu’on ne compte pour rien, que tu ne comptes pour rien, nous tous en voie de disparition. Il y a bien la gare à laquelle tu as songé, immobile au-delà du pont qui enjambe la Sambre à l’extrémité de la place Emile Buisset. Mais pour aller où ? La voix du système de positionnement global t’a sommé de faire demi-tour.
Pas d’avenir, on leur en a trop fait bouffer, plus de listes de commissions jetées devant les magasin, plus de magasins. L’infime espoir pourtant que les choses demeurent en l’état quelque temps encore, misérables et vivantes, un pas de porte sur lequel s’asseoir, un mur contre lequel s’appuyer, penser que ce qu’on pense est pensée, et passer sans qu’on ait à décider, mais sans perdre de vue non plus qu’on a gardé en état le poste frontière de Zoufftgen au cas où on serait amenés à de nouvelles déportations. Les cloches se sont tues, plus une brique de vent, un jeune entrepreneur, vue haute, a repeint une roue de pierre sur la façade d’un vieux moulin.


Pas de plaque commémorative pour cette nouvelle débâcle sinon le sourire extatique des épuisés et les murs éventrés des immeubles échangés, c’est promis, contre une autre misère, c’est juré, celle des centres commerciaux. Il n’y a pas de ligne de front pour la misère, fidèle à l’espèce, qui accroît dedans et dehors son empire. Il est 19 heures, ne crains rien, mais ne repasse pas à 23 heures.
Tu auras appris à Charleroi que le Général Comte Letort, l’aide de camp de Napoléon, est mort le 16 juin 1815, deux jours avant la bataille de Waterloo. Tu auras aperçu derrière le suaire du système de positionnement global quelque chose que celui-ci n’a pas entamé, le beffroi de la maison espagnole de Mons et la tour Saint-Jacques de Namur qui sortent le cou, jettent leur tête dans le ciel, les oies qui raient les eaux noires du fleuve, les yeux du mourant sur le seuil de la boucherie de Charleroi, cheveux blanc et sourire d'ange, le silence désabusé de la Meuse et de son affluent la Sambre, le soleil qui revient comme pour la dernière fois.
Jean Prod’hom
40

Aller de l’avant, c’est le prix à payer, mais y parvenir au plus vite pour rejoindre au plus tôt le reste qui est presque tout et que rien ne saurait mettre au pas.
Jean Prod’hom
Rue Marie vierge

Nos existences se sont singulièrement allégées depuis qu'on arrache les unes après les autres chacune des pages de l'histoire brochée de nos villes. On découvre au détour de nos pérégrinations des scénographies inouïes à l'image des vies minuscles de leurs locataires, des blessures béantes cousues main, forcloses jusque-là.
Des restes adhèrent encore comme des chairs molles au recto de vieilles boîtes vides, ce sont celles des fantômes avec lesquels on vivait. Il faut pourtant tourner la page, sans espérer quoi que ce soit de nos anciennes habitudes, ni feuille ni crayon, ni gomme. Plus de réparation mais des marges d'erreur prises en considération avant même de commencer, une succession d'éditions princeps.
A chaque fois il faudra donc tout reprendre sans pagination fixe, condamnés que nous sommes à ne plus pouvoir en sortir et à devoir lire en tous sens. Mon imaginaire oscille, au-delà des images, comme sur un tape-cul.
Jean Prod’hom
Il y a fêtes votives

Il y a fêtes votives
les trains à crémaillère
l'assiduité
il y a les ciels bretons
les échanges bilatéraux
il y a Célestin Freinet
les vers à soie
les magasins Leclerc
les vide-greniers
Jean Prod’hom
Terres d'écritures

Déposer un peu de pigment noir sur le blanc mat et âpre de la porcelaine nue si mal armée, mettre du noir sur du blanc, c'est déjà écrire, n'est-ce pas ? Mais quoi ? Des lettres ou l'alphabet primitif qui les constituent, un mot ou une phrase, quelques-un des noms des anges que mentionne Umberto Eco dans son Vertige de la liste, initiale rouge coquelicot, ou ceux des démons, ceux des étoiles les plus brillantes, une poignée de titres organisant les chapitres des Notes de chevet de Sei Shonagon, ou les bienheureux qui échappent à l'appétit de l'Eisthenes du Quart livre ?
C'est selon, peu importe, car la calligraphie met à l'épreuve la relation première du tracé avec son support, de la lézarde avec le blanc cassant de la page blanche : enfance de l'écriture dans son indécise éclosion d'avant la lettre. Car la vérité est en amont, lorsque l'écriture, avant de faire système, n'était que fêlure, à la fois ruine et anticipation de la ruine, condamnée à briser la belle unité du monde pour la recomposer ensuite. La rencontre de la calligraphie et de la terre cuite était inéluctable.
Ils campent bien avant la lettre, tout prêts de l'origine mais un peu après le bing bang. Le réel et l'écriture sont contemporains et nos constructions tremblent. Pas l'ombre d'un décor, mais la vérité d'un séisme qu'un vase ou une coupe au bord ourlé et âpre contient un instant avant de se briser.
Graphic porcelaine et céramique contemporaine
Du 7 juillet au 28 août 2011
Grignan
Christine Macé
et les calligraphes
•Christine Dabadie-Fabreguettes
•Denise Lach
•Anne Gros-Balthazard
•Kitty Sabatier
Jean Prod’hom
Terres d'écritures
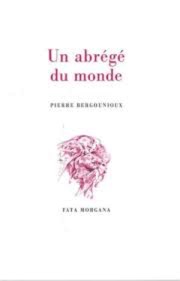
Déposer un peu de pigment noir sur le blanc mat et âpre de la porcelaine nue si mal armée, mettre du noir sur du blanc, c'est déjà écrire, n'est-ce pas ? Mais quoi ? Des lettres ou l'alphabet primitif qui les constituent, un mot ou une phrase, quelques-un des noms des anges que mentionne Umberto Eco dans son Vertige de la liste, initiale rouge coquelicot, ou ceux des démons, ceux des étoiles les plus brillantes, une poignée de titres organisant les chapitres des Notes de chevet de Sei Shonagon, ou les bienheureux qui échappent à l'appétit de l'Eisthenes du Quart livre ?




C'est selon, peu importe, car la calligraphie met à l'épreuve la relation première du tracé avec son support, de la lézarde avec le blanc cassant de la page blanche : enfance de l'écriture dans son indécise éclosion d'avant la lettre. Car la vérité est en amont, lorsque l'écriture, avant de faire système, n'était que fêlure, à la fois ruine et anticipation de la ruine, condamnée à briser la belle unité du monde pour la recomposer ensuite. La rencontre de la calligraphie et de la terre cuite était inéluctable.
Ils campent bien avant la lettre, tout prêts de l'origine mais un peu après le bing bang. Le réel et l'écriture sont contemporains et nos constructions tremblent. Pas l'ombre d'un décor, mais la vérité d'un séisme qu'un vase ou une coupe au bord ourlé et âpre contient un instant avant de se briser.




Graphic porcelaine et céramique contemporaine
Du 7 juillet au 28 août 2011
Grignan
Christine Macé
et les calligraphes
•Christine Dabadie-Fabreguettes
•Denise Lach
•Anne Gros-Balthazard
•Kitty Sabatier
Jean Prod’hom
Dimanche 17 juillet 2011

Deux belles et longues heures sous un parasol aux allures de liseron blanc devant un thé sur la terrasse du Sévigné, une fin de matinée sous une pluie fine, rare dans cette petite ville qui peine à se réveiller; elle disposera après la sieste d'une seconde chance pour se lancer en plein jour, mais sans conviction. Deux coups de tonnerre et les cris d'un enfant à la table voisine – j'ai vu Michel Drucker en vrai – n'y changeront rien.
Voir en vrai ? Je ne les verrai pas, ni ne souhaite au fond les voir ceux que j'imagine désoeuvrés dans un salon plongé dans l'ombre, à deux pas de cette terrasse, le peintre et l'écrivain.
Ils se retrouvent comme chaque dimanche dans la maison du premier, à 11 heures pour un repas maigre et une après-midi qui se prolonge jusqu'au soir, car il ne peint pas plus que lui n'écrit, ou presque plus, ni l'envie ni la force. Leurs compagnes ne sont pas bien loin mais on ne les entend pas, elles n'ont jamais imaginé que les choses puissent s'arrêter, il faut arroser les fleurs et nourrir l'appétit d'oiseau de ceux qu'elles ont servis tout au long de leur vie.
Ils sont seuls dans la fraîcheur d'un salon un peu sous terre qui est comme un centre du monde. Ils ont enfin la vie devant eux, devant eux les jours et les nuits cousus comme un seul jour. Dehors il pleut, ils ne sortent plus, surtout pas le dimanche, ou à contre-temps lorsque le village se ressaisit à l'aube ou au crépuscule des entre-saisons. Ils sont maintenant assis et occupent chacun l'un des côtés d'une longue table sur laquelle traînent les traces d'un repas frugal, les couverts, quelques fruits, deux verres de vin, une carafe d'eau. Ils parlent, sortent de leurs poches profondes des morceaux de souvenir qu'ils déposent sur la table à côté de la corbeille de pain, vieux arbres sans fruits qui ne demandent rien. De la suite il n'y en a que dans le silence, il s'ébroue et les rafraîchit, faufile bout à bout leurs propos qui tombent du ciel comme des samares et les font sourire.
Ils ont l'appétit des oiseaux mais ce sont des géants, modestes et sans crainte dans les long rouleaux du silence, ils détestent par-dessus tout les cris des enfants qui entament leur corps chétif. Ils se ressemblent, se ressemblent tellement qu'on aurait peine à dire qui a écrit et qui a peint, car ils sont d'après, nés de la dernière pluie. Ils vont se coucher les mains vides, un mot parfois, mais vite oublié, ou une idée qui reste sur le seuil.
Ils énumèrent ce qui fut, mais n'évoquent ni la peinture ni l'écriture, ils ne regrettent rien, noctambules du jour c'est ensemble qu'ils se sentent bien, confondus dans l'ombre du salon comme l'inconnu dans la foule. Le reste du temps ils le passent à surveiller ce qui demeure et empilent leurs affaires qui traînent sur les commodes, ils décantent leur vie.
Ils sont comme tous les autres, mais eux sont arrivés à leur fin, ils ont fait un pas de retrait et laissé toute la place au silence qui les a portés, eux et leur folle entreprise, ils sont devenus ce qu'ils ont écrit et ce à quoi ils ont renoncé. Ils le rédigent à leur insu derrière la porte, dans le clair-obscur, et je n'en saurai rien.
Jean Prod’hom
Bédarès

Un petit maître toscan du temps des Lorenzetti conçut une peinture de petit format oubliée dans la réserve d'un musée de la province siennoise que j'eus la chance de découvrir il y a une trentaine d'années. Or un détail de cette peinture m'est apparu distinctement l'autre matin au fond d'un bassin abandonné sur les bords d'un sentier longeant le Lez près de Bédarès. Ne m'est revenu en mémoire que ce détail – l'angle inférieur droit – qu'il m'a suffi de déborder pour retrouver le bateau couché sur le flanc, le vert et l'ocre et, de proche en proche, les restes du vent, l'odeur du goudron, la filasse, le bonheur de peindre, l'arrachement, les jointures et le rivage. Personne dans cette représentation, pas même un nom à l'angle du tableau, mais une main divine.
Jean Prod’hom
(FP) Nos désirs s'étendent au-delà de nous

Être ici et en même temps ailleurs, c'est ce à quoi nous obligent nos vies habitées par le souci de l'avenir, cet état en a rendu plus d'un malheureux. Montaigne dit juste : Nous ne sommes jamais chez nous, nous sommes au-delà. Mais nous devons concéder pourtant que cet inconfort, auquel chacun de nous est tragiquement confronté et qui déroge au sacro-saint principe d'identité sans lequel notre raison ne serait pas, installe d'emblée la possibilité même du temps – l'inquiétude –, et la promesse indéfiniment reconduite d'une résolution, celle de l'irréconciliable – l'histoire. L'écriture, quelle qu'elle soit, n'est rien d'autre en définitive que le procès-verbal des avatars de cette contradiction, le compte-rendu des variations d'une promesse dont l'échéance est constamment différée, C'est pour cette raison qu'on entend sourdre de tout texte une plainte, comme le bruit de la mer du creux du coquillage.
Hormis dans un usage improbable de l'écriture qui, par un retournement dont je ne saisis encore ni la genèse ni la mesure, devient le lieu même où l'au-delà est rapatrié dans l'ici, et la plainte – l'ici rejeté dans l'au-delà – un chant ou le murmure de la mer, et ma vie une averse. (P)
Jean Prod’hom
D'une traite

Frapper à la porte en espérant non pas qu'elle s'ouvre mais que fermée sur le silence qu'elle a préservé du désastre elle vous rappelle que le chemin est encore long et qu'il vous faudra toutes vos forces et du courage pour aller là où l'on ne croise personne et où il n'y a rien sinon d'autres portes fermées chaque jour plus rares qui commémorent ce peu qui fut dans nos maisons et hors d'elles et dont notre âme aura à se satisfaire lorsqu'il n'y aura plus rien.
Jean Prod’hom
Dimanche 10 juillet 2011

On quitte la grand-mère et Chazelles sous la pluie pour un double transfert, de la rive droite du Rhône à la rive gauche aux abords de Vienne, d'en-dessus Valence à en-dessous peu après Loriol. On abandonne le pisé pour les pierres sèches, les pommes de terre pour l'olive, une idée de l'existence pour une autre. Demeurent les stations d'essence, la grégarité, les péages, la grogne et l'euro, les aires de repos, l'ivresse et la vigne, et le lierre qui sont partout. Le soleil a fait le ménage sur la terre comme au ciel et commence à dessécher les ardeurs : on en fera bien moins que ce qu'on s'était promis et on profitera du temps restant pour revisiter un instant l'idée saugrenue et assassine d'en demander autant aux Grecs et aux Portugais, aux Italiens et aux Espagnols qu'aux Suédois.
Les fleurs rouges du laurier battent la porte, la maison est fermée depuis l'Ascension, on en diffère jusqu'au soir l'ouverture complète pour garder dedans cette odeur de puits et le silence qui s'est installé sitôt les volets clos, obéissant en cela à la même loi que la poignée de sable jeté à la mer. Dehors les grappes de raisin pendent lourdes et primitives, les abeilles vrombissent dans la glycine, les cigales et les grillons assurent le contrepoint.
L'ombre est cher, il y a foule au Lez. Mais Lili a repéré dans ses eaux basses et troubles un banc de gros, des gros très gros. Ses cris et l'expédition qu'imaginent alors Louise et Arthur inquiètent les équipages concurrents qui s'éclipsent. Il est temps pour moi d'occuper la place abandonnée par ces pêcheurs de fortune et de lézarder au pied de la pile du pont. Les enfants qui n'en demandaient pas tant m'abandonnent sur la rive de l'autre monde, j'y consens avec l'assurance que la modeste épuisette de chez Leclerc tiendra éloignés le silure et le brochet longtemps encore.
Une sieste, un peu de lecture les yeux mi-clos... mais un peu seulement car il y a du grabuge sur le rafiot. Lili, qui n'a pas bien saisi l'esprit des manoeuvres exigées par le patron de l'équipage et transmises par son second, a été déposée à terre. Il me faut la récupérer et rejoindre les deux autres sur le pont, au plus vite, avant que l'équipée ne prenne le large avec à son bord le scorbut, et rétablir la paix sans recourir à l'injuste courte paille.
C'est fait mais le mal aussi. Je prends donc les commandes de l'embarcation et ramène tout ce petit monde au port où les attend leur mère, elle n'aura pas à les consoler, ils ont déjà oublié leur pêche miraculeuse, ils rêvent à d'autres achats chez Leclerc.
Jean Prod’hom
Il y a les murs de pisé

Il y a les murs de pisé
le brie
la grâce qu'on frôle parfois
il y a les vessies natatoires
la fraîcheur piégée au plus fort de l'été
la leçon des gens qui ne nous portent aucune attention
l'abondance
la truite qui mord
les interminables vaisselles
Jean Prod’hom
Deux fois l'an

La vieille s'est levée avant tous les autres et les attend de pied ferme dans la fraîcheur d'une cuisine d'un autre temps. Elle a dès sept heures fait le gros dos pour endurer les mille maux qui l'assaillent et parasitent le marbre de son corps usé. Lorsque je la vois, elle a déjà fait le gros de la journée : sa toilette d'abord, le point sur l'actualité ensuite. Elle est montée en ville acheter une baguette, a terminé, au pas encore, la lecture du Dauphiné qu'elle partage avec son voisin. Lui reste l'imprévu auquel elle adresse derrière ses volets clos un salut ironique.
Ce matin la vieille attend. Elle attend, car aujourd'hui c'est jour de fête. Sa petite-fille – la fille de son fils – et ses trois petits-enfants dorment à l'étage. Il sont venus la veille, comme chaque année, la saluer de l'étranger. ils dorment bien là-haut, dans les monts du Lyonnais, c'est ce qu'elle se dit et s'en réjouit, car c'est un peu elle, chez elle. Elle est assise à l'extrémité d'une chaise, sur un petit qui vive, guette les bruits, prête à les accueillir et à leur sourire. Elle languit, mais sans précipitation, de les voir autour de la table. Lorsqu'ils déjeuneront, elles regardera les enfants, un peu dépitée qu'ils mangent si peu, elle s'en faisait une fête. Mais elle oubliera bien vite car l'humeur de ces vieux-là se refait derière eux comme la mer après le passage d'un bateau. Ils passeront la journée ensemble, puis une seconde nuit avant de se quitter le matin suivant jusqu'à l'automne. Tout est réglé, de la salade de haricots au jambon, à l'os pour l'occasion, le téléjournal avec le fromage blanc, les filles qu'on met au lit et l'aîné qui regarde Fort Boyard. Demain on ira à Courchau chez sa fille, la soeur du père de la mère des trois petits.
Je fais un saut en ville, quelques lignes de Montaigne sur une terrasse, tout le monde dort quand je reviens. Il y a eu un gros orage, la pluie n'a pas lâché la maisonnée, la terre est grasse. On repart avec quelques pommes de terre, courgettes et carottes du potager.
On se reverra à l'automne, au jour de la fête des morts, lorsque la vieille ira fleurir la tombe de son fils au bord du lac Léman. Elle dormira chez nous deux nuits. Et comme chaque fois qu'on se quitte, elle pleure à l'idée que c'est la dernière. Les choses iront ainsi jusqu'à ce qu'elles n'aillent plus. Dans la voiture, près de Feurs, les enfants l'ont oubliée, mais je sais pourtant qu'elle est entrée dans ces lieux qu'ils ignorent encore, depuis dix ans, par petites doses, deux fois l'an, là où on est chez les autres après notre mort, là où sont les êtres qui ne sont pas encore nés, jusqu'à ce que, disparue de chez les disparus, elle n'ait de place que diffuse, ténue, dans la mémoire infiniment complète du dernier homme.
Jean Prod’hom
Entre le Riau et le Torel

Plus d’un sage a loué son allure, sa légèreté, sa vivacité, sa fidélité aussi. Elle constitue peut-être ce qu’on peut faire de mieux au cours de notre existence, mais celle qui nous accompagne ne nous appartient qu’à moitié. Appendice d’une autre nature, elle est comme un rebord de nous dans le monde, ce qui nous y tient, ce qui coule de nous en lui et qui remonte pour nous y attacher par un bout. Elle est peut-être, s’il en faut, la plus haute des preuves de notre existence et de nos relations.

Elle fait un peu peur, te regarde tandis que tu gesticules, ou te tourne résolument le dos quand elle enfonce son nez dans le bitume.
J’aime les grandes ombres, démesurées, et les ombres joueuses qui font de nous des pantins au mouvement imprévisible, anges noirs libérés de la gravitation. J’aime aussi les ombres la nuit, les innombrables petites ombres nées de soleils de fortune, pâles copies, fantômes tremblants, ombres sans amarres, flottantes, indécises, qui rappellent lorsqu’on ferme les yeux la fragilité de nos existences.



Jean Prod’hom
39

On reviendra demain, et on remontera la Corcelette, à l’ombre, jusqu’à la grande cascade. Et plus tard, juste avant d’avoir froid, pendant que tu joueras sur la place de jeux devant le collège avec Roxane et Louise, sous le soleil, j’irai chercher la voiture qu’on aura laissée près du pont sous le cimetière.

Jean Prod’hom
Dimanche 3 juillet 2011

Quelques rires encore puis plus rien, sinon le bruit de l’eau et l’ombre, et la fraîcheur qui peinent à se faire entendre ou qu’on devine à peine. Tous trois se sont éloignés et, de fil en aiguille, ont disparu en amont derrière les branchages qui encombrent le lit de la rivière. Arthur est grand, pas d’inquiétude. Et puis il suffit de laisser faire la rivière qui les tient en laisse.
Me marre en lisant adossé à un hêtre quelques pages du texte que Cendrars consacre dans la première partie du Lotissement du ciel à Joseph de Cupertino, patron des aviateurs. Les choses, c’est-à-dire les faits historiques, biographiques, littéraires, les souvenirs – les vrais et les faux – les canulars, les procédés littéraires, les citations, les réflexions sont si bien huilés ensemble qu’on peut marcher léger dessus et qu’on finit par éprouver un plaisir comparable à celui qu’on éprouve lorsqu’on marche sur l’eau.
M’égare pourtant à vouloir suivre l’esprit de Cendrars qui s’égare à vouloir suivre, situer, identifier, localiser la survie d’une main coupée qui se fait douloureusement sentir, non pas au bout du moignon ni dans l’axe radial ni dans le centre de la conscience, mais en aura, quelques part en dehors du corps, une main, des mains qui se multiplient et qui se développent et s’ouvrent en éventail, le rachis des doigts plus ou moins écrasé, les nerfs ultasensibles qui finissent par imprimer à l’esprit l’image de Çiva dansant qui roulerait sous une scie circulaire pour être amputé successivement de tous ses bras, que l’on est Çiva, lui-même, l’homme divinisé. M’arrête là, renonce à le suivre vers la fin et reviens à la survie d’une main coupée qui se fait douloureusement sentir,..., en aura, quelques part en dehors du corps, en éventail. Je m’en souviendrai ce soir.
J’ai beau appeler, les enfants ont disparu quelque part en dehors de moi, les voici coupés de ma sphère d’influence. Et l’angoisse monte comme la marée, il faut faire vite. Trop tard, serait-il trop tard ? Lili s’est noyée dans le go sous la cascade, Arthur ne l’a pas aidée, qu’elle se débrouille, elle l’a assez enquiquiné les jours passés. Pauvre Lili, pauvre Arthur, pauvre Louise qui ne sait pas trop bien quoi faire, pauvre de moi. Que vais-je dire à leur mère ? Peut-on vivre après une telle tragédie ? C’en est fait de moi, amputé d’un coup de mes trois enfants et de ma femme, il faudrait... Miracle ! les voici, la moyenne en éclaireuse, la petite dans les bras du grand, tous trois revenus de nulle part. Quel bonheur ! Quelle belle après-midi !

On se retrouve plus tard sous le cerisier, les fruits sont bien visibles, rouges et immobiles, c’est tout simple de les pincer et de les croquer, on ne dit pas assez cette facilité. Et quoi qu’il se passe dans l’avenir, de la forme que prendra l’étau administratif et policier, tu te rappelleras qu’il avait été facile un jour de manger des cerises à même l’arbre, de regarder se former un essaim d’abeilles ou de tremper tes pieds dans la rivière. N’est-ce pas ?

On rentre à pied de Froideville, avec les ombres qui s’allongent, on traîne le pas parce qu’on discute et qu’on discute de la mort. Arthur pense qu’il reste quelque chose après notre disparition, moi aussi, mais on ne sait pas exactement quoi, ni l’un ni l’autre. Je lui rappelle alors une conversation que nous avions eue il y a bien des années déjà. Il semble aujourd’hui comprendre ce que je voulais dire, je lui parle alors du texte de Cendrars lu ce matin. J’éprouve un certain bonheur à marcher ainsi en parlant de la mort. En revanche le gaillard est un peu moqueur avec les croyants, moi pas. Je le lui dis, je trouve même qu’ils ont une certaine chance, une telle confiance donne un sacré courage, quand bien même ils ne sont à l’abri de rien. Sans compter que ce dont ils sont dépositaires en arrière de ce qu’ils disent, avec les mécréants, les athées ou les agnostiques qui se taisent n’est rien d’autre que le peu dont nous disposons pour penser notre condition et le monde qui nous entoure.
Des circonstances divines ont voulu que nous interrompions soudain cette sainte conversation.





Jean Prod’hom
Il y a la rose des chantiers

Il y a la rose des chantiers
la chair de l’abricot
le vol du pic épeiche
il y a la chambre du fond
le matin du premier jour
il y a l’inconnu du vendredi qui débarrasse la table du jeudi saint
les colères enfantines
le vol instantané des abeilles
il y a les comptes-à-rebours
Jean Prod’hom
38

Pas de livre
ce matin
branle-bas devant la maison
les enfants mangent
des cerises à pleines mains

Jean Prod’hom
Initiation à l'art du porte-à-faux

Pour Anouck
L’une des missions essentielles de l’école est d’initier ceux dont elle a la charge à l’art du porte-à-faux, en les obligeant à répondre simultanément et continûment à deux exigences que tout oppose : prendre la mesure des connaissances fixées par la société des savants dans les domaines bien circonscrits d’une encyclopédie partagée mais toujours déjà désuète et éveiller leurs conciences en y instillant un doute radical dont l’application résolue les conduira au seuil d’un territoire sans cadastre, aux propriétés inconnues, d’où ils auront, jeunes encore, à dessiner de nouveaux horizons et à la table duquel ils auront à écrire les récits et les mythologies de demain.
Aider les géniteurs à faire de larves aphasiques, en moins de dix ans, des adultes polyglottes, telle est sa tâche. En leur donnant assez de confiance pour que, assistés de leurs petits courages et de savoirs-faire confinant souvent au déraisonnable, ils soient en mesure de s’écarter des normes de la cohorte, abandonner le paradigme dont plus rien ne sort, s’avancer en des lieux que ne rend familiers aucun jeu de questions et de réponses. Pour que ces femmes et ces hommes nouveaux soient prêts à retrousser les impasses, à penser l’inconcevable en nouant ses mailles et donner une chance au réel et à ce qu’on n’imaginait même pas.
Vaste programme pour un impossible métier, d’autres l’ont dit. L’école n’a en effet jamais été à même de répondre à cette double tâche, pas plus que l’histoire n’a su éradiquer le mal ou assurer le progrès promis. Idée régulatrice cependant qui anime l’enseignant qui enseigne. Personne n’a donc rencontré les demi-dieux de cette mythologie. Parfois pourtant la chance est là et le pédagogue en rencontre une incarnation, assez solide pour accepter les dures exigences qui nous viennent de l’ancien et suffisamment fragile et légère pour s’élever dans le ciel et tenir sous ses ailes le nouveau paysage.
J’en ai rencontré une. Elle éclairait tout ce qu’elle touchait, s’affairait avec un soin qui nous ramenait aux grands travaux des temps anciens : respect des règles, des traditions, respect des personnes, des textes, respect du temps, des lieux,... non pas que cet asservissement assouvît ses désirs, mais parce qu’il constituait comme une ascèce préparatoire, une propédeutique à la grande aventure de la pensée dans laquelle elle s’engageait naturellement, avec la discrétion de ceux qui volent haut et qui voient grand angle. On la voyait là préparer l’avenir, s’assurer de la nature de chacune de ses parties, de leurs relations, quêter d’autres ordres, reprendre s’il le fallait ces travaux de l’esprit qui vont à la vitesse de l’éclair, un éclair qu’on apercevait briller dans ses yeux rieurs. Ne s’agissant pas de puzzle, il n’y avait ni pièce manquante ni clé de voûte, mais elle savait que ce qui vaut la peine d’être fait est ce qui ne l’a pas été. Elle allait vent arrière dans le silence, en équilibre sur deux pieds de sa chaise ou la tête plongée dans son ombre, toute à elle-même au service de quelque image qu’on peine à dire. Alors on devinait que la grâce devenait une propriété de la pensée et, sur le visage de cette jeune fille fragile et déterminée, le porte-à-faux donnait lieu à une danse réglée et aventureuse.
P.S.
Avertissement
Jean Prod’hom
Combat de reines en Lacanie

Elles s’appellent Paméla, Pivoine, Tundra, Katchina ou Pigeon, Baticha ou Palma, Choupette ou Eden, Vendée, Sirène, Violine, Java, Muscade ou Coucou, Lara, Violette, Flora, Baya ou Pakita, mais elle s’appellent aussi Bagherra, Comanche, Cheyenne, Pagaille, Bulldozer ou Dynamite. Ne nous y trompons pas, c’est ainsi qu’on commémore au printemps le combat de titans que se livrent là-haut sur la montagne l’imaginaire et le symbolique dans l’arène du réel.

Jean Prod’hom
29 mai 2011
Virevoltant au-dessus des ornières

Pour Lea
On pourrait ne pas prendre acte de leur existence, car elles délaissent au cours de leurs premières années le centre, où qu’elles soient, à ceux et à celles qui ne peuvent pas vivre loin des projecteurs. Et tandis que, un peu maladroites, elles butent contre les plinthes en caressant de l’épaule les murs blancs, elles regardent intriguées et naïves les ambitieux monter à l’assaut de la citadelle. Sans bien comprendre.
Elles n’en veulent pas à la bande de sauvages qui s’approprient le langage et le monde qui va avec, elles leur lancent même parfois un sourire qui les apaisent un instant. Qu’on les laisse tranquilles. Pourtant ne croyez pas qu’elles sommeillent, elles butinent sans effrayer personne, discrètement. Tout est si fragile, alors n’en rajoutons pas. Et tandis qu’elles vont sur la pointe des pieds, leur esprit vif pince le tout-venant qu’elles remontent à tire-d’aile, de quoi faire un nid dans lequel elles accueilleront plus tard ceux qui viendront. Elles vont assurées, assurées de ce qu’elles peuvent mais incertaines de ceux qui les entourent, reines, reines, reines sans couronne.
Et soudain, sans avertir, voici qu’elles se mettent à parler, à dire ce qu’il était temps de dire. Ce sont ces voix que tout le monde attendait, présentes lorsqu’on en a besoin, lorsque le mauvais temps s’installe, voix longtemps tues, hésitantes autrefois fermes aujourd’hui, pleines de cette sagesse qui ralentit le carrousel de nos existences, voix apaisées vers lesquelles les visages marqués par le désarroi se tournent, patientes, inébranlables.
C’est dès le début, lorsque je l’ai vue il y a longtemps déjà, se confondant avec l’air qu’elle touchait à peine que je compris qu’elle était de cette race-là. Tout dans son être était retenue, de son poignet fin qui virevoltait comme une hirondelle près de son épaule, à ses paupières qu’elle fermait lentement pour ne pas froisser l’air qui l’entourait. Elle était comme ces feuilles solitaires que le vent porte et qui tombent sans bruit sur le miroir de l’étang.
Je la soupçonnais parfois de ne pas être parmi nous, feignant de nous écouter pour ne pas blesser notre amour-propre, bercée par le vent du large, attachant bout à bout des bouts de pensée lointaine qui plus tard constitueraient non pas un conte de fées mais ce foyer qui ménage une place à ceux qui auront à reprendre ce qu’on leur a laissé.
Elle n’était jamais là où l’on croit, c’est-à-dire là où elle était, ne s’offusquait pas du tour que prenaient les événements si bien que, quand bien même elle ne le voulût pas, elle rendait idiots ceux qui croyaient qu’elle pût être ailleurs ou qu’il pût en être autrement.
Elle fut certainement dans une des vies qui précéda la sienne un de ces papillons blancs qui accompagnent l’été le promeneur sur les chemins forestiers, insaisissable, le précédant sans le laisser s’approcher, fragile et obstiné, virevoltant à midi au-dessus des ornières, à deux pas du promeneur qui sourit.
P.S.
Avertissement
Jean Prod’hom
Dimanche 26 juin 2011

Doulce mémoire en plaisir consommée
O siècle heureulx que cause tel scavoir.
La fermeté de nous deux tant aymée,
Qui à nos maulx a sceut si bien pourvoir,
Or maintenant a perdu son pouvoir
Rompant le but de ma seure esperance
Servant d’exemple à tous piteux à veoir.
Fini le bien le mal soudain commence.
Pierre Sandrin a mis en musique Doulce mémoire, un huitain attribué à François Ier, auquel Hugues Salel répond peu après en composant une jonglerie musicale, un rebours dont la principale caractéristique est de faire apparaître le premier vers à la fin et le dernier au commencement.
Finy le bien, le mal soudain commance;
O cueur heureux, qui mect à nonchaloir
La cruauté, malice et inconstance,
Qu’on voit souvent au féminin vouloir
La méprisant ne se pourra douloir:
Car la vertu croistra sa renommée,
Luy despartant pour si loyal devoir
Doulce memoire en plaisir consommée
On a beau retourner les choses en tous sens, le dernier vers du huitain ne dit rien d’autre que ce qui est toujours déjà en route. Devenu premier vers du rebours il rappelle ce dont il est la fin, avec entre deux ce que la mémoire retient des plaisirs aux extrêmes de la lucidité. La fin est au commencement, on peut le regretter mais la vie n’est pas un palindrome, condamnés à s’y faire au plus extrême de la joie comme au plus profond de la peine.

Allons! ma belle commencer à ramasser l’herbe, le jour tombe, la nuit commence, on finira demain lorsque se lèvera l’aube. Ainsi passent nos jours.
Jean Prod’hom
Tendreté de la pierre

Il est, écrit Ovide dans sa douzième métamorphose, au milieu de l’univers, entre l’océan, la terre et les plaines célestes, sur les confins des trois mondes, un lieu d’où se voit tout ce qui se passe en tous lieux. C’est la demeure de la Renommée, mille issues, mille ouvertures nuit et jour, jamais de silence, jamais de repos. Elle répand le bruit que des vaisseaux grecs arrivent, raconte le sanglant prélude des combats, ce que peuvent les Troyens, le sang sur les rivages du Sigée, les exploits de Cycnus qu’aucun javelot ne transperce, le bouclier d’Achille fait d’airain et de dix cuirs, la cuirasse et la poitrine de Ménætès.
La Renommée raconte encore le repos d’après les premiers combats, le long entretien des chefs des Grecs et les récits que leur fait Nestor : les noces de Pirithoüs et d’Hippodamie, l’ivresse des Centaures qui, enflammés par le vin, abusent des invitée, la résistance de Thésée – l’ami de Pirithoüs – qui arrache Hippodamie des mains du centaure Eurytus, lui fait vomir sa cervelle broyée au milieu du sang et du vin, les combats qui suivirent, les os fracassés du visage de Céladon, le menton fracassé d’Amycus qui vomit ses dents brisées, les yeux de Grynée percés par les bois d’un cerf, la tempe de Charaxus frappée par un tison, l’épieu qui pénètre Rhoetus à l’endroit où le cou se joint à l’épaule, le glaive de Dryas atteignant Crénéus entre les deux yeux, à l’endroit où le nez se joint au front, le fer qui s’enfonce dans le cou d’Aphidas, la lance de Pirithoüs clouant la poitrine de Pétreus à l’arbre qu’il étreignait, cette même lance ressortant par l’oreille gauche d’Hélops, l’immense Bianor que Thésée saisit par les cheveux et dont il brise les durs os du crâne.
C’est cela qu’Ovide, la Renommée et le vieillard de Pylos racontent, les durs combats des Grecs et des Troyens, ceux des Centaures et des Lapithes

Antonio Canova, Thésée luttant contre le centaure Biénor, Kunsthistorisches Museum
Mais dans le creux de chacun de ces récits, ils nous font entendre la tendreté de la pierre, le robuste genou d’Achille qui presse la poitrine de Cycnus, Thésée qui presse du sien les flancs de Bianor et le creux de tes reins.
Jean Prod’hom
Vienne au crépuscule

Il y a audience ce matin à Schönbrunn, comme chaque jour tout le jour : dans le bureau de François-Joseph, la salle de bains de Marie-Thérèse, mais aussi dans la chambre des enfants de l’archiduchesse, le cabinet d’aisance de Sissi, la chambre à coucher des souverains. Pourtant le château est vide, on a beau chercher, personne, personne à qui demander ce qui est à qui. On avance par wagons, ignorant silencieusement ce qui est en train de se passer, comme des déportés, on comprendra dans trente ans ce qu’on imagine mal. On se faufile comme des hommes qui vont à l’abattoir, rien à se mettre sous la dent sinon quelques extraits de récits futiles, personne pour nous accueillir, impossible d’entendre quoi que ce soi, pas même ce qu’on ne dit pas, le centre est vide. Même chose au zoo, mais là les rhincéros et les guépards ont les yeux empaillés de tristesse. Ce soir on fera le Ring avec le tramway numéro 1, puis nos coeurs danseront à reculons en écoutant une valse de Strauss à la Hofburg, un grand tour sur la Riesenrad pour faire bon poids. Oh! vertige vertige, je tourne en rond, il est temps que je prenne la tangente : Linz, Salzburg, Innsbruck, Feldkirch, Buochs, Zurich, Berne, le Riau.

Les juifs du vieux cimetière de Friedhofcentral ressuscitent : le lierre et les herbes folles caressent les pierres, s’y accrochent, saint désordre, les fendent, elles penchent, n’en finissent pas de s’affaisser, comme une seconde vie.
Jean Prod’hom
Maria-Theresien-Platz

La Bohème et la Hongrie n’ont jamais suffi, pas plus à elle qu’aux Habsbourg qui l’ont précédée sur le trône impérial, la mer Noire à l’est les a éloignés depuis le commencement du concert des nations, il n’y a rien à faire de cet inconnu-là et l’Anglais cadastre le couchant. Alors Marie-Thérèse regarde vers le nord, aura-t-elle gain de cause? Pour qui la prend-on? Pour la bonne à tout faire, celle qui exploite les mines de Silésie et maintient à bonne distance l’Ottoman? Il n’en ira pas ainsi, Marie-Thérèse ne se satisfera pas des marches, veut la peau de ceux qui l’ont trahie et la place qui lui revient, au centre. Alors, regardant une fois encore vers le nord, sa convoitise croise le cours lourd et obstiné du grand fleuve. Et, sans qu’elle le veuille, ses pensées glissent d’ouest en est, le long des plaines de ce qu’on imagine à peine, se mêlent aux eaux troubles du grand fleuve, celui qui épuise les rêves et sombre au levant.

Jean Prod’hom
Dimanche 19 juin 2011

Perdu la béquille de ma mémoire et un peu de ma raison, gorge serrée de par les circonstances, oubliée à mes pieds, que sais-je.
Au milieu du passage du Puisoir j’entends des voix d’outre-tombe, celle d’un jeune loup débordant de fatuité, clinquante, acide, qui assène une enfilade de vérités pleines de sincérités. Il aurait tellement mieux valu qu’il garde tout cela pour lui et qu’il consomme ses petites sottises en aparté, là surtout. Il entend à peine les mots étouffés du vieux et de sa vieille qui ne demandent rien, bougent à peine leur tête qu’ils tiennent surbaissée dans l’obscurité d’un laboratoire. Ils ont serviles et sages perdu la partie. Il croit les consoler le diable. Je ne les vois pas, j’ai beau me pencher, leurs voix seulement, incapables de faire taire le coq, leurs voix dans cette boutique à l’abandon, nature morte creusée dans le néant de l’espérance. Faites le taire, réveillez-vous, plumez-le, faites le taire.

Et ce soir un hérisson aux piques luisantes attend immobile que je m’en aille. Sa patience viendra sans effort à bout de la mienne. Après vous. Je pars demain pour Vienne, inquiet de ce que je laisse derrière moi, ils feront bien sans moi, et mon éloignement fait croître l’étendue de ma peine. Je n’ose imaginer qu’un jour je n’entendrai plus ces voix.
Jean Prod’hom
Revenants

Friedensreich Hundertwasser sur la Löwengasse.

Le duc Maximilien de Bavière et sa belle-soeur Sophie, archiduchesse d’Autriche, de retour au Prater.

Jean Prod’hom
La fin de l'histoire

Au XVIIIème siècle, Schönbrunn s’impose avec l’archiduchesse Marie-Thérèse et Etienne de Lorraine comme la résidence d’été de la famille impériale. De 1814 à 1815 les participants au Congrès de Vienne y danseront. François-Joseph y verra le jour en 1830. Cette même année l’Aiglon y mourra. Kennedy et Kroutchev s’y rencontreront pendant la Guerre froide. Et puis plus rien.

Jean Prod’hom
Juste capable de m’en réjouir

J’trouve toujours difficile de dire « oui » sans ajouter un « mais » après.
Le mercredi après-midi on faisait la guerre au gros Georges et à tous ceux d’en-haut. C’était une vraie guerre, grandes manoeuvres et longues trottes du fond du jardin au petit parc. On rameutait la fine fleur d’en-bas en trompettant dans le tube amer des pissenlits, on se ravitaillait au goulot des fontaines, assaisonnait nos rêves de conquête du sucre extrait des fleurs de trèfle, on affûtait nos sens en passant le nez sous le volet de la boîte aux lettres de la biscuiterie. Mais le gros du temps, on le passait sur un bout de pré ou au flanc d’un talus pour une guerre de position immense et silencieuse. Au coeur de l’été, on creusait des cuvettes qu’on remplissait d’eau et dans lesquelles on regardait désarmés passer les nuages, vautrés dans nos silences jamais empruntés. C’était une guerre d’un autre temps, sans haine et sans fin, qui n’a cessé que lorsque nous avons quitté le quartier, si noble et si pure que nos ennemis avaient oublié depuis longtemps qu’on était en campagne. On avait éradiqué toute forme de violence, ne connaissait ni morts ni blessés, au bilan quelques égratignures dues aux ronces qui bordaient le pré descendant en pente douce le long des escaliers tournants. On nageait sans fausse note la tête à l’envers dans le ciel. On ne comprenait rien à rien mais on avait lâché les écoutes, pas le temps d’enterrer ceux qui nous quittaient, on allait de l'avant, on était de la race des chasseurs-cueilleurs, faisant jurer le coq et l’âne, le turquoise et l’incarnat. On chassait le froid avec les mains, mangeait les fraises à pleines poignées. Puis l’un d’entre nous lançait une idée qu’on essayait de rattraper avant la tombée de la nuit, la petite troupe se rendait dans le lit du Flon ramasser les cadavres qu’avaient abandonnés les fêtards du samedi soir, 50 centimes pour chaque bouteille, 2 francs 50 dépensés en brisures en haut le Valentin qu'on mangeait en descendant Riant-Mont.
Edith avait la peau brune qui me rappelait le grain du ventre chaud de Chouchane, on cambait par-dessus les nuits, on enfilait bout à bout ce qui nous passait par la tête. Jamais on n’a pris une seule décision, pas besoin, parce qu'on faisait les choses au diapason, sans craindre de maltraiter les harmonies et de faire jurer les croassements de la corneille avec le sifflement des merles. Pendant une douzaine d’années on n’a pas grandi, l’autre c’était nous, dévorant tout ce qui se présentait, suivant un programme qu’on sortait d’un sac de billes. On faisait avec ce que les autres ne voulaient pas, reliefs, ombres sans doute, de doutes qui ne nous encombraient pas. Personne n’en savait rien, ni nous non plus, pas le temps pour ça. Notre âme n’habitait pas notre corps, je nous étions sans question.
« Oui mais », dit un jour Michel à Jean-Pierre. J’avais douze ans, on jouait les trois dans le jardinet qui jouxtait le rez de Riant-Mont 1. Ils se sont mis à rire à mes dépens. J’ai eu l’impression non seulement qu’ils me tournaient le dos mais qu’ils avaient quitté le paradis depuis longtemps déjà. Pour faire bonne figure je suis monté à la Colline, on tirait les équipes, Lometti et Fincat les meilleurs, je suis resté en carafe.
Il y a entre les jeux de mon enfance et l’écriture de ses exploits de longues années et un « oui mais » qui me reste au travers de la gorge. Je suis resté là, dans ce jardinet, accoudé à la table de ping-pong, songeur, incapable de faire quoi que ce soit, incapable de renoncer tout à fait aux heures glorieuses de l’enfance, incapable de les oublier comme Jean-Pierre, incapable d’en mourir comme Michel le décida un jour, tout juste capable, parfois, de m’en réjouir.

Publié le 3 juin 2011 dans le cadre du projet de vases communicants chez Kouki Rossi (Koukistories) .
Jean Prod’hom
Il y a la justice distributive

Il y a la justice distributive
le trot assis
la chaire de Giovanni Pisano à Pistoja
le papier de verre
il y a la règle de trois
le tramway interurbain
les longues durées
il y a les friches
il y a le cri de l'archer
Jean Prod’hom
XCI

La vieille comtesse toscane rencontrée à l’entracte d’un spectacle de clowns proposé par le Théâtre de Mézières s’offusque à l’idée de devoir payer l’impôt ecclésiastique.
- Je ne paie plus! Quoi qu’il en soit je rentrerai à Orvieto et j’irai dans le caveau familial, à vie et sans débourser un sou.
Souhaitons lui de trouver quelques indulgences en solde? Ou qu’on lui en vende à crédit, crédit credo. Ah! Rome!
Jean Prod’hom
Dimanche 12 juin 2011

Lorsque je remonte ce matin de la laiterie pour rejoindre le chemin des Tailles, le ciel est large et le bleu est libre, et je pourrais comme si souvent m’en réjouir : le soleil le zèbre d’or en tous sens et essore les prés, le vent baigne les corps et les flaques dans lesquelles les moineaux font leur toilette lancent des feux.
Mais sans que je n’en connaisse les raisons, tout cela ne m’atteint pas et je fais la moue, la nuit ne m’a pas lâché et je reste à côté de ce dans quoi on s’abreuve pour surmonter les imperfections de notre condition : le premier est vide, le second chauffe à blanc et le troisième souffle sur des restes moribonds. Je suis condamné à attendre, et à croire, à espérer que quelqu’un ou quelque chose m’invite à entrer dans la danse, m’y oblige en douceur, sachant pourtant que, quoi qu’il advienne, il nous est interdit de nous y livrer entièrement sous peine de perdre la raison.
Et c’est un livre que j’avais pris la précaution de glisser dans une poche de mon gilet qui me tire hors du désert où je suis retenu par des forces noires et me dépose sur le chemin des Tailles. Un texte sombre, sans appel, d’un homme condamné qui écrit jusqu’à la fin les pas qui l’y conduisent, dans des souffrances dont il ne cache pas les effets mais dont il ne tire aucune gloire, dans une écriture qui chatoie encore un peu et offre une jouissance paisible à celui qui veut bien le suivre, à défaut d’autre chose, en des voies imprévues et souterraines qu’une syntaxe au rasoir endigue, jusqu’aux prochains remous ou au large delta qui ne manquent pas de se présenter à celui qui a choisi de poursuivre son chemin sans se laisser arrêter par rien jusqu’au terme du parcours sur terre qu’on appelle une existence.

C’est à peine s’il se considère comme un habitant de cette terre, quoique, en raison de son inépuisable beauté, nullement impatient de la quitter, mais torturé par le désir impossible à satisfaire de s’y rendre invisible, d’en être un spectateur clandestin, tour à tour émerveillé et horrifié, jamais indifférent en tout cas, sinon autant se vouloir atteint de cécité – la faculté de percevoir étant pour ainsi dire la seule à le maintenir en vie, une vie qui, à force d’avoir à la défendre sur tous les fronts est devenue bien plus rarement source de jouissance paisible que de tension nerveuse, en dépit de quoi elle n’a rien perdu de son pouvoir d’attrait, et même il s’en est accru avec l’affaiblissement général de l’être, les infirmités de la vieillesse.
Louis-René des Forêts, Pas à pas jusqu’au dernier

Réussi à quitter la nuit, mais à demi, car pas tout seul. Mais pourrait-il en être autrement? Je songe à tous ces vieux qui se satisfont de presque rien depuis qu’ils savent qu’ils ont perdu la partie, à la vieille de Pra Massin. Et soudain les oiseaux qui piaillaient se mettent à chanter.















Jean Prod’hom
XC

Jean-Rémy a été une plaie si profonde dans ma vie qu’il va me laisser à sa mort, je le crains, un souvenir impérissable. Tant et si bien que je me suis mis à lui souhaiter une très longue vie, afin que je puisse continuer à rêver et espérer, tout au long de la mienne, sa complète disparition.
Jean Prod’hom
Plus personne pour nous dire de rentrer

Tandis que les gouvernements rassemblent dans le ciel européen le stock d’enclumes qu'ils vont faire pleuvoir à deux reprises pendant le siècle sur les civils et les appelés (qui, soit dit en passant, seraient restés sourds aux appels si on leur avait appris à écouter ce qui ne se dit pas), Arthur Schnitzler écrit en 1908 Der Weg ins Freie – qu'on a traduit maladroitement par Vienne au crépuscule. C’est l’histoire de quelques égarés qui vont et viennent dans le pot au noir. Et ce qui se prépare là, avec eux, c’est un autre orage, un orage d’interrogations fantômatiques que les salons feutrés de l'aristocratie et de la bourgeoisie du Ring ont cadenassées depuis plusieurs siècles dedans la boîte aux convenances d'un monde bariolé et rythmé par des rituels et des postures toujours plus irrespirables et inconfortables. Ou forclos, c’est selon, dans le glacis qui s’étend au pied des fortifications d’une conscience qui cède de ne plus y croire, dans les marécages qu’alimentent le fleuve bleu en crue. Il faut résilier le bail. Schnitzler a ouvert la boîte de Pandore, scandale, la déraison déborde sous le couvercle de la raison impériale.


Copies-écran du "Troisième Homme", Carol Reed, 1949
Les personnages de Vienne au crépuscule n'en finissent pas de sortir, dès le matin, sur les allées du Ring, dans les bois, au Prater, à la campagne. Parce qu'il n'est nul besoin d'aller bien loin pour sortir la tête hors de l'eau. Parfois en Italie, dans le Midi, en Allemagne ou en Suisse, mais quelques jours seulement, car ils préfèrent rester à Vienne, le temps y est suspendu, la tête pleine de questions, saturée de désirs contradictoires. Georges von Wergenthin le musicien et Henri Bermann l’écrivain en commencent l'analyse, au café, en train, couchés sur un divan ou assis sur un banc du Prater. Les pensées lointaines refont surface, elles ne les effraient pas, ce sont toujours les nôtres. Ils regardent par la fenêtre chacun pour soi le monde qui les entoure, les visages qui s’animent et un sentiment de paix les saisit, ils ne sont liés à personne. Ils font toutes sortes de choses, jouent au tennis, peignent leurs états d’âme ou écrivent, perdent leur temps ou composent avec l’ennui. Ils sortent en plein air et poursuivent un chemin dont ils ne connaissent pas la destination, avec une sensation de quiétude qu'un un art du déséquilibre leur permet d’atteindre. Ils vont à bicyclette, ne s’étonnent pas que l’on puisse jouer des fortunes à une table de jeu, ou qu’un de leurs amis périsse dans un duel. Parfois, le regard aimable d’une femme rencontrait le sien et semblait vouloir le consoler de déambuler par ce bel après-midi de fête, seul, portant les marques extérieures d’un deuil.


- Vous aimez la solitude
- Il est difficile de répondre à une question aussi générale.
On a su canaliser les berges du Danube et celles de la Wien, Théodor Herzl lance le projet d’endiguement du peuple juif en lui proposant la terre de Sion, mais aucune barrière ne retient ce qui craque de toutes parts. On a beau tenter de remettre de l'ordre. Sans succès. On réalise le métro, on rêve aussi d’explorer les sous-sols des consciences où tout se mélange de façon contradictoire, on place le portrait de François-Joseph dans le vestibule de la Caisse d'épargne postale, un bâtiment conçu et réalisé par Otto Wagner, guide de la Sécession, qui s'éloigne des modèles de la pierre de taille, lourde et impériale de ses maîtres August Sicard von Sicardsburg et Eduard van der Nüll, les maîtres d’oeuvre de l’Opéra. Mais tout est faux-semblant, plaques de marbres collées sur un petit appareil de briques rivetées par des faux clous d’aluminium. Loos et Kraus partent en guerre contre l’ornement, la déconstruction a commencé. On tente ailleurs de tout garder, ensemble Makart et Klimt, secrètes la recette de la Sachertorte et la façon de plier les serviettes au temps de Marie-Thérèse. On a placé le coeur des empereurs habsbourgeois dans des bonbonnières et l'or dans des coffres, bientôt les robes de Sissi. Comment s’y retrouver dans ce grand fatras, ce parc d’attractions fait de tout et de rien qu’est devenue la Vienne du tournant, une ville soudain nue.


Georges von Wergenthin le musicien et Henri Bermann l’écrivain se promènent encore un peu dans le Prater.
Tous étaient d’accord qu’on ne pouvait quitter le Prater sans être monté sur le Grand Huit.
Dans l’obscurité avec un vacarme assourdissant, leur wagon dévalait la pente, puis remontait sous les cimes noires des arbres; et dans ce bruit sourd, rythmé, Georges découvrait peu à peu un motif musical burlesque à trois temps. Redescendant l’escalier avec les autres, il savait déjà que cette mélodie devait être exposée par le hautbois et la clarinette accompagnée par du violoncelle et de la contrebasse. C’était de toute évidence un scherzo, peut-être pour une symphonie.
« Si j’étais entrepreneur, déclara Henri résolument, je ferais construire une telle piste sur des milles de distance, à travers prairies, collines, forêts, à travers des salles de bal, sans oublier des surprises en cours de route. » En tout cas, il poursuivait son idée, le temps était venu d’exploiter en grand au Prater l’élément fantastique. Il avait lui-même songé à un manège qui grâce à un mécanisme spécial s’élèverait, tournant en spirale pour atteindre le sommet d’une tour. Il lui manquait malheureusement les bases techniques nécessaires pour préciser le projet. Tout en marchant, il imaginait des mannequins et des groupes grotesques pour le stand de tir, et il finit par proclamer la nécessité urgente d’un grand théâtre de marionnettes pour lequel des poètes originaux écriraient des pièces à la fois gaies et profondes.
Il commence à faire frais, ils parviennent à la sortie où une voiture les attend.
- Cet été factice ne peut faire illusion jusque dans la nuit. « Tout cela sera bientôt définitivement passé » dit Henri dans un accès de mélancolie disproportionné, puis il ajouta comme pour se consoler : « Eh bien, on travaillera. »


Et ils se sont mis au travail pour éclairer les marges et les dessous de la conscience, le désoeuvrement, le rêve et la rivalité des pulsions. J'entends encore cette cacophonie dont la littérature d'aujourd'hui tente d'esquisser la partition, cacophanie : ghetto, réserve ou marécage, c'est selon, mais on est enfin à l'air libre, décidément dehors, plus personne pour nous dire de rentrer.


Le Prater fut d’abord une forêt marécageuse traversée par le Danube, puis la réserve de chasse de l'empire, clôturée, un ghetto créé par Ferdinand II au début du XVIIème siècle pour débarrasser les Juifs du centre ville. L'empereur Léopold Ier tenta en vain de les déloger (quelques années avant qu'il ne fasse élever sur le Graben la colonne de la Peste qui rappelle les ravages dont celle-ci fut responsable en 1679). C'est à la fin du XVIIIème siècle que l'empereur Joseph II ouvrit cet espace au public, pas tout l'espace, mais celui où l'on mange des saucisses, le Wurstelprater, 43 baraques en 1780 pour boire du vin et de la bière, feux d'artifice. Dérivée de la Ländler, une danse paysanne, la valse exerce sa magie, car c'est au Prater, nous rappelle Christine Mondon, qu'est apparue la célèbre danse viennoise lors de véritables joutes musicales entre Joseph Lanner et Johann Strauss père... La valse, constate un Viennois, "enflamme la tête, brouille l'esprit, excite les appétits charnels et éloigne toute idée de révolution". Pas sûr! Les Viennois cessent de valser en 1848 et Johann Strauss le fils écrit la Marche de la révolution, s'opposant ainsi de front à Johann Strauss le père qui demeure fidèle à la monarchie. Sous la valse couve une guerre, En 1866 la défaite de Sadowa sonne le glas des espérances de l'empire autrichien. L'exposition universelle de 1873 organisée au Prater consolera un bref instant le coeur des Viennois. Neuf jours après l'ouverture de la bastringue, la Bourse s'effondre, il n'y a plus de digue.
Jean Prod’hom
Il y a les nombres imaginaires

Il y a les nombres imaginaires
les coiffes bigoudènes
les leviers de vitesse au volant des 403
il y a les embellies
les sécessions
le trousseau de clés qu’on ne comptait plus retrouver
il y a 1848
les contre-pieds
le glacis au pied des remparts
Jean Prod’hom
J'aime le café

Peter Altenberg a écrit les Esquisses et nouvelles esquisses viennoises dans les dernières années du XIXème siècle, je les ai commandées ce matin. Les premières ont paru à Vienne en 1896, les anciennes et les nouvelles ont été traduites et publiées par Actes Sud en 1993. Je ne sais rien du bonhomme, mais devine que c'était un solide allumé qui hantait les bistrots du premier arrondissement, ami des quelques comètes de la Sécession qui ont éclairé le ciel de Vienne au tournant du siècle, ami de Schnitzler et de Klimt, de Kraus et de Loos. Je n’en sais rien d’autre, sinon ce qu’en dit ce billet signé Elsa datant de 1908 paru ici. Et puis il y a ce petit poème lu en 1995 par Erica Tunner à l'occasion des Chemins de la connaissance.


Ils se retrouvaient tous au café Griensteidl, jusqu'à sa démolition en 1897. Karl Kraus en profita pour discréditer avec le sourire la Jung Wien en rédigeant La littérature démolie.
Vienne est en train d'être démolie en une métropole moderne. Avec ses vieilles maisons s’effondrent les piliers de nos souvenirs et bientôt une pioche irrespectueuse aura fait table rase de l’honorable café Griensteidl. Admirable décision du propriétaire dont les conséquences sont imprévisibles. Notre littérature n’aura plus de toit et les fils de la production poétique seront coupés. C’est à domicile que nos hommes de lettres devront poursuivre leur joyeux cénacle; la vie professionnelle, le travail avec ses emportements et ses énervements variés se déroulaient dans ce café qui n’avait pas son pareil comme centre d’échanges littéraires. Cet établissement aura mérité par plus d’une qualité sa place d’honneur dans l’histoire de la littérature... Nos plus jeunes poètes, surtout, regretteront amèrement la chaude intimité de cet intérieur viennois qui est toujours parvenu à pallier, par son ambiance, le confort qui lui faisait défaut. Seul le courant d’air qui traversait de part en part ce café idyllique pouvait apparaître aux hôtes sensibles comme un manquement au style; d’ailleurs, ces derniers temps de jeunes écrivains payèrent souvent leur productivité de rhumatismes. Il allait de soi que dans un café aussi exceptionnel la nature des serveurs présentât un trait littéraire. Car ici les garçons de café se sont lentement adaptés au milieu. Déjà leur physionomie exprimait une certaine connivence avec les aspirations artistiques de leurs clients, oui, la fière conscience de participer à leur manière à un mouvement littéraire. Cette faculté de se projeter dans la personnalité de chaque client en ne renonçant pas à la sienne propre a consacré la supériorité de ces serveurs sur tous leurs collègues; on peut difficilement croire que c’est un syndicat de cafetiers qui leur a procuré ces emplois et non la Société des gens de Lettres. Une lignée de garçons de cafés importants a exercé dans cet établissement, illustrant le développement de la vie de l’esprit dans ce pays.
Mais rien ne ralentit leur ardeur. Ils prirent leurs cliques et leurs claques et déménagèrent au café Central, un palais néo-vénitien où Peter Altenberg se faisait envoyer son courrier. Karl Kraus, dérangé par le bruit, n’y passait guère, il établit son campement au café de l'hôtel Impérial où il discutait le coup avec Rilke, Freud et Mahler. Altenberg s’y arrêtait parfois, ou rejoignait Loos au café Museum – un établissement dont celui-ci avait dressé les plans –, faisait des projets avec Alban Berg qui mettra en musique quelques-uns de ses textes, ou écoutait les peintres Oscar Kokoschka et Egon Schiele qui tiraient à boulets rouges sur l’oeuvre de Makart.
Le temps a passé. Mais Peter Altenberg n’a pas quitté le devant de la scène, dans quelques jours je me rends à Vienne, j'irai au Central, le café où se dresse une statue en papier mâché de l’écrivain assis, et le cimetière (Zentralfriedhof) où il repose couché. J'aime bien les écrivains de café aux noms bien serrés : Schnitzler, Klimt, Kraus et Loos. Mais j’en bois trop.
Jean Prod’hom
Kaffeehaus
Du hast Sorgen, sei es diese, sei es jene – ins Kaffeehaus!
Sie kann, aus irgend einem, wenn auch noch so plausiblen Grunde, nicht zu dir kommen – ins Kaffeehaus!
Du hast zerrissene Stiefel – Kaffeehaus!
Du hast 400 Kronen Gehalt und gibst 500 aus – Kaffeehaus!
Du bist korrekt sparsam und gönnst Dir nichts – Kaffeehaus!
Du bist Beamter und wärest gern Arzt geworden – Kaffeehaus!
Du findest Keine, die Dir passt – Kaffeehaus!
Du stehst innerlich vor dem Selbstmord – Kaffeehaus!
Du hasst und verachtest die Menschen und kannst sie dennoch nicht missen – Kaffeehaus!
Man kreditiert Dir nirgends mehr – Kaffeehaus!
Dimanche 5 juin 2011

Le père et le fils traversent le pont qui franchit la Birse peu avant que la Sorne ne s’y jette. Ils s’appuient tous deux à la rambarde, inutile de trop parler ou de remonter l’affluent, il a plu à verse du côté de Bellelay et Undervelier, ça a raviné, les truites ne vont pas mordre. Ils décident à haute voix de remonter la Birse jusqu’à l’entrée de Courroux, regardez, il n’a pas plu du côté de Moutier et de Tavannes, l’eau est toute claire, vous venez d’où? Quel beau dimanche matin, n’est-ce pas? Nous on est de Courtételle.

Il n’y a plus trace de l’exploitation du fer qui occupa les hommes de la vallée tout au long du XIXème siècle, j’ai beau chercher. Des quelques dépressions qu’on m’a signalées et qui indiquent l’entrée d’anciens puits, je n’en vois aucune. Le fer jurassien n’a pas su rivaliser avec l’anglais et on a tout rebouché. Si, un vestige, un seul, les restes d’un pont de chemin de fer qui franchit la Birse en amont de la passerelle et qui ne mène plus nulle part, et pas grand monde.
Les hommes n’ont guère modifié leurs habitudes depuis le Moyen Âge, ils balaient la cour de leur ferme avant de se rendre à la messe, Mais aujourd’hui les cloches de l’église ne parviennent pas à secouer le paysage qui somnole, sur les flanc du Colliard un promeneur s’éloigne, il va voir les choses d’un peu plus haut, j’aperçois l’heure au clocher de l’église, il est bientôt 9 heures 30, deux hommes assombris par les excès de la veille boivent sous le soleil une bière sur la terrasse du café de l’Ours, les cloches se sont tues. Et bien moi j’irai. Plus de 200 personnes à l’intérieur de l’église et un choeur de paroisse qui chante à tue-tête. Je feuillette le recueil des Chants notés de l’assemblée, publiés par la Commision internationale francophone pour les traductions et la liturgie, et découvre à la page 740 le 807, Joyeuse lumière, écrit et composé par Lucien Deiss.

Je lis et relis mais n’y comprends rien, passe à côté de ce qui comble certains. En sortant discrètement avant l’eucharistie, mais après avoir versé ma modeste obole aux oeuvre du jour, j’aperçois pour mon édification un dépliant sur lequel sont écrits parmi d’autres quelques mots accompagnés d’un lien internet : Epiphanie, le podcast de la Parole de Dieu. Me dis que les progrès de nos églises sont précisément ceux qu’on s’imaginait, voilà qu’on pourra aller à la messe en tout temps et en tout lieu. Pas sûr que ce soit une bonne opération pour l’avenir de l’église catholique romaine et ne comprends pas pourquoi Benoît XVI ne met pas le holà à cette tendance délétère.

Je continue en direction de Courrendlin dans un paysage déchiré par un quartier de villas et les travaux de la Transjurane. Me trouve comme un idiot perdu dans un réseau de culs de sacs, de barrières de sécurité, contournant des bretelles, cambant des regards, des réhausses, des couvercles, des piliers, blocs de coffrage, bordures, canniveaux, gabions et ballast. Peine à m’en sortir. Plus loin une villa a survécu, entourée par une belle pelouse qu’un robot tond, il a perdu la tête mais, apparemment satisfait de son sort, il ne tente pas de s’enfuir.
Si, en se retournant, on choisit l’angle qui convient, on peut voir ce qu’on ne voit pas, les choses telles qu’elles étaient avant de devenir ce qu’elles sont, mais il faut cligner les yeux et ne pas trop écouter le silence gris et défait de ce quelque chose qui ne s’en remettra pas. Et puis se hâter, se hâter parce que le sol et le courage pourraient venir à manquer.

Jean Prod’hom
LXXXIX

Gros coup de blues ce matin, mais il a bien fallu finalement qu’elle renonce à se battre contre ce qu’elle espérait changer et qui ne changera pas, elle le sait désormais, c’est au-dessus de ses forces. Elle monte alors au grenier, ouvre la vieille armoire à l’odeur de naphtaline et se saisit d’un ensemble d’un autre temps qu’elle emporte dans la chambre à coucher pour l’enfiler loin des regards, la fenêtre est ouverte. Elle se regarde dans la glace, il faut bien reprendre ce que sa mère n’a pas terminé, c'est son tour. Elle descend à la cuisine et branche le petit poste de radio pendu à la corniche du bahut, elle se met courageusement à la tâche, l’eau coule dans l'évier, imitant les faits et gestes de celle qui l'a devancée, calmement, posément, comme elle l'a toujours fait, mais elle le fait librement ce matin. Elle tisonne le feu, fait la vaisselle laissée sur la table, pèle des pommes-de-terre, rien n'a changé à Pra Massin.
C'est un exemple d’abnégation qu’une petite fille observe depuis le seuil de la cuisine, ce sera peut-être un jour son tour, mais personne n'en sait rien.
Jean Prod’hom
L’embellie | Kouki Rossi

la jeunesse va emporte
ses promesses
nous laisse
œuvrant
aveugles
où nous rêvions de joie
il y a le pot chinois
rutilant sur la table
le fruit du mur muet
où vont frayer les âmes
il y a l’aube appliquée
à couvrir le rocher
de vieux ors
ceux des peintres
les théâtres grandioses
où promener nos corps
vaillants
un peu nerveux
par besoin d’importance
puis il y a ceux-là
qui trouvent le courage
l’amour fou inventer
même si
rien jamais
ne vient taire le manque
ils rendent au jour neuf
l’éclaircie
de sa grâce
Kouki Rossi
écrit par Kouki Rossi qui m’accueille chez elle sur son site Koukistories dans le cadre du projet de vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.
Et d’autres vases communicants ce mois.![]() Nicolas Bleusher et Christopher Selac
Nicolas Bleusher et Christopher Selac ![]() Martine Sonnet et Urbain trop urbain
Martine Sonnet et Urbain trop urbain ![]() Anita Navarrete-Berbel et Brigitte Célérier
Anita Navarrete-Berbel et Brigitte Célérier ![]() Céline Renoux et Christophe Sanchez
Céline Renoux et Christophe Sanchez ![]() Franck Thomas et Guillaume Vissac
Franck Thomas et Guillaume Vissac ![]() Cécile Portier et Pierre Ménard
Cécile Portier et Pierre Ménard ![]() Franck Queyraud et Loran Bart
Franck Queyraud et Loran Bart ![]() Anne Savelli et François Bon
Anne Savelli et François Bon ![]() Carine Perals-Pujol et Joachim - Séné
Carine Perals-Pujol et Joachim - Séné ![]() Isabelle Parriente-Berbel et Louise Imagine
Isabelle Parriente-Berbel et Louise Imagine ![]() Maryse Hache et Laurence Skivée
Maryse Hache et Laurence Skivée ![]() Chez Jeanne et Xavier Fisselier le roi des éditeurs et Nicolas Ancion
Chez Jeanne et Xavier Fisselier le roi des éditeurs et Nicolas Ancion ![]() Michel Brosseau et Jacques Bon
Michel Brosseau et Jacques Bon ![]() Christine Jeanney et Christophe Grossi
Christine Jeanney et Christophe Grossi ![]() Caroline Gérard et Juliette Mezenc
Caroline Gérard et Juliette Mezenc ![]() Ghislaine Balland et Dominique Hasselmann
Ghislaine Balland et Dominique Hasselmann ![]() Piero Cohen-Hadria et Conte de Suzanne
Piero Cohen-Hadria et Conte de Suzanne![]() Kouki Rossi et Jean Prod’hom
Kouki Rossi et Jean Prod’hom
Dimanche 29 mai 2011

On a failli l’écraser ce matin dans une longe courbe entre Mézières et Corcelles, où il est soudain apparu, caché jusque-là par les herbes hautes et les rames de colza. On roulait au pas, c'était un homme que personne n'avait vu encore dans le coin, il semblait traqué, pieds nus et torse tatoué, pressé, les traits tirés, inquiet d’avance de ne pas trouver là de quoi s’arrêter, incapable de mettre à respectable distance l’enfer vers lequel il se hâte. On ne le reverra plus.
Est-il seulement possible aujourd’hui de vivre vagabond, de rien et à découvert? Les chemins vicinaux trop coûteux à exploiter disparaissent, l’inconnu est d’entrée le malvenu, les inspecteurs du travail ont mis le holà aux coups de main des employeurs de fortune, les églises ferment leurs portes avant la tombée de la nuit, on cadenasse les refuges. Les vagabonds sont condamnés à accélérer leur marche, plus nus que jamais, répondre d’une misère dont beaucoup réussissaient autrefois à tirer parti. Il ne fait pas bon être vagabond aujourd'hui, les chiens errants ont une vie bien meilleure.
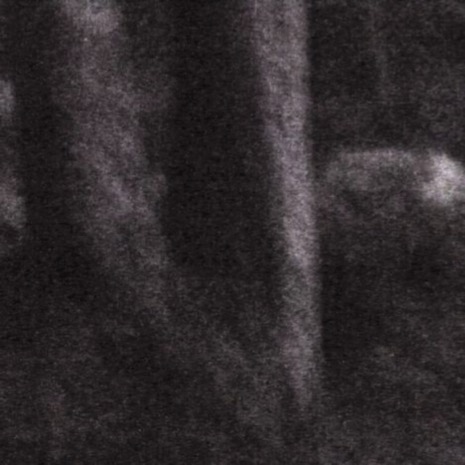



Ce soir la nuit monte des corps du bois, en continu, souffle sur les longues herbes inclinées de l’étang, le vert et le bleu sombrent, le renard revient sur ses pas avant de s’enfuir, j’ai beau me croire chez moi, il se sait chez lui. L’obscurité lisse les jointures des choses, ça tient ensemble, la terre et le bois, le ciel et mes doigts.
Jean Prod’hom
Il y a les zones piétonnes

Il y a les zones piétonnes
la voix de Jean Starobinski
les panneaux de fin de limitation de vitesse
il y a les moraines
les secrets de la main gauche des droitiers
les enfants qui dorment dans les bras de leur mère
il y a l'obscurité du fond de l’océan
les vieux atlas
la vaine résistance des bories
Jean Prod’hom
Ton ambition croît et ma volonté plie

La phrase avance, rampe, serpente, le mot s’appuie sur celui qui le précède, pour jeter loin devant celui qu’il tient en laisse et qu’il suit, comme si la phrase était pilotée à la fois de l’avant et de l'arrière et qu’en tout lieu le dernier mot avait l’allure d’un premier de cordée. La phrase s’allonge alors, comme un serpent qui ondule, et le sens sort de sa gaine, de sa double gaine, gonfle aussi longtemps que le mot de tête danse en cadence avec le mot de queue.
Derrière son apparence corpusculaire, le langage est bel et bien de nature ondulatoire, si bien que tu écris ce que je lis autant depuis la fin que depuis le commencement, et que je lis ce que tu écris en tous sens avec la conviction que tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir pour retenir le sens à l’intérieur de sa mue qui te déborde à mesure que ton ambition croît et que ma volonté plie.
Jean Prod’hom
Fin de journée

Je suis couturière, poète, coiffeuse et peintre, il n’y a que ressemeler mes chaussures que je ne sais pas faire. Regardez s'il vous plaît, la lune se couchait, c’était en 1975. J'ai fait ce soir-là un beau dessin ? L'automne, vous aimez ? Mon mari faisait le traducteur pour la Confédération : français, allemand et russe, il était bien à l’aise aussi avec l'italien et l'espagnol, il fumait comme un Turc et travaillait la nuit. Moi je l'attendais, il n’a pas mis six semaines pour mourir. J’habite en face du château, je trouvais ce dessin un peu perdu sur cette feuille, alors j’ai écrit cette nuit ce petit poème, à l'encre, un peu triste, n'est-ce pas ? Mais je suis quand même venue boire un café.
La vieille surfe un peu folle sur la mare de larmes, de doutes et de désillusions gaies qu'elle a laissée derrière elle. Un ami à elle est à l’hôpital. Elle n'y croit plus tout à fait, elle rit en mettant bout à bout quelques-uns des morceaux intacts de ses jours. Elle rit, elle rit poliment, d’elle-même et de ce qui l'entoure avant de quitter précipitamment le café du Poids. C'est la fin, mais elle, elle le sait quelque part, une fin qui n'en finit pas et qui la réjouit comme le jour qui se lève. Elle traverse la place et s'éloigne, un lourd cabas la fait se dandiner, comme un canard égaré, dans cette petite ville de la vallée de la Broye.
Jean Prod’hom
La gymnastique intellectuelle entame leur sérénité

Pour Lucas
La gymnastique intellectuelle entame leur sérénité, les exercices les dégoûtent, les méthodes lorsqu'elles ont livré leur secret les rebutent. Un profond ennui les paralyse aussitôt qu’ils comprennent que l’institution scolaire, et ils le comprennent finalement assez vite, leur demande avant tout d'être en mesure de répéter aveuglément ce qu’on leur a fait découvrir, extraire des connaissances qui n'ont plus cours, mémoriser ce qu'ils auraient pu mémoriser ailleurs et plus rapidement, entonner des hymnes à la gloire de ce qui va de soi.
Je veux dire ici de leur esprit ce que Claude Levi-Strauss dit du sien : ... mon esprit présente cette particularité, qui est sans doute une infirmité, qu’il m’est difficile de le fixer deux fois sur le même objet. Au diable les procès verbaux, les rapports, les listes, les repérages, les corrections, les transcriptions, à d'autres ces activités qui nous empêchent d'aller plus loin, de vivre, de défricher de nouvelles terres et de construire des ponts. Ils sont de la race des conquistadores.
Lévi-Strauss écrit plus loin : Les aptitudes me manquent pour garder sagement en culture un domaine dont, année après année, je recueillerais les moissons : j’ai l’intelligence néolithique. Pareille aux feux de brousse indigènes, elle embrase des sols parfois inexplorés; elle les féconde peut-être pour en tirer hâtivement quelques récoltes, et laisse derrière elle un territoire dévasté. Je n'ose imaginer la détresse de l’ethnologue lors de la rédaction des Structures élémentaires de la parenté ou des Mythologiques. Je n'ose imaginer parfois la leur.
Celui auquel je pense aujourd’hui était de la même tribu, frère d'un autre, ils avaient tous deux l'intelligence néolithique, n'aimaient ni lire ni écrire. Ce n’est pas que le langage ne les séduisait pas, au contraire ils y étaient sensibles comme des musiciens. Qu’il soit correct ou incorrect, ils s’en battaient l’oeil, comme Cendrars, pourvu que ça soit bien vivant. Ils aimaient rêvasser autour d’une chose ou d’une idée. Mais l’ennui, l’ennui, l’ennui quand on écrit, l’ennui – Cendrars revient souvent là-dessus, tellement ça le dégoûte, tellement c’est contraire à sa nature et à son tempérament – ... Imaginer une histoire, des personnages, un sujet, les faire évoluer et les mêler à une aventure d’accord, tout ça c’est amusant. Mais le jour où on doit mettre en forme tout cela sur du papier, comprenez-vous, c’est un métier tellement ingrat, et réellement, réellement, Cendrars le disait en toute sincérité, j'ai peu eu de satisfaction devant une page, c’est exceptionnel. Me dire ça mon petit Blaise, c’est pas mal torché et c’est même très bien, ce satisfecit-là, on se l’accorde bien, bien rarement, parce qu’on pense surtout, quand on écrit quelque chose, à tout ce qu’on n’a pas mis dedans, ce qu’on avait envie d’y mettre, mais c’est tellement difficile de cerner les choses avec l’écriture et avec des mots qu’on reste déçu.
Cendrars et les deux frères avaient besoin de faire autre chose, d’abord parce qu’écrire c’est une grosse fatigue, et puis écrire ce n’est pas réellement vivre, ce n’est pas la vie de l’esprit, la vie de l’esprit c’est la contemplation. Ils n’aimaient pas écrire et se justifiaient par le fait qu’ils n'étaient pas les seuls. Ils ont raison, j'en suis. Jamais Cendrars n'a été un monsieur qui écrivait tant d’heures par jour dans un cabinet, c’est lui qui le dit, au bout d’un certain moment il en avait marre et il ne souhaitait qu’une seule chose, s’arrêter et foutre le camp. Eux c'était la même chose, l’école n'était pas à leur dimension. S’ils aimaient les calembours et les jeux de mots, ils ne se trompaient pas sur leur fonction et ne les confondaient pas avec la réflexion.
Ils n'ont jamais perdu de vue la vérité immédiate, c'est dire qu' ils excellaient dans les activités orales qui laissent une place à l’improvisation et à l’intrusion immédiate du monde dans lequel on est, l’écrit les désolait. Ils se tournèrent alors vers la musique et les arts graphiques, croyant jouir là de la liberté qui leur manquait. Plus tard ils se remirent à écrire, sans qu'ils s'en rendent tout à fait compte, avec leur sang, des paysages et des fugues, des rhapsodies et des cathédrales. Ces aventuriers avaient-ils le choix ?
P.S.
Avertissement
Jean Prod’hom
Il y a les bisses

Il y a les bisses
les secrets qu’il convient de garder
les mains des nourrissons
il y a la boucherie artisanale
les fronts populaires
les pommiers en espalier
les chemins de dévestiture
il y a les grandes marées
il y a la doucette
il y a les iris d’eau
Jean Prod’hom
L'enfant qui a la tête en l'air

Pour Nathan
L'enfant qui a la tête en l'air
Si on se détourne, il s'envole.
Il faudrait une main de fer
pour le retenir à l'école.
L'enfant qui a la tête en l'air
ne le quittez jamais des yeux:
car dès qu'il n'a plus rien à faire
il caracole dans les cieux.
Il donne beaucoup de soucis
à ses parents et à ses maîtres:
on le croit là, il est ici,
n'apparaît que pour disparaître.
Comme on a des presse-papiers
il nous faudrait un presse-enfant
pour retenir par les deux pieds
l'enfant si léger que volant.
Ce poème de Claude Roy que l’institutrice a demandé à Louise d’apprendre pour jeudi m’a conduit ce soir à faire défiler quelques-unes des têtes en l’air que j’ai croisées depuis le temps sans être en mesure de les accueillir comme il le fallait. Mais le peut-on lorsqu’on sait qu’elles ne songent qu’à caracoler dans les cieux ? C’est lorsqu’elles s’envolent pour de bon qu’on se prend à les regretter, regretter notre main de fer qui n’a saisi que du vide.
Ils sont légions les enfants des talus, ils hantent les livres que l’école fait lire aux enfants sages. Qu’on songe à Bosco, à Dhôtel, à Rimbaud et à tous les autres. L’école buissonnière a nourri l’école obligatoire depuis Jules Ferry. Sauf que parfois ils s’en vont pour de bon.
Seul, au milieu de cette agitation, je me tais. Assis au bout d’une des tables de la division des plus jeunes, près des grandes vitres, je n’ai qu’à me redresser un peu pour apercevoir le jardin, le ruisseau dans le bas, puis les champs.
De temps à autre, je me soulève sur la pointe des pieds et je regarde anxieusement du côté de la ferme de la Belle-Etoile. Dès le début de la classe, je me suis aperçu que Meaulnes n’était pas rentré après la récréation de midi. Son voisin de table a bien dû s’en apercevoir aussi. Mais, dès qu’il aura levé la tête, la nouvelle courra par toute la classe, et quelqu’un, comme c’est l’usage, ne manquera pas de crier à haute voix les premiers mots de la phrase :
« Monsieur ! Meaulnes... »
Je sais que Meaulnes est parti. Plus exactement, je le soupçonne de s’être échappé.
Il était un peu de cette trempe, rien ne retient l’enfant qui a la tête en l’air, aucun récit, aucune promesse. On le croyait ici, il était déjà bien loin. Caché derrière la frange buissonnante de ses cheveux, il clignait des yeux pour que jaillissent des gerbes d’étoiles, un pied sur le devant, dressé comme un conducteur de char romain, secouant à deux mains les guides, il lance sa bête à fond de train et disparaît en un instant.
P.S.
Avertissement
Jean Prod’hom
Dimanche 22 mai 2011

C’était aujourd’hui la fête à la ferme des Mélèzes, le club Passepartout de Moudon organisait la seconde manche de la Swiss Cup Trial.
Les coureurs se sont mêlés tout au long du jour aux spectateurs, c’était bon enfant, et moi dedans jusqu’au cou. Les applaudissements se sont mêlés aux odeurs de cuisine, les rires des enfants aux plaisanteries des piliers de la buvette et de la cantine. On a cherché à isoler les mauvais signes du ciel pour les conjurer et se donner les moyens de passer en équilibre à côté de l’orage. C’est fait, on l’a détourné au-dessus de Savigny et, en écho à ce miracle, le budget a basculé du bon côté.
En fin d’après-midi les spectateurs se dispersent, les juges boivent une bière tandis que les organisateurs démontent en une paire d’heures l’infrastructure d’une fête à laquelle plus de soixante bénévoles ont participé depuis plusieurs semaines. On a remis les prix, rentré les cochons et le poulain, les chèvres, le lapin et les moutons. Les tracteurs avec leur lourde remorque s’éloignent. Les tables, les tonneaux, les bancs et les palettes sont empilés, les collecteurs de béton s’emboîtent comme des poupées russes, on aligne les traverses de chemin de fer. Demeurent sur le pré les restes d’un mikado géant.
En remontant au Riau j’aperçois les oubliés du jour qui respirent à nouveau. Ce n’est plus le règne du tous, de l’aucun ou de l’un, mais celui du quelques-uns, quelques sifflements, quelques gouttes, quelques pas.



Jean Prod’hom
37

Disparaître à tout instant pour ne jamais avoir à rejoindre la foule des revenants.
- Mais que reste-t-il lorsqu’il n’y a plus rien?
- Ce qu’il y avait.
Jean Prod’hom
Il y a les glaciers qui craquent la nuit

Il y a les glaciers qui craquent la nuit
le tronc frêle des noyers
l’étoupe
il y a ceux qui font ripaille
les fleurs de l’acacia
les canaux de dérivation
il y a les mines de sel
les abeilles qui essaiment
les arrangements à l’amiable
Jean Prod’hom
Le couloir était éclairé par des sourires

Pour Jill
Tu es allé de la cuisine au salon, le couloir était éclairé par des sourires, de la salle de bains à la chambre du fond pour ton compte. Tu as entrepris sur ton édredon des voyages autour de ta chambre, élevé des châteaux de sable qui se sont effondrés sous ton regard ravi, tu as fait des parties de cartes avec des amis nés de ton imagination, joué avec des ombres. Et sans l’avoir décidé tu as appris à marcher, à construire, explorer, raconter et jouer. Tu as même fini hors toute obligation par distinguer la lumière de l’ombre sans lesquelles tu n’aurais rien su de tout cela.
On t’a fait croire ensuite, dès ton entrée à l’école, à toi et à tes camarades que la connaissance c’était autre chose, qu’elle s’obtenait méthodiquement, par alignements et entassements. On vous a demandé instamment de mémoriser des lettres et des mots, des opérations et des dates, des syntagmes de glace et des coques vides, de suivre les lignes, répéter les refrains, faire vite les comptes qui assureront votre promotion. L’institution scolaire et la société civile se sont aperçus à la fin de l’efficacité discutable de l’entreprise, nos élèves ne savent pas lire, vos enfants ne savent pas compter, c’est la faute aux parents, aux enseignants, à la société, aux élèves. Nous allons changer de manuels, nous allons user d’autres méthodes pour trois petits tours et puis s’en vont. C’est ainsi, pas même le mont de Piété, c’est du pareil au même, je n’y puis rien.
Que faire aujourd’hui sinon, chaque fois que l’occasion nous en est donnée, montrer que les connaissances ne sortent pas d’un chapeau, ne tiennent pas alignées sur un bâton. Pas de truc, ou des trucs issus de patientes mise en scène.
C’est en octobre 2012 que notre Etablissement scolaire disposera de bâtiments scolaires tout neufs. Ils accueilleront les enfants des nouveaux arrivants. Pourtant, si on regarde par la fenêtre, il n’y a rien, un gros trou seulement, des ouvriers qui vont et viennent, des machines qui ne fonctionnent pas et des camionnettes vides, un chantier qui semble s’éterniser et ne déboucher sur rien. Qu’on ne s’y méprenne pas, les travaux ont commencé il y a plusieurs années déjà...
Je ne suis pas un spécialiste mais je sais en effet qu’il a fallu discuter de la nécessité de construire de tels bâtiments, coûteux, il a fallu prendre en compte l’évolution démographique de notre région, déterminer l’emplacement de ces nouvelles constructions, garantir leur accord avec les règlements cantonaux, leur compatibilité avec l’environnement immédiat, s’assurer de la facilité des accès. Déterminer leur forme et les éléments qui les constitueront, présenter les choses de telle façon qu’elles ne déclenchent pas un cortège d’oppositions, convaincre les payeurs. Il a fallu appeler une entreprise pour liquider l’ancien et démolir la villa de Mottier, verser une larme, abattre des arbres, assurer la sécurité, amener la petite grue pour dresser la grande, creuser enfin, renforcer, protéger, isoler... pour que la construction de la nouvelle école puisse enfin débuter.
Les choses sérieuses ont commencé bien avant avant qu’elles ne commencent, c’était il y a des années déjà. Reste aujourd’hui un trou, tout est joué, ce ne sera qu’un jeu d’enfants d’aligner et d’entasser bientôt les briques. Notre nouvelle école a été terminée bien avant que les travaux ne commencent.
Il est temps de comprendre que la construction des connaissances ressemble sous cet angle étrangement à la construction d’un bâtiment. Pour qu’une connaissance tienne debout, je dois en comprendre la nécessité, en accepter les désagréments momentanés, en anticiper les gains. Je dois vaincre les oppositions tant internes qu’externes, défaire les connaissances qui occupaient les lieux, garder ce qu’on est bien incapable de modifier, préparer les outils indispensables dont on aura besoin, établir l’ancrage des notions principales, anticiper les liens qui feront de ces connaissances des éléments dans un réseau plus vaste, ménager des ponts, des liens. Et enfin, ne pas fermer la possibilité de s’en défaire, car les connaissances, comme les châteaux de sable se font renverser un jour par les vagues.
P.S.
Avertissement
Jean Prod’hom
Jean-Daniel, Javier ou Elisabeth

C’est aujourd’hui une affaire heureuse et sérieuse, heureuse parce que ça marche, sérieuse parce que Louise a rencontré quelqu’un à sa taille, d’accord et capable de l’accompagner sur des chemins qui ne sont pas les nôtres. On s’est rendu lundi soir en famille à Maracon pour une audition. Lui c’est Javier, elle c’est Louise, il lui accorde sa guitare avant de l’accompagner, c’est son professeur et elle l’admire. Il lui laisse ensuite la place et elle joue seule. Elle voudrait des leçons plus longues, une demi-heure c’est court. Il est d’accord. Il lui parle, elle le regarde. Il parle peu et elle joue beaucoup, ils jouent ensemble parfois, elle joue seule le matin au réveil, à midi, à 4 heures, le soir avant de se coucher. A la fin, c’est une affaire entre elle et sa guitare qui lui fait aujourd’hui des promesses.
Nos enfants auront grandi d’avoir été avec des autres là où nous ne sommes pas, chacun son tour, hier c’était Arthur, aujourd’hui c’est Louise, demain ce sera Lili. Et si on laisse nos enfants entre les mains de ces gens-là, c’est pour qu’ils puissent mener à bien ce qu’on est bien incapables de faire, les conduire plus loin que nous ne le pouvons, ou ailleurs, ou ici, mais moyennant ce détour qui les libérera de notre emprise. La société serait bien mal prise sans ces passeurs, Jean-Daniel, Javier ou Elisabeth, qui dénouent avec soin les fils qui ont lié nos enfants à notre amour immense, aveugle et nécessaire.









Jean Prod’hom
Dimanche 15 mai 2011

C’était le dimanche 12 septembre de l’année passée, nous avions pique-niqué la veille au bord du Doubs, avec le soleil, mangé une truite et dormi à l’hôtel de l’Union de Tramelan. Mais je suis seul ce matin, Sandra et les filles sont restées au Riau et Arthur est allé rejoindre Jean-Daniel pour la reconnaissance du parcours de la course à laquelle il va participer aujourd’hui.
Celle qui assurait le service du petit déjeuner dans cet hôtel fermé le dimanche est à nouveau là. J’aurais bien voulu savoir ce que cette native de Tirana et son mari devenaient, ses enfants aussi. Il y a huit mois, elle s’était assise à notre table et avait raconté un bout de sa vie.
Rien à faire cette année pour connaître la suite, je n’ose pas la déranger, elle semble triste et fatiguée, les yeux enfoncés dans le sommeil. Elle a servi les quelques clients de l’hôtel, parmi ceux-ci deux malcommodes que je me suis empressé de détester. Puis elle s’est assise, deux morceaux de pain et un café serré, pas tout à fait là, les yeux dans le vide, bien au-delà la petite place déserte. Pourtant il m’a semblé que son rire était au bord de ses lèvres, je n’ai pas insisté, me suis rappelé sa voix rugueuse avant de me pencher sur un livre qui m’a paru bien idiot.
Jean-Daniel est arrivé sur le site de la première manche de la Swiss Cup, petit carnet à la main : il passe en revue avec les coureurs les difficultés des différentes zones. Arthur est le seul coureur du club à rouler dans la catégorie des Benjamins, il dispose ainsi pour lui seul des conseils avisés de l’entraîneur. Ils s’éloignent en tête à tête, je les aperçois de loin, me fais discret. Je ne saurai rien en définitive de ce qu’ils se sont dit, je n’y comprends d’ailleurs pas grand chose, m’efforce même de me maintenir dans cette docte ignorance. N’est-ce pas une des façons de laisser aller de leur côté, sans les encombrer, ceux qu’on a faits? quitter son rôle de père dans un monde qui n’est plus seulement aux yeux du fils le monde de la famille.










Je les laisse à leur plan et vais faire un tour. La gravière qu’exploitent les Huguelet n’a guère changé, les coureurs, les parents et leurs accompagnants errent. On se croirait un matin de fête foraine, quelques courageux sortent de leur caravane et baguenaudent les mains dans les poches, les responsables de la course apparaissent au compte-gouttes et se réchauffent les mains autour d’un verre de café, quelques voitures arrivent, les langues se mélangent, italien, suisse-allemand, français, les enfants sautent comme des cabris sur les obstacles. On regarde inquiet le ciel qui ne donne pas toutes les assurances, les buvettes s’ouvrent, la journée prendra longtemps avant de démarrer.
La mienne n’aura pas commencé, j’aurai vécu dans le sillage et l’ombre de mon fils, porteur d’eau et oreille bienveillante, fournisseur de sandwichs et consolateur, content de voir à la fin de la journée cet enfant grandir d’un coup, prendre conscience qu’il peut vivre dans la peau d’un vainqueur, soulagé, mais aussi un peu seul, là-haut, sur le podium.









Jean Prod’hom
A.11

J’apprends dans l’ouvrage de Jean-Paul Bled sur l’histoire de Vienne que le bal à la Cour avait lieu quelques jours après le bal de la Cour. Il rassemblait moins solennellement près de sept cents personnes. François-Joseph portait l’humble habit du colonel, les invités une petite tenue de gala. Le menu se composait invariablement des cinq mêmes plats : crème d’oie en tasse, poisson mayonnaise, pâté, rôti et glace, le tout arrosé de champagne. C’est exactement ce qu’on voit dans le troisième film de l’inoubliable série des Sissi.
J’ai l’intime conviction que François-Joseph a un peu trop regardé cette série, sa femme aussi du reste qui, le temps passant, devint une pâle copie de Romy Schneider. Si on ajoute que François-Joseph, le vrai, celui du film, s’est inspiré de la dégaine de David Bowie, on peut sans hésiter affirmer que la politique spectacle est née à Vienne dans la seconde moitié du XIXème siècle.
Jean Prod’hom
On l’ignore avant de le savoir

On y est depuis toujours mais on l’ignore avant de le savoir, et on ne le sait que si on se laisse prendre et qu’on s’y enfonce encore. Alors le dehors vient dedans et le dedans va dehors. La rumeur prend la main sur la raison qui la rejoint en se mêlant à l’inarticulé, s’y défait au ralenti, se mêle aux poussières, à la terre, aux nappes de lumière en suspension et aux prés fauchés. Rien n’a changé pourtant. Ou tout du tout au tout. La tête ne dépasse plus, c’est dire qu’on ne l’a pas sur les épaules, ou plutôt, ce qu’on attend d’elle ne répond plus : on est dehors avec les oiseaux. Nul besoin de retenir son souffle, il suffit de respirer, sans mélange, quelques visages muets qu’on n’imagine à peine. Ça dure, une durée égale à celle de ces rêves qui restent en arrière et qu’on tente de retenir au réveil, inutile de vouloir colmater les brèches, il n’y en a pas. Impensable de prendre peur, rien à craindre, rien à perdre non plus sinon un peu du peu de raison qui reste, guettant le leurre auquel on veut mordre pour remonter un morceau de tout ça.
Tu es suspendu au hameçon de celui qui t’a ferré et qui t’attend plume à la main. C’est délicat, ce qu’il retire c’est bien toi mais tu n’as pas de bord et ses mots sont bien trop rodés. Il faudra que tu leur donnes d’autres noms et du vent pour dire la route qui va d’ici à là-bas et retour, les visages inconnus aperçus au volant de leur voiture, lointains, tournant sans fin sur les giratoires. Pas trace de danse, ce n’est pas un ballet, réveille-toi sans précipitation, parce que le monde accroché au leurre que tu retires n’est pas indifférent à celui que tu habites.
Mais là-bas tu étais dedans avec le dehors et tout débordait sans toucher à rien. Ce n’était pas loin de ce qui ne se peut pas, aussi léger qu’un souvenir. Il n’y avait pas de vent et je n’étais ni Pierre, Jacques ou Jean. On ne voulait rien bâtir, il avait suffi qu’on nage avec les autres, ça valait le coup. Plus que jamais hors jeu dans le jeu, dedans dehors sans jamais que ça s’effiloche. On avait tous un oeil sur le miracle.
Jean Prod’hom
Il y a les procédés de distillation

Il y a les procédés de distillation
la poudre d’escampette
il y a l’architecture gothique et la pensée scolastique
il y a la police de proximité
l’eau au goulot des fontaines
la pêche à pied
il y a la salade à tondre
la nécessité
la levée de l’immunité
Jean Prod’hom
Dans un monde que ni eux ni nous n’imaginions

Pour Rick
On ne le dit pas assez, mais une des tâches de l'école – la principale peut-être et un peu à son insu – vise à décoller l’enfant du giron ménagé par ceux qui l'ont accompagné jusque-là, au sein d'un milieu doux et étroit, mère et père. dans leurs bras d’abord, attaché à leurs basques ensuite sous la bienveillante protection des lares familiaux, et de le conduire – sans qu’il s’attache trop aux passeurs que l’institution a mis sur son chemin (parce que tout serait à recommencer) – à la rencontre de nouveaux horizons, au-delà desquels s'étendent des plaines sans fin et d'autres mers, vivent des dieux inconnus, où se succèdent les guerres et frémit cette liberté à l’acceptation de laquelle le nid douillet dans lequel il a passé les premières années de sa vie ne le prépare pas.
En ce sens les récits lus à l’école jouent un rôle majeur. On y est invité à tourner les premières pages de livres dont on se serait dessaisi peut-être sur le champ, maintenus ouverts par obligation parfois, mais qui ont eu l’inestimable vertu de nous égarer loin des pénates.
Je me souviens bien de cette année-là, nous avions lu Thomas Platter (Ma vie), Jules Verne (Le Tour du monde en quatre-vingts jours), Blaise Cendrars (L’Or), Alain-Fournier (Le Grand Meaulnes), Georges Simenon (Maigret s’amuse), Charles-Ferdinand Ramuz (Si le soleil ne revenait pas) et Philippe Claudel (Les Âmes grises). Et lui, qui ne demandait rien hors les jeux et le plein air qui le comblaient, se mit à lire avec curiosité la merveilleuse histoire du général Johann August Suter. Il s’intéressa sans prévenir au contexte géo-historique de la découverte de l’or en 1848, à la figure conquérante de Suter débarquant sur la côte californienne, au petit air de jazz qui accompagne la lecture des textes de Cendrars. Un hasard? Je me suis souvenu alors que le garçon avait, par sa mère, la moitié de sa parentèle du côté de Bâle et qu’il parlait la langue rugueuse de Johann August Suter de Rünenberg. Tout vient de là.
Je me souviens d’un autre moment encore. Le garçon connaissait Saint-Martin, il s'y était rendu enfant avec ses parents, un séjour dont pourtant il ne lui restait rien sinon l’idée d’une forte pente, il y était retourné à deux reprises il y a peu avec un ami. On lisait donc Si le Soleil ne revenait pas, et le garçon, un peu remué, s’interrogea sur le fait pour lui impensable que le Saint-Martin où se déroule le récit de Ramuz n’épousait pas exactement le village cadastré du Saint-Martin d'aujourd'hui. Il avait en outre ouvert par curiosité l’annuaire téléphonique de la région dans lequel il avait découvert que les patronymes des personnages du récit du Ramuz en avait été tirés, pas un ne manquait. Il prit conscience alors que le Saint-Martin de son enfance n'était pas le Saint-Martin de Ramuz, que le Saint-Martin de Ramuz lui donnait accès à un autre monde que le sien, une géographie différente de celle de l’administration, que seule la littérature est en mesure de figurer : il y a le haut et le bas, des lignes de partage et des lignes de fracture sur lesquelles s'échelonnent des valeurs et des temps différents. Il découvrait alors que le réel, comme les récits qui en lèvent partiellement le voile en multipliant les mondes d’au-delà de l’horizon, peut être lu comme une mythologie sans laquelle les autres ne seraient pas.
Comme si, pour qu'il y trouvât son compte, un point devait le relier à son passé d'enfant, qui lui donnerait l’impulsion mais aussi le courage d'aller de l'avant. N’en va-t-il pas de même pour nous autres? C’est, au fond, ce qui nous retient, ce qui nous ramène en arrière, les souvenirs, les sensations qui nous propulsent en avant. La matrice d’où l’on sort et le nid familial qui nous abritent ensuite ne s'opposent pas aux milieux ouverts et complexes qu’on est amené à investir. Ils ne vont pas les uns sans les autres, ils se rencontrent en un point qui porte le nom de désir.
On ne s'éloigne ni de ses proches ni de ses ancêtres, on s'en décolle. Ils demeurent si proches qu’on les retrouve à la fin transfigurés dans un monde que ni eux ni nous n’imaginions.
P.S.
Avertissement
Jean Prod’hom
Dimanche 8 mai 2011

Je ne l’entends pas s’approcher, il est à vélo, me dépasse au bout du plat avant que je le rejoigne au milieu du raidillon qui mène à la Mussilly. Il est descendu de sa bécane, avec un peu de bave au bas du menton, bonjour. Il essaie de parler mais n’y arrive pas, il hoche la tête, sourit, je lui parle, ne me répond pas, essaie encore, essaie, hoche la tête, oui il a eu une attaque, il y a quelques années, oh oui. Il vient de là-bas, au bout de son doigt, non, pas de Corcelles, Pully peut-être. Il sourit encore, moi ausi je crois. C’est bon de pédaler, de marcher, oui c’est bon. Il essaie encore une fois, à peine trois mots au total, inachevés, avant de parvenir au chemin qui entre dans le bois. Il me salue, monte sur sa bécane, se lance, s’il tombe. Je l’aperçois au bout du chemin près du refuge, il pédale encore, c’est le vent qui le soutient. On dit du sourire de Bouddha qu’il est impénétrable, le sien aussi, il tient ensemble son bonheur d’en être et l’impuissance qui l’habite, l’irrévocable qui nous précède et l’irrémédiable qui nous attend.

Les choses on bien changé depuis ce dimanche de janvier où je passais par-là. Les abeilles ont lancé les grands travaux, s’affairent autour du colza et butinent les derniers pissenlits. Encore quelques jours avant l’effacement des jaunes et l’établissement sans limite des verts. Je lis en marchant la seconde moitié de Kosaburo, 1845 (Nicole Roland), avec le sentiment idiot – qui ne me quittera pas – qu’il recèle une clef. Je la trouve à la fin, la serrure aussi, mais elles ne sont pas appariées.

Je connais au moins une issue, une réponse à l’amoncèlement des soucis dont s’alourdissent chaque jour nos vie : sortir, sortir là où il n’y a rien, ou presque rien, ici, là, là où l’interrogation n’appelle aucune réponse, mais se mêle à la rumeur qui la porte. pour devenir la soeur des eaux dormantes. Assis sur une souche, je regarde passer ce qui ne passait pas, l’enfer que je m’étais construit, qui se défait comme parfois les nuages et rejoint en morceaux le dérisoire. Dans la pente des talus, les fraisiers sauvages ont fleuri.

Le paysage tourne autour du réservoir de Goumens-la-Ville. Je bifurque avant Malapalud dans le lit du Talent pour le remonter rive droite jusqu’au Moulin, rive gauche jusqu’au chemin qui conduit à Assens par les étangs artificiels des Bois aux Allemands, il y a foule. Il y a eu foule aussi à l’Espace culturel où je babille un instant avec Catherine. Il est 18 heures 30 lorsque je m’assieds sur les escaliers devant l’église : le retable aux couleurs d’Arlequin, sculpté en fanfare dans les ateliers de Jean-François Reyff autour de 1680 est inaccessible, une porte fermée à clé en barre l’accès, elle est cachée derrière une fenêtre à double vitrage qu’une artiste, Renate Buser, a installée là. Pour qu’on réfléchisse peut-être. Alors je réfléchis.

Jean Prod’hom
36

C’est souvent beaucoup plus tard qu’on ressent les effets du poison des paroles bues à grands traits. Seul antidote alors, d'autres paroles. Ou le silence, car la guérison est ailleurs, il est encore temps de tailler la pierre.
Jean Prod’hom
L'inconnue du jour de la rentrée

Pour Julia
C’est lundi jour de rentrée, ils s’approchent avec des souvenirs plein derrière la tête, somnambules et naïfs. Ils ont mené la belle vie, en témoignent leur visage de bronze et les sourires qui strient leurs visages jusqu’aux oreilles, que de choses à raconter, corps reposés et déliés, heureux de revoir ceux qu’ils ont quittés sans même se dire au revoir, c’était la veille, ce matin à peine bonjour, pas la peine. Ils rayonnent assurés d’avoir fait le plus beau des périples, pressés de tout dire. Chacun à son tour en fait le récit assourdissant.
C’est un lundi d’août, dernier jour heureux, les inconscients débordent d’idées neuves, on reprendra tout depuis zéro, cahiers neufs, notre agenda sera le compagnon de l’intime, écriture de gala et bestiaire aux couleurs des poissons de la Mer Rouge, je serai à leur image. Ils se regardent comme des frères et soeurs, leurs sourires se croisent, oh! comme tu as changé, tu reviens d’où, des quatre coins du monde, d’Acapulco ou de Lozère, de Brazzaville ou de la Gruyère. Il y a celui qui parle à tort et à travers et celui qui l’écoute, il y a ce qu’on ne dit pas ou qu’on murmure en baissant les yeux, on hoche la tête, il y a ceux qui écoutent un peu en retrait, ceux qui s’évitent, la belle élégance de celle à la jupe aux coquelicots et celui qui l’admire.
Parmi eux, cette année-là, une inconnue, il faisait beau, t’en souviens-tu? Elle semblait se demander ce qu’elle venait faire dans cette galère. Elle s’est assise la première, à l’arrière, dans le troisième cercle, celui d’où on regarde les choses venir, elle a déposé son sac à main sur la chaise voisine, vide.
Ils discutent, choisissent un compagnon ou une amie, négocient les places, mettent la main sur l’espace qu’ils se partagent, rappellent des promesses, prennent des résolutions, Le travail? personne n’y croit encore, que fait-on là? Ils glissent alors leurs souvenirs avec les papiers-brouillons sous la table, c’est pour tout à l’heure, le silence s’insinue finalement le long des rangées, l’une après l’autre, ils se mettent tous à la cape.
La nouvelle se tiendra toute la journée hors la mêlée. Elle m’apprendra plus tard dans la classe vide qu’elle revient de Floride, où elle a vécu avec sa famille. Combien d’années sont-ils restés dans le Nouveau Monde, je l’ignore. Me l’a-t-elle dit, le lui ai-je demandé ou ai-je oublié? Ce doute que je n’ai jamais voulu ou pu éclairer, qu’elle ne m’a peut-être jamais invité à dissiper, je l’ai peut-être soigneusement entretenu, si bien que la nouvelle n’a jamais cessé d’apparaître à mon esprit comme la nouvelle, tout au long des jours qui ont suivi et bien au-delà. J’avais l’impression qu’elle avait laissé en arrière des malles qui resteraient fermées, n’emportant dans son sac à main que le strict nécessaire. Qu’allaient lui réserver ce nouveau pays et les amis qu’elle y retrouvait? J’avais le sentiment qu’elle était à tout instant sur le point de repartir, prête à rejoindre avec les siens sa vraie maison.
En attendant il fallait lui ménager une place de fortune et lui laisser du temps pour s’acclimater et apprivoiser ce nouveau nouveau monde, panser les blessures de l’exil. Je n’y puis rien, la première image s’incruste, on le sait. Sans que je le veuille, sans qu’elle m’en dissuade, la nouvelle est restée à l’arrière du petit théâtre qu’est la salle de classe, occupant les lieux les plus éloignés, près de la porte ou des fenêtres qui donnent sur l’océan, disparaissant même parfois derrière ceux qui prennent le gros de la place. Mais la mémoire me trompe-t-elle?
Lorsque je me suis rendu compte de l’empire que cette première image avait exercée sur moi, je me suis avisé qu’elle avait tout au long de ces années appris mille et une choses, compris, écouté, progressé, qu’elle avait bien été là, parmi nous. Mais cette remise au pas, par la raison, n’est pas parvenue à effacer l’idée que la nouvelle n’allait pas rester, qu’elle allait tout et tous vite nous oublier. On va venir la chercher en fin d’après-midi, elle n’est que de passage, elle va reprendre l’avion qui l’a déposée la veille, à tel point que j’entends parfois dans le français qu’elle parle l’anglais qui l’habite. Oui, je l’imagine américaine encore.
C’est au bord d’un champ de colza, assis sur une de ces pierres que les paysans retirent des labours, sous le ciel bleu et les traînées d’un long-courrier, que j’écris ces lignes qui m’aident à comprendre le peuple de ceux qui, en raison des circonstances, vont et viennent par-dessus les océans. La nouvelle élève a fait voir, au cul-terreux que je suis resté, la possibilité même d’une vie de transit, dans un espace multiple où l’on ne sait jamais avec certitude si l’on se rend quelque part ou si l’on en revient, si les pas que nous faisons nous rapprochent ou nous éloignent de notre vraie maison. J’ai souri, il faisait beau et chaud, je l’imaginais dans ce long-courrier, voyageant pour affaires, parlant deux langues. Il y a des gens dont on ne sait jamais s’ils partent ou s’ils reviennent, alors on oublie un peu qu’ils sont bien là. Mon Dieu que le temps passe vite.
P.S.
Avertissement
Jean Prod’hom
35

La vie sociale est un songe si ténu, si fragile – mais si bien confondu au sommeil de nos consciences – qu’il pourrait tourner au cauchemar sans que, du fond de notre nuit, on n’éprouve un seul instant le besoin de s’en aviser. On peut se consoler en se persuadant qu’en ces circonstances le cauchemar peut également devenir un songe. Ça c’est l’autre rêve.
Jean Prod’hom
Dimanche 1 mai 2011

La vertu de la prière, c’est d’énumérer les choses de la création et de les appeler par leur nom dans une effusion. C’est une action de grâces. (Blaise Cendrars)
Je remonte plein soleil sur Vuibroye en longeant le Grenet bientôt sec, en écoutant Miriam Cendrars évoquer la participation de son père au J’accuse d’Abel Gance. Nous sommes en 1919, le cinéaste français à besoin de gueules cassées pour dénoncer les horreurs de la guerre. Elles ne manquent pas dans la capitale. Blaise Cendrars fera l’affaire, une trentaine d’années, le bras droit laissé dans les tranchées et du temps à revendre.
André Dhôtel n’apparaît pas dans le film d’Abel Gance, pourtant l’Ardennais en avait une belle de gueule cassée, surtout à la fin. Né en 1900, il a 14 ans lorsque la guerre commence, fait de la philosophie à Paris alors que la guerre s’éternise dans le nord. Il retourne à Attigny en 1919 quand la paix est signée. Il n’y bougera presque plus.
J’ai toujours associé les deux écrivains que pourtant rien ne semble rapprocher. L’un bourlingue et écrit au fer, l’autre paresse le long de la Meuse et file des textes improbables. Tout les oppose quoi que...
En 1957, Dhôtel publie en effet un récit qu’il intitule Saint Benoît Joseph Labre dans lequel il raconte l’histoire d’un vagabond du XIXème siècle que Léon XIII canonisera et qui deviendra le saint patron des mendiants et des sans domicile fixe, un oeil bienveillant sur les inadaptés, les rêveurs, les pèlerins, les naufragés, les malheureux, les mécontents. les hommes libres, les insoumis. Ceux qui ont eu des revers de fortune; ceux qui ont tout risqué sur une seule carte; ceux qu’une passion romantique a bouleversés...
Saint Benoit Labre était un jeune homme extrêmement pieux, tellement voué à la religion que son entourage lui reprochait d’être un peu trop confit en religion. Il désirait aller dans un couvent. Or il a fait trois essais et chaque fois ce fut un échec complet. Ce n’est pas que la vie du couvent ne lui plaisait pas, c’est qu’il n’en obtenait qu’une angoisse épouvantable. C’est donc un échec. Après le troisième couvent, il part sur la route... Que s’est-il passé? Je crois d’abord qu’il avait voulu saisir le bonheur dans l’amour de Dieu et le fait même de vouloir saisir ce bonheur l’a mené à une catastrophe. Vous vous souvenez de cette parole de Rimbaud : le bonheur a été mon remords, mon ver... Benoit s’est trouvé très indigne, au dernier degré de l’indignité, mais l’aventure est celle-ci: cette indignité n’a pas entamé sa foi, elle n’a fait que la rendre plus vive car il a compris qu’il était en présence de l’inacessible et il s’est aperçu que si on ne peut pas atteindre l’inaccessible, on peut aller vers... Alors où va-t-il? N’ayant pu rester dans un couvent, il va visiter tous les couvents possibles et imaginables. Quelquefois il entre, quelquefois il se présente à la porte, espérant être appelé un jour... eh bien on peu dire qu’un poète se présente à la porte et attend, non qu’il y ait un appel, mais une sorte de parole qu’il n’attendait pas. Benoit, ne pouvant rien faire d’autre, marchait. Le poète, ne pouvant rien faire d’autre, cause. Il se met à causer un peu à tort et à travers. (André Dhôtel)


J’apprends aujourd’hui que Blaise Cendrars, dans le creux de Montpreveyres, entre Servion et la Goille, peu avant sa mort, manifestant jusqu’au bout le besoin d’écrire la sainte alliance de l’horreur et de la beauté, écrivait les pages d’un livre qu’il aurait intitulé Les Lépreux et dans lequel il aurait raconté la vie de saint Benoit Joseph Labre. Nous sommes en 1961, André Dhôtel avait fait paraître son Saint Benoit 4 ans auparavant. Moi j’avais 6 ans et je ne savais pas lire.
Jean Prod’hom
Elle avait envie de disposer un peu plus d’elle-même

Pour Gabriella
Elle se savait un peu plus âgée que les autres, avait l’envie de disposer un peu plus d’elle-même, oh seulement un peu, à peine, mais à cet âge ça compte, à cause de l’idée qu’on s’en fait. Et puis nos institutions taillent dans le temps de manière si arbitraire qu'il suffit que vous soyez né en mai pour que vous deveniez un petit parmi les petits, en août pour que vous intégriez le groupe des grands. Supposez encore un instant que vous soyez pour des raisons qui ne vous appartiennent pas un prématuré, ou un tard venu, et vous serez convaincu que l’institution qui devait assurer l’égalité des chances devient, par un manque de souplesse congénital, une immense loterie.
Grande, un peu plus grande, elle avait l’envie d’un peu plus de liberté, pour garder, parmi les plus petits, au moins symboliquement, l’avance qu’elle avait prise au commencement. Mais la demande qui lui fut faite de placer ses velléités d'indépendance sous l’étouffoir au prétexte qu'elle se trouvait désormais avec des plus petits la condamna au grand écart : être loyale avec ceux qu’elle avait dû quitter et qui continuaient leur chemin un peu en avant d'elle et ralentir son allure pour se glisser dans les traces de ceux qui venaient de l'arrière, des traces presque à sa taille pour autant qu’elle les acceptât. Partagée donc entre ceux qui n’étaient plus là, ceux parmi lesquels elle avait commencé à devenir et qui lui avaient assuré cette première reconnaissance essentielle et ceux qui n'étaient pas encore là, les plus petits, parmi lesquels elle dut recommencer à devenir, pour la seconde fois.
Il fallut du temps pour que le grand écart se réduise et qu'elle se fasse à sa nouvelle condition sans baisser la tête. Et c'est dans cet espace laissé pour compte par les uns et par les autres qu'elle grandit, leva la tête et accéda, je crois, au monde qui l'entourait, C'est dans cet espace qu'elle calibra ses ambitions, établit ce qui lui restait à faire pour être auprès d'elle-même. C'est dans cet espace que les parties dont nous sommes tous faits trouvèrent petit à petit leur cohésion et leur centre de gravité. On est tous pareils, même si les chemins qui conduisent au fragile équilibre sont variés, c’est dans la différence qu’on s’approche de ce qu’on sera à la fin, sans qu’on sache exactement si on y parviendra. C’est le travail de chacun, nouer ce d’où on vient avec ce vers quoi on va pour être là où on est, sans que ce qui nous entoure ne nous dévore en nous faisant croire que la vérité est celle de l'alliance du nombre et de la pression, c’est-à-dire de l’appartenance.
Tout ne va pourtant pas sans heurt, nos cicatrices en témoignent, plus d’une fois on est las, prêt à laisser de côté le travail obstiné, tenté que nous sommes d’aller au plus court pour rejoindre au plus vite ces lieux qui exhibent les signes de notre temps, où l'on croit les choses si vraies et si belles qu’on est sur le point d’y attacher nos existences. Plus d’une fois il m’aura fallu du courage et me reprendre, surmonter la tentation des images. Mais qu'ont-ils devant eux ceux qui sont devant moi ? Qui m'appelle? Que ceux dont je suis sur les pas et que ceux qui me suivent ne deviennent pas ceux qui m'empêchent de me pencher sur ce qui se présente sur les côtés du chemin.
Il est temps de réformer mon entendement, car les choses ne vont pas comme on le veut, et c'est bien ça la question. La rage n'est pas un gage, et il ne sert à rien que nous chargions de nos manques celui qui n’en peut rien. Faudrait-il que le monde se comporte autrement ? Puis-je infléchir ma condition, cesser enfin de recourir à mon bon droit qui ne ferait que différer d'un tour le courage qu’il faut pour se consacrer à ce qu’on ignore ? Convient-il de tirer au plus court ? par désir d'économie ou économie du désir ?
Aujourd’hui je l’aperçois sur une terrasse du bord du lac, avec une amie d’hier et une de demain, elle évoque ses projets. Mais est-ce bien elle ? Elle a un petit geste qui montre le sud, un pays et le soleil au-delà des Alpes, après que le Rhône s’est couché dans la mer. Oeil brun et vif derrière des lunettes à soleil, l'oeil de quelqu’un qui veut ce qu’il veut et qui sait ce qu'il peut, elle dit, on n’a rien sans rien, elle dit aussi, on ne réduit jamais complètement le grand écart qui nous a fait. Et puis ce rien qu'on met dans le pot pour être enfin quelque chose qui ressemble à quelqu’un, c’est un sacré travail d’en étendre la portée.
P.S.
Avertissement
Jean Prod’hom
Il y a le taudis de devant la forge

Il y a le taudis de devant la forge
l’inopportun
il y a ceux qui vivent sur la pointe des pieds
les premières fraises
le brie
les tourbières
il y a les deux pies du pin
la pauvreté de la vie monacale
les monosyllabes
Jean Prod’hom
C’était au début, elle riait avec ses yeux en amande

Pour Anne-Sophie
C’était au début, elle riait avec ses yeux en amande qui disparaissaient dans l’éclat sonore de sa voix, éloignant les questions qui lui étaient posées, n’y répondant pas, peu ou à côté. Que voulez-vous ? elle était comme ses camarades, à mille lieues du terroir qui les avait vu naître et du foyer qui alimentait leur sens. Ce n’est pas qu’elle ne voulait pas jouer le jeu, mais elle en comprenait mal les règles et au fond n’y croyait pas. J’avoue qu’elle n’avait pas tout tort et son honnêteté souriante lui a permis de franchir des étapes que tous ses contemporains n’ont pas surmontées avec la même sérénité. Pensez donc!
En les soumettant dès leurs premiers pas à l’idée qu’elle détenait fermement un ensemble fini de questions auquel correspondait un ensemble fini de réponses nécessitant les unes et les autres une formulation stricte, l’école obligeait ses bleus à une première épreuve qui devait les conduire d’emblée à une conversion épistémologique majeure. Si formellement l’affaire ne semblait pas hors de leur portée, elle l’était pourtant dans sa réalisation et allait les conduire, de déception en déception, de chicane en chicane, à un carrefour où il leur faudrait prendre une difficile décision.
Accepter les présupposés de l’entreprise, pactiser avec l’inconcevable, prendre plaisir aux parcours de dressage et tirer quelques avantages mondains de l’application mimétique de singeries scolastiques ? Ou renoncer à ces présupposés et, partant, refuser la récompense promise à ceux qui s’approchaient du but et qu’on encourageait en les invitant, pour qu’ils patientent, à revêtir l’uniforme des seconds couteaux ou à endosser le rôle du muet dans une pièce à laquelle plus personne ne croyait vraiment ?
La déception fut grande, autant pour les sages qui avaient élaboré le plan et le programme que pour ceux qui en respectaient scrupuleusement les parties ou qui en avaient perdu de vue le sens. Il fallait s’y résoudre, de telles années de formation ne mèneraient nulle part, sinon à la maîtrise abstraite d’un ensemble de coques vides et de formulaires dont la maîtrise ne permettrait rien d’autre que de parasiter et pasticher ce que l’homme a à compendre. Chacun avait à composer au plus vite avec ce douloureux constat.
Car une seconde épreuve les attendait, autrement plus radicale: les réponses n’ont aucun intérêt parce qu’elles sont toutes contenues dans les questions qui vérifient leur pertinence. Pire, il y a bien plus dans les questions que dans les réponses, qui emmènent dans leur sillage ce qu’elles ont laissé de côté pour circonscrire leur champ. Il faut donc reprendre les choses depuis le début, commencer enfin les observations si souvent différées et les réflexions auxquelles les réponses attendues d’autrefois barraient l’accès. Il faut se résigner à se mettre enfin au travail, et plutôt que de rédiger des réponses à des questions qui ne se sont jamais posées hors les traditions, chacun doit se mettre à l’étude du monde qui l’entoure et de la tradition à laquelle le premier est suspendu, chacun doit prendre le risque de s’en approcher en lisant les récits qui en donnent le corps véritable et en fournit la légende. Car ce sont les contes et légendes qui éduquent nos enfants, c’est-à-dire les conduit hors de l’école, les dissuade d’y rester pour rejoindre au plus vite ce dont elle les a éloignés et qu’elle avait la charge de leur présenter. Pour retrouver le réel dont il a fallu réduire un instant la voilure, histoire de déchiffrer le b.a.-ba des langages qui seront leurs alliés lorsque ils auront à rejoindre la jungle du début, quand ils auront à y instituer ce qui n’est pas, dans des régions qui ne sont pas encore.
Elle était comme ceux de son âge, croyait qu’il existait un lot de questions et de réponses définitives, qui attendaient sagement dans un réduit qu’on s’y intéresse et auxquelles on aurait accès lorsqu’on serait adulte. Je me souviens de ses doutes, au début. Elle était jeune et, comme ils se doit, ne voulait saisir du monde que ce qu’elle en voulait, dans l’insouciance du temps. Et puis, de fil en aiguille, sans heurt ni bousculade, elle a accepté qu’il en allait autrement, que le monde n’est pas à son image, et qu’il méritait les égards de son attention. On l’a vue alors à la fin s’approcher du monde et s’y intéresser, dans ce qu’il a de beau mais aussi dans ce qu’il a de difficile, de s’y inscrire et de s’y montrer efficace.
Je l’imagine aujourd’hui sur une terrasse de café, c’est l’été, elle n’est pas pressée, bien mise dans des habits Abercrombie & Fitch qu’elle a achetés à Copenhague, elle lit le journal, intéressée aux affaires du monde. L’obligatoire et les jeux d’enfants sont derrière elle. Elle attend une amie qui a un peu de retard, mais ne lui en veut pas, elle sait profiter du temps qui passe. Elle sourit d’aise derrière ses lunettes à soleil. Elle se souvient de ses rêves d’autrefois et de la mer. Elle sait ce qu’elle va entreprendre dans les années qui viennent, sans ignorer que la route est encore longue. Elle aime l’année des quatre saisons. C’était à la fin, elle riait avec deux yeux en amande qui disparaissaient dans l’éclat sonore de sa voix. Elle riait des questions qu’elle se posait et qui ouvraient les portes cochères du monde, un monde immense aux dimensions de nos existences.
P.S.
Avertissement
Jean Prod’hom
LXXXVIII

Il y a plus d’une année qu’on ne les a pas revus au village, Michel et Marjolaine mènent leur retraite tambour-battant, sans enfants ni petits-enfants, libres comme l’air. C’est la fin de l’après-midi et il fait beau sur la terrasse du café, on n’entend qu’eux, ils nous racontent leurs voyages dans le Tyrol, en Croatie, à Naples, et puis dans les Cévennes. Deux nouveautés sautent aux yeux, la petite caravane qui les suit partout et que l’on aperçoit sur quantité de photographies, et puis, plus grave, la manière dont ils s’adressent la parole :
- C’est dans un camping à l’entrée d’Anduze, la veille du 14 juillet.
- Mais non papy, c’est à Sainte-Enimie, lorsque nous revenions de Florac.
- Mamy! je t’en prie, tu n’y es pas.
- Papy!
On se regarde d’un oeil étonné avant de trouver l’explication la plus vraisemblable : Michel et Marjolaine s’appellent papy et mamy depuis qu’ils se sont acheté une caravane, par manque de place.
Jean Prod’hom
Il y a les heures creuses

Il y a les heures creuses
la purée de châtaigne
le retour discret des hirondelles
il y a les pentes douces
les arcs surbaissés
la place des Clercs à Montélimar les jours de marché
il y a l’austérité
les habitations troglodytes
il y a les greffes et les porte-greffe
Jean Prod’hom
Elle était du premier et du troisième cercle

Pour Lucy
Elle était du premier et du troisième cercle, mais pour le comprendre il faut retourner au commencement...
C’était un espace qui répondait à des règles strictes, hémicycle entourant une place vide que venaient occuper à tour de rôle ceux qui avaient pour mission de transmettre aux nouveaux-venus les savoirs-faire que l’humanité avait développés durant plusieurs millions d’années. Les vicaires avaient à leur disposition neuf ans pour mener à bien leur tâche. Tout le monde saisissait l’importance de l’affaire, sans toutefois être en mesure d’évaluer correctement la dimension de l’entreprise qui s’avéra, comme vous le devinez, impossible. Avec le temps la scène se stabilisa et les acteurs trouvèrent leurs marques. On peut aujourd’hui, avec un peu de recul, schématiser la situation de la manière suivante.
Les nouveaux-venus se répartissaient chaque début d’année en trois demi-cercles concentriques. Devant, une couronne dense mais réduite, celle des individus éveillés à toute heure du jour et de la nuit, actifs et volontaires, avides de connaissances, prêts même à donner une ou deux heures de leurs loisirs quotidiens pour réduire d’une ou deux années le temps de leur formation et en finir au plus vite. Ils devenaient avec le temps un peu songeurs, résignés de constater que leurs initiatives n’accéléraient pas les choses, révoltés même lorsqu’ils se rendaient compte qu’ils devraient malgré tout aller jusqu’au bout.
Derrière ce premier cercle, la couronne plus dense de ceux qui avaient deviné que les places du milieu leur permettraient de répondre à leur double nature : dresser l’oreille lorsque c’était nécessaire, pour saisir l’information dont ont leur demanderait de se souvenir plus tard et dont ils auraient à rendre compte, mettre de côté les pierres d’angle et les clés de voûte des édifices qu’il leur suffirait de reconstruire lorsqu’ils en auraient besoin. C’était affaire de quelques minutes au cours de la journées, ils vaquaient le reste du temps à leurs petites affaires, publiques ou privées, avec la discrétion de ceux qui ont saisi les règles du jeu et qui ne demandent rien à personne.
Et puis à l’arrière, dans le troisième cercle, ceux qui ne voulaient rien savoir, rien voir, rien entendre et étaient là, bien au chaud, fermement décidés à terminer le rêve qu’un réveil trop brusque avait interrompu et organiser le temps qui leur reviendrait lorsque l’institution voudrait bien les laisser partir. Ils souhaitaient en outre pouvoir s’entretenir sans être dérangés et sans déranger non plus leur voisinage des affaires du monde, allégeant ainsi l’atmosphère, il faut le convenir, des milles futilités qu’ils y jetaient sans lesquelles les espaces clos deviennent aussi mortels que des prisons. Et puis, mélangés à eux, le public des curieux, ceux qui ne voulaient pas trop s’impliquer mais souhaitaient, tant qu’à faire, considérer avec le recul nécessaire la scène qu’ils avaient à jouer et qu’ils étaient bien résolus à ne pas jouer trop tôt.
Elle était du premier cercle, éveillée, toujours pimpante, alerte, prête à se mettre à l’ouvrage, mais il lui fallait un certain temps avant de réellement s’y engager. Il lui fallait en effet considérer la situation, observer attentivement ses caractéristiques toujours changeantes, hésitant même parfois à faire le pas, non pas qu’elle doutât de l’intérêt des tâches qui lui étaient proposées, mais parce qu’elle aurait voulu en savoir plus sur le sens de l’entreprise. On savait bien que finalement elle s’y ferait, elle se mettait alors au travail sans qu’on le remarquât, un peu résignée vraisemblablement, mais toujours avec le sourire. C’est ainsi que, locataire du premier cercle, elle mettait un zeste de l’atmosphère qui régnait à l’arrière, allégeant d’un certain poids le sérieux qui pouvait habiter ceux du devant. Je crois bien qu’elle s’y sentait bien, toute proche du centre de gravité apparent de la scène, et pourtant, profondément distante. Avec elle c’était le troisième cercle qui se plaçait devant. C’était peut-être la meilleure place pour mettre toutes les chances de son côté, ne pas être dérangée en manifestant une présence forte et vivifiante, mais garder une distance suffisante pour ne pas s’engager tête baissée dans une entreprise dont l’institution se gardait bien d’expliquer comment et quand on en sortirait.
Je savais qu’elle aurait aimé être ailleurs, souvent, sur une autre scène, sous un tilleul ou une treille, avec un livre et du soleil. C’était une infatigable lectrice peu décidée à se lancer tête baissée dans les tâches qu’on lui présentait bien peu romanesquement, mais assoiffée de lecture, refusant de lâcher cette naïveté sur laquelle l’enfant lit, vit et construit son avenir, en maintenant à distance le monde qu’il serait toujours assez tôt de rejoindre.
Je l’imagine aujourd’hui heureuse dans la cafétéria d’une bibliothèque – bibliothécaire, étudiante, enseignante ou responsable de la cafétéria – avec les amies auxquelles elle est toujours restée fidèle, quand bien même chacune d’elle a pris une autre trajectoire que la sienne. Elle n’en dédaigne aucune, c’était une infatigable lectrice, j’imagine qu’elle l’est aujourd’hui encore, gardant près d’elle ces récits qui nous permettent d’apprivoiser le monde brutal dans lequel on vit, ces récits qui ont remplacé un jour, avantageusement, l’école qu’il a bien fallu que nous acceptions.
P.S.
Avertissement
Jean Prod’hom
Dimanche 24 avril 2011

L’insouciance traîne les pieds et écrit dans la poussière et le thym les principes d’un bonheur sans queue ni tête. Tu te laisses glisser à l’arrière, le long du lit du Lez. Les coquelicots battent des mains, je devine le vent passer sous ta jupe, près des piles d u vieux pont, entre Grignan et Colonzelle par le Lez. Les enfants font de longs détours, débordent du chemin, leurs jeux font d’interminables méandres, prennent à témoin les roseaux qui hochent du chef. Ils conçoivent des gris-gris un sac à main ou des boucles d’argent, puis passent le gué pieds nus, les rires en grappe et, tandis qu’ils s’éloignent dans le vieux village, j’entends au loin, du côté de Chamaret, les aboiements étouffés d’un cabot oublié dans un vide-poche.

Jean Prod’hom
Aurait-il pu en être autrement ?

C’est en descendant la route des Plaines-du-Loup, un samedi soir de printemps, perdu dans la foule des supporters du Lausanne-Sport que je pris conscience des maigres moyens dont je disposais pour changer le cours des choses.
La rencontre était à peine terminée que la fureur des supporters retombait en morceaux au pied de l’arène. La foule s’agitait d'un mouvement continuel et divers, on se heurtait, rebondissait dans un silence de mort, les uns à de grandes distances, les autres faiblement. Les flux tardaient à trouver leur lit et on dut, papa et moi, hors toute discipline, nous glisser en marge de l’affluence pour remonter à contre-courant au lieu même où nous attendait le nôtre. On y parvint sans peine. Malgré mon jeune âge, j'aidai au passage certains de mes semblables à trouver leur direction, je trouvai la mienne. Il nous suffit alors, accompagnés d’innombrables ombres, de suivre la pente qui allait nous conduire de la rue de la Pontaise à celle du Valentin, silhouettes toujours moins nombreuses dans la nuit, puis de celle-ci jusqu’au numéro 4 de Riant-Mont, avec pour seules ombres les deux nôtres.
Dans un silence de mort? Pas tout à fait, car on entendait en chaque lieu des malédictions, murmurer des imprécations. Les âmes rongées par le ressentiment s’affairaient autour de l’irréparable, prêts à voiler la roue de la fortune, lynchaient les pauvres bougres qui s'étaient battus jusqu'à la fin, inventaient les causes de la terrifiante défaite des Seigneurs de la nuit, ordonnaient les remèdes dont l’administration eût conduit à l'autre version du monde. Il fallait trouver des coupables, en appeler à des héros neufs, exiger la démission du coach et engager un mage, corriger les principes, multiplier les travaux, bref, faire en sorte qu'il eût pu en aller autrement. Ce revers de la fortune était inacceptable, en effet, et nous chagrinait tous, il aurait dû ne pas être. Moi j'allais la main dans celle de mon père qui tentait, comme nos voisins, de m'emmener sur les voies de l'aigreur, je ne l’écoutais pas et demeurai silencieux.
Car moi aussi je cherchais une raison à cette humiliante défaite, mais ne supportais pas d’en charger quiconque, car enfin, ma présence sur les gradins du stade n'avait pas suffi à faire basculer le résultat. Tandis que j'essayais de saisir les conditions qu'ils eût fallu remplir pour qu'un tel malheur n'advienne pas, je sentais au fond de moi la vraie cause de ce désastre : moi. Le coupable c'était moi, de n'avoir su lancer ce mouvement qui, de cause et cause, eût abouti à l'inversion de la tendance. Aurais-je dû hurler avec les loups, lancer des cris et applaudir? Cela n’aurait pas suffi, je le savais, il fallait bien plus, un don, le don de toute ma personne. Ma présence n’était-elle pas en définitive la raison dernière de cette mortifiante défaite. C'est un sacrifice qu'exigeaient les Seigneurs de la nuit, seule mon absence au stade eût pu changer l'issue de la rencontre, c’eût été le prix à payer pour la victoire de mes dieux.
Je me trouvai dès lors dans une situation inconfortable. Ou je montais au stade et l'équipe de mon coeur risquait de perdre pour me signifier que je doutais d’elle. Ou je me sacrifiais en renonçant à mon plaisir et assurais sa victoire. C’est ce que je fis deux semaines après. Mais les Seigneurs de la nuit perdirent encore. Je compris pourtant immédiatement ce qui s’était passé et leur en fus profondément reconnaissant. Si mes héros avaient en effet laissé échapper la victoire, c’était tout à fait volontairement, pour me communiquer qu’ils avaient été touchés par l'énormité de mon geste, la dimension de mon sacrifice. Ma décision les avait plongés dans un abîme de reconnaissance : incapables de fêter une victoire dont mon sacrifice eût été la cause, les Seigneurs de la nuit avaient préféré laisser filer la victoire. Personne n’en sut jamais rien parmi les supporters. Je me couchai sitôt arrivé à la maison, le lendemain matin c’était jour de culte.
Je ne suis pas guéri. Je me surprends parfois à calculer les effets du sacrifice sur le réel, j’aurais pu si souvent infléchir le cours des choses.

Publié le 1 avril 2011 dans le cadre du projet de vases communicants chez Isabelle Pariente-Butterlin (Ædificavit).
Jean Prod’hom
Cette passion de connaître les choses

Pour Marine E
Cette passion de connaître les choses, par l’allure d’abord, les racines ensuite ne devrait pas l’avoir quittée. Mais ce dont elle cherche aujourd’hui à dégager la vérité n’a vraisemblablement plus la même origine. Lorsque je l’ai connue elle avait soif depuis longtemps déjà et visait la perfection dans tout ce qu’on lui proposait d’entreprendre. Elle répondait avec un soin extrême aux tâches qu’on lui enjoignait d’accomplir et aux objectifs qu’on lui demandait d’atteindre. Elle le faisait non seulement avec une volonté qui ne faiblissait pas, mais avec une méthode et une intelligence telles qu’elle conduisit imperceptiblement les responsables de l’institution à se bonifier, clarifier leurs propos, préciser leurs buts, affiner le sens des devoirs qu’ils soumettaient à ceux dont ils avaient la charge. La donzelle, en voulant bien faire et en honorant l’institution en tout obligea celle-ci à devenir meilleure, toujours meilleure, c’est-à-dire à devenir enfin ce qu’elle prétendait être.
Mais lorsqu’elle s’aperçut que l’institution n’y parviendrait pas et ne serait pas en mesure de la satisfaire comme elle le souhaitait sa vie durant, elle prit le parti de choisir elle-même les domaines où elle pourrait étancher sa soif. J’ignore le moment où elle prit cette décision et si même elle la prit, j’en doute, les choses ne se passent pas ainsi, mais je sais que cette prise de conscience fut accompagnée d’un sourire dont elle ne se départit jamais plus, comme si elle avait compris qu’elle avait été bien folle de croire en l’institution avec une telle ferveur, de placer une telle confiance en ceux qui l’avaient accompagnée jusque-là. Elle ne leur en a jamais voulu, mais elle s’aperçut par là-même que si l’institution n’était pas sans faiblesse, elle non plus n’en manquait pas. Elle prit conscience simultanément de ses limites, elle ne pourrait pas en tous les domaines viser la perfection. Mais elle ne manqua jamais à l’idée que ce qu’elle entreprendrait, elle le réussirait.
L’inquiétude qui l’habitait de ne pas être à même d’honorer les commandes s’est dissipée à mesure que croissait la conscience qu’elle pouvait être à elle-même sa propre commanditaire et se pencher librement sur les domaines circonscrits par ses envies. On ne s’approprie pas le monde dans le langage de ceux qui nous le donne, mais dans celui qui finit par être le nôtre, un peu bègue et hésitant. Mais la volonté obstinée de comprendre ceux qui nous précèdent, dans leur langage, la confiance qu’on leur voue lorsqu’on est enfant, la difficulté ultérieure de s’en défaire ne sont pas inutiles. Plus l’univers de celui qui l’assujettissait était riche, plus il enrichira son propre univers en le débarrassant de l’autre (Elias Canetti).
Je l’imagine toujours aussi passionnée, sans rien avoir perdu des exigences qui la portaient autrefois. Je l’imagine affairée, n’hésitant pas à poser des questions à ceux qui l’entourent, pour embellir leur vie, la simplifier ou les aider, sans être rongée par le sentiment de ne pas y parvenir, mais en souriant d’aise de pouvoir s’en approcher et y prêter son concours. Je l’imagine aujourd’hui à la tête d’une entreprise ou à la maison, dans les bureaux d’une ONG ou sur les bancs d’un groupe parlementaire, honnête et l’oeil brillant de cette ironie apparue dans ces années-là. Elle sait que ce qu’on a réalisé et réussi dans la peine n’est presque rien. Je l’imagine où qu’elle soit parmi les autres, phare discret, exemplaire de ce qu’il est possible : passer outre les injonctions et l’attente désespérée, conjuguer le sérieux de l’existence, son cortège de soucis avec la légèreté, l’ironie et l’apparition souriante de l’aube.
P.S.
Avertissement
Jean Prod’hom
Dimanche 17 avril 2011

La haute pression mélangée à l'inertie des dimanches soulève le ciel. Le soleil chasse les locataires des maisons encore froides et nous voilà, fenêtres ouvertes, la bride sur le cou. Balade du côté de l'étang dont j'aurai vu le cycle tout au long de l'année. Son étendue – son identité – perceptible pendant l'hiver ne l'est plus. Les aulnes et les bouleaux ont colonisé la tourbe et la bruyère ne s'y retrouve pas. Il y a quelques années, quel que soit le temps, on pouvait en faire le tour, je crains qu'il ne disparaisse et redevienne un refuge pour les lièvres et les chevreuils repoussant plus loin les canards et les grenouilles. Mais où?

Hans Steiner
Lorsque je rentre, Louise joue de la guitare, Lili se raconte des histoires, Arthur lit. Sandra dort, victime d’un virus qui a profité de sa fatigue. On la laisse tranquille et on descend au Musée de l'Elysée qui présente un ensemble de photographies réalisées par Hans Steiner.
Des photos de l'ancien temps? demande Lili. C'est exactement cela Lili, des photos de l'ancien temps. Hans Steiner est en effet né tandis que le XXème siècle venait de commencer et il est décédé alors que je n'avais que sept ans. C'est en cela que ces photographies fascinent, elles font voir ce que je n'ai pas pu voir, ou à peine, parce qu’elles nous font voir les choses comme on n'avait pas l'habitude de les voir, entre reportage et mise en scène, publicité et engagement, des images qui sont encore d'aujourd'hui mais réalisées avec les moyens d’hier, ou l’inverse, sur la crête, à bonne distance de ce qui est sous nos yeux et de ce qui a basculé dans les fosses inodores de l’histoire.
Je sens encore une fois combien le passé, qu'il soit proche ou lointain, demeure vivant à deux pas de nos existences et ne constitue en définitive qu'un des modes un peu passés du présent. Me demande au passage si Hans Steiner n'a pas été l'auteur d'une photographie que j'ai retrouvée dans un carton et qui m'a ramené bien loin en arrière, un peu avant que je cesse d’être un enfant.


Hans Steiner
Arthur, Louise et Lili se sont comportés comme des grands et, pour fêter ça, on mange la première glace de l'année. Ils s'y sont retrouvés même, je crois, parce que ces photographies de Hans Steiner constituent un bon relais, susceptible de les conduire sans heurts d'ici à là-bas, à cet ancien temps que l'on distingue sans peine et qui fait sourire, parce que ce sont d’abord des images capables de faire voir ce qu'elles ne contiennent pas en propre, ou mieux, ce qu'elles ne contiennent pas du tout mais indiquent seulement, comme ces maisons éclairées, aperçues depuis le train, qui nous rappellent au crépuscule la possibilité d’un autre pays où nous aurions pu vivre.




Jean Prod’hom
Il y a le triomphe de la lumière

Il y a le triomphe de la lumière
la face immergée des icebergs
le monde des abeilles
il y a la mort annoncée du dollar
la camomille
les concours d'été
Vienne en 1900
il y a les clés qu'on croyait perdues et qu'on retrouve
la fragilité des barrages
Jean Prod’hom
Enfant on le disait bagarreur

Pour Raphaël
Enfant on le disait bagarreur, mais personne n’y prêtait foi parce qu’il était les égards mêmes. Le temps a passé, seul lui s’en souvient et peut-être en rit. Pourtant, à la réflexion, alors qu’on a perdu de vue cette idée ou parce qu’il n’y a pas lieu qu’on s’en préoccupe, le souvenir des kilojoules qui animaient sa forte tête, lorsque on y songe aujourd’hui, se déployant dans toutes les directions pour embrasser ce qui se présentait à lui et qu’il n’eût pas été possible d’embrasser sans eux pourrait nous amener à rectifier l’idée préconçue. Car sans les circonstances dont il sut tirer profit, le bambin n’aurait-il pas renoué avec les manières belliqueuses de ses premières années, prêtées peut-être à tort, qui font du plus bel esprit un bagarreur? Pour chacun d’entre nous, la distance est faible entre deux destins.
Tout était bon pour son appétit d’ogre. Depuis qu’il avait accepté que les circonstances attisent son intelligence, il en redemandait. D’un esprit vif, il dormait bien, en éveil continuel et doté d’un physique dur à l’épreuve, n’hésitant pas dès l’aube à pénétrer les secrets de nos habitudes et déjouer les pièges semés sous les pas des nouveaux-venus pour les assagir. Mais il ne perdait pas de vue les refuges que sa prudence lui avaient conseillé de ménager pour garder intacte la fraîcheur de ceux qui s’éveillent. Le mélange a réussi, je m’en souviens, intéressé au monde dans ce qu’il a de normatif, acceptant même pour mieux les dépasser les règles qu’on rencontre dans les officines de dressage, les saisissant même jusqu’à l’extrémité de leur fonction. Il a su, quand il le fallait, se mettre à leurs services lorsqu’il s’avérait que leur partage était, morale provisoire, essentiel au bon fonctionnement du jeu démocratique au bénéfice duquel il n’a pourtant jamais mis sa liberté en dot.
J’imagine aujourd’hui qu’il a réussi le plus difficile, ce qui chez la plupart d’entre nous demeure inatteignable, écartelés que nous sommes par le désir de la réussite sociale et l’ivresse de la liberté, j’imagine que lui appartiennent non seulement les grandes avenues des capitales mais aussi les chemins buissonniers qu’aperçoivent dès la première heure ceux qui ont bon pied, dans le préau et dans les livres, derrière les talus qui bordent les autoroutes et parmi les camomilles qui soulèvent les pavés, curieux de ce qu’on voit du seuil, à mesure qu’on prend goût au plein air et au vent du large, au-delà de la raison qui tient ensemble les convenances. N’est-on pas toujours déjà bien loin des murs qu’il nous a fallu habiter, de l’autre côté de l’Atlantique ou en Patagonie? Intrigués par des conjugaisons inouïes, par les bizarreries de nos habitudes, les hésitations de l’histoire qui nous font voir les nôtres?
Il est aujourd’hui vraisemblablement de ceux qui ont su garder les pieds sur terre et la tête au ciel, je ne l’ai pas revu depuis des années. Je l’imagine assidu, aux prises avec une lecture ardue dans une bibliothèque de quartier ou au côté d’un criminel dans le prétoire d’une grande ville, dans une banque dont il tiendrait avec soin les cordons de la bourse, l’oeil ouvert sur la liberté et l’horizon de notre espèce, sans lequel la première se vide de son contenu et la seconde va au mur. Je l’imagine en fin d’après-midi, le visage assombri par le sérieux, en taxi par exemple, consultant un dossier dont j’ignore la teneur, et même le domaine, s’assurant qu’il en va comme il l’a voulu. Je l’imagine le soir, souriant avec le soleil qui se couche, baskets et baladeur, il court sur les quais de l’Arno ou du Tibre, pour tenir en équilibre ce qu’il a choisi, car tout est plus facile lorsque le corps entraîné se tient droit. C’est ainsi qu’il gère ses troupes en gardant les marges sans lesquelles les autres n’ont aucune chance d’être avec vous, et vous avec eux. Il vit, somme tout, une vie analogue à celle de n’importe qui.
P.S.
Avertissement
Jean Prod’hom
Avertissement
C’est à cet exercice proche de la fiction que je me suis livré, non pas pour esquisser les lignes d’un destin dont je ne sais ma foi trop rien, mais pour rendre à chacun une existence propre, imaginaire, construite à partir de presque rien, dont on ne retiendra pas l’adéquation avec ce qui a été, est ou sera, mais l’intention, celle de redonner une consistance au corps et à l’âme que l’institution a pris en otage pour exercer au mieux sa tâche, avec le risque de les user jusqu’à la corde. Il était temps de me mettre sur la pointe des pieds et d’imaginer des personnes et des événements qui sont devenus avec le temps la possibilité même de l’avenir.
Pour Raphaël :Enfant on le disait bagarreur
Pour Marine E : Cette passion de connaître les choses
Pour Lucy : Elle était du premier et du troisième cercle
Pour Anne-Sophie : C’était au début, elle riait avec ses yeux en amande
Pour Gabriella : Elle avait envie de disposer un peu plus d’elle-même
Pour Julia : L’inconnue du jour de la rentrée
Pour Rick : Dans un monde que ni eux ni nous n’imaginions
Pour Jill : Le couloir était éclairé par des sourires
Pour Nathan : L’enfant qui a la tête en l’air
Pour Lucas : La gymnastique intellectuelle entame leur sérénité
Pour Lea : Virevoltant au-dessus des ornières
Pour Anouck : Initiation à l'art du porte-à-faux
Pour Marine H : Quitter son giron
Pour Floriane : Le fil ténu qui me fait tenir debout
Pour Gaël : On n'est jamais là lorsqu'il le faut
Jean Prod’hom
34

Une des solides vertus de l’écriture fragmentaire quand elle se fait résolument brève, plus brève encore qu'elle ne le devrait, lorsqu'elle a soulevé le couvercle du ciel et qu'à la fin elle se tait, c’est de ne pas tenir en laisse son lecteur. A la condition toutefois de n’emprisonner en son sein ni énigme ni secret – ou pire qu'elle le feigne – et qu'elle n'use d’aucune de ces boucles qui font revenir le lecteur bienveillant au commencement par un da capo de convenance. C’est la force discrète de le chasser loin d'elle, comme quand le maître, assuré enfin que seule son absence libère l’élève, peint le vol d’une hirondelle dont la disparition accapare un instant celui qui dans son dos attend, avant de l’abandonner à un silence qui le condamne à prendre l’air et à pousser sa vie plus avant. Loin de moi pourtant la condamnation de l’autre scène, celle du mirage qui tient captif le lecteur, l’autre écriture sans laquelle nous serions tous occupés à tenter d’attraper l'inconnu qui se cache derrière le miroir.
Jean Prod’hom
Dimanche 10 avril 2011

Il viendra un temps où l’entière mémoire de cette époque maudite reposera entre les mains d’écrivains, de peintres, de cinéastes, de musiciens. A chacun de trouver sa forme, l’essentiel étant de résister aux forces de l’oubli.
Michèle Kahn, Le Shnorrer de la rue des Rosiers
![]()
Me souviens aujourd'hui des quelques trottes qui m'ont fait voir du pays, celle qui m’a conduit d’ici à Sils-Maria par le glacier d'Aletsch, cette autre du lac d'Aiguebelette à Saint-Hippolyte-du-Fort, Cucuron par le Gran Paradiso, de Sainte-Croix à Porrentruy, Constance par Planfayon et Hérisau, les Vosges par Lure, Florac par le Puy, Mende et les Causses... et toutes les autres, j'en oublie. Et cette dernière il y a quelques jours qui me fit passer de twitter, où j’ai fait la connaissance de Michèle Kahn, à la rue des Rosiers où, peut-être, Stasiek lui confia ce que transmit à Stanislaw le Shnorrer Stanislaw Marynarz de la rue du Roi-doré, l’histoire de sa déportation de Lodz à Dachau, de Radom à la rue Taitbout par Constance, pas loin de Feldkirch où Stefan Zweig croise en 1919 l'empereur déchu – et Zita son épouse en vêtements noirs – quittant l’empire autrichien, alors que l’écrivain retourne à Vienne qu’il a quittée pendant la guerre, monde d’hier dont il se souvient, sa rencontre avec Theodor Herzl dans les bureaux de la Neue Freie Presse, à deux pas des constructions du Ring, néo-classiques, néo-baroques ou néo-gothiques élevées par les architectes à la solde de François-Joseph, de celles fleuries d'Otto Wagner et des architectes de la Sécession, de la bâtisse sans sourcils d'Adolf Loos auquel on doit tant, où nous sommes nés pour la plupart d’entre nous, du café où Arthur Schnitzler installa un peu avant 1909 le baron Georges et Henri, évoquant au crépuscule et sans y croire l'oeuvre qu'ils n'écriront pas.
C’est la folie du voyage, entre romans et réalité, à pied et sans heurts, avec les nuits pour étapes. Il n'y a pas d'autres manières de voyager et s'asseoir sur l’un des bancs du Prater ou l’unique du chemin des Tailles. La littérature tient ensemble le temps des hommes comme seule la marche rassemble les paysages, toutes deux tendues par les transmissions lentes. On passe d’ici à son voisin, de celui-ci au café du coin et ainsi de suite, de fil en aiguille, de proche en proche jusqu’à Rome ou, plus vieux, jusqu’à la Mussilly.
Jean Prod’hom
Persistance d'une forme

Retour depuis quelques jours à Louis-René des Forêts, celui de Face à l'immémorable, retour fidèle, avec l’assurance que ses mots, une fois encore, dans leur teneur brutale et la figure – le motif, le trait – qu’ils savent lui opposer, se présenteront à nouveau comme ceux de celui qui n'en finit pas de nous précéder sur la voie sans issue de nos vies, qu’il a su tout à la fois vivre et dire par un tour de grâce qui redonne goût à l’intelligence et à la lucidité, en opposant à leur poison mortel quelque chose comme une mélodie, une épure de consolation.
En soufflant sans lyrisme sur le dérisoire qui baigne nos vies, en honorant de son attention les impasses triviales de nos plans, sans s’appesantir nulle part, Louis-René des Forêts parvient à nous relever de l’abattement auquel nos esprits sont naturellement conduits, par une courbure de la phrase ou un balancement miraculeux qui redirige nos pas vers d’autres destinations – fragments à l’armature de plomb, patiemment faufilés – jusqu’à la planche d’un envol qui nous mène au ciel, d’un coup, en une seule respiration, une respiration qui à la fois soutient l’entreprise et en est le terme tant désiré, à l'extrême pointe des tourments, non pas en restituant dans leur vérité les pierres lisses cousues main de nos expériences revisitées, mais en enlaçant dans son collet la vérité d'un mystère qui lui échappe.
Les fragments de Face à l'immémorable sont les égaux de ces nuits qui remettent debout, disent l’impossible sans qu’on en meure. J’entends le bruit de la pierre lancée qui ricoche dans la mémoire bien après qu’elle repose dans la vase de l’étang, c’est le silence de Face à l'immémorable, mince ouvrage aux larges mailles d’où s’échappent goutte à goutte de petites rédemptions, brefs éclairs qui ramènent à l’essentiel, un peu de paix et le sourire du silence lorsqu’il se fait bienveillant, avant d’autres épreuves.
Jean Prod’hom
Les tourments d'Eric Chevillard

Levé à l’aube, j’ai démarré ce matin l’entreprise si souvent différée qui devait compléter l’enquête que je mène depuis un certain temps déjà sur un large pan de l’oeuvre d’Eric Chevillard et, plus spécifiquement, me permettre de saisir la raison pour laquelle il s’était arrêté là de son décompte, 807, un mardi de janvier, dans ce qui devait être à l’évidence un jardin sous cloche; pourquoi l’homme a reconduit une telle entreprise un jeudi de septembre – de la même année – au prétexte qu’il souhaitait connaître le monde – dans une pelouse cette fois-ci; pourquoi il a demandé un jour de novembre – alors que les prés sont maigres – sa réadmission dans le pavillon des aliénés qu’il n’aurait jamais dû, dit-il, quitter; pourquoi enfin cette oeuvre qui l’effraie tant, son oeuvre l’a conduit tout naturellement à soupçonner qu’elle était celle d’un autre.
Je vous passe le détail. L’homme est aux abois, incertain de l’avenir. Pourra-t-il achever cette oeuvre qu’il dépose brin à brin dans les rayons des bibliothèques du monde avant que celles-ci, si tôt déjà et il le sait, ne soient désherbées par les mains inexpertes de quelques fonctionnaires qui, tout comme lui, n’auront su de leur vie distinguer le merle au chant humide du corbeau aux sinistres présages?
Il ne reste à cet homme rien d’autre que la dérision en porte-à-faux, celle de l’homme tard venu qui découvre à la fin la confusion dans laquelle il fut, dernier cri de la littérature de pavillon, lorsque le génie se réveille et prend conscience avec effroi qu’il aurait pu ne pas être le premier serviteur des écrivains des pelouses, mais l’Alexandre de ceux des pâtures, celui qui dénoue, se dresse avec hardiesse au milieu du pré, deux poignées d’herbe portées au ciel, ultimes offrandes adressées à Dieu qui connaît le secret chiffré de ses tourments.

Jean Prod’hom
29 avril 2011
Celui qui nous précède

Ne pas faire long, raccourcir même, pour ne laisser à la fin qu'une phrase, un souvenir, celui de cette figure qui nous conduit parfois jusqu'à l'ombre silencieuse des impasses noires, l'avenir, que nous croyons dompter d'abord, dans les rêts duquel nous nous débattons ensuite avant de tenter, ultime recours, d'indignes négociations, en désespoir de cause on se retourne, poches vides et mains nues, à deux pas de l'épuisement, on sort la tête à l'air libre, ciel bleu, allégé, on suit respectueusement le chemin qui s'éloigne un instant dans le bois, on débouche dans la lumière au-dessus des Tailles, avec les montagnes nues et la terre qui respire à peine, sachant que tout cela ne nous a rien apporté, sinon un bref répit qui nous aura délivré un court instant des vains combats, aux bord des pleurs qui baignent la margelle du monde, mais aussi des livres et des incessants bavardages, juste un moment, dans le monde immobile, là devant et la fin de la journée toute à nous qui penche vers la nuit.
Jean Prod’hom
33

Lorsque l'esprit, pour le faire taire, réduit le réel au raisonnable, ne résistent à son emprise que quelques récits fumeux et leurs ombres, qui rejoignent à la fin celle que laisse sur les bas-côtés du chemin notre volonté carnassière quand elle croit infléchir le cours des choses.
Jean Prod’hom
32

Regarde la rivière qui creuse et modèle le paysage. Imite-la, mais rappelle-toi que tu ne disposes pas de son temps. Utilise le tranchant du couteau.
Jean Prod’hom
31

Pour Isabelle Pariente-Butterlin
Elle se tient debout dans une cour d’école pleine de soleil, immobile comme Socrate dont elle se souvient, tel une pierre levée, l’oreille tendue sur le rien qui l’entoure. Il tient dans sa main ce qui a eu, ce qui peut ou pourrait, mais aussi ce qui aurait pu avoir lieu. La journée passe. Elle bouge à peine, elle donne une petite chance supplémentaire à ce qui aura lieu, Socrate s’incline et se retire. C’est ainsi parfois qu’elle va de l’avant.
Jean Prod’hom
30

On a appris que ça ne se faisait pas, que le vert des saules jurait avec celui des mélèzes, c’est tout de même très joli, parce que les saules et les mélèzes ne sont tout au plus que des riverains sans intention sur les bords d’un chemin désert qui leur apporte un peu de lumière. Je le vois bien, ils ne prêtent aucune attention à ce qui les entoure, ne font que durer, chacun pour soi, mais j’ai remarqué qu’ils le font sans en rajouter, et c’est pour cela qu’ils n’éprouvent ni le besoin de se rapprocher ni celui de se quitter.
A l’arrière des grappes de samares tiennent solidement aux branches des frênes, à la traîne de l’an passé. C’est ici comme partout ailleurs, toujours la même chose, mais on sait que ça ne se répète pas, on sait que ça dure, ça dure si bien qu’on on ne se plaint pas, qu’on soit en avance d’un pas ou en retard d’un an.
Jean Prod’hom
Dimanche 3 avril 2011

Sous les draps les reins, l’ombre des grasses matinées, les fenêtres ouvertes avec les moineaux qui battent l'air. Du robinet de l'évier, en-bas, gouttent les mesures d'un temps long, à côté de deux pichets d'eau, vides. Dehors les vernis s'écaillent, l'esprit d'escalier sommeille avec les pioches dans les remises.
Pas un chat sur la route qui mène aux Chardouilles mais une litière au bout du pré. Je m'étends hors les mots dans la solide durée, sous l'empire d'un rien qui étend son empire jusqu'à la lisière des pensées, me dissimule derrière des vagues qui ondulent, se chevauchent, maintenues ensemble – ne veux pas savoir comment.
Un groupe d'enfants attend la venue de ceux qui les ont tant attendus, rivés les uns aux autres, à l'attente et aux promesses. Tout à l'heure les petits joueront l'air de l'apocalypse joyeuse, un canon, dix-sept langues.
Il est si simple lorsqu'on voit clair, trop clair, trop simple de lever les forces noires de ceux qui vivent dans la suie des rêves. La violence est dans la bascule. Reviendront alors les jours pleins jusqu'à la gueule de canons et de sang noir, les fers rouillés, volets fermés dès le saut du lit. On ne verra plus dans le ciel le ciel et la ouate des nuages, mais les traces d'un chat noir sur le capot de nos véhicules en ruines. Ma foi il n'était pas désagréable le temps d'avant, lorsqu'on ne feintait pas trop avec la mort.
Jean Prod’hom
Factuellement vôtre | Isabelle Pariente-Butterlin

J'aime bien les faits. Ils ponctuent le temps, la journée. Du lever au coucher, c'est une ponctuation, la journée est une phrase, il faut la dire sans se tromper, comme à l'époque où je croyais que j'allais faire du théâtre, brûler les planches… ! Non : les faits. Comme une pulsation sur le cours du temps. Ils permettent de vérifier les étapes franchies de l'avancée sur la ligne temporelle. Je me souviens encore de ce que disait mon vieux prof, "il ne faut jamais regarder ses pieds quand on descend un escalier, il vaut mieux qu'un roi shakespearien tombe dans l'escalier s'il ne peut pas faire autrement, mais ne regardez pas vos pieds", ça n'a jamais pu marcher avec moi.
- Monsieur Z…, votre rendez-vous de 9 h est arrivé.
- Un instant, s'il vous plaît.
C'est rassurant. Je m'appelle bien Z…, ça c'est vérifié pour la journée. C'est stable, régulier. Je peux mettre une croix. J'ai fait l'appel de moi-même. Il y a des certitudes sur lesquelles on peut tabler pour la journée sans trop d'imprudence. Moi, ma qualité première n'est pas l'audace, cette histoire d'escalier a été le déclic, je n'ai jamais réussi. Je fais les choses, au fur et à mesure, comme elles se présentent, comme ça on arrive au bout de la journée, il est encore possible d'acheter le journal au guichet de la gare et de rentrer pour les informations. Il est neuf heures. Neuf heures du matin. Si je prends, entre neuf heures et, mettons, neuf heures douze, un intervalle de douze minutes pendant lequel il suffit que je fasse autre chose, alors Monsieur W… en conclura que moi, Monsieur Z…, suis suffisamment 1) important pour le laisser attendre, 2) occupé pour avoir déjà, à neuf heures du matin, douze minutes de retard sur le planning de ma journée, ce qui, au regard d'une journée de, mettons encore huit heures, si j'enlève le temps du déjeuner, me permettra d'avoir huit fois douze minutes, soit… quatre-vingt-seize… ça fait une heure trente-six tout de même… de retard. Et pour ce faire, c'est du grand art, je ne suis pas obligé de perdre mon temps. Je ne perds pas mon temps, pour faire perdre le sien à Monsieur W…, ce serait mesquin, je vais juste un instant faire autre chose. Je suis bien inséré, bien installé dans une trame sociale, temporelle qui fait que Monsieur W… va attendre sans rien dire, et que moi, pendant ce temps, je ferai autre chose.
Bon, enfin, tout ça, ça permet de vérifier, à intervalle régulier, qu'on est en vie.
Et de toutes façons, j'ai toujours autre chose à faire, c'est vrai. Je suis occupé, personne ne pourra dire le contraire. Je n'ai qu'à ouvrir mon agenda. J'aime bien ce mot. Neutre pluriel. Litt. : les choses qui sont devant être faites. J'ai fait du latin, autrefois. Pas beaucoup, mais ça, je m'en souviens. J'ai réussi à parvenir à ce point de mon existence où mon agenda est rempli pour plusieurs semaines à l'avance. Nous sommes en mars, fin mars-début avril précisément, et déjà il se remplit pour … septembre. Dominique le remarquait hier. Même en novembre, j'ai déjà des rendez-vous qui sont marqués, pris. Mon temps de novembre est déjà pris.
Tiens, ça me rappelle de vieux souvenirs, tout ça. Je me souviens du registre que tenait mon père, il se remplissait des réservations au fur et à mesure de la saison, je le regardais, se noircir, se remplir, il me semblait que l'avenir prenait corps dans les registres, les agenda, les plannings, les réservations, plus tard il m'a même laissé écrire les noms des clients, mais c'était déjà à l'époque où ça ne m'amusait déjà plus. Les gens savaient qu'ils dormiraient ici le tant, c’était ferme, réservé, on versait des arrhes à la réservation, sinon mon père effaçait le nom, inexorablement. Il les effaçait du grand registre du temps. Et c'était comme s’ils n'avaient jamais appelé, jamais réservé, et même, comme s'ils n'avaient jamais existé. À la limite, on aurait pu dire ça. Mon père tenait le grand registre du temps, et au fur et à mesure des semaines, la grande double page se noircissait, se remplissait, des noms étaient effacés, déplacés d'une chambre à une autre, certains disparaissaient, d'autres revenaient à intervalles réguliers.
Maintenant c'est mon tour. Je sais, tiens prenons un exemple au hasard, que si je voulais aller, disons, voir la mer le 28 mai, eh bien je ne pourrais pas ! C'est une certitude, et les certitudes sont des victoires sur le temps, non ? Moi, Monsieur Z…, je suis tellement occupé, que si je voulais aller voir la mer le 28 mai, entre mon déplacement à Amsterdam et celui à Besançon, eh bien je ne pourrais pas parce que, entre les deux, des déplacements professionnels, tous les deux, hein ?, je dois régler le dossier W… oui, celui-là même…. Et vu l'affaire, une journée ne sera pas de trop.
- Faites-le entrer, Dominique.
- Bien, Monsieur. Un instant, s'il vous plaît. Je vais le chercher, il est sorti dehors fumer une cigarette.
C'est lui, maintenant, qui me fait perdre mon temps ? Il ne manque pas de culot. Ce n'est pas si compliqué d'ajuster son temps, ses gestes, ses mouvements. C'est la condition sine qua non pour que quelque chose fonctionne dans le monde. Le monde social est une petite mécanique de précision, non ? Il s'imagine quoi, celui-là ? Qu'il est un roi shakespearien ?
Isabelle Pariente-Butterlin
écrit par Isabelle Pariente-Butterlin qui m’accueille chez elle sur son site Ædificavit dans le cadre du projet de vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.
Et d’autres vases communicants ce mois: ![]() Brigitte Célérier et Benoît Vincent
Brigitte Célérier et Benoît Vincent![]() Sandra Hinège et Pierre Ménard
Sandra Hinège et Pierre Ménard ![]() Guillaume Vissac et Laurent Margantin
Guillaume Vissac et Laurent Margantin ![]() Joachim Séné et Marc Pautrel
Joachim Séné et Marc Pautrel ![]() Dominique Hasselmann et François Bon
Dominique Hasselmann et François Bon ![]() Michel Brosseau et Stéphane Bataillon
Michel Brosseau et Stéphane Bataillon ![]() Franck Queyraud et Samuel Dixneuf-Mocozet
Franck Queyraud et Samuel Dixneuf-Mocozet ![]() Anne Savelli et Piero Cohen-Hadria
Anne Savelli et Piero Cohen-Hadria ![]() Christine Jeanney et Maryse Hache
Christine Jeanney et Maryse Hache ![]() Anita Navarrete-Berbel et Christophe Sanchez
Anita Navarrete-Berbel et Christophe Sanchez![]() Claire Dutrait et Jacques Bon
Claire Dutrait et Jacques Bon ![]() Cécile Portier et Bertrand Redonnet
Cécile Portier et Bertrand Redonnet ![]() Christopher Selac et Franck Thomas
Christopher Selac et Franck Thomas ![]() Morgan Riet et Vincent Motard-Avargues
Morgan Riet et Vincent Motard-Avargues ![]() Isabelle Pariente-Butterlin et Jean Prod'hom
Isabelle Pariente-Butterlin et Jean Prod'hom
Jean Prod’hom
Consolations

Quand le ciel s’assombrit, l’homme pense avec tristesse aux vies qu’il eût pu mener s’il en fût allé autrement. Il devrait au contraire se consoler en se rappelant que ce qui a existé un jour ressemble étrangement à ce qui n’est resté que possible, c’est-à-dire à ce qui n’existe pas.
Lorsqu’au terme de son existence l’homme fait le bilan, il pense à regret qu’il a trop souvent voulu couper au plus court.
Avant d’identifier et de prévenir autant que faire se peut le talon d’Achille qui menace sa vie, l’homme est amené à faire d’innombrables expériences, neutraliser les prédictions, conjurer le hasard, user des lumières de la raison, éviter les chausse-trapes du langage... En vain.
Il eût suffi pourtant d’un peu plus que l’exacte durée de sa vie pour que celle-ci lui livre les secrets de sa faiblesse congénitale. Or c’est à l’instant même qui précède la saisie de ces secrets que la vie le quitte traîtreusement, inévitablement, sans défense.
Publié le 4 mars 2011 dans le cadre du projet de vases communicants chez Estelle Ogier (Espace childfree).
Jean Prod’hom
Il y a le bon aloi

Il y a le bon aloi
l’arbitraire du signe
la mer lie-de-vin
il y a les modes d’emploi
le Front populaire
l’électro-ménager
il y a le col du Septimer
les associations de bénévoles
les dons d’organes
Jean Prod’hom
Dimanche 27 mars 2011



























Que pense
le papillon
de l’éphémère
et la pierre
du possible

Jean Prod’hom
LXXXVII

Comme chaque année, fin mars, Jean-Rémy assainit sa propriété. Il s’attaque d’abord aux chiens errants du quartier qui, de l’aube au crépuscule, conchient le pied de ses haies et de ses arbres fruitiers, pissent sur ses forsythias, ses hortensias, arrosent son paillasson et sa plate-bande. Caché dans sa traditionnelle tenue de combat qui le confond au gris de sa maison, Jean-Rémy guette et, chaque fois que l’un d’eux montre le bout de son nez, jaillit de la tranchée, l’injurie, lui lance pierres et bâtons. Le combat est inégal, chacun d’eux s’enfuit. Le soir, lorsque le soleil disparaît derrière l’horizon, harrassé, Jean-Rémy songe aux coriaces qu’il a su mater, il fait monter du fond de sa gorge un grondement sourd qui fait savoir alentour son bonheur d’avoir triomphé.
Puis, tandis que les chiens pleurent à la lisière du bois, Jean-Rémy s’approche du compost au pied duquel il pisse abondamment. Tout son corps frémit. Il pointe son nez vers une étoile et lance au ciel, interminablement, comme un loup, des modulations qui expriment la douleur, le silence, le froid, la solitude, les ténèbres. Des instincts assoupis depuis longtemps se réveillent. D’une façon vague, il se ressouvient des temps premiers de son espèce, des temps où les hommes sauvages parcouraient la forêt primitive en bandes et forçaient les proies qu’ils tuaient pour se nourrir. La vie de ses ancêtres se ranime en lui, et les vieilles ruses de sa race redeviennent les siennes. Elles lui reviennent sans effort, sans qu’il eût à les redécouvrir, comme s’il les connaisssait depuis toujours, c’est l’appel de la forêt. Il entonne le chant d’un monde nouveau, qui est le chant de la bande. Demain les chiens qui lui répondent reviendront, et un jour, plus tard, Jean-Rémy rejoindra la meute, les chiens de son espèce.
Jean Prod’hom
Vivre au septième degré

Elle est demeurée volontairement à la traîne, s’est contentée, un peu aveugle, de l’en-deça de toute chose, de tout événement, de toute entreprise, nouvelle venue ou vieille locataire. Elle s’y est tenue fermement en acceptant le retard qu’elle n’a jamais cru bon devoir combler, un retard bientôt chronique, tandis que ceux qui l’entouraient rêvaient, flambaient, prenaient possession du monde.
Elle n’a jamais fait la fine bouche devant la rumeur désarticulée que les aventuriers laissaient derrière eux, elle se contentait de ramasser l’ombre de leurs entreprises avec une brosse et une ramassoire. La vieille a réussi là où personne n’a jamais rien obtenu, puisqu’il n’y avait rien. Je l’ai vue plus d’une fois tirer l’invisible filet de la bienveillance, elle aimait par-dessus tout marcher, mêlait le bruit de ses pas au silence. La vieille vivait en marge des signes de domination et des décisions de bon ton, là où la musique loge le septième degré de ses gammes, dans les appartements de la sensible.
Jean Prod’hom
LXXXVI

Anatole a bien mauvaise mine lorsqu'il s'assied à notre table. Pas d’appétit, pas soif non plus. Me demande discrètement de le suivre un instant, il veut me parler. Je quitte la tablée, c'est un ami.
On monte en direction du cimetière. Un peu avant le portail, Anatole me rappelle ses parents – que je connaissais bien – décédés il y a plus de 10 ans.
– Mais, poursuit-il la voix hésitante, j’ai toujours eu un doute, je ne possède aucune preuve tangible que mon père est bien mon père, ma mère ma mère. Que dois-je faire? Entamer une procédure judiciaire pour lever leur pierre tombale et la chape armée de mes doutes?
Je souris d'abord, Anatole est blême. J’essaie de plaisanter en lui assurant que je n’ai aucune certitude, moi non plus, que mes parents morts aujourd’hui ne sont peut-être pas mes parents bilologiques? D’où me vient en effet cette artificielle confiance, on se ressemblait si peu. Car enfin, Oedipe n’a-t-il pas tué, il y a longtemps déjà, celui qu’il cherchait? Et Arthur, Louise, Lili,... ne les a-t-on pas échangés par mégarde à la maternité? Me voici d’un coup orphelin.
Jean Prod’hom
Il y a les vases communicants

Il y a les vases communicants
l’éblouissement premier lorsqu’il revient en second
il y a la moleskine
la vie après la mort
les agrafes parisiennes
la respectable distance qui nous sépare du soleil
il y a les prétentions qui s’effritent
les groupes de travail dans le domaine de l’éducation
il y a la double rotation de la terre
Jean Prod’hom
A.10

A considérer la fiche signalétique de l’homme, on ne peut s’empêcher d’être fiers. A chaque fois on a su demeurer du côté des vainqueurs. Pensez! on aurait pu végéter parmi les mousses, les champignons ou les algues, migrer avec les sardines ou les morues, barboter avec les canards et les oies.
Et bien non, on s’est retrouvé à chaque coup à l’avant du peloton, d’abord en concurrence avec d’autres primates, macaques et gibbons. On s’est débarrassé ensuite des australopithèques, il y a moins de dix millions d’années, avant de laisser sur place homo erectus et les hommes de Cro-Magnon. Nous voici sapientes au sommet de l’arbre de l’évolution.
Nos peurs n’ont pourtant pas disparu et ce n’est pas sans raison. Je crains en effet qu’on n’ait pas toujours été très classe à l’égard de nos concurrents et que, par une ruse dont le darwinisme a le secret, un cousin de l’homme de Neandertal, caché quelque part entre Düsseldorf et Duisburg, pointe un matin son nez et nous pose-là, pris dans les mailles du filet de l’évolution. A moins que ce ne soit un proche de l’orang-outan, du dindon ou de la lotte. Ou pire une mousse.
Jean Prod’hom
avec le concours d’Histoire générale | LEP
Dimanche 20 mars 2011

Matinée à l’hôpital ophtalmique pour une poussière que j’ai ramenée la veille de Forel-sur-Lucens à l’occasion des gros travaux de nettoyage du local du club de trial. Ce ne serait pas un hôpital si on m’y avait attendu, je m’y présente avant 9 heures, c’est après 10 heures seulement qu’un médecin – qui ne colle pas à l’image que je me fais des médecins – plonge son oeil dans le mien: pas de poussière, pas de bris de verre, bris de bois ou bris de fer, il repère pourtant un petit vaisseau qui a sauté. Il en profite pour visiter les coins et recoins de mon oeil gauche dont un collyre a dilaté la pupille et paralysé le muscle ciliaire. De mon oeil gauche je ne vois rien de particulier, sinon des éclairs multicolores; de mon oeil droit, j’aperçois l’oreille de l’inconnu, proche, trop proche, percée d’un anneau d’or.
Et puis tout s’enchaîne comme chez Lucrèce: tiens mais c’est une uvéite,... l’inflammation de l’uvée, cher Monsieur! c’est souvent le signe d’autre chose, de ceci ou de cela. Mais ne craignez rien, ce n’est peut-être qu’une poussée orpheline. Elle peut être aussi le signe d’une maladie générale, style maladie de Bechterew... Je ne bouge pas, laisse passer l’orage qui dépose, seconde après seconde, de drôles de dépôts sur les choses qui m’environnent. Puis retire la tête de l’intérieur d’un dispositif complexe en forme de cloche, constitué de divers appuis, vis et barres d’acier... qui me fait immanquablement penser aux dispositifs de la trépanation d’antan.
Une infirmière me retire ensuite 9 millilitres de sang pour qu’on en ait le coeur net. Le médecin signe une ordonnance pour des gouttes de cortisone que je devrai appliquer toutes les heures au cours des deux prochains jours; il me faudra, ajoute-t-il, trouver un conducteur pour me ramener à la maison; enfin, et c’est le bouquet, il place sous mon nez un papier m’autorisant à un arrêt de travail d’une semaine. C’en est trop, me vois grabataire et aveugle. Décide de négocier le tout: j’appliquerai les gouttes, mais j’irai travailler; quant à mon retour, j’y vois suffisamment clair; c’est entendu, on se retrouve dans 48 heures pour un bilan. L’entrevue aura été courte, je saurai mardi dans quelle mesure ma vie a changé.
Je sors de l’asile des aveugles – c’est ainsi qu’on appelait autrefois l’hôpital ophtalmique de Lausanne – un peu sonné et oublie même de faire quelques photos de ce beau bâtiment qui date d’un siècle et demi.

Intérieur d’un épicéa, avec la naissance des branches
C’est peut-être ainsi que vont les choses. Un jour, un pépin de santé vous tombe dessus qui bouleverse votre vie. On croyait que ça n’arriverait jamais, en tous les cas pas un dimanche, et disons beaucoup plus tard.
Si tout cela n’est que bricole, il faudra pourtant que je prenne garde de ne pas faire le crâne. Il aurait pu en aller autrement. Me restent deux jours à vivre dans une espèce de sursis au statut ontologique incertain. En attendant je rentre au Riau, vais faire un tour avec une drôle d’impression, entre appréhension et appréhension.
Jean Prod’hom
En lisant Claude Favre

Faut lire, s'y plonger, faut recommander, partager, propulser, diffuser. Hé! les gars, faut parler de, crier que. Quoi mais qui? mais qui mais quoi? Et pourquoi? Pas de réponse, silence radio. Pressions, petites pressions, ah quand tu nous tiens. Mais pourquoi pas. Et c'est pas long. Lire simplement, indispensable de lire simplement, n'est-ce pas? Et en toute indépendance. Lire donc Interdiction absolue de toucher les filles même tombées à terre.
C’est un texte bricolé par une effrontée, ardente et cruelle qui manie l’arme blanche. Geste précis, sourire aux lèvres, le sang coule à peine, un peu de crasse en fin à peine. Et pourtant, grave que je vous dis, grave, c’est toujours comme ça quand on ne s’y attend pas. Alors que tu souhaitais simplement aller au bar, les voici qui dévalent, en veux-tu en voilà, des filles de toutes les couleurs, à chaque coin de rue, par petits groupes. D’un coup t’es au ciel, un autre et te voilà au sol. Ça se fait pas, d'accord avec toi. Mais quel chambard! Et ça n’en finit pas, d’impasses en doux étranglements où la phrase qu’on croyait pouvoir suivre un moment peinard trébuche, silence. Sur le bitume qui brille des restes, des mots tombés du ciel, des bouts de chandelle, des bris de verre émoussés. Tu clignes des yeux, des deux yeux avant de reprendre ta lecture, à voix haute, c’est-à-dire que tu remontes, au pas si t’es pas pressé, pour te laisser glisser une seconde fois en-dessous de la cote d'alerte en espérant que tu tomberas enfin sur la bitte d'amarrage qui te permettra de mettre la main sur le mètre-étalon que tu te jures de ne pas lâcher si tu le tiens une fois. Mais tu descends comme sur un toboggan, pas lisse pas propre. Et tu devines alors que tu vas te retrouver, quoi qu’il en soit, niquedouillé d’avoir cru pouvoir garder l’équilibre dans ces grosses masses en déséquilibre et aux loopings locaux malicieux qui font tantôt un gros boucan tantôt un silence assourdissant. Quand même pas, elle osera pas, la bitte d'amarrage n’est en définitive qu’un foutu morceau de savon auquel fallait pas se fier, un savon qui racle les restes de ta résistance.
Eh si, pour un peu t’aimerais que ça s’arrête, pour un autre peu pas, c’est une autre version de toi, un gros séisme, profond qui fait pas dans le détail. Ses petites répliques sont pleines d’esprit, il y a du jeu. Il ne te faut pas espérer désormais que ça se referme, le texte s’évase, t'as l'impression que les phrases vont à l'envers, qu'elles se sont donné le mot pour aller à contre sens, vers le commencement. Tu t'éloignes de ce que tu croyais comprendre. Au bilan t'as pas bougé et t'as l'impression de tenir dans tes mains un tableau vivant.
Ce texte court est une bastringue de notre temps, tu te dis même qu’il est temps de changer de métier, rejoindre la congrégation des déménageurs ou des conducteurs de poids lourds, ou tiens, tenir un bar. Pourquoi je ne tiendrais pas un zinc? pourrais être devant, y a pas à dire, s’en passe des choses. Quand ça tournera en eau de boudin ou en coulis de framboise, je me retirerai à l’étage et regarderai les choses de loin. Je fermerai les yeux et écouterai ce qu'on ne voit pas au coeur de la mêlée, bruits de trottoir, voix des filles, un peu de sang, un mouchoir et une brosse à dents qui tombent d’un sac, avec des sanglots. Tiens, ça s’engueule sous les réverbères, tu vois l’histoire maintenant, ç’est devant mon bar, dans le terrain vague attenant, je lis mal, mais les choses vont de travers. Attention pas toucher. Silence. Une petite partie de belote plutôt? tarot ou poker? On remettra debout ce qu'on entendait de guingois, mais plus tard..
Qui parle? Dis-moi! plus personne n'est là, je n'entends que les échos noirs des colères ravalées, c'est pas pour la galerie, ni pour les piafs, c'est pour te montrer le lustre du désastre, la désaffection.
Sur la chaussée mouillée, il y a le temps qui s’effeuille comme un artichaut, les parfums de l'abandon, des personnages dans des décors bidons et une intrigue pourrie. Il y tombe des cordées de mots, c'est le crépuscule avec un marteau et une pelle tandis que la montagne croule de dépit. Comprenne qui pourra, on se tait, gros danger qu’on en prenne plein la gueule. On passe une fois, deux fois, A côté des traces toutes fraîches, les anciennes ont disparu et laissent carte blanche à d'autres entreprises. Et on s’en reverse une dose en cachette, ne dites rien, c'est sans fond comme la soif. Je me sens seul, il n'y a plus grand monde, pour un peu on va se croiser dans ce poème qui charrie de si belles épaves.
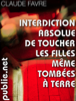
Interdiction absolue de toucher les filles même tombées à terre de Claude Favre (Ed.Publie.net)
Jean Prod’hom
Il y les livres dans les bibliothèques la nuit

Il y les livres dans les bibliothèques la nuit
le paracétamol
les grenouilles en route pour l’étang
il y a la charpente des fermes vaudoises
tes cheveux en bataille
il y a les actualités du soir diffusées par la radio lorsqu’on est loin de tout
le retour à la normale
le dégel
il y a la succession de nos petites conversations
Jean Prod’hom
Dimanche 13 mars 2011
Pour Joachim Séné
En mémoire
loin très loin
le passage des bombardiers
à mes pieds
sur le bitume
l’animal écrasé
sept cent soixante-huit grenouilles
encore invisibles
sortent de terre
trente-neuf ont pris les devants
sur la glace de l’étang
rampent
désarmées
un peu trop tôt
pas sûr qu’elles tiennent le coup
elles écrivent dans la précipitation
l’alphabet des malentendants
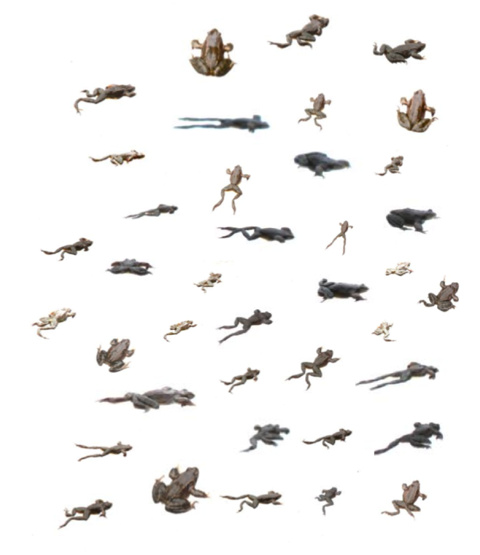

Jean Prod’hom
19 mai 2011
A.9

On renonce à parler de civilisation quand un groupe humain ne manifeste pas d’autres soucis que ceux de se nourrir, de transmettre la vie et de parer au plus pressé. Certains signes montrent alors que ce groupe cesse de réfléchir et se désorganise. Les flottements dans les rites mortuaires sont les signes avant-coureurs de son extinction.
Jean Prod’hom
avec le concours d’Histoire générale | LEP
En lisant O. Rolin

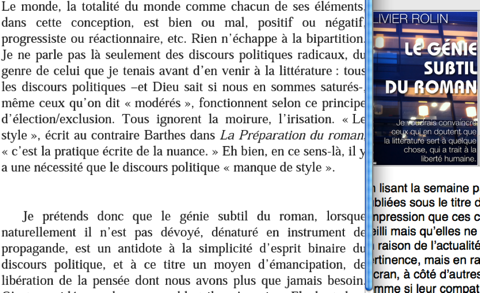
En lisant la semaine passée les conférences d’Olivier Rolin publiées sous le titre du Génie subtil du roman, j’ai eu soudain l’impression que ces conférences non seulement n’avaient pas vieilli mais qu’elles ne le pouvaient pas. Non pas tellement en raison de l’actualité de leur propos ou de leur indéniable pertinence, mais à cause de l’allure qu’elles avait trouvée sur l’écran de mon ordinateur, à côté d’autres fichiers ouverts sur mon bureau. C’est comme si leur compatibilité matérielle et formelle avec ce que j’essayais en vain d’écrire sur l’ambiguïté de tout propos libérait le texte de Rolin en en déverrouillant l’accès. Tout ce qui s’écrit est bel et bien bricolage. On le savait, en tout cas pour soi-même, il est désormais temps de l’envisager pour les textes qu’on lit.
Faudrait-il donc avoir fait un jour l’économie du livre pour que le texte se dématérialise et apparaisse enfin comme la matière vivante de la pensée? Quoi qu’il en soit et pour le coup, le sens était soudain raffraîchi, le propos allégé. Fragilisés les enchaînements, levées les barrières symboliques. Pour user d’une métaphore bientôt incompréhensible, l’encre des textes de Rolin n’avait pas fini de sécher.
Je reconduisais le mystérieux sentiment de toucher ce que je voyais se déployer sous mes yeux, en lisant ce qui s’écrivait pour la première fois, une fois encore, dans le lieu même où j’écrivais, c’est-à-dire dans l’espace même de mon énonciation. C’est sûr, Rolin avait écrit pour moi et ce texte me touchait plus que de coutume. A moi d’ouvrir d’autres perspectives dans la langue qui nous est commune. Il suffisait d’écrire la suite, je m’y emploie. Lire ou écrire, c’est chaque jour d’avantage le même.
Est-ce que nos pratiques de lecture et d’écriture, le rôle du commentaire qui a si souvent verrouillé le sens supposé, ne vont pas prendre un autre tour, bouleverser l’enjeu accordé à la lecture, à l’écriture, déplacer effectivement leurs frontières?
Le texte est lieu de passage qui mène celui qui s’y risque en ses bords. Mais désormais il n’y a plus à avoir de vertige. Le texte déborde en tous lieux sur d’autres textes, qu’il s’agit de lire ou d’écrire. Il y avait autrefois entre les livres de nos bibliothèques des gouffres sacrés que canonisait l’exercice du commentaire ou du compte rendu. L’horizon est à nouveau ouvert, comme quand est apparu le livre. On recommence, mais avec d’autres vertiges.
Il y a désormais entre les textes, en-dessous et au-dessus d’eux, d’autres textes qui s’emboîtent à l’infini, s’appellent et se répondent, prennent des initiatives ou patientent. Comme si la pensée en exercice avait trouvé un nouveau lieu, un nouvel attribut, comme les corps ont trouvé l’étendue. J’ai eu le sentiment que les textes plus que jamais trouvaient leur lieu naturel dans le texte et non plus dans les bibliothèques. S’il ne constituent pas l’être, le texte constitue l’un de ses attributs essentiels.
Le livre a laissé filer ce qu’il retenait jusque-là serré entre ses mâchoires, reste l’entretien infini, la pensée qui pousse les hommes à y voir un peu plus clair parce que ce qui est convenu n’a jamais suffi. Le texte m’accueille un instant, m’héberge le temps d’un voyage qui me mène en ses bords, là où j’écris, de guingois, pour cet autre lecteur qui passe. Ce qu’on lit c’est l’inassouvi qui fait vivre le texte que l’on écrit.
Mais revenons à l’essentiel, il faut lire les belles conférences d’Olivier Rolin.
Jean Prod’hom
Derborence

M’enthousiasme à cause de Derborence, évoque Si le soleil ne revenait pas et La Grande Peur dans la montagne. Ne le dis pas, mais c’est Derborence que je préfère. M’emporte un peu lorsque j’entends les élèves se réjouir du visionnement, la semaine prochaine, du film réalisé par Reusser. Leur promets les plus hautes déceptions auxquelles conduisent immanquablement tous les cinéastes qui ont voulu exploiter les trouvailles stylistiques d’un écrivain. M’emporte pour ça jusqu’à l’épuisement. Me demande même si je vais rester debout, mais tiens bon. Il fait beau lorsque les élèves s’en vont, fais un crochet par l’étang pour essayer de relever la tête. Vomis discrètement derrière un gros frêne.






Toute la partie orientale de l’étang est transfigurée, on entend ici puis là des coassements sourds et profonds. Les gelées des grenouilles se substituent lentement aux gelées de l’hiver, si fines désormais qu’on croirait des osties. J’aperçois deux grenouilles qui traversent le chemin leur donne un coup de main. J’ai hâte que la nuit vienne, rentre et l’attends. Faut-il encore que je puisse en disposer. Je diffère la rédaction d’une note sur Le Génie subtil du roman d’Olivier Rolin, renonce à mettre de l’ordre sur mon bureau, brûle d’en finir. C’est fait, je suis resté debout et vais me coucher.
Jean Prod’hom
Dimanche 5 mars 2011

On sort pour la première fois, même si c’est pour la seconde ou la troisième fois qu’on sort pour la première fois cette année. Mais on le dit aujpurd’hui plus fort au-dedans parce qu’on y croit plus fort au-dehors, oh les beaux jours. Et si l’on renvoie à plus tard le ramassage des branches mortes du tilleul, des foyards et des chênes, c’est parce qu’on se sait soudain un peu immortel. Le soleil veut ça, on dirait même qu’il y prend un certain plaisir. J’imagine des feux, les feuilles mortes de la veille et les tailles des roses, j’en sens l’âcreté, aperçois quelques cheminées, les fumées bleues qui se mélangent au ciel vide.
On s’y est préparé en s’allégeant, trop peut-être, il ne faudra pas lambiner. Les échelles laissées à l’automne dans les vergers servent à nouveau. Les vieux, cauteleux et imprudents, mêlent leurs bras à ceux des pommier et des cerisiers. On aperçoit qui dépasse leur main grise l’extrémité de la poignée rouge ou jaune d’un secateur. Fleur et Edelweiss guettent le retour des taupes et des mulots dans le pré dur d’à côté. C’est chacun pour soi et nous du nôtre. On ira à l’étang, Arthur devant. On a des manières si différentes d’essorer nos esprits.

L’enfant, confiant, laisse à ceux qui l’accompagnent le souci du lieu, où il est et où il va. Malheur à ceux qui l’abandonneraient dans l’effroi des bois, malheur aussi à ceux qui ne l’y conduiraient pas. Le Petit Poucet avait-il lu le récit qui conte ses exploits? Suffirait-il donc de donner des noms aux lieux de son égarement pour en écarter le souffle noir?

Il faudra attendre encore un peu avant de voir le merle revenir aux Censières, d’où il s’était enfui il y a dix-huit mois et où il reviendra comme une flèche qui ne se serait fiche nulle part, lorsque le sous-bois aura bourgeonné et se sera remplumé. L’eau qui s’écoule au goulot de la fontaine donne une idée assez exacte de l’immobilité qui passe.
On rentre, le jardin donne au sud, il est comme une grande cage sans barreaux que les oiseaux quittent parfois. On entend les premiers tracteurs qui sonnent la charge, les bruits se rapprochent, c’est une bande de moineaux qui piaillent dans la haie vive, ils ont levé un pan du printemps, c’était autrefois un temps à mettre le linge sécher dehors.
Jean Prod’hom
Il y a ta petite jupe

Il y a ta petite jupe
les calculateurs d’estime
le jour avec lequel on se lève
les noisetiers en mars
les draisines
le bruit du gravier autour des grandes propriétés
il y a les vestes en velours côtelé
les pics épeiches
il y a les parties de balançoire
Jean Prod’hom
Ce serait ainsi

Dans une aile du palais en ruines, au fond d’un local où se réunissaient autrefois les membres du pouvoir sacerdotal, une douzaine d’hommes masqués s’acharnent sur une femme qu’ils invectivent. Elle ravale ses larmes mais ne se souvient de rien. Elle a les yeux fixés sur un tableau au centre duquel se tient immobile un pendu masqué de noir, maintien stable. Douze hommes au visage glabre rient, ou grimacent, on les dirait en effet inquiets, inquiets que le pendu ne leur fasse soudain faux bond.
On frappe à la porte de chêne massif, deux enfants tendent un papier noirci de signes, l’un des douze hommes lit les ordres, ils se lèvent, soulèvent leurs masques, ce sont des inconnus qui ne dépendent d’aucune administration. Se saisissent chacun d’un balai et s’éloignent sans un regard pour celui dont les larmes se sont mises à couler. On croirait entendre un air de tango. La femme s’approche alors du tableau, retire la corde qui serre le cou de celui dont elle retire le masque. L’homme parle par geste. Ils quittent tous deux le local, longent le palais avant de se retrouver sur le front de mer, ils attendent debout tandis que le bruit de la mer écope le désespoir qui les entoure et dans lequel ils s’enlisent d’abord. On les voit pourtant se détacher des ruines qui les entourent, il n’y a bientôt plus qu’eux qui tanguent.
Jean Prod’hom
A.8

Homo sapiens ignorait selon toute vraisemblance que sapiens il l’était. Quant à ce qu’il savait, on l’ignore aujourd’hui. Pour rompre le cercle vicieux et faire court, on prétend dans les manuels scolaires qu’homo sapiens se distingue de ses prédécesseurs par un outillage plus perfectionné. Personne ne voit exactement le rapport. Ce bon mot sert parfois – rarement – au bar de la rue d’en face pour animer les conversations. Mais je n’y vais pas au bar d’en face.
Homo sapiens se présentait ainsi: plutôt petit, trapu et musclé, c’est tout lui, grosse tête, crâne aplati, front bas, sombre, obscur, obtus, c’est pas moi, arcades sourcilières proéminentes, face avançant en museau, peu de menton, rien de bien nouveau. Les paléontologues affirment que le volume de son cerveau dépassait celui des hommes actuels :1700 cm 3. C’est beaucoup, on ne ménageait pas le carburant, on chassait dans toutes les directions, rennes, mammouths, rhinocéros, laineux s’entend, bisons, petits chevaux. Il fallait aller vite. Comme aujourd’hui. Pourquoi? Personne ne le sait. Aujourd’hui les hommes ont leur bar, si bien que leur cerveau ne mesure plus que 1400 cm 3. Ils ont inventé le papier tue-mouche.
Homo sapiens, faut y croire. C’est dès 10 ans qu’on demande à nos enfants d’apprendre par coeur qu’on a quand même un outillage plus perfectionné que les bêtes. Ils doivent y croire dur comme fer. On leur enseigne en outre pour leur édification que le premier homo sapiens d’Europe date d’au moins 100 000 ans. On l’appelle homme du Neandertal, c’est une vallée près de Düsseldorf, on n’y a rien trouvé d’autre. Comment l’homme de Neandertal passait-il ses journées? Il est permis d’en rêver. Mais ça on préfère le cacher à nos enfants, il n’y a pas de temps à perdre, on n’a pas terminé le programme.
Jean Prod’hom
avec le concours d’Histoire générale | LEP
Estelle Ogier

Il n’avait fallu rien moins que deux chocolats chauds pour conclure la balade d’une douzaine de kilomètres – à travers la campagne enneigée et vide – d’un père et de son fils qui goûtèrent le bonheur de marcher ensemble au coeur glacé d’une nature complice.
Il n’avait fallu rien moins que six orteils au Polydactile - peint par Louis Rivier en 1943 – pour descendre de sa croix sous les yeux ébahis de sa mère. Le fils rejoignit les vivants qui ne l’attendaient pas car ils étaient en train de mener leur vie privée derrière leur porte privative qu’ils n’ouvrirent pas au va-nu-pieds.
Il n’avait fallu rien moins que 16 volumes du dictionnaire de la langue du XIXe et du XXe siècle (1789-1960) – « Trésor de la langue française », édité par le Centre National de la Recherche Scientifique – pour oser inventer mon propre monde en parcourant les définitions des mots comme on découvre un paysage à bicyclette.
Estelle Ogier
écrit par Estelle Ogier qui m’accueille chez elle sur son site Espace childfree dans le cadre du projet de vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.
Et d’autres vases communicants ce mois : ![]() Candice Nguyen et Christine Jeanney
Candice Nguyen et Christine Jeanney ![]() Sam Dixneuf et Stéphane Bataillon
Sam Dixneuf et Stéphane Bataillon ![]() Juliette Mezenc et Christophe Grossi
Juliette Mezenc et Christophe Grossi ![]() François Bon et Guillaume Vissac
François Bon et Guillaume Vissac ![]() Michel Brosseau et Jean-Marc Undriener
Michel Brosseau et Jean-Marc Undriener ![]() Anna Vittet et Joachim Séné
Anna Vittet et Joachim Séné ![]() Cécile Portier et Christophe Sanchez
Cécile Portier et Christophe Sanchez ![]() Clara Lamireau et Urbain trop urbain
Clara Lamireau et Urbain trop urbain ![]() Anita Navarette-Barbel et Arnaud Maïsetti
Anita Navarette-Barbel et Arnaud Maïsetti ![]() Morgan Riet et Murièle Modély
Morgan Riet et Murièle Modély ![]() Nolwen Euzen et Benoit Vincent
Nolwen Euzen et Benoit Vincent ![]() Maryse Hache et Michèle Dujardin
Maryse Hache et Michèle Dujardin ![]() Elise et Piero Cohen-Hadria
Elise et Piero Cohen-Hadria ![]() Anne Savelli et Franck Queyraud
Anne Savelli et Franck Queyraud ![]() Dominique Hasselmann et Dominique Autrou
Dominique Hasselmann et Dominique Autrou ![]() Marlène Tissot et Vincent Motard-Avargues
Marlène Tissot et Vincent Motard-Avargues ![]() Kouki Rossi et Brigitte Célérier
Kouki Rossi et Brigitte Célérier![]() Estelle Javid-Ogier et Jean Prod’hom
Estelle Javid-Ogier et Jean Prod’hom
Jean Prod’hom
Dimanche 27 février 2011

Tout ce qui vient jusqu’ici provient d’en haut, des hauts, de l’hospice, du col, de Bourg-Saint-Pierre et de Liddes et finit là sous les ponts d’Orsières, au pied d’une église de pierres, avec d’autres restes, ceux qui viennent des fonds de Ferret. Il faut savoir que la moitié des choses qui s’usent finissent de ce côté-ci, l’autre moitié dégringolent là-bas, de l’autre côté du col et, bien après qu’on ne les voit plus, troublent les eaux du Pô. C’est si difficile à penser, à imaginer, on résume cet autre parti des choses d’un geste qui indique qu’on a déjà bien assez à faire de ce côté-ci.

Les deux Dranses ne s’attardent guère le long du cimetière, elles ont donné rendez-vous à Sembrancher à la troisième, celle de Bagnes. Ensemble elles récupèrent toute l’eau du massif du Grand Combin qu’elles livrent au Rhône à Martigny. Là on n’en parle plus, elles ont fait leur travail. On rêve alors aux rives du fleuve, à Lyon, Avignon, Marseille et la mer. Mais Orsières reste à Orsières. Ça fait longtemps que plus rien ne bouge ici.
Sur la rive droite de la Dranse d’Entremont, Chandonne s’accroche à la pente, sans gros efforts depuis le temps. Elle a trouvé au-dessus du Torrent d’Aron un repli un peu plus large d’où on peut voir Vichères qu’on ne voit pas d’ici parce qu’à Vichères, on y est.

A Chandonne on cultivait des pommes de terre et du froment, sur des terrasses pas trop en pente, il fallait bien maintenir la terre en haut. A Vichères, on cultivait des fraises, c’était avant 1956, car les fraises finissaient en bouillie lorsqu’elles arrivaient en plaine, parce que pour les amener sur la place de Martigny on ne disposait que des chars, et les chemins étaient comme deux ornières profondes. Il n’y a plus de fraises à Vichères.
Eux ils sont tous là ce matin, le Velan, les Aiguilles de Valsorey, le Petit Combin, le Mont Brûlé bien en face avec un peu à gauche le Mont Rogneux, même si on ne les voit pas. Ils ont la tête dans les nuages. Pourtant ils sont là, c’est sûr, et on les verra demain, la radio l’a dit. Rien n’a changé depuis l’orogenèse en arrière des 12 carreaux de l’ancienne chèvrerie où je suis.

La vallée d’Entremont est large comme une baignoire. Il est donc aisé lorsqu’on vient du nord d’atteindre le col d’où s’ouvre la voie du sud. On comprend alors d’un coup la curiosité des premiers hommes qui se hasardèrent là. On devine même la voix des Lombards et des Sarrasins à Mont-Joux, mêlée au gravier des moraines, aux éboulements, au silence des Combins, au vent. Mais j’ai beau tendre l’oreille, je n’entends pas le pas cadencé des 46 000 soldats qui ont longé la rive droite de la vallée au printemps de l’année 1800. Napoléon Bonaparte leur avait-il demandé de se taire?
Jean Prod’hom
Il y a les chemins de traverse

Il y a les chemins de traverse
le col du Septimer
la valeur d’usage
le déclin des empires
il y a les madeleines
la célébration des jubilés
le réchauffement climatique
les petites morts provisoires
il y a le brassage des peuples
Jean Prod’hom
LXXXV

Lili rentre de l’école.
- Qu’as-tu donc fait ce matin? demande sa mère.
- De l’histoire biblique.
- De quoi avez-vous parlé?
- De Yakari.
- De Yakari?
- Oui.
- Et puis?
- De Jean le bassiste et d’Elisabeth.
Jean Prod’hom
29

Quand donc les grandes surfaces proposeront-elles enfin des dispositifs capables d’étendre nos peaux de chagrin?
Je patiente, dit la vieille en brassant un jeu de 52 cartes, j’ai toujours su m’occuper.
Tenir à bonne distance ce qui nous tient éveillé.
Jean Prod’hom
Au pied du brise-lames

Un matin dʼaoût 1988 entre Kérity et Saint-Pierre, un coup dʼoeil, un éclair peut-être, à deux pas du phare dʼEckmühl une lueur danse. Les jours passent, lʼintrus se déplace à lʼabri dans lʼanse, même lueur que la veille mais un peu plus loin ou un peu plus près cʼest selon. Hésite, tant de choses brillent, le ramasse enfin à marée basse, ne sais pas pourquoi, beau et bleu, avec des vagues et le ciel, lʼhorizon et la mer de sable. Il recèle peut-être quelque chose que les autres nʼont pas, personne ne le sait, tu lʼignores encore; le sentirais pourtant si tu le prenais dans la main, la douceur, le grain dense, la fraîcheur, le cintre. Tu lʼas mis dans ta poche.
Les jours suivants, dʼautres tessons lancent leurs feux tout autour, lieux sans attrait mais bénis des dieux: Lesconil, Saint-Guénolé, Loctudy. Tant quʼà faire tu les ramasses. Pas tous, les élus seulement, ceux qui ont su réduire leur fracture et lustrer leur chiffre.
Sʼensuit nʼimporte quoi, une carte du monde et du tendre, avec ses criques, ses digues, ses grèves, ses ports, ses môles, ses épaules, ses levées, ses jetées, ses rivages, ses plages. Des voyages avec dedans la tête un seul désir, celui dʼune pierre dans le creux de la main, terre cuite engobée, glacée, émaillée, portée au comble de la perfection, terre de couleur sur les rivages dʼun rêve bien vivant, petite éternité.
Sachez que le miracle se répète à deux pas du repaire des marins qui savent la gourmandise de la mer, là où les buveurs de lait jettent leur bol comme des amateurs de vodka. Cʼest ainsi quʼils remettent à lʼocéan sans crier gare les tessons au bord tranchant, les restes de la cuisine du monde.
Les fragments ballottés par la marée, déplacés par les courants, la houle, par les tempêtes se font oublier à lʼombre protectrice de la pierre qui les a brisés et deviennent purs joyaux, taillés, façonnés, polis, limés par lʼeau qui mêle au sable son grain. Ils vont et viennent au gré des circonstances secrètes qui les embellissent, repris par la mer, laissés sur la grève, se calent, se déplacent à peine. Certains trouvent alors une seconde vie, individuelle, particulière, resplendissante. Pas tous et pas pour longtemps.
Avant dʼêtre réduites au couchant, ces petites ruines racontent en accéléré la beauté, chacune à sa manière. Regardez-les chercher lʼunité, non pas celle du pot dont elles ont été arrachées, mais celle du peu serti de rien, à lʼimage de notre condition. Elles font voir dʼincomparables petits motifs qui se réduisent comme peau de chagrin.
Le sable à la lisière de lʼair et de la terre ronge avec la mer et le vent ces petites oeuvres inespérées qui flambent un instant, petite perfection discrète que caresse lʼeau. Tout va très vite, dix ans à peine avant que le motif ne disparaisse et nʼoffre plus au chasseur des mauvais jours quʼune pierre blanche, aussi blanche que la mie du pain quʼemporte le goéland.

Un seul tesson aurait suffi, le premier, celui de Penmarcʼh. Mais pour quʼenfin celui-ci fasse voir son visage dans sa fragile mandorle, il aura fallu que je coure les côtes bretonnes, les îles grecques, les rivières, la côte turque, le Léman, les ports de la Méditerranée, les Lofoten, la Loire, vingt ans au total pour une collecte forcenée, avec à la fin les poches bourrées de cailloux de Palerme et de Paimpol, de Venise et de lʼÎle de Sein.

La multiplication a mis le rêve en miettes. Ils ont fini dans un tiroir, en tas, le tiroir dʼune table de douanier, avec des pièces de monnaie bulgare et un Louis dʼor, disséminés ensuite en tous lieux de la maison, identifiés, localisés, datés. Placés dans des casses dʼimprimerie comme sʼils étaient les éléments dʼune langue qui allait révéler ses secrets. Lʼentassement sʼest poursuivi avec la certitude que la vérité de lʼensemble jaillirait un jour et quʼil serait temps alors de faire quelque chose de ces merveilles. Mais quoi. En garder quelques-uns parmi les centaines qui dorment dans leur niche. Les offrir à celle qui mʼaccueille, petite monnaie sans crédit, analogue à celle quʼutilisent les enfants sur les quais de Saint-Polde-Léon. Décidé à laisser ces pierres prometteuses à leur sort, je ne peux toutefois mʼempêcher aujourdʼhui de soulever du bout du pied les innombrables tessons blancs qui jonchent les rivages. Ils dissimulent parfois au verso – ils sont rusés, le saviez-vous? – un beau visage et son secret. Jʼen ramasse quelques-uns pour réveiller, un instant, cette folie dʼil y a plus de vingt ans et ajouter discrètement, lorsque la nuit vient, une croix sur ma carte du tendre. Tout cela ne débouche sur rien, je le sais aujourdʼhui, sinon sur lʼassurance dʼavoir été là où ils furent un jour, à Mazara, Epesses, Patras ou Patmos. Ils ne sont que de petites méditations sans mobile apparent dont je me souviens à peine et peine à me séparer, minuscules théâtres qui tiennent le temps dʼun éclair le monde au creux de leurs mains, la béatitude et le temps qui passe.
Penmarc’h 1988 - Corcelles-le-Jorat 2011

Publié le 4 février 2011 dans le cadre du projet de vases communicants chez Juliette Mézenc (mot-maquis).
Jean Prod’hom
Dimanche 20 février 2011

C’est le dernier jour de la neuvième édition d’Accrochage, exposition annuelle que le Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne consacre à la fine fleur de la scène artistique vaudoise contemporaine, présentation d’œuvres récentes d’artistes de différentes générations sélectionnées sur libre présentation par un jury de professionnels. Je m’y rends avec Arthur quelques heures avant que ne retombe le rideau et qu’on place dans la nuit de quelque cave (ou les dépôts de nos généreuses banques), ce qui brilla un instant aux cimaises.
Je ne m’y retrouve pas... mais avoue que, en ce domaine, je ne connais rien, ni les sauts de loup ni les chicanes qui contraignent les artistes à se dépasser bien au-delà de ce que le Béotien que je suis est capable d’imaginer. J’admets donc volontiers que chacun des travaux présentés ici n’est que la pointe d’un iceberg dont je ne vois pas le ventre immergé. Car l’avenir est certainement radieux et Arthur met tout plein de bonne volonté.
Il me faut toutefois tenir à bonne distance l’ex falso sequitur quodlibet que me souffle un mauvais génie, prendre garde à ne pas rejoindre les grognons aigres des zones critiques qui ne se lassent pas de jeter le discrédit et les moqueries les plus triviales sur les travaux de ceux qui cherchent – sans toujours trouver – des issues à la boîte de Pandore dans laquelle ils sont enfermés, bref, tenir à bonne distance la superbe pleine de fatuité des professionnels de la critique et le gros dégoût.

Restent quelques odeurs, le bruit de vieux tram d’un vieux carrousel à dias qui projette le passé sur l’écran de l’avenir et le souvenir d’une ligne continue, noire, fixée au sol à soixante centimètres des murs sur lesquels sont exposées les merveilles. Une ligne qu’il ne faut pas franchir, scotch noir tiré à la va-vite.
Interdit de photographier le travail des artistes, précise une employée du musée lorsqu’elle me voit prendre mon appareil. Mais la ligne? la ligne noire? Interdit aussi, droits d’auteur obligent. La ligne fait-elle partie des travaux présentés? La dame n’en est pas sûre mais ne fléchit pas, moi non plus. Est-ce une représentation de l’infranchissable, une esthétisation de la clôture religieuse, un jubé de notre temps? Je ne peux m’y faire, elle réfléchit encore, cherche avec sérieux une issue. Elle me propose enfin de rejoindre l’entrée du musée, de prendre contact avec le responsable de l’exposition qui est dans le vestibule. Il m’informera et lui communiquera par téléphone sa réponse. Je pourrai alors la rejoindre et, sous sa surveillance, photographier cette ligne interdite.
Elle a tourné le dos, je n’attendrai pas. Bandit! souffle Arthur. On s’enfuit.

Jean Prod’hom
Houle d’après la bataille

Ça sent la fumée, c’est agréable (la fumée de feuilles). Il y a de beaux noyers dans les champs. La terre a été remuée. Il y a des saules aussi, mais pas des saules pleureurs, des saules impulsifs qui partent en l’air. C’est une espèce. Un homme passe avec une bicyclette postale – jaune. Ce doit être le frère d’un facteur. (Charles-Albert Cingria)
Il faudrait saisir le monde avant qu’il ne devienne une figure de pierres, des grimaces sur ton visage, un pavage de bonnes intentions, avant que les choses qui le traversent ne s’embourbent dans une terre dont on dira qu’elle leur était due. Juxtaposition encore hésitante, bouts d’innocence, cortège de modesties mises bout à bout, sans mot de liaison. Parataxe, aucune subordination, ni relation ni ordre, nappe ou vague continue, présences, pluies et glissements.
Les phrases se mettent à pencher, regarde le lierre, il monte en spirale autour du nouvel arrivant, deux mots font saillie, le miel coule, j'aperçois un tunnel qui creuse sa galerie, les nuages font des bascules – politesses de voisinage. Le monde tangue, un seau percé, une araignée tisse tes cheveux, l’éclair d’un sabre illumine les bois.
Il faudrait saisir le monde d'avant la bataille à laquelle se livreront les éléments à l’étroit dans les couloirs du langage, lorsque les choses ne sont encore que prépositions, lorsque le monde balance les bras en tous sens. Peu de choses, deux ou trois qui dansent un pas de deux.
Faut-il croire à cette lâcheté de la première heure, l’espérer parce qu’on n’y tolère ni arrière-pensées ni sous-entendus? Il y a là comme une mélodie qui chasse l’implicite, courbe l'espace et nous dispense des coups d’éclat, sans que rien ne soit mis à l’index ou érigé à la tête de l’état. L'abondance nue débarrassée des chevilles et des mortèzes, des boucles de barbelés qui sacralisent le langage, des effets, des figures qui jalonnent et enchaînent.
Restent la flamme de l’ostensoir dans l’église vide et les innombrables voyages sans noise ou d’après la noise. Il ne sert à rien d’anticiper, la rupture continue tient haut les coeurs. Les mots libérés du corset des mots montrent du doigt la douce conspiration des choses qui sourient lorsque le témoin de la bataille se réveille désorienté.
Jean Prod’hom
Il y a les fromages à pâte molle

Il y a les fromages à pâte molle
les faux-monnayeurs
le demi-sommeil
les standard nationaux de la formation professionnelle
les moteurs diesel au cul des barques des vieux pêcheurs du lac
les phases d’aménagement
il y a les poches retournées
tous ces matins qui ressemblent au premier matin du monde
il y a Pors Even à marée basse
Jean Prod’hom
28

Sommes trop à vouloir faire le beau temps, me retire.
Il y a des nuits où je dors comme un livre.

Les ruines sont les miettes d’un autre désastre.
Jean Prod’hom
Jacques Chessex

Si l’on vous demande
un jour
pourquoi ces vies
dites-leur s’ils sont vivants
la couleur de vos passions
les verres vides
sur la table du jardin
les pinceaux en carafe
et bientôt plus rien
Ropraz, 14 novembre 2000
Ropraz, 27 juin 2010
Ropraz, 28 décembre 2010
Jean Prod’hom
Il y a les seaux percés

Il y a les seaux percés
la cour de Sainte-Agathe
il y a les convenances
les chevaux de manège
le lit de l'ignorance
il y a le dérisoire auquel on s'attache
la courte-paille
les braises sous les cendres
il y a oh! les beaux jours
Jean Prod’hom
Dimanche 13 février 2011

On dira qu’il y a la mer, la mer d'abord, partout la mer, la mer qui vous regarde; mais elle ne vous regarde pas la mer, elle va pour son compte, étrangère, tout entière sur une voie parallèle. On pourrait dire alors qu’il y a le jour, l'affairement des hommes et le silence la nuit. Il vaudrait mieux dire qu’il y a la mer, la terre, les hommes, le ciel, qu’il y a toutes ces choses, et que toutes ces choses tiennent miraculeusement ensemble. C’est un enfant qui les tient d’abord, du bout des doigts, un enfant sur un balcon, avec son père qui les nomme, un enfant qui reviendra un jour les mettre ensemble. Autant d'îles, de souvenirs nus restés à l’ancre que rabat soudain le vent, coquelicots et camomilles qui aiguisent l’appétit de celui qui veut savoir. Tout est donné pour la seconde fois, se tenir immobile, mettre bout à bout les choses, comme dans un tableau, mais un tableau qui serait sans bord, les laisser monter avec la vague, peindre en haut la ville qui coule dans notre dos jusqu'à la mer, avec la rivière qui la traverse et le sud en contrebas. Faire tenir ensemble pour la seconde fois ce qui tenait la première fois sans personne: le jour, la nuit, la mer qui lui résiste, leur étrange noblesse, seules, sans moi ni toi. Il n’y a personne sur le balcon.
On ne saura jamais où c’était. Mais ce que je sais c'est que ça monte jusqu’ici parce que, du balcon où j’écris ces mots, j’aperçois le jardin, le lac, et plus loin la mer. Ça commence on ne sait pas très bien quand ni où, le long de la rivière qui serpente, ça va plus loin dans le nord et ça échoit là. Plusieurs fois on a vu ça, et chaque fois il nous avait fallu aller vite, ça durait un instant, le bleu du ciel avec les cloches le dimanche et quelques traînées dans le ciel, le passage du renard et les cris du geai. Tout s’envolait et il ne servait à rien de vouloir le retenir, il fallait recommencer à la ligne. On reprend, la ville et la mer tout entières, avec les hommes qui s’affairent, une fresque, un pré, un carrefour, des usines, miraculeusement ensemble. J’ai lu avant-hier ce miracle, relu aujourd’hui près de l'étang, – Où s'arrête la terre. Il passe et repasse sans faire de vague, avec des îles qui semblent bouger, des bateaux flottant sur le vide. C’était bien avant que la ville ait un nom, bien avant que nous en soyons, mais on l'ignorait, et ce fut notre chance. C’est un livre sur la terre, la mer, la ville et l’universel.
De tout cela on ne se souvient pas exactement, quelques mots et des parfums qui nous font lever les yeux bien au-delà de l’horizon: l’enfance dans la poussière, bouts de tôle et fenouil, le regard qui appareille vent arrière, avec le balcon, et les chemises qui sèchent au vent. On ne sait pas pourquoi, une date, une couleur, une seconde, tout part de là et nous ramène-là sur une marche d’escalier, les coquillages incrustés dans la pierre. Ils venaient de l’étranger, des rizières et de la neige. Nous voici hors du monde avec les éclats que nous a ramenés la mer, la fraîcheur des galets, le corps léché par l’incessant travail du verbe et du silence. Il y a dans ce livre une odeur d’après-guerre, ils ne sont pas si nombreux les temps de paix, n’est-ce pas?
C’est un tableau, la mer et la ville, avec le sang qui coule mais qu’on ne voit pas vraiment, une image du monde sans subordination, ou à peine, celle de l’attente, du désir, de la promesse de parler un jour de l’aube. Que de temps il aura fallu pour remonter le temps, se baisser pour ramasser ce qui ne vaut rien mais qui fait respirer nos vies. Faut-il être une enfant de la mer pour comprendre le lieu? Je suis un enfant de l’arrière-pays.

Où s'arrête la terre de Michèle Dujardin (Ed. Publie.net)

Jean Prod’hom
LXXXIV

C’est la Saint-Valentin, Arthur est allé samedi matin faire ses emplettes au marché. Il a mis 9.90 pour un collier.
- Et toi, papa, combien tu mettais?
Jean Prod’hom
A.7

Les hommes s'en aperçurent il y a 400 000 ans : c'est au crépuscule que les chimères endossent l’habit des chauves-souris, à l'aube que celles-ci redeviennent des chimères. Pour mettre bon ordre à ce va-et-vient et à cette indécision de l’être, et pour que leur corps ne se confondît pas dangereusement avec lui-même, les hommes de la première heure se hâtèrent de séparer le jour et la nuit en faisant du premier l'hôte des chauves-souris, de la seconde l'hôte des chimères. On appela diurnes les rêves qui habitent le jour, nocturnes ceux qu’accueillent la nuit. On s'accorda à dire que le jour se levait et que la nuit se couchait. On convint encore que l'avenir et le passé se partageraient certaines des caractéristiques des chauves-souris et des chimères. Mais les premiers hommes le firent avec si peu de méthode que les chimères n’ont jamais cessé de coloniser le jour et les chauves-souris patientent en grappes avant d’être lâchées dans les endroits les plus reculés de nos nuits.
Quant à l'homme, rien n'a changé, regardez-le, il marche aujourd’hui encore en se penchant vers l’avant. Il faut en convenir, le chemin est long avant qu’on y voie clair. On découvre avec inquiétude le futur dans notre dos, et on prend conscience de l’impasse dans laquelle les premiers hommes nous ont mis en traçant à la va-vite les grandes orientations de l’espèce. On sait lire, prétendent les plus optimistes qui, pour nous faire patienter, nous enjoignent de faire lire à nos enfants certaines des fables qu’ils ont conçues :
Une de distinctions essentielles entre l’homme et l’animal est la conscience du temps. L’animal n’a probablement aucune notion du passé ni de l’avenir. L’homme, lui, sait distinguer aujourd’hui d’hier et de demain. Il a une mémoire.
Il sait aussi qu’il mourra un jour. Cela l’amène progressivement à se poser des questions sur le sens de la vie, sur sa place dans l’univers. La conscience du temps est sans doute liée à la croissance du cerveau.
Comme l’homme possède la notion de l’avenir, il est capable de faire des projets. L’outil en est la preuve : en effet, il est fabriqué en vue de faire telle ou telle chose.
Ces propositions, profondes et incompréhensibles, ne feront pas la lumière sur ce qui s'est passé et se passera. Elles ne nous aideront guère, je le crains, à placer l’avenir devant nous.
Jean Prod’hom
avec le concours d’Histoire générale | LEP
Main courante

Il m'a raconté que, tandis que nous allions chacun de notre côté, il y était retourné.
Tu y reviens comme si tu sortais de terre, une terre que tu remues à peine et qui reçoit ta visite sans y avoir songé, terre aux racines muettes mais qui n'oublient rien. Tu es un revenant, te dresses au milieu de ce dont tu faisais partie sans le savoir, mais d'où il a bien fallu t'éloigner un jour, sans quoi tu serais resté aveugle, le nez collé au carreau. Tu retournes donc dans cette maison et ce jardin, le tien et le sien, laissés en plan un jour, sans regrets, c’est-à-dire sans y avoir abandonné quiconque, c'est-à-dire sans avoir averti non plus celui qui aurait pu y rester... Et tu constates que tu y es demeuré, comme un mort dans un cimetière.
Il se promène et découvre, tandis que j'étais mort, les choses qui ont veillé à mon chevet, elles lui murmurent que nous en étions, l'accueillent comme un disparu plongé dans une petite éternité. Il a bien changé, alourdi de tout ce que j'ai laissé aujourd'hui près du portail.
Lorsque il glisse sa main sur la main courante de l’escalier qui monte à l’appartement, ce n’est pas seulement comme autrefois, c’est comme demain et après-demain lorsque il ne sera plus. Car ce n’est pas moi seulement qui tiens la rampe, mais l'autre aussi, le revenant. Et tenant la rampe, je tiens la main de l’enfant que je fus, je tiens la main de mon père, mais aussi celle du fils du père que je suis devenu. La main de son père dans celle de mon fils, celle de mon fils dans celle de son père. Et tenant celle de mon fils, je tiens celle du revenant, celle d'autrefois, celle qui tenait celle de mon père.
J’aperçois les fers descellés du balcon, la butte sous le frêne, le muret des escaliers Hollard, le pigeonnier, la porte, les studios modernes. Le temps n’a pas avancé, il ne passe pas, il pousse comme les racines du fond du jardin, et on repasse, comme des revenants, baies rouges éphémères du houx, la main collée à la rampe, main dans la main avec la petite éternité, celle qui transite parmi les hommes.



























Jean Prod’hom
Un tour encore

On dit oui et les idées se multiplient comme si on écartait les bras, heureux d’avoir un pays et toute la journée devant soi. On fait un pas, deux pas en direction du quelque chose qui tient ensemble l’horizon, impose sa loi sans qu’on sache vraiment comment et pourquoi, donne chair aux ombres et aux mirages croisés en chemin. On veut s’approcher pour y voir clair, le temps presse, plus près encore, et le temps dont on dispose fond à mesure qu’on prend les dimensions de ce qu’on laissera à la fin derrière soi. Il ne reste bientôt plus rien, il faut se hâter et glisser quelque chose dans le seau qui fuit, n’importe quoi, quelque chose. Mais comment faire tenir debout et solide ce qui s’étale et réduire ce qui fut à quelques mots? Faudra-t-il toujours mettre un peu de la lumière sous le boisseau pour ne pas tout abandonner et détaler les mains vides?
Arrivé au tournant du jour, la bouche est sèche, on aligne quelques mots qu’on espère pourtant fidèles. Plus jamais ça, on ne nous y reprendra pas, trop dur. Mais ce sont d’autres mots qui parlent soudain, sous la dictée desquels l’imprévisible jette ses mailles, et on respire à nouveau. Deux lignes ou trois qui déroulent leur foulée. On sourit d’avoir à peu près réussi ce qu’on ne pouvait complètement manquer et qu’on a cru un instant pouvoir faire naître au forceps. C’est fait, on a lacé à notre insu, une fois encore, les deux bouts de l’horizon.
Le beau temps revient avec le soir, les verts et les ocres de la plaine confondent leurs impressions, la nuit dénouera les noeud du jour et on se lèvera allégé demain. Sisyphe aura retourné le sablier, on aura devant soi un pays tout neuf, le viatique pour un tour de manège et toute la journée devant soi.
Je rêve ce soir à un horizon qui ne se réduirait pas à l'empan de notre courte mémoire mais à l'envergure de nos bras étendus, à un horizon qui aurait, un matin, l’horizon pour horizon.
Jean Prod’hom
Dimanche 6 février 2011

Relu ce matin la fin du Grand Meaulnes et frappé, plus encore qu'autrefois, par l’épuisement accéléré de la narration dans la troisième partie, réduite à la juxtaposition froide et sèche des événements qui se succèdent comme celles des pièces d’un dossier à instruire. Mais cette mise à plat, qui débouche sur une invraisemblable déception, relance pourtant jusqu’à la fin le mystère. Le secret pénètre la ville – Bourges et Paris –, la sidère comme l’arrière d’une comète, avant de s’épuiser, sans qu’on y croie vraiment, dans un labyrinthe de lieux blancs. On ne peut croire tout à fait que les hôtes du rêve de Meaulnes ne vont pas rejoindre les Sablonnières pour de nouvelles noces, on ne peut concevoir que cette aventure – qui n’a au fond jamais eu lieu sinon dans le rêve gonflé à blanc des promesses – ne se poursuive pas. Leur amoncèlement mêlé au silence et aux innombrables secrets qui règnent à Sainte-Agathe, nourrit le mystère de la première partie, lequel se fragmente dans la troisième, succession d’accidents commandés par les circonstances, les ratés de la communication et des corps trop éloignés. Les identités princières des Sablonnières se divisent, multipliant leur présence en des lieux quelconques, faux passagers de vrais malentendus. François, Frantz, Augustin, Yvonne et Valentine, les rois sont pâles, dépris, lâchés par le rêve d’un seul. L’aube a déserté les âmes, il n’y a plus rien, oubliée la possibilité d’en être. Les corps disjoints sont fauchés par une guerre d’avant la guerre. Il aurait fallu aller vite, plus vite encore au bout de l’aventure.
Le Grand Meaulnes est le récit d’un jour, sidération du monde à l’aube, avec le rêve d’une nuit, celle qui fut la première. Longue inspiration. On sait qu’à midi il n’y aura pas de lendemain et le soir, la cour de Sainte-Agathe est déserte.

Balade l’après-midi sous le soleil. Par la Mussilly, la Moille au Frêne, Pra Massin et le chemin des Tailles, les Chênes, la Grisaude et Praz Piot. Les haies vives croisent leurs doigts sur le ciel, déjà prêtes à flamber. Dans le labyrinthe de leur trame des mésanges se sont donné rendez-vous et jouent à cliclimouchette, dessus dessous, dessous dessus, dessus dessous,...
- Qui est-ce?
- Je ne sais pas.
- Qu’est-ce qu’ils font?
- Oh! c’est que c’est jeune, ça s’amuse.
C’était en effet sur le chemin, comme quand les enfants jouent à la « couratte » (qui est le nom qu’on donne au jeu), et c’étaient les deux garçons. L’un courait, l’autre courait. Dsozet allait devant, Justin allait derrière. Quand celui qui était derrière courait plus vite, celui qui était devant faisait de même, comme pour ne pas se laisser rattraper. Car le jeu est qu’on se rattrape, et celui qui vous rattrape a gagné. (Derborence I, 6)

Quelques mètres après le mémorial de Pra Massin, Louise et Lili questionnent. Un peu d’embarras. Car s’il est à la portée de n’importe qui d’évoquer la détresse spirituelle d’un homme qui n’a plus de force et se donne la mort, il est plus difficile de leur expliquer techniquement la pendaison, les préparatifs, la longueur de la corde, sa fixation, le noeud, la durée du passage vers l’au-delà... C’est même au-delà de mes forces et je noie le poisson.

Jean Prod’hom
Il y a les chardonnerets

Il y a les chardonnerets
les sommaires
les tavelures de la vieillesse
il y a tes paupières
la caravane abandonnée à la lisière du bois
la fidélité des ombres
la voiture du facteur qui s'éloigne
il y a les nuits assez longues pour donner tout le repos qu'il faut
les monuments aux morts
Jean Prod’hom
27

Il a voulu le bien d’autrui, y a mis tout son enthousiasme et un solide acharnement, mais il s’avise aujourd’hui que ne pas vouloir son malheur eût amplement suffi.
Il soupçonne que d’autres eurent cette même idée. Mais lui c’est lui, et lui c’est moi. S’instille alors une folle ambition, celle de donner à cet épisode de conscience une expression plus profonde, plus précise et plus belle, plus légère et plus élégante que celle qu’en ont donnée ceux qui l’ont précédé. Il n’aperçoit pas immédiatement le malin qui grimace derrière lui, auquel il devra bientôt tenir tête avant que ne lui tombe sur le dos la cohorte des démons qui guettent sur le seuil.
Jean Prod’hom
Juliette Mézenc
Comment présenter ça ?
dialogue à bâtons rompus OU réunion au sommet (tout le monde n’est pas d’accord sur le sous-titre à donner à cet article, veuillez nous excuser pour les désagréments occasionnés)

![]()
Quincaillerie ?
Fourre-zy-tout ?
Vous avez vraiment mais alors vraiment aucun orgueil hein !
Quoi ?
Laisse-les faire, c’est pour la comm’, on s’en fout
Comment on s’en fout ! ils voudraient se saborder qu’ils ne feraient pas mieux
On n’a qu’à écrire chacun un texte pour présenter le bidule et puis voter
Non non non, vous êtes trop nombreux là-dedans à délirer complet
Laisse-les faire, le vote ça n’engage à rien
Moi je dis que le titre suffit : Le Journal du brise-lames en arial narrow blanc sur fond noir, sobre
Moi perso je préfère le lucinda sans unicode
On peut choisir en fonction de
Voilà où on en est rendu, avec leur refus de faire des choix clairs, de s’en tenir à une ligne, un style, de se choisir un bon petit parti pris
On t’a déjà expliqué : le parti pris du n’importe quoi, pas de plan, pas de ligne, pas de rigueur, faire feu de tout bois. Glaner. Et construire au petit bonheur la chance
Et puis t’inquiète, tous ces petits bouts de rien, ils s’agglomèrent autour du grand caïd, tu sais, le brise-lames, tu te rappelles, le truc sur lequel on bosse depuis des années
Ouais, par intermittence
Justement, l’intermittence construit l’objet, aussi
On pourrait écrire
Dans ce livre (est-ce un livre) vous trouverez (avec des tirets pour faire liste, organisation béton) :
![]() -
-![]() une utopie artisanale et chaotique
une utopie artisanale et chaotique![]() -
-![]() de minuscules coquillages en bande organisée
de minuscules coquillages en bande organisée ![]() -
-![]() un magasin de souvenirs
un magasin de souvenirs![]() -
-![]() un peu d’Histoire
un peu d’Histoire![]() -
-![]() un roman photo : le homard Omar
un roman photo : le homard Omar![]() -
-![]() des bulletins de météo marine
des bulletins de météo marine![]() -
-![]() des migrations dans tous les sens
des migrations dans tous les sens ![]() -
-![]() des rêves absurdes
des rêves absurdes ![]() -
-![]() des rêves terrifiants
des rêves terrifiants![]() -
-![]() des anecdotes (réhabilitons l’anecdote)
des anecdotes (réhabilitons l’anecdote)
Ridicule
Faut bien tenter quelque chose
Tout ça n’est pas sérieux
Juliette Mézenc, collectif

écrit par Juliette Mézenc qui m’accueille chez elle sur son site motmaquis dans le cadre du projet de vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.
Et d’autres vases communicants ce mois :
![]() Laurent Margantin et Daniel Bourrion
Laurent Margantin et Daniel Bourrion ![]() Christine Jeanney et Anita Navarrete-Berbel
Christine Jeanney et Anita Navarrete-Berbel ![]() Maryse Hache et Piero Cohen-Hadria
Maryse Hache et Piero Cohen-Hadria ![]() Joye et Brigitte Célérier
Joye et Brigitte Célérier ![]() Samuel Dixneuf et Michel Brosseau
Samuel Dixneuf et Michel Brosseau![]() Chez Jeanne et Leroy K. May
Chez Jeanne et Leroy K. May ![]() Estelle Ogier et Joachim Séné
Estelle Ogier et Joachim Séné![]() François Bon et Christophe Grossi
François Bon et Christophe Grossi ![]() Cécile Portier et Anthony Poiraudeau
Cécile Portier et Anthony Poiraudeau ![]() Amande Roussin et Benoit Vincent
Amande Roussin et Benoit Vincent ![]() Marianne Jaeglé et Franck Queyraud
Marianne Jaeglé et Franck Queyraud ![]() Candice Nguyen et Pierre Ménard
Candice Nguyen et Pierre Ménard ![]() Christophe Sanchez et Xavier Fisselier
Christophe Sanchez et Xavier Fisselier![]() Nolwenn Euzen et Landry Jutier
Nolwenn Euzen et Landry Jutier ![]() Leila Zhour et Dominique Autrou
Leila Zhour et Dominique Autrou ![]() Jean-Marc Undriener et Claude Favre
Jean-Marc Undriener et Claude Favre![]() Clara Lamireau et Michel Volkovitch
Clara Lamireau et Michel Volkovitch ![]() Bertrand Redonnet et Philip Nauher
Bertrand Redonnet et Philip Nauher![]() Isabelle Pariente-Butterlin et Louise Imagine
Isabelle Pariente-Butterlin et Louise Imagine![]() Juliette Mézenc et Jean Prod'hom
Juliette Mézenc et Jean Prod'hom
Jean Prod’hom
Dimanche 30 janvier 2011

Elles se promènent, retraitées bientôt, sur les quais entre Paudex et Lutry, voix rauque des demi-distinguées et mises en plis sous chapeaux d'apparat. Il semble que leur belle amitié file sur des rails. De loin en tous cas, car je comprends vite qu’il s’agit en réalité d’une petite association de malfaiteurs.
Elles s'arrêtent à deux pas d'un portail ouvrant sur le lac mais fermé à double tour. Leur foie torturé a repeint leur visage en jaune, l'acidité de leur estomac les oblige à tordre les lèvres, de la vapeur sort de leurs bouches sèches, c'est de l'aigreur. Leurs jambes sont des fers cassants, leurs mains s'agrippent au vide. Enfermées dans une bulle de haine, elles semblent respirer encore. Je tends l'oreille pour fouiller leurs secrets.
Elles organisent aujourd'hui le lynchage de leur ancienne meilleure amie. Le rituel est fixe: chacune à son tour lance une flèche qu'elle justifie par le récit bref d'un événement dont elle tire elle-même une condamnation définitive. L’autre ricane, confirme la sentence en ajoutant quelque chose comme une preuve, inarticulée, avant de reformuler le jugement. C'est sans appel. A l'autre de lancer sa pierre: récit bref, justification, condamnation, ricanement, confirmation, petit ajout et reformulation. Et ainsi de suite.
Elles ont tant de raisons d’en vouloir à leurs meilleures amies que l’opération se prolonge, emprunte des chicanes, faisant voir parfois d'étranges détours au cours desquels elles ne peuvent s'empêcher de condamner les pauvres (qui pourraient quand même travailler), les malchanceux (qui l'ont bien voulu), les malheureux (qui rampent au lieu de redresser la tête). Elles s'arrêtent enfin. Le lynchage est en effet si bien engagé qu'il peut continuer et se terminer sans elles. Leurs victimes agoniseront seules.
Elles s'éloignent en silence, deux silhouettes au long cou dressé comme celui des cormorans, elles suçotent leur triomphe. Direction tea-room où je les aperçois plus tard, épuisées par la bataille qu’elles viennent de livrer. C'est la faim, elles plissent leurs lèvres de plaisir en pinçant un bricelet qui craque sous les dents. A leurs pieds un chien broie les restes d'une carcasse de poulet que l'une d'elle a conservé dans un papier d'aluminium. Leurs mains lourdes des bijoux de l'avarice s'agrippent à une tasse de thé noir qui ne s'en formalise pas. Moi j'hésite, pèse le pour et le contre. Faut-il que je dénonce à la Cour internationale de justice ces femmes qui se privent de tout pour faire la peau des absents avec des cure-dents? Je crains qu'elles ne passent encore une fois entre les gouttes, mais qu'elles prennent garde, une lutte acharnée contre ces associations de malfaiteurs se prépare, des avocats ont flairé le bon coup et préparent des dossiers.
En sortant du café, j'aperçois sur le toit plat d’un immeuble résidentiel une douzaine de hérons immobiles qui guettent de là-haut le gros poisson, fiers, hautains. Eux ne parlent pas, ils conchient les balcons de gros industriels que l’on aperçoit derrière des baies vitrées. Ils regardent la télévision le dos tourné au lac. Un rouge-gorge s'éloigne en sautillant sur le brise-lames gorgé de fer. Il s'en fout.

Je continue les yeux baissés. Peu de déchets, peu de tessons, je le craignais. Faudra-t-il que je remette à l’eau ceux que je ramasse depuis 20 ans? Suis-je le seul à avoir fait main basse sur la polychromie des rives du lac Léman? Lugrin Tourronde, Meillerie, Epesses, Nyon,... Je découvre enfin le tesson que j’étais venu chercher. Mon après-midi est sauvée, vais pouvoir terminer ma lecture de Quignard et préparer ma visite chez Juliette Mézenc.
Un petit saut dans le temple de Lutry. Sur le lutrin le Psaume 82.
Rendez justice au pauvre, à l’orphelin,
déclarez juste l’humble et le pauvre.
renvoyez libre le pauvre,
arrachez le faible aux prises de l’impie.
Dieu lève-toi! juge la terre,
car tu es l’héritier de toutes les nations.
Je ne peux m’empêcher de penser aux deux paroissiennes qui ont rendu justice tout à l'heure au bord du lac. Et continue ma visite; dans une vitrine à l’entrée, des brochures au titre évocateur: Au bout de la nuit / Châle de compassion / N’attendez pas d’être épuisé / Chaque minute dans le monde, un enfant perd la vue! Il fait un peu froid dans cette église. Faut filer, prendre de la hauteur, quitter le lac et sa ceinture noire, l’oeil torve des hérons, les gros industriels, les complots de la haine ordinaire. Je remonte à Mézières par Savigny et Moille-Margot avant de rejoindre le Riau par le château de Ropraz. Le jour est fade et pâle, les verts et les roux refroidis par le givre lissent le paysage que la terre noire au pied des haies vives fait bourronner. Pris dans la ronde du jour blanc les cris sont étouffés, les ravages de la petite propriété sont avalés, on pourrait presque y habiter.

Jean Prod’hom
Une gêne technique à l'égard des fragments I

On conçoit ce que laisse entendre cette manie harcelante du soin qu’il porte à ce qu’il laisse se détacher de lui par petits morceaux, cette attention au déchet, cette polissure du lambeau ou de la miniature...
Il passe pour être le premier à avoir composé de façon systématique un livre sous forme fragmentaire...
Cela ne s’apparentait pas à des grappes de pensées, ni à des manières de bandeaux ou de coutures de citations mises plus haut que tout, jusqu’aux poutres, passionnément incrustées et serties, ni à de véritables chapitres à l’aspect plus ou moins thématique...
Brillon dit que la Bruyère consacra dix ans à écrire les quatre cent dix-huit fragments et balança dix ans s’il les produirait...
Il mit vingt ans à trouver un parrainage qui occultât ce caractère démembré et moderne.
Racine et Boileau sobriquettèrent avec perfidie Jean de la Bruyère du surnom de « Maximilien ». Il était l’homme qui fait des bouts de texte, des maximes, Boileau estimait que le plus difficile de l’art consistait dans la liaison, et dans tous les genres de transition...
Il semble que La Bruyère ait poussé cette hantise de la fragmentation jusqu’à la manie vide ou du moins une apparence peu intelligible. A la fin de l’oeuvre, certains discours qui étaient écrits de façon suivie furent par ses soins fractionnés sans raison apparente à coups de pieds de mouche. On pourrait voir là le premier témoignage d’une sorte de compulsion au blanchiment, qui est très moderne, et qui est très obscure.
D’emblée le fragment pose une double difficulté qu’on ne surmonte pas commodément: son insistance sature l’attention, sa multiplication édulcore l’effet que sa brièveté prépare.
Les mots latins de fragmen, de fragmentum viennent de frango, briser, rompre, fracasser, mettre en pièces, en poudre, en miettes, anéantir. En grec le fragment, c’est klasma, l’apoklasma, l’apospasma, le morceau détaché par fracture, l’extrait, quelque chose d’arraché, de tiré violemment. Le spasmos vient de là: convulsion, attaque nerveuse, qui tire, arrache, disloque.
Pascal Quignard, Une gêne technique à l’égard des fragments, Fata morgana,1986
Une gêne technique à l'égard des fragments II

Quand Fr. Nietzsche écrit: « L’aphorisme où je suis le premier des maîtres allemands est une forme d’éternité. Mon ambition est de dire en dix phrases ce que cet autre dit en un livre – de dit pas en un livre », voilà une considération qui pourrait en détourner. Le fragment est conçu ici comme concentration, noyau de pensée, plénitiude essentielle, idéale, platonicienne, autarcique, limée, fourbie. On voit mal le pluriel, le mortel, le rompu et le discontinu que certains modernes affirment y découvrir. Fr. Nietzsche rêve d’une petite boule extrêmement dense et non déchiqutée. Au bout du compte un grain éternel, circulaire, inséparable, un atomos.
Rien ici de la bribe, de la loque, du copeau – des charpies que nous ne cessons pas d’écrire, ni de lire.
Ainsi emploie-t-on souvent le terme de fragment de façon très abusive. Sous ce jour, une large part des textes fragmentaires que nous lisons sont des « fragments d’Héraclite ». Non pas oeuvres volontaires. Il s’agit simplement d’extraits de livres perdus, ou non aboutis...
Fragment veut dire ici »morceau, débris d’un livre qui est perdu »....
L’oeuvre d’Héraclite n’était pas quelques traits épars. C’est un visage défiguré. C’était un visage.
En fait le fragment trahit plus de circularité, d’autonomie et d’unité que le discours suivi qui masque vainement ses ruptures à force de roueries plus ou moins manifestes, de transitions sinueuses, de maladroites cimentations, et expose finalement sans cesse à la vue ses coutures, ses ourlets, ses rentraitures. C’est trop souvent le rêve du petit tout, du petit morceau blotti et enveloppé sur lui-même...
Le fragment fascine sans doute aussi par ce caractère un peu ruiniforme, dépressif. Il est ce qui s’est effondré et reste comme le vestige d’un deuil. Il est la citation, le reliquat, le talisman, l’abandon, l’ongle, le bout de tunique, l’os, le déchet d’une civilisation trop ancienne ou trop morte...
Il est détritus et singularité...
Minuscule catastrophe, minuscule épave, et minuscule solitude.
Ils sont comparables à ces petites flaques d'eau qui sont déposées sur le chemin après l'averse, et que la terre n'a pas bues. Chacune d'entre elles reflète tout le ciel, les nuages qui se sont déchirés et qui passent, le soleil qui luit de nouveau. Une grande mare, ou tout l'océan, n'auraient répété le ciel qu'une fois.
Il y a une sorte de paradoxe insoutenable et même sans aucun doute d’imposture à frabriquer directement des débris, à façonner la fracture pour elle-même, à polir les arêtes, à en aiguiser le tranchant fallacieux, à feindre la violence, ou la sauvagerie, ou le génie, ou la folie, ou le hasard: bref à ne pas se fier au bris lui-même, à faire l’économie du mouvement destructeur dont la fracture ne devait être qu’une trace résiduelle. On voit sur les marchés méditerranéens, dans les pays particulièrement riches en vestiges et en fouilles, des fabricants de faux débris d’antiques. Si faussaires et mercantiles qu’ils soient, par pur souci d’une vraisemblance plus persuasive et par la convoitise d’un gain qui lui soit proportionné, ce sont des vases entiers que ces boutiquiers brisent, et des statues intègres qu’ils mutilent.
Tombé du ciel. Il faut la surface continue d’un sol lui-même coutumier pour que l’aérolithe soit...
L’ordre de la succession bâtit une architecture qui aussitôt subjugue et, si je puis dire, tient les rênes. En termes de petit solfège: le changement de chapitre constituerait la pause, l’alinéa le soupir, le point le demi- soupir, etc. Resterait le blanc ou le pied de mouche ou la petite étoile alors assimilable à des espèces de demi-pauses.
La Bruyère s’efforce d’attacher celui qui le lit à force de richesse dans les tours. Ce sont des petits problèmes curieux posés tout à coup laissant la réponse incertaine, un emportement brusque, une remarque tendre, ou une confidence mélancolique, un cri violent qui paraît arraché, une maxime plus sententieuse, une définition sèche, une allusion réaliste, une petite dissertation grammaticale, une hébétude qui se révèle une lourde malice, une argumentation philosophique plus scolaire, une petite scène de roman, une objuration morale, une métaphore longuement filée, une question délicate, un morceau de patois, une notation pédante ou ingénieuse, une description fidèle, un trait qu’inspire une méchanceté pure, une liste d’objections réfutées point par point, des petits tableaux hallucinés de la campagne ou de la ville, une lourde construction morale, une mise à nu cinglante ou cynique, une anecdote tirée de l’histoire ancienne, une oraison funèbre, un court compte rendu de voyage, un pastiche, un monologue intérieur, une vieille inscription romaine, une harangue, des dialogues, enfin mille sortes de portraits, miniatures, en pieds, rébus, comédie, biographie, etc.
Une attaque intense, arrachée au vide et que son intensité aussitôt broie. Sa densité même la replonge dans le néant tout à coup. Son interruption doit bouleverser autant que son apparition a surpris.
L’opposition la plus profonde est celle du lié et de l’épars, du système et de l’intrus. Vase soudain égueulé. Falaise dans la mer. Adversaire que l’épée éventre. Mais d’abord le vase intact; d’abord la mer étendue, anhumaine, et immense; d’abord l’adversaire.
Pascal Quignard, Une gêne technique à l’égard des fragments, Fata morgana,1986
Une gêne technique à l'égard des fragments III

Jour après jour il met en tas ses bouts de papier qui sont autant d’extraordinaires marque-pages glissés dans les livres des Anciens... Telle observation de l’un, de l’autre, lui paraît digne d’intérêt, il la note encore avant qu’il se couche, l’ajoute à son ramas. Comme ces bouts de papier vite foisonnent, tombent, s’égarent, je ne sais, volettent, il confectionne une sorte de petit dossier pour les ranger. Il cherche en vain à lier tout cela. Une telle tâche le rebute. Et saison après saison, au fur et mesure qu’il s’y emploie, les notes se sont accumulées et leur entassement élève la difficulté et décourage. Il estime que le livre est peut-être là; qu’il suffit d’associer ces lambeaux par thèmes, de les mêler avec un souci d’unité ou de contraste. Et, qu’ils s’assemblent ou qu’ils s’entrechoquent, qu’il suffit de placer entre eux des blancs, des pieds, de mouche. Cela ferait un livre. Ce conditionnel est atroce. Il est le noeud de la difficulté.
On le présente capable de s’asseoir dans un fauteuil, de se tourner vers la fenêtre sur sa gauche, de lire, de concevoir une pensée en lisant, d’être astreint tout à coup à la noter avec précision, tout en lui donnant un tour original, et même une sorte de rétraction et de soudaineté, de rudesse et de puissance. C’est un bout de vie qui se touche comme avec le doigt, qui permet de revoir avec une sorte de lueur, et qui a une espèce de sang sous la peau. C’est très rare. C’est une minuscule scène de béatitude. Ceux qui descendent des tétrapodes, qui ont l’usage des langues, qui affectionnent les parures et qui sont omnivores, qui aiment à se tenir dressés sur leurs pattes arrière et qui ont de la répugnance à l’endroit de la mort ne connaissent pas un nombre si illimité de bonheurs. Il ne me semble pas qu’il existe de désagréments, de légers malaises ou de solitude qui ne s’effacent devant la communication que durant quelques instants elle permet, Je suis assis dans un fauteul qui est trop proche dans l’espace. Je prête l’oreille à un son qui est très loin dans le temps. Je lis.
Pascal Quignard, Une gêne technique à l’égard des fragments, Fata morgana,1986
Dimanche 23 janvier 2011

L’histoire rapatrie des charniers les laissés pour compte qu’elle place délibérément en avant du chantier qu’il a bien fallu ouvrir pour chercher une raison d’être hypothétique à nos existences. L’histoire ressuscite à tour de bras, moule, habille les reliques des éradiqués, guillotinés, chassés, ensevelis, brûlés, dresse dans les cours de nos maisons leurs images pour que nous disposions de repères et puissions aller droit devant à la rencontre de l’étrange rêve du jardin promis. L’histoire pilote nos vies de l’arrière, pieds dans les ronciers, projette à l’avant les roses de l’églantier et mêle les bourreaux de salon au chasseurs de papillons, les belles victimes aux visionnaires déments, le service public aux génocides.

L’homme et le caterpillar qu’il chevauche saignent le réel, l’histoire en est le récit charmeur. Lausanne 1638, plan Buttet et sa traduction qu’en a réalisée quatre maquettistes de la Direction des Travaux de la ville de Lausanne: maisons silencieuses, tours de gala, portes dorées, moulins pour le pain, canaux de dérivation, le Flon et la Louve à ciel ouvert, arbres en fleurs, vendanges tardives, jardinets, paix perpétuelle. Imageries d’un futur à côté duquel on a passé, détenues dans le sous-sol de nos consciences, la campagne nue, des amis, marchands, bourgeois, l’évêque même. On ne voit que ce qui n’est plus et qui est sans avoir été. Un décor pour Alice, avec autour de la cathédrale le cortège des saints en habits d’Arlequin. On y croit à peine, je rêve.

Dehors la ville se dresse, sourit, poursuit sa méditation, imperturbable, avec les hommes à ses pieds, comme des gueux dans l’enceinte du Château Saint-Maire. Rien à craindre pour ces derniers venus, sinon la plus haute des craintes, celle d’être nés là, et hier, et accepter que tout cela ne mène nulle part, passer ce secret au suivant autant que faire se peut pour en être enfin.
Tu seras Elie, le Major ou l’évêque. Et sur les îlots formés des sédiments recueillis par de belles âmes, tu réhabiliteras le monde et son ombre sans leurs ombres, comme s’il t’était toujours loisible de trouver une place, en toutes circonstances. Tu seras meunier, scieur, vicaire ou sculpteur, prêt à l’idylle dans une nuit où le sang ne coule plus, la Louve et le Flon filaient vers la mer. Mais rappelle-toi, nous ne disposions ni de notre vie ni du présent. C’était le 23 janvier, jour de l’Indépendance vaudoise.

J’ai traversé comme une flèche la zone industrielle d’Ussières, déchiré par les lanières du froid, incapable de rêver. L’histoire ne fait pas de détour par l’Ecorcheboeuf, la bise noire en soulève les dessous, ramène les supplices, les terreurs, la sensation qu’on pourrait ne pas en revenir, sans qu’on sache vraiment quelle forme pourrait bien prendre cette fin, sinon celle de l’abandon.

On ne peut s’empêcher de se battre, d’abord se taire, rejoindre les bancs de l’église de Carrouge autour d’un puits d’où se font entendre des voix nues, parenthèses de bienveillance. Et personne pour siffler cette indiscipline, cet hors jeu collectif en marge de ce qui est et de ce qui aurait pu être, en marge du bruit et du silence.

Jean Prod’hom
26

Les regrets raccomodent nos vies, le pardon les défait.
Jean Prod’hom
Il y a les enfants à l’école

Il y a les enfants à l’école
les marins retraités sur le môle
il y a la précarité de nos engagements
les conversions à ski
il y a les zeugmes
les promenades au petit matin
les chevaliers du ciel
il y a Bonperrier un peu après le col de l’Asclier
le crachin en automne
Jean Prod’hom
Comme des petits livres sur un tapis vert

Ils allumaient le feu dans les chalets; partout en haut des cheminées ou par les trous des portes, un joli petit plumet bleu balançait doucement dans l’absence de tout courant d’air.
Les fumées grandissaient, elles s’aplatissaient du bout, elles se trouvaient confondues dans leur partie supérieure, faisant comme un plafond transparent, comme une toile d’araignée, tendue à plat, à mi-hauteur des parois au-dessus de vous.
Et, dessous, la vie reprenait et la vie continuait, avec ces toits posés non loin les uns des autres comme des petits livres sur un tapis vert, tous ces toits reliés en gris; avec deux ou trois petits ruisseaux qui brillaient par place comme quand on lève un sabre; avec des points ronds et des points ovales qui bougeaient un peu partout, les points ronds étaent les hommes, les points ovales étant les vaches.
Quand Derborence était encore habitée, c’est-à-dire avant que la montagne fût tombée.
Mais à présent elle vient de tomber.
Charles-Ferdinand Ramuz, Derborence I, 2
Une autre saison du livre

Ils branchaient leur liseuse à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit; partout derrière les baies vitrées ou devant, en haut et en bas, de jolies petites lumières jaunes vertes, rouges, bleues, dessinaient des constellations dans la pénombre du grand loft.
Les lumières diffusaient, rejoignaient du bout des doigts ce qui restait du ciel; la clarté grandissait dans le prolongement équivoque des plafonds de verre, faisait le dos rond pour se nicher dans le creux de la voûte céleste; malmenées lorsqu’elles touchaient le fond, faisant comme une semaison de vers luisants en peine, un drap de lin élimé aux motifs stellaires, tendu à plat au-dessus de ce qui restait de nous.
Et dessus, dessous, les âmes échangeaient par vases communicants leurs sécrétions sépia, elles ondulaient dans le marbre aux mailles liquides de la grande circulation, se chevauchaient; avec des couloirs et des chicanes, des carrefours et des abysses comme un livre sans bord, un livre sans couture, un livre rongé par d’imprévus rendez-vous, c'est-à-dire pas un livre du tout, avec parfois venus de très loin des éclairs, des secousses, des souvenirs; ceux du dehors, ceux des choses, des bêtes, des hommes, des livres d'autrefois.
Quand l’île était encore habitée, c’est-à-dire avant que le ciel ne fût tombé.
Mais à présent il vient de tomber.
Jean Prod’hom
A.6

On alimentait la flamme tout au long de la nuit. On recueillait à l’aube les braises dans des caissettes portatives de fortune avant de reprendre la route, avec la crainte constante que le feu ne s’éteigne. C’est ainsi qu’on vivait il y a 500 000 ans, à la merci du moindre accident – manque de bois, pluie violente, inattention. J’éprouve à l’instant la même sensation que ces habitants du Caucase d’autrefois, alors que la nuit tombe et que la bise ne mollit pas, isolé du monde, incapable d’allumer un feu par frottement rapide d’un bois dur sur un bois tendre – ou le choc d’un silex sur un bloc de pyrite –, incapable d’enflammer la mousse et l’herbe sèche, le petit bois dans le poêle, incapable de mettre la main sur une boîte d’allumettes. C’était ce soir, dans les montagnes noires du Jorat, la même angoisse devant la même nuit froide.
Jean Prod’hom
avec le concours d’Histoire générale | LEP
Dimanche 16 janvier 2011

L’apiculteur a déposé deux ruches bleue et jaune à la lisière du bois Faucan, leurs locataires préparent la saison, s’agitent depuis midi, font des plans. Il faudra certes attendre encore un peu, qu’elles ouvrent les yeux et lessivent la planche d’envol, mais hier soir, en revenant de Ropraz, il faisait déjà jour, on n’y croyait pas Arthur et moi, souriants à l’idée qu’on allait bientôt voir le jour avant d’aller à la mine. Personne n’y croyait tout à fait, mais l’hiver a bel et bien passé, qu’on soit encore au mois de janvier ne change rien à l’affaire, qu’il revienne dans quelques jours non plus.
Ici, au coeur des bois, ce sont les mélèzes qui se chargent de donner l’avant-goût du printemps. Ils recueillent les feux et clairent le plan des bois. Les silhouettes de l’hiver fondent en bordure de chemin. Il vaut mieux désormais ne plus s’asseoir sans précaution sur les billes de sapin qui gouttent comme de vieux tubes de colle percés.

Je dispose de tout l’après-midi pour ne pas revenir en arrière et aller à pas lents par la Corbassière jusqu’à l’orée du bois des Orgires qui vous tire vers l’avant. Les histoires, les livres et tout le saint-fruscin sont restés à la maison. Nous ne sommes que quelques points éloignés sur les chemins vicinaux qui tiennent ensemble Bottens et les Poliez, Froideville et Villars-Tiercelin. Bonjour Monsieur Courbet, bonjour Madame Grognuz. Tenez! on aperçoit le réservoir de Goumoens-la-Ville, blanc comme le melon du Mont-Tendre.

Terre glaise noire remuée, jaune or couleur moisson la bande qu’a épargnée la charrue en bordure des chemins de dévestiture. Tout autour les piquets d’accacia un peu raides se réveillent, s’étirent avant de dérouler les colliers primitifs des clôtures le long des chemins aux courbes idéologiques. Les uns et les autres se croisent par-dessus par-dessous. Sous l’épaisseur du tapis herbeux des bonzes poussent, et on aperçoit les rides de leur nuque épaisse. On se satisfait de la maigreur et de la pâleur des verts, faite au feu de l’ombre qui bourronne au pied des haies. Les vagues viennent se désaltérer dans les creux.

Sur le plateau de Bottens ne reste de la guerre de religions qu’un champ désert dans lequel se font face tête-bêche les églises catholique et protestante que les fidèles peinent à réchauffer. Pour ne pas choir, j’entre dans la seconde pour m’assurer que les six orteils du Polydactile que Louis Rivier a peint en 1943 sont toujours là. Le compte est bon. J’ouvre tout grand la porte, m’étonne que la mère et le fils ne frémissent pas au vent de cette résurrection-là. Je leur en veux même un peu. Réforme et Contre-réforme n’auront servi à rien, au village les deux cafés sont fermés, le ciel est vide. Et c’est tant mieux quand nous n’avons rien à perdre et qu’il fait beau.

Je rôde autour du château disparu avant de plonger sur Malapalud et suivre le Talent, avec en frise l’alternace des molasses gréseuse et marneuse des côtes de Rabataires. L’eau coule froide dans l’ombre. Personne. Mais où sont donc les vivants? les 7 milliards qu’on m’avait annoncés ce matin? En grappes dans des maison privatives? jardin privatif et pensée privative? Nous ne nous priverons pas aujourd’hui du temple immense dont il se sont coupés et qu’ils ont laissé aux bohémiens et aux va-nu-pieds.

Ces balades d’un jour, on s’y lance sans savoir comment on en reviendra, et on en revient sans savoir comment on y est allé. L’éblouissement reste là-bas quand on y retournera.
Jean Prod’hom
LXXXIII

L'une a laissé ses ancêtres sur les bords du détroit de Messine, l'autre sur les rives de la Manche, elles m'ont souri cet après-midi comme si je leur avais offert une rose.
Jean Prod’hom
Il y a les brise-lames

Il y a les brise-lames
la liberté académique
les brindilles de paille accrochées à la laine de ton pull
la passementerie
il y a la contestation
la clé des champs
les maisons à demi cachées par les arbres
il y a les âmes qui trottinent
les séjours imprévus
Jean Prod’hom
La cafétéria

Il fait entendre, dans l’ombre des quelques mots qu’il m’adresse aujourd’hui et sur lesquels il bute, la menace d’anciens malentendus dont il ne dira rien, déposés en lui comme le sable au fond de la mer. L’homme remue sa peine.
Il vit aujourd’hui de peu, engagé à 50% dans une entreprise de vente par correspondance. Vie solitaire je crois, dans un petit appartement du bas de la ville, une pièce et demie. On ne lui connaît aucun amour. On devine pourtant quelque part un enfant, celui qu’il a été ou celui dont il souhaiterait la présence. Cet homme je l’admire sans l’envier.
Mais tout va mieux, semble-t-il dire, comme s’il avait dompté le monde qui ne l’a guère épargné et le temps dont il suit l’absence de cadence. Il remue à peine, ne regrette rien, s’accroche à la lenteur. Il traverse incognito ses journées. Il aura vécu deux fois plus longtemps que nous autres, avec un secret qui s’éclaircit et dont il cultive les fruits doux et amers. Il ne demande rien à personne et laisse discrètement sur la table de la cafétéria les friandises que ceux qu’il a dû quitter lui envoient de chez lui. Je ne me souviens jamais de son nom. On apprendra sa mort qu’on sera tous morts depuis longtemps déjà.
Jean Prod’hom
A.5

Qu’ont fait nos ancêtres depuis qu’ils se sont dressés sur leurs membres arrière et qu’ils ont quitté, après que les circonstances et le milieu leur ont emmanché la tête en équilibre sur la colonne vertébrale, la vallée du Rift il y a 10 millions d’années? On n’en sait trop rien, mais assurément pas de grands travaux. Cueillir et chasser, rêver peut-être, cueillir des digitales et lancer des galets en fin de journée sur les lacs près desquels ils devaient se reposer...
S’obstiner c’est moins sûr. Il faudra en effet attendre plus de 7 millions d’années avant que, de leurs mains, ils ne taillent les premiers éclats de quartz dans des pierres ramassées ici ou là, éclats dont ils firent les premiers outils et qui attestent peut-être de quelque chose comme une volonté. Finis alors les ricochets, les ronds dans l’eau, les siestes aux lisières, finie l’insouciance.
Mais qu’ont-ils fait? Il faudra en effet un million d’année encore pour qu’ils s’avisent que les galets dont ils avaient tiré des éclats tranchants offrent, eux aussi, des bords tranchants, plus maniables et pratiques à l’usage. Les spécialistes appelleront galets aménagés ces galets à l’extrémité desquels un ou plusieurs éclats ont été enlevés. Ont-ils cherché à récupérer les pierres taillées qu’ils avaient laissées autrefois derrière eux pour ne conserver que les éclats? On peut le penser au vu du million d’années qui aura été nécessaire encore avant qu’homo erectus ne s’avise qu’en enlevant des éclats sur deux côtés, il créerait un tranchant plus aigu encore, qui pourrait servir à déchirer la viande, à broyer un os, à couper la branche sur laquelle il est assis. Les paléontologues n’ont pas tranché la question. Ce qui n’empêchera pas l’un d’eux de nommer pompeusement ces galets des bifaces. Mais ne nous voilons pas la face, quelque chose cloche dans toute cette affaire. Qui défendrait en effet plus d’un jour l’idée qu’on puisse inventer le recto d’une feuille en fermant les yeux sur son verso?

Je soutiens les néo-moralistes qui tiennent d’abord les hésitations et l’aveuglement des premiers hommes pour une chance, celle de nous offrir une leçon, une première leçon de patience: chaque chose en son temps. Mais une leçon de dissimulation aussi, car la vie de nos ancêtre devient toujours davantage, à mesure que les recherches progressent, une bombe à retardement.
Jean Prod’hom
avec le concours d’Histoire générale | LEP
Dimanche 9 janvier 2011

S’il y a souvent place pour deux sous les grands parapluies noirs des boulevards, il n’y a aujourd’hui, sous ta capuche, de place que pour toi. A peine. Alors tu la rejettes dans le dos, te racontes des morceaux d’histoire. Un berger sur la colline garde ses brebis, sous un large feutre noir, enveloppé dans une cape plissée comme une girolle, il va et vient sous le crépi du ciel.
- Et toi, que gardes-tu?
- La possibilité de m’abandonner à la pluie qui ne lésine pas, la possibilité de ne rien garder parfois, sans autre auxiliaire qu’un coeur qui bat. Je regarde à mes pieds les ornières qui font le plein, demain les moineaux vont se régaler. La pluie pourrait ne pas cesser de tomber et ça me fait du bien.

J’entends à peine réveillé la pluie et me rappelle les feuilles gaufrées des châtaigniers derrière le grand mas à la terrasse détrempée. Le brouillard lévitait immobile au dessus de la vallée du Vidourle. Je me promène dans le bois, et c’est comme si je m’en allais en direction du jour, l’interminable jour, abrité par la pluie qui en fait voir la trame. Je touche du bout du doigt le bout des cornes de l’escargot qui me ramène à la pluie d’aujourd’hui, un instant, avant de repartir par d’autres passes, une silhouette sur le chemin de Ricken au petit matin tiède, des signes noirs sur la chaussée délavée, sur les tuiles de Vuadens, les ardoises de l’enfance, les lauzes de Sauveterre, t’en souviens-tu, les tôles au-dessus de Feutersoey, le sapin des Charbonnières, enfin là, avec la pluie, celle d’aujourd’hui, avec les odeurs de là-bas lorsque les fumées âcres des feux d’automne réveillent mes souvenirs et rassemblent de proche en proche les tessons de celui que j’ai été, le vase que je suis dans un monde à l’abandon. On a mis les arrosoirs à l’abri sous l’auvent de l’ancenne laiterie.

Le redoux lèche les plaques de neige attardées. Les fontaines tirent la langue, les ruisselets se gargarisaient. Les vieux tonneaux renversés ont le ventre vide, pour un peu on aurait voulu leur faire relever la tête. Personne ce matin n’avait osé prendre les devants, songé à exiger une interruption immédiate de l’averse, on acceptait et personne ne se plaignait. Les portes de l’église de Syens étaient restées fermées à double tour, le coeur au sec. Et moi enfermé dehors, je n’avais à me plaindre de rien. J’ai marché sur l’eau, fait sonné les six sous qui traînaient au fond de mes poches. J’étais dedans, abrité par la pluie, inutile de forcer la porte, pas de raison d’en sortir. J’ai vu une bergeronnette sautiller sur les bords de la Broye.

C’est pas une saison pour remuer, qu’il m’a dit. On garde les bêtes dedans avec ce temps. On transhume seulement deux fois l’an, t’entends. Moi, je suis fier de mes godasses, de mes falsards et de ma gore-tex. Je nage étanche comme un poisson dans l’eau. Je n’ai rencontré personne d’autre cet après-midi. Coupé de tout, rien ne tremble, ni la pluie décidée ni le haut ni le bas. Eblouis par les mousses lessivées, les anges ne craignent pas de mettre les pieds dans la boue. Voici les quelques mots que je voudrais t’offrir dans la double jachère des dimanches de pluie.

Des Jaunins au Torel, du Champ des Dames à Vers chez les Rod, la terre meuble vous fait des pieds de plomb. Du Riau des Méleries aux Chênes et à La Verne, feux de plastique, jaunes, bleus, jeux d’enfants et restes de châteaux en Espagne, bleu, blanc, rouge et tuyaux verts, étincelles de fer des machines agricoles abandonnées dans le pré sur lesquelles, éblouies, les maisons de l’hiver ferment les yeux. Sous le pont de la Bressonne glaise d’eau glisse au pied de la paroi de molasse sur laquelle s’agrippent les mains lisses du froid.

Toute la journée il pleut, me colle à la peau cette idée de retrouver le beau visage effacé de la pluie. Trempé au pied de la vieille ville. A Moudon on m’attendait. Je me suis glissé à l’arrière comme un chien mouillé, la pluie pianotait sur le capot de l’auto. Devant Saint-Etienne, une double hélice de luminaires a éclairé la nuit, qui tombait elle aussi, elle avait ôté tous ses habits. Il eut été insensé de vouloir s’éloigner. Mais je ne regardais plus, comme si le nom qu’il eût fallu donner à la pluie fût plus beau encore. Ah! la belle après-midi.

Jean Prod’hom
Belle Joux

Les méandres de la Trème avaient été corrigées, on avait aménagé ses rives, essarté les bois, accroché des leurres aux bras des étoiles, les hommes avaient exposé leur âme velléitaire, cherché midi à quatorze heures, ils étaient allés à gauche, ils étaient allés à droite, avaient rêvé un autre ordre du monde, le haut en bas et le bas en haut, tracé des chemins pour revenir sur leurs pas, lorsque l’un d’eux s’avisa un matin que tout cela n’allait pas.
Il maudit un instant les hésitations d’où étaient nées leurs entreprises avant de louer l’esprit de décision des choses: la rivière ne baisse pas les bras et franchit les obstacle sans jamais revenir sur ses pas. Les nuages jouent les masques sans quitter le jeu. Il ne siffle pas aux oreilles du vent lorsqu’il perd un peu de son souffle. Le lac ne languit pas. Le vase déborde et le feu ne se trompe pas.
Derrière tes allures d’aventurier quatre heures sonnent déjà à la cloche du village, un chien aboie, un corbeau remue l’immobile coup de pelle et une lame chasse la neige, le renard file au plus droit la tête renversée vers le ciel. Le dernier mot a donc été dit et tu écris l’étendue blanche. Une dame et son chien te rattrapent, bonjour bonjour, laissent quelques miettes sur la nappe qui nous sépare et, dans le verger, le gui fait le fanfaron sur les épaules d’un vieux pommier qui rit sous cape. En arrière du chemin un poème de Robert Walser.
La neige ne monte pas en tombant
mais, prenant son élan,
descend, et puis se pose.
jamais elle ne monta.
Elle n’est par essence
à tous égards, que silence,
pas trace de vacarme.
si seulement tu lui ressemblais.
Le repos et l’attente
- telle est son attachante
et douce identité,
Vivre, pour elle, c’est s’incliner.
Jamais elle ne retournera
d’où elle est descendue,
elle ne court pas, elle est sans but,
être calme est son bonheur.
Il se souvient alors de la Trème, la conçoit de mémoire, ses sources multiples et ses secrets dans la Joux Noire lorsqu’elle ouvre ses bras au Châ, au Mormotey et plus tard à l’Albeuve, lorsqu’elle se perd dans ceux de la Sarine. Il s’attarde sur ses rives, mêle ses pas aux empreintes des disparus pour tresser une guirlande à l’inexorable.

Publié le 7 janvier 2011 dans le cadre du projet de vases communicants chez Murièle Laborde Modély (L’oeil bande).
Jean Prod’hom
Il y a les transports gratuits

Il y a les transports gratuits
la beauté sur la terre
les salons de coiffure
il y a le Doubs en amont de Goumois
les 52 morceaux du squelette de Lucy
les passages pour piétons
il y a le provisoire
les feux d’artifice
il y a la modestie à laquelle on est réduit
Jean Prod’hom
Derniers jours de la bureaucratie

On décidait bien peu de choses au centre du bâtiment de l’administration et de la protection sociale, au rez des mensonges en enfilade, à l’étage un double processus en miroir et, ici et là, quelques impayés punaisés. On discutait certes encore des principales conditions d’octroi des pensions, mais par habitude, parce que de l’argent il n’y en avait plus. Pour la répartition des taxes dans l’aile orientale du palais l’affaire était vite réglée. On exonérait d’emblée les commensaux et ceux de leur lignée qui avaient été de l’équipe fondatrice de la confédération des certitudes et, avec l’accord tacite mais nécessaire des absents auxquels on octroyait le droit de vie ou de mort sur le personnel étranger qui avait pour fonction de couvrir le scandale, on prenait les devants en pressant le solde de se taire et de retourner chez lui.
Les quartiers avaient déjà organisé le réseau des solidarités et quelques bénévoles investis de la générosité sans laquelle quiconque perdrait la face proposèrent les premières formes de jeux de rôles. Quant aux plus cérébraux, ils tentèrent de donner une définition adéquate du mot blasphème après avoir listé les expressions qui relevaient sans aucun doute de son domaine; personne ne goûta à l’usufruit de cette passionnante recherche. On veilla encore quelques années à l’exécution des peines, puis on renonça; on hésita bien une paire d’ans à revenir à ces anciennes fêtes du solstice d’hiver, colorées et efficaces, au cours desquelles on se prêtait dès l’aube à l’examen des viscères d’un bon à rien, foie d’une égarée ou reins d’un vieillard trouvé à la sortie d’un débit de boisson, pour combler le vide et obtenir une paix à bon marché. Les choses allèrent de ce pas avant qu’on ne touchât le fond lorsqu’on oublia que personne ne consultait plus les registres qui faisaient état des propriétés et du service de chacun.
Cette tournure des choses n’est pas moins vraie que nulle part ailleurs, on ne le dit pas assez, mais ce n’est que beaucoup plus tard qu’on sut déminer les chausse-trappes de la double négation et du parenthésage en cascade.
Jean Prod’hom
A.4

Au lendemain du long séisme qui déchira l’Afrique du nord au sud, il y a 10 millions d’années, les primates de l’ouest se réveillèrent sous la pluie, mais au coeur d’une forêt dense et protectrice qui les réjouit et dont ils ne sortirent que beaucoup plus tard avec la démarche du gorille et du chimpanzé. Les primates de l’est, eux, se levèrent les pieds au sec et c’est tant mieux. Mais ils découvrirent assez tôt qu’ils étaient dans de sales draps et que cet espace adossé à des montagnes toutes neuves, ouvert à tout vent et sans pluie, allait leur occasionner bien des soucis. Trop tard. On craignit à juste titre pour leur avenir. Sans griffes sans crocs, sans les mollets des zèbres et les cuisses des antilopes comment allaient-ils s’en tirer? Les grands fauves de l’est africain guettaient.
C’est l’occasion qui fait le larron, se dirent les plus avisés d’entre eux qui se mirent à chercher une issue à cette vilaine passe: un dispositif pour repérer avant qu’il ne soit trop tard la venue de leurs pédateurs et s’éclipser. Cette décision fut grosse de conséquences. Ils se dressèrent en effet d’un même mouvement sur leur pattes arrière libérant ipso facto ce qui leur tiendra lieu de mains qu’ils placèrent derechef en visière sur leur front: rien à l’horizon pour se mettre à l’abri, ou si peu, et les grands fauves qui étaient sur le point de leur tomber dessus... Faut savoir que leur cerveau était encore de dimension réduite, à peine la cylindrée d’une Fiat Topolino.
Si donc la bipédie protégea indirectement certains des hominidés du soleil, ils n’obtinrent cependant, en se redressant, que le droit de voir croître leur peur en intensité et en durée, d’autant plus que la savane perdait jour après jour ses derniers bosquets. Homo erectus se déplia donc encore avec la peur qui grandit analoguement. Il n’en fallut pas plus pour qu’Homo erectus décidât de quitter l’Afrique qui ne lui amenait décidément rien de bon.
Le volume de son cerveau avait grossi et atteint déjà celui du cylindre d’une Peugeot 807, mais c’est à pied qu’il partit en direction du Caucase, de la Chine, de l’Inde et de quelques autres contrées où, par bonheur, l’on ne parlait pas encore la mutitude de langues que l’on connaît aujourd’hui. Et ses mains, me demanderez-vous? Et bien c’est plus tard, beaucoup plus tard que l’homme inventera la casquette qui les libérera définitivement, repérant alors toujours plus loin et toujours plus tôt les grands fauves de l’est africain. La peur de ce touche-à-tout ne cessera de grandir.
Jean Prod’hom
avec le concours d’Histoire générale | LEP
Murièle Modély
avec une moue légère
qui creuse un accent grave
sur le bord de sa lèvre
je sens bien qu’être une fille
de surcroît de la ville
dans sa bouche terreuse
brûle comme une ortie
je sais bien qu’un jour
son regard indulgent
heurtera âprement
le pli de sa glabelle
je sais qu’il me perdra
quelque part dans la nuit
que je m’égarerai
en chemin dans les blés
dans les
coteaux
du Gers
où je vois
une bosse
deux bosses
un troupeau
de chameaux
où je vois
des poils ras
puis blonds
et leur tonte
l’été
où je ne vois
rien
que
feuilles
plantes
arbres
sans nom
je dois
lancer en l’air
et sur lui
d’étranges
petits
sorts
pour voir ses cheveux, sa langue crépiter
quand il m’identifie comme une citadine
pour voir sur sa tête, le ciel du jour qui sombre
s’embraser dans le bref flamboiement d’une orange
pour voir les nuages dégorger tout leur jus
asperger d’un voile roux le bitume et ses mots
pour l’écran sirupeux qui dessine sur nous
un nouveau paysage
Murièle Modély
![]()

écrit par Murièle Modély qui m’accueille chez elle sur son site L’oeil bande dans le cadre du projet de vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.
Et d’autres échanges ce mois :
![]() Juliette Mezenc et Christine Jeanney
Juliette Mezenc et Christine Jeanney ![]() Christophe Grossi et Michel Brosseau
Christophe Grossi et Michel Brosseau ![]() François Bon et Laurent Margantin
François Bon et Laurent Margantin ![]() Martine Sonnet et Anne-Marie Emery
Martine Sonnet et Anne-Marie Emery ![]() Anne Savelli et Urbain, trop urbain
Anne Savelli et Urbain, trop urbain ![]() Jérémie Szpirglas et Franck Queyraud
Jérémie Szpirglas et Franck Queyraud ![]() Kouki Rossi et Jean
Kouki Rossi et Jean ![]() Piero Cohen-Hadria et Monsieuye Am Lepiq
Piero Cohen-Hadria et Monsieuye Am Lepiq ![]() Marie-Hélène Voyer et Pierre Ménard
Marie-Hélène Voyer et Pierre Ménard ![]() Frédérique Martin et Francesco Pittau
Frédérique Martin et Francesco Pittau ![]() Jean-Yves Fick et Gilles Bertin
Jean-Yves Fick et Gilles Bertin ![]() Candice Nguyen et Benoit Vincent
Candice Nguyen et Benoit Vincent ![]() Nolwenn Euzen et Joachim Séné
Nolwenn Euzen et Joachim Séné ![]() Isabelle Pariente-Butterlin et Xavier Fisselier
Isabelle Pariente-Butterlin et Xavier Fisselier ![]() Christine Leininger et Jean-Marc Undriener
Christine Leininger et Jean-Marc Undriener ![]() Samuel Dixneuf et Philippe Rahmy-Wolff
Samuel Dixneuf et Philippe Rahmy-Wolff ![]() Lambert Savigneux et Lambert Savigneux (ben oui)
Lambert Savigneux et Lambert Savigneux (ben oui) ![]() Christophe Sanchez et Brigitte Célérier
Christophe Sanchez et Brigitte Célérier ![]() sur twitter et en 9 twits chacune, Claude Favre @angkhistrophon et Maryse Hache @marysehache (elles ont choisi de publier les deux textes chez celle qui a un blog : Maryse Hache)
sur twitter et en 9 twits chacune, Claude Favre @angkhistrophon et Maryse Hache @marysehache (elles ont choisi de publier les deux textes chez celle qui a un blog : Maryse Hache)![]() Catherine Désormière et Dominique Hasselmann
Catherine Désormière et Dominique Hasselmann![]() Murièle Laborde-Modély et Jean Prod'hom
Murièle Laborde-Modély et Jean Prod'hom
Jean Prod’hom
Il y a les pêcheurs à la mouche

Il y a les pêcheurs à la mouche
la ferblanterie
l’accord du participe passé des verbes pronominaux
les flaques d’eau
il y a les augmentations de salaire
les terres grasses que la charrue décolle
il y a Henri Calet
les petits viatiques
le discours indirect libre
Jean Prod’hom
Dimanche 2 janvier 2011

C’est décidé, on ira au cinéma à pied, ça ne fait finalement qu’une douzaine de kilomètres du Riau jusqu’au Zinema d’Oron, n’est-ce pas? Et on marche depuis que tu es tout petit. Souviens-toi des Diablerets, de la Vallée de Joux, de Plan Francey,... il t’en reste des morceaux et des photographies dans les albums.
La route de la Moille Messelly est verglacée si bien qu’on renonce à emprunter le chemin du remaniement, on bifurque à la patte d’oie sur Rachigny, fond sur la Goille où F se remet de son opération. On brasse la neige avec insouciance dans le côteau de l’autre côté de l’Echu. Un renard bondit d’un bosquet et plonge dans le lit du Cerjuz. On guigne à tout hasard dans le cabanon des veaux qui surplombe la rivière. Le roux a filé, rejoint par un chat qui disparaît lui aussi. Arthur sautille, grimpe, court.
Près d’un hangar caché dans le bois sous la route de Berne, on entend les chants désordonnés d’oiseaux, c’est une volière en amont du pont de la Bressonne qu’on souhaitait rejoindre par le Moulin du Creux. Aux piaillements se mêle un tube des années 90, les propriétaires s’affairent, on remonte discrètement. Qu’on ne nous prenne pas pour des brigands.
Arthur lance des boules de neige sur tout ce qui bouge. On traverse la zone industrielle de l’Ecorcheboeuf jusqu’au café de la Croix d’Or, fermé malgré les lumières qu’on aperçoit derrière les rideaux. A cause d’Ussières tout près, c’est un lieu qui me fait immanquablement penser à Dhôtel, au Plateau de Mazagran et à l’Ile de la croix d’or.
On fera une halte à Mézières en face d’un caraque, d’un vermicelle et de deux chocolats chauds. Puis, par Chenau, on atteint le pont de la Carrouge. Il nous faut alors remonter la route du Paradis, comme en 2002, entre Tanneires et Roseires, jusqu’au cimetière de Ferlens où S repose fauché par un train. Je raconte cette sale histoire à Arthur tandis qu’il caresse un chaton devant chez les B, la maison est vide, le village est vide, la campagne est vide. On rejoint Fontaine, entre Champ Jaquet et les Planches, longe la lisière du Bois de Fey avant de glisser dans la neige jusqu’au pont du Parimbot. On remonte sur la Possession d’où l’on aperçoit Oron à l’avant de son château, le Niremont et les Alpettes, plus loin les Vanils.

On laisse au nord Auboranges et sa belle maison carrée, traverse le Champ Paccot au-dessus de Vuibroye avant de descendre jusqu’au pont qui franchit le Grenet à deux pas de la Broye. Arthur court devant, onze ans seulement, saute comme un cabri et allonge le pas, se retourne pour s’assurer que je ne le perds pas de vue. Jusqu’à Châtillens où les cloches sonnent, il est 4 heures.

On remonte ensemble en direction du centre de la petite ville qui abrite près de 1500 habitants, s’assoit sur un muret devant l’Etablissement médico-social du Mont où il fait bon vivre, géré par la Fédération des Eglises adventistes du 7e Jour, quelques boules de neige dans le lit du Flon, petit affluent de la Broye, un coup d’oeil chez Denner, les voix de deux loubards, et un chocolat chaud. Un chocolat chaud pour conclure notre balade, au tea room, seul établissement public ouvert de cet ancien chef-lieu de district qui file du mauvais coton.
Une douzaine de kilomètres, le bonheur de marcher avec son fils, et celui peut-être de marcher avec son père, il n’en faut pas plus pour qu’on renonce au cinéma.





Jean Prod’hom
Le lilas et l'aubépine

Les élus dont le nom était précédé d’une particule avaient pour missions principales de déclencher des bourrasques par la seule force de l’illocutoire et d’agiter au moment voulu les consciences. Les autres s’assuraient du silence des modestes.
Mais trop de chefs nuisent, qu’ils soient à la tête d’une bourgade de cinq cents ou d’une province de cinq mille, et les caciques, vite rongés par le doute et discrédités au moindre impair qu’ils ne manquaient pas de commettre dans l’usage bien établi de la langue de bois, perdaient avec leur tête les grandes orientations de la raison et le contrôle général des intempéries. C’en était fait de la paix du travail et, à terme, de leur particule.
Mis à l’écart on les retrouvait sillonnant les bois, soumis à la tentation puis à l’entretien des maigres cours d’eau de la zone orientale de l’île, la volonté calcinée et l’os fleuri pour user d’une expression locale. On assistait alors dans les villes à la ruine de la domesticité et à l’empiétement des consciences. On déplorait en outre au carrefour des taches d’huile et on signalait des heurts d’amertume sur le périphérique.
On retrouvait plus tard ces anciens élus dans des camps où ils goûtaient à la terreur. On les identifiait à leur matricule brodé sur un serre-tête que certains portaient en sautoir. Là pas le temps de tergiverser ou de chantonner. On avait faufilé à l’envers des tissus qu’ils portaient le jugement sommaire de leur condamnation et on tablait sur l’obstination proverbiale de vieilles incontinentes, sûres de leur bon droit, pour emporter les souvenirs des condamnés qui gouttaient en bon ordre de dessous leur tunique de bure. Elles étaient tenues de se rendre nuitamment derrière les grillages, nues, pour un face à face nocturne dont l’horeur ne s’imagine plus.
En automne, pour que les serpillères et les secrets n’encombrent pas la cour de l’enceinte, on les jetait avec les différends et des brassées de litiges dans des bartasses auxquelles un aveugle tiré au hasard boutait le feu. Que de cendres! que de noirceurs! Mais de jeunes arbrisseaux y plongeaient leurs racines et, avec l’arrivée de juin, des senteurs supérieures flairaient le renouvellement, faisaient le mur fuyant à tout vent dans la direction de l‘échappée belle.
Jean Prod’hom
A.3

A cette époque, il n’y avait pas seulement les températures et les continents qui bougeaient. Les hommes – qui n’ont pas toujours fait la manche – aussi. Si bien que, pendant les périodes froides, alors que de gigantesques glaciers recouvraient le nord de l’Europe, de l’Asie et de l’Amérique du Nord, que les masses d’eau emprisonnées par le froid ne coulaient pas, que le niveau des océans était beaucoup plus bas qu’aujourd’hui, les plus timides de nos ancêtres ont saisi l’occasion d’aller à pied de Calais à Douvres sans se mouiller.
Jean Prod’hom
avec le concours d’Histoire générale | LEP

































