Les livres à la benne

Il y a dix jours exactement, un homme brun, bien mis, break ripolinée et cinquantaine cendrée jetait six sacs de livres dans la benne du vieux papier de la déchèterie locale. C’était un dimanche et l’inconnu n’était pas domicilié dans notre village – on se connaît tous par ici. Il a semblé gêné de ma présence, je l’aurais été aussi. Que cachait-il ? Pourquoi se mettait-il dans un tel état ? J’ai voulu le réconforter en lui soufflant d’un air entendu, ma foi, qu’il le fallait bien de temps à autre. Il a levé les yeux au ciel, sombres et brillants, puis s’est glissé hors la déchèterie comme un serpent. Je n’ai pas voulu en savoir plus, mais il y avait quelque chose de terrible dans ses yeux, et puis d’un peu louche, comme s’il avait voulu se débarrasser d’un mort, ou de son linge sale. Ça ne se fait pas, n’est-ce pas? L’inconnu allait-il revenir le lendemain reprendre ce qui, comme il semblait le croire, aurait pu le trahir? J’ai imaginé un bref instant que cet inconnu était un écrivain et que les livres qu’il avait jetés dans la benne étaient, sans le savoir, ceux qu’il avait écrits et qu’on allait oublier. Le camion de l’entreprise chargée d’emmener le vieux papier sur le brasier a passé hier en fin d’après-midi. L’affaire est close.

Au fond de la benne le visage de Gustave Courbet m’avait pourtant fait signe et j’ai relevé consciencieusement ce dimanche-là les coordonnées sommaires des ouvrages jetés par le brigand. Un jour qui sait? Le livre aura disparu, trop lourd, trop encombrant, trop cher,... Il aura laissé la place à une tablette qui contiendra tous les livres de toutes les bibliothèques pour un prix dérisoire et illusoire. On regrettera peut-être alors les équipées dans les déchèteries et les grands feux dans lesquels on jetait les livres en se mordant les lèvres de honte.

Jean-Pierre Richard, Etudes sur le romantisme, 1970
La Bible du pêcheur, 2001-2003
Michel Viala, Poésie choisie, 2009
Hans-Michael Koetzle, Photo icons, Petite histoire de la photo, 2007
Gérard Genette, Figures III, 1972
Jacques Scherer, La Dramaturgie classique en France, 1973
Jean Prod’hom, Etudes de Lettres, La Part des hommes (tiré à part), 1985
Guide du routard, Italie du Sud
Guide du routard, Suisse
Valérie Poirier, Loin du bal et autres pièces, 2008
Henri-Alexis Baatsch, Hokusaï, 2008
Atlas alphabétique, Les Etats du monde
René Benjamin, La Galère des Goncourt, 1948
Stéphane Guégan, Michèle Haddad, L’ABCdaire de Courbet, 1996
Giovanni Boccaccio, Decameron, 1968
Michel Chauvy, Passions et démesures latines, Cicéron, Lucrèce, Catulle, 1999
Robert Aron, Les Grands Dossiers de l’histoire contemporaine, 1964
Michel Puech, La Philosophie en clair, 2004
Anne Cunéo, Les Portes du jour, Portrait de l’auteur en forme ordinaire, 1982
Jean-François Revel, Mémoires, le voleur dans la maison vide, 1997
Albert Thibaudet, La poésie de Stéphane Mallarmé, 1926
Collectif, Société Vaudoise des Pêcheurs en rivière, 1908-2008
Guides Hachette, Orthographe, 1999
Nayrolles , Profil d’une oeuvre, pour étudier un poème. 1996
E. Giddey, Histoire générale du XIVe au XVIIIe siècle, 1957
Dan Brown, Da Vinci Code, 2003
Maurice Wilmotte, Critique littéraire, 1921
Alain Jouffroy, Manifeste de la poésie vécue, 1994
Winston Churchill, Réflexions et aventures, 1932
Georges Pompidou, Anthologie de la poésie française, 1961
Bescherelle, La Conjugaison, 2004
Yasmina Khadra, Ce que le jour doit à la nuit, 2008
Collectif, Guide culturel de la Suisse, 1982
Jim Harrisson, Legends of the fall, 1979
Collectif, De l’ours à la cocarde, 1999
Robert Brasillach, Comme le temps passe, 1937
Eric Massery, Une si belle ignorance, 2009
Emanuelle delle Piane, Pièces, 2010
Michel Vergères, Le Pisteur, L’escroc finit en hiver, 2004
Eschyle, Agamemnon, 2001
Sarcey, le Siège de Paris, 1967
Brasillach, Notre avant guerre, 1941
Stanley, Soumission à l’autorité, 1994
Georges Clémenceau, Grandeurs et misères d’une victoire, 1973
J.-L. Clade et P. Perrin, Au Coeur de la Vallée de la Loue, 2010
Gérard Genette, Figures I, 1965
Michel Butor, La Modification, 1994
Marielle Pinsard, Les pauvres sont tous les mêmes et autres poèmes, 2009
Marcel Schneider, La Littérature fantastique en France, 2007
Gérard Genette, Figures II, 1969
Arnaldur Indridason, Hiver arctique, 2009
Léon Daudet, La vie orageuse de Clémenceau, 1938
André Bellessort, Sainte-Beuve et le XIXe siècle, 1954
Kwong Kuen Shan, le Chat philosophe, 2008
Claude Bron, Orthographe, 1990
Georges Pillement, La Poésie érotique, 1970
Charles-Ferdinand Ramuz, Journal, 1943
Christine Barras, La sagesse des Romands, 2009
Léo Spitzer, Etudes de style, 1970
Georges Poulet, La Conscience critique. 1986
Collectif, Anniversaire du Gymnase cantonal de la Cité, 1987
Collectif (Corinne Desarzens), Récits sur assiette, Textes inédits d’auteurs romands sur la cuisine. 2009
Collectif (Pierre-Yves Lador) Plumes bigarrées, Inédits suisses, romands sur le livre, 2009
Sylvie Durrer, Le dialogue dans le roman, 1999
Marcel Cohen, Histoire d’une langue le français, 1950
Collectif, Gymnase de la Cité, Annales 1995-1997
PS
J’ai tiré au hasard cinq livres parmi les soixante-cinq dont l’inconnu s’est débarrassé, en me jurant de les garder et de les lire. A moins que je ne change d’avis et que je ne suive son intemporel exemple.
Jean Prod’hom
Il y a les grandes distances

Il y a les grandes distances
la mayonnaise
il y a les bichons maltais
le silence d’après l’abattage
la pluie sur les toits d’ardoises
il y a les rédactions de Fritz Kocher
le principe du tiers exclu
la sonnerie de fin des cours
il y a la volonté du lierre
Jean Prod’hom
Dimanche 26 décembre 2010

Ses yeux, que je me représente immenses et brillants, n’auront rien vu du grand monde qu’il désirait tant découvrir. Ils auront eu au moins le don de rester grands ouverts dans le petit qui était le sien...
Robert Walser à propos de Fritz Kocher
Ce n’est pas le vent qui m’a poussé au-delà du domaine de la Solitude entre Montmeillan et les Galites, ni aucun des forfaits qui meublent nos vies et les talonnent dès l’aube, c’est l’autre, un autre, le brigand déguisé en bourgeois chapeauté. Il n’en voulait plus et n’y tenait pas plus que cela, allait de l’avant. Il avait croisé après midi des promeneurs du dimanche, s’en était détourné sous cape, glissant par-dessus le talus dans un pré où la neige s’ammoncèle intacte, lourde. Il n’avait pas craint de troubler sa blancheur inédite. Je l’ai vu s’arrêter là où la neige est moins profonde, où percent des touffes d’engrais vert, mais les traces sont effacées et lui, dos tourné, est bien loin dans le désert. J’ai cru comprendre un peu ce brigand et le pays qu’il habitait. J’ai écouté le double silence du lac acoustique.
Il ne se passe rien, il y a trop de choses – est-ce ironie pour me protéger et aller de l’avant, torturé par la lourdeur du dedans? Entre l’aube et le territoire d’après, il n’y a dans la neige que détours, hésitations et pas de danse, des ans qui passent pour faire bonne figure, traces de bêtes dont on ne veut rien savoir, passants sans visage. On a abattu de vieux arbres hier et le silence s’est réveillé lorsque je me suis arrêté. Nos vies sont d’un seul tenant, un jour et une nuit, on titube aux alentours, là où l’on fut un instant au repos. Parti tôt avec les autres, un moment avec eux avant d’aller où personne ne va, que la neige tombe une fois encore et ce sera fini. Les chiens aboient devant la Grange aux Roud, j’entre dans le bois comme un voleur. Tant de choses font de même, refusent l’affiliation, se croisent, laissent des traces tôt effacées, ne bronchent pas, ne se plaignent pas, la neige fait le reste. Joye a abandonné sa caravane dans le bois de Ban
Je ne suis qu’un locataire d’un meublé dans un décor immobile que seule la nuit surprend, égaré cet après-midi dans le bois sec, pas de bruit, un dédale d’avenues, de sentes et de feux de broussailles où la bête garde les siens au chaud. Comment pourrait-on partager le désert? Comment chevaucher les nuages qui filent vers le sud. Faut-il s’éloigner pour n’être plus seul? Derrière moi les traces s’effacent, il n’y a pas de nuit prochaine, c’est toujours la même, une nuit un jour, et entre elles la neige.
Attester du réel qui passe derrière les vitres de nos fenêtres, on est là, l’autre aussi, plus aimable et correct lorqu’on ne le dérange pas. Quelle histoire tirer de cette petite promenade, quel fil tirer sans déranger la belle ordonnance, pour que rien ne soit changé avec la retenue qui sied ? Ecrire ce qui ne s’écrit pas, mais qui mérite d’être poursuivi avec les égards qui lui sont dus, effacer les traces qui y conduisent comme la neige sur la neige, les lettres sur la page.
Qu’on ne surestime pas cet autre qui est en nous, qui marche et qui s’éloigne. On écrit beaucoup trop, un bon pas suffit parfois, un acte en engendre un autre, et on se débarrasse de tout ce qui n’est pas soi, on se défait pour n’être plus rien, sinon un souvenir, une pensée qui passerait par là ou dans la tête d’un hypothétique lecteur. A force de distraction on parvient à s’éloigner de son but, avec au fond du coeur une belle réserve d’étonnement, c’est que les choses s’en vont, et nous avec. Se coucher dans la neige, par un saut effacer les traces et les tourments. Pas avant d’avoir appris à marcher et à lire, personne pour nous aider.
Aucun souvenir de ce que Robert Walser a vu au-delà du pâturage qu’on appelait Am Ende der Welt, mais le souvenir d’une image, persistante, celle d’un homme dans le soleil, le dos tourné à tout, brassant la neige, un chapeau sur la tête pour qu’on ne le poursuive pas. Les flocons tombent derrière lui et recouvrent les traces qui auraient pu nous faire croire que le chemin est facile et qu’il suffit de prendre la bonne direction, alors qu’il nous faudra recommencer, marcher et puis écrire, qu’il nous faudra recommencer sans rien regarder, ni l’arbre à la lisière du bois ni le nuage qui feint de nous montrer la direction.

J’ai marché et je marche encore, mais pas d’allure égale.
Tantôt j’allais d’un coeur serein,
Tantôt - même le ciel connaît cela -
Je perdais toute envie soudain.
Dans un long jour empli de peine.
Robert Walser
Jean Prod’hom
Vanités de la soldatesque

Il en va des incorporations comme de la grâce, armées de rang ou cohortes d’anges c’est tout un. Dès l’aube les conscrits enfilaient leur tunique aux reflets turquoise en jurant qu’on ne les y reprendrait plus, serraient en vain la poudre d’escampette qui traînait au fond de leurs poches. L’appellation de leurs missions vives et sommaires restait sous les verrous, bel exemple qui tranche avec les anciennes manières. Et tandis qu’ils attendaient que se présente un coup d’état ou une succession de coups fourrés, ou un défunt laissé en carafe, les froides et difficiles conditions qui agitaient le monde d’en-dessous obligeaient les conscrits à ne plus distinguer sarments et serments qu’ils jetaient au feu.
Les plus habiles, bien sûr, demeuraient à l’abri, dans le voisinage de l’honorable, derrière le réseau dense d’une famille de questions et le labyrinthe de leur filiation. Et on sauva ainsi, c’est vrai, quelques hommes et les traditions administratives de la philosophie naturelle, mais en réalité le procédé était sans effet, on ne stoppa pas l’alternance de la vie à de la mort vers laquelle les insulaires allaient au pas de sénateur. Les petits tas d’énergie primitive qu’ils apercevaient sur le chemin les obligeaient à baisser les paupières et on pouvait lire alors le dessin des regrets que les larmes n’effaceraient pas.
Jean Prod’hom
A.2

Si l’orang-outang vit aujourd’hui en Asie et seulement en Asie, si le gorille et le chimpanzé se rencontrent en Afrique, et uniquement en Afrique, c’est en Amérique du Nord que vivaient les plus anciens primates dont l’orang-outang, le gorille, le chimpanzé et l’homme ne sont que les lointains descendants.
Jean Prod’hom
avec le concours d’Histoire générale | LEP
Inscrites au Registre de la Mémoire du monde

L’Agence internationale des prisonniers de guerre créée à Genève en 1914 a eu pour tâche de rétablir les liens familiaux entre personnes que la guerre avait séparées. L’Agence a établi le fichier des disparus ordonné par régiment et par compagnie. Elle a rédigé six millions de fiches permettant de suivre le sort de deux millions de prisonniers.
Les indications au dos de certaines des 5119 boîtes de fiches exposées au sous-sol du CICR à Genève et inscrites au Registre de la Mémoire du monde de l’UNESCO ont disparu.

















































Jean Prod’hom
Il y a les pois mange-tout

Il y a les pois mange-tout
l’invention de la trigonométrie
le dégel
les traces du renard autour du poulailler
la vis d’Archimède
les pulls en cachemire
la voix de Valère Novarina
il y a les gares de province la nuit
il y a les lois de l’hospitalité
Jean Prod’hom
Dimanche 19 décembre 2010

Tiré en arrière par le poids et la lenteur de ce qu’on emmène malgré soi, il avance cahin-caha, brasse la neige haute et lourde qui tapisse le pré derrière le Chauderonnet, avant de déposer le trop-plein à la lisière du bois et trouver là un milieu qui ne l’oblige à rien, sinon à suivre la cadence, oscillant entre des morceaux de langue qui s’échappent et, enhardi par les empreintes laissées par d’autres solitudes, le chemin qu’il trace. Il décale la gravité vers l’avant, même allure, quelque chose comme une phrase creuse dans la neige un sillon qui se perd au bout du chemin, le souvenir de quelque chose plutôt que rien. Seul, bien seul, mais avec l’autre qu’il héberge, ne serait-ce que pour témoigner un instant de son existence, marcher pour qu’ils ne fassent qu’un à deux pas de l’étang, les mains croisées sur les genoux ou partout ailleurs.
J’entends soudain un bruit de pas qui froissent la neige, ce ne sont pas les miens, viennent de l’intérieur et les cloches qui se prêtent au jeu. Un pan de lumière éclaire tout ensemble, la grande peur qu’il faut surmonter, la tragédie sans laquelle notre âme prise en otage par les ambitions ne se faufilerait pas jusqu’à l’universel avec ses pattes d’oie et ses habits de semaine. Les dieux veillent dans les fourrés.
Mais qui se doute de ce que que l’on est et qui s’en préoccupe ? Je ne suis qu’une simple coïncidence au milieu du jour, avec pour seule assurance les mailles du passé et la promesse de la solitude sans laquelle l’autre ne serait qu’un leurre. Un peu à côté pour me mettre enfin au pas, c’est-à-dire marcher et renouveler l’alliance du lierre et du frêne, avec les cloches qui vont et viennent. Je lève les yeux vers le ciel sans dessus ni dessous, avec un ruisseau en contrebas, un pont et le devisement du monde, le soleil pour faire bonne figure, et tout autour la grandeur, une grandeur qui nous contient, la neige, le ciel et le meilleur.
Il a déposé les preuves passagères de son existence sur le chemin des Censières avant de tourner une page, on ne revient pas sur ses pas. Il a croisé des voix, celle de Ramuz, celles de Starobinski et de Mettra, un peu de nostalgie pourquoi ne pas le dire, nostalgie du simple, du rugueux, du bienveillant. Nostalgie du simple et de l’encore plus simple, jusqu’à ce rien d’où il conviendra de tirer un jour, peu importe, quelque chose ou bien rien.
Jean Prod’hom
Membra disjuncta

C’est en gorillant un aveugle essartant l’ombre pour gagner un peu de lumière que le poète, bras tendus vers le ciel, devint la proie de la vermine cachée dans les plis de ses pensées. On se gaussa de sa maigreur et de ses épaules nues et on l’abreuva de vin mauvais. Il écrivit alors ce vaudeville en vers, dont il ne reste que quelques éléments dispersés, rimes mièvres et rimes viles embrassées, que l’aveugle transcrivit en braille à même les murs de soutainement de la ville du premier royaume.
Il y était question du commerce de la misère, du luxe et de la brouille, du quiproquo sans fin qui anima leurs relations, de leurs possessions, de leurs ambitions. Il y était question aussi d’un bois à l’orée duquel des chiens sauvages surveillaient une vis d’Archimède au pied de laquelle poussaient des populages. Les préposés bénéficiaient de quelques avantages mais ne faisaient pas dans la gaudriole, peu de diversité à la sortie et sans portance ma foi, les petites perceptions rejoignaient de quart de tour en quart de tour l’exécré, puis les eaux usées. Le reste je l’ai oublié.
Jean Prod’hom
A.1

Tout me semble hors d’atteinte dans ce domaine, et pourtant un petit calcul suffit ce matin pour mettre à la portée de mes mains l’inconcevable durée qui maintient à distance la question des origines, ainsi la formation de la Terre il y a 6 millards d’années.
Si, sur une ligne droite, un millimètre équivaut à une année, un centimètre à 10 ans, un mètre représente mille ans. Et ainsi de suite... Un kilomètre, un million d’années. Un milliard d’années, c’est mille kilomètres, soit la distance de Lausanne à Berlin.
Le calcul est simple, le raisonnement implacable et j’y vois de plus en plus clair. L’origine se rapproche, pensez donc, trois allers et retours Lausanne-Berlin en wagon-couchette et me voici déjà dans les parages du big bang, pas si loin que ça somme tout. Mais, me retournant, j’aperçois soudain la fin du monde qui fond sur moi la gueule grand ouverte. Je tente de retrouver un semblant de réconfort en gardant à l’esprit le fait que la prochaine glaciation n’aura pas lieu avant plusieurs milliers d’années. Comptons large, disons cent mille ans... soit la distance de l’Auberge communale au banc devant l’église...
J’ai pris ce matin la ferme résolution d’user de tous mes pouvoirs pour préserver mes enfants de l’insoutenable vérité des origines et des fins en les maintenant forcloses dans les chiffres de fer des nombres.
Jean Prod’hom
avec le concours d’Histoire générale | LEP
Dimanche 12 décembre 2010

Ils régnaient sans ostentation dans l’embrasure de la fenêtre, en haut un peu à droite. Leur cou maigre et leur tronc dégarni attestaient leur origine modeste, le temps qui passe, les résistances qu’il faut opposer à ce qui advient pour aller de l’avant. Ils allaient sur l’âge, trois devant liés par le silence des grandes décisions suivis avec une confiance aveugle par un grupetto souvent désobéissant. Ce sont les premiers qui montraient la direction, libres au-dessus de la mêlée, la tête dans le ciel, d’eux que s’écoulait la lumière jusque dans la bibliothèque. Leur grandeur, leur raideur parfois, leur dignité s’offraient sans secret. Mais il était difficile de les imaginer les uns sans les autres.
Comme s’ils avaient pris le parti de la sédentariré la veille seulement, par une décision libre. Mais pour un temps seulement, prêts à reprendre une aventure à laquelle ils n’avaient pas renoncé. C’était étrange de les retrouver chaque matin à leur place, parce qu’ils semblaient la veille sur le point de vouloir continuer leur route. Je les dissuadais et le vent les faisait vaciller. Qui donc les aurait accueillis? Ils sont restés là-haut, équilibrant les jours et l’embrasure de ma fenêtre, donnant aux vieux arbres rabougris du verger un air enfantin, s’effaçaient au printemps devant l’exubérance miellée du tilleul. En octobre et novembre considéraient avec bienveillance le chant du cygne des feuillus sur les bords du Riau, leur précarité. Ils gardaient la hauteur, la distinction des sauvages, se réjouissaient en silence de tout, mais est-il bien prudent de dire tout cela ainsi?
Ils avaient dû comme les autres se lever hors la terre maigre, écarter les bras pour régner discrètement sur ce quartier des bois. Je les imaginais pourtant échappés d’une prison bien loin à l’ouest, ripés-là au terme d’une longue épopée et se retournant parfois sur leur histoire. Ils étaient montés de la plaine à la queue leu leu, surgissant un beau matin du creux de l’un des nombreux vallons dont se réjouit le Jorat, surpris par la majesté des lieux, satisfaits de la discrétion de l’accueil. Je me suis raconté tant d’histoires, tout est fini, les bûcherons ont tronçonné la petite tribu. Ça tient de si peu, tout disparaître, n’est-ce pas?
Une fois ce matin, une autre cet après-midi je suis monté à la Mussilly voir où ils se dressaient. Je n’avais jamais éprouvé le désir d’en savoir plus, la terre où ils avaient jeté l’ancre, jamais je n’avais fait le lien entre cette présence du dedans l’embrasure de la fenêtre et cette existence du dehors, juste derrière les ruches qui flamboient à la belle saison au bout du grand pré. Je ne découvre que ruines et coeurs vermoulus, vivants et fumants encore, ils n’avaient jamais fait voir la fatigue et l’usure qui les taraudaient, courageux et dignes comme les chats qui vont mourir dans le sous-bois. Ce ne sont que des histoires, l’horizon s’est aplani, le dessin a déserté le paysage. Sans eux rien n’aurait été comme avant. Je crains que les vieux arbres du verger ne se prennent trop au sérieux. A quoi désormais s’accrocher?
Les disparus 2
Jean Prod’hom
Il y a les congés payés

Il y a les congés payés
la première page de l’Arrière-Pays
les amphibologies
les oeufs à la coque
les échelles oubliées l’hiver dans les vergers
la bataille de Castelfidardo
la porte ouverte des églises quand il fait du cagnard
les essaims d’abeilles
le mètre-étalon
il y a la réglisse
Jean Prod’hom
Dos rond

Tandis que les femmes sarclaient de maigres laitues et les ombres chétives de salsifis, les hommes versaient une larme sur les plantages autrefois fertiles des planches de la fin. A dix heures on mâchait une nourriture rudimentaire, noix maigres trempées dans un sirop d’aubergine et on échangeait quelques vaines paroles pour faire taire les peines. Les sieurs les plus affamés marchaient sur les mains pour quelques sous, collectés et consacrés aux efforts de guerre et à la restauration des cultes. Une telle exigence paritaire comblait la conscience indolente des insulaires. Ruinées les petites échoppes du centre-ville nées du commerce de la pauvreté, seuls les porteurs d’eau capitalisaient certains avantages en échangeant huiles essentielles et tranches de foie rances contre générateurs d’autorité et secrets d’embryons. On perdit de vue l’endroit et on se consacra tout entier à l’envers.
Jean Prod’hom
Prophétie

Et le nombre sacré apparaîtra en toute chose, en tout lieu et à tout instant.
Et le nombre 807 nous débarrassera de l'inconscient.
Et le monde redeviendra comme au commencement.
Jean Prod’hom
11 décembre 2010
Mise à ban

Cʼest une poignée de ruines qui serrent les coudes à lʼécart de la grandʼ route où frémissent des couronnes de chardons, les oiseaux lâchés dans la campagne ne sʼy attardent guère. Le gros des souvenirs a rejoint depuis longtemps le silence des albums, le temps avance au ralenti. Un inconnu traverse la cour, les yeux fixés sur le mélange de terre et de gravier dont son visage a gardé lʼempreinte. Pas de grandiloquence chez lʼhomme, ni regrets ni hâte, pas de pire non plus dans des lieux livrés autrefois au travail, à la douleur, aux plaisirs. Mais qui donc sʼen souvient ? La fin va son bonhomme de chemin. Lʼinconnu avance délivré de rien, ouvert à tout, loin de la providence et des bonnes manières. Il a renoncé aux vaines entreprises, la sueur ne goutte plus dans la poussière de la cour que le silence serre aujourdʼhui de toutes parts. Au milieu des ruines sʼest établi lʼabandon.
Il y a dans ce corps qui nous lâchera un jour, à lʼécart, un lieu où patientent les images de ce qui fut. Il y a dans la tête, dans le coeur, ailleurs peut-être, des images vivantes que rien ne menace, indemnes comme les bris de verre. Elles sʼéloignent sans jamais disparaître, rien nʼen sort ni ne sʼy ajoute, elles tremblent comme la chevelure des linaigrettes. Loin de la disgrâce.

Photo / Michel Brosseau
Barbelés sectionnés, fers tordus et bancs de rouille, les barreaux se font rideaux. Les tôles battent de lʼaile, les portes défoncées bâillent, le vent fait grincer le portail par lequel entre et sort le temps gagné et le temps perdu. Les pillards ne sont quʼun vieux souvenir, personne ne songe plus à y entrer. Le portail fermé par un triple collier de chaînes sʼouvre majestueusement sur rien. Ni sursis ni restauration, une pente à peine, les fruits de lʼéglantier, des herbes sèches, quelques simples dans des pots de terre cuite sur le rebord des fenêtres. Tout peut encore attendre.
Ce nʼest quʼune image à lʼarrière de la tête, yeux mis-clos, ou ailleurs peut-être, nourrie par le silence qui pousse depuis dessous et les itinéraires de la mémoire. Nul besoin de gouvernail ni dʼétrier, lʼimage va de son pas à la manière des disparus dans un bouquet de friches. Ce nʼest quʼune image, lʼimage dʼun temple clos ouvert à tous vents que font vivre le lierre et la mauvaise herbe, une image pour ôter les peurs, celles du labyrinthe et du temps qui passe. Lʼusure remue lʼinusable fin des choses, bris de faïence, fenêtres borgnes, cheminées et briques muettes. Les vieux crépis en attestent, les morts ne se réveillent pas.
Lʼhomme est né dans lʼabandon, y retourne allégé lorsquʼil se débarrasse de ce quʼil croyait être ses biens, sʼy retrouve comme il y fut, sans peine et sans consolation, ici où les feuilles dansent, ou là où lʼaccidentel improvise. Tout y est en lʼétat, un peu passé, éclairé par les brillants dʼune négligence heureuse.
Jʼincline désormais vers lʼavenir de ce qui nʼen a pas, car tout finit pas arriver, la fin aussi, bien avant que la phrase ne se termine, sʼarrondisse avant quʼelle ne sʼéloigne et que je mʼy abandonne.
Lʼoeuvre toujours déjà en ruine, cʼest par la révérence, par ce qui la prolonge, la maintient, la consacre (lʼidolâtrie propre à un nom), quʼelle se fige ou sʼajoute aux bonnes oeuvres de la culture. (Maurice Blanchot)
Publié le 3 décembre 2010 dans le cadre du projet de vases communicants chez Michel Brosseau (à chat perché).
Jean Prod’hom
Il y a les chats

Il y a les chats qui boutiquent la nuit
la winchester 73
il y a les vêpres à l’abbaye de Hauterive
la déclaration des droits de l’homme
il y a le corps brûlant de l’endormie au milieu de la nuit
les bandes velcro
il y a les monuments au mort
le modus tollens
il y a le système automatique de fermeture des portes
Jean Prod’hom
Dimanche 5 décembre 2010

C’est en 1994 que le plan d’affectation du Rôtillon – avec ses quatre îlots homogènes – a été accepté par le Conseil communal de la ville de Lausanne. Ont suivi quinze belles années de controverses, de fouilles et de plans, une espèce de sursis, on pouvait rêver. Il avait été prévu qu’on bâtisse un «miniplex» de salles de cinéma, un centre de vie enfantine et des logements, un bâtiment destiné à l’accueil de jour et à l’hébergement de personnes souffrant de maladies psychiatriques. C’est fait pour le parking mais on a renoncé aux salles de cinéma, en échange on leur a fourni la vidéosurveillance. Il y aussi un salon de coiffure et une boutique de mode, une de ces institutions de réhabilitation psychosociale dont on a tant besoin, une crèche, une régie immobilière, des surfaces commerciales et quelques appartements, tout porte à croire qu’on ne va pas faire la fête tous les soirs au Rôtillon. Ah si, on a ouvert un restaurant, le Double Z sur les bords de l’îlot C, car ce soir le parking tout illuminé est en gloire, un tractopelle à ses côtés, le godet à terre, pas pressé de creuser le dernier îlot sur lesquel la nuit descend, pensez donc, depuis le temps.
On ne reverra pas le Flon couler de sitôt, enterré le passé industriel, oubliés les talus en friche, adieu les grandes tannées, le Café des Artisans, les squats et les prostituées.
Qui place sur les devantures de nos librairies les amers de notre irresponsabilité? Natura maxima, L’Encyclopédie du chocolat, 365 Etincelles, Montagnes sacrées, Switzerland the World, Le Coeur en paix, Drôles de labradors, La Recherche du paradis, L’Herbier essentiel. Qu’on leur fasse la peau.
Aïe, quelque chose m’a piqué le coeur, et une poussière m’est entrée dans l’oeil. Les rosiers poussent de travers et les roses sont laides. C’est comme si le diable avait fabriqué un miroir qui ne montrait que les âmes grises. Un seul établissement public est ouvert, à l’extrémité de la Rue de l’Ale, en face d’une boutique qui brade ses fonds, le restaurant du Cygne. C’en est trop. La nuit serre ses mâchoires sur une ville en liquidation. Je me hâte d’aller récupérer Sandra, Arthur, Louise et Lili à la sortie du Petit Théâtre. La Reine des Neiges les a ravis. A mon tour de les emmener à la maison. Tiens, le soleil est revenu.
Jean Prod’hom
Séparatif

La question des eaux usées eut le double effet de jeter le discrédit sur l’hygiène du grand nombre et d’instiller le doute sur les écoulements vétustes qui avaient conduit le coeur du petit palais et la cour des grands à l’inondation. On nota avec dégoût le retour massif des cris et des peines sur les chemins sans drainage. Il eût fallu de l’à propos et quelque directive, et qu’on s’y arrêtât, mais trop de raison nuit. Chacun surveillait son voisin, disparues les petites intentions enterrées à l’intérieur de soi, les ordures déversées dans le clos du voisin et la haine crasse dès le lever du soleil. On décida donc de couper dans le vif, mais il s’avéra inutile d’utiliser la force ou la main de son voisin pour laver l’honneur, balayer les contestations et soigner les apparences. On sous-traita l’entreprise. C’est en face du temple que quelques scrivaillons se fendirent d’une méthode au goût douteux pour garantir la place de chacun. Ils conçurent le premier algorithme qui permit de séparer la grâce du cambouis. Au grand nombre la variole et la rage, les coups de soleil et les panaris. Aux bien nés le bon goût et l’insouciance, la chaise longue et les lieux d’aisance. On escamota les échafaudages de ce procédé littéraire, personne ne dit rien. Cette méthode prit plus tard le nom pompeux de dichotomie.
Jean Prod’hom
Complément à l'œuvre de René Girard

La petite ville de Gstaad peut passer pour l’une des plus jolies des Préalpes occidentales. Il y fut précepteur dans les années soixante-dix. Un couple de Portugais catholiques et dociles assurait alors l’essentiel du train de vie d’une riche famille polonaise dans un chalet de maître situé entre la Lauenenstrasse et la Rotlistrasse : elle cuisinait, blanchissait le linge et tapottait les traversins ; il faisait les courses, endossait le gilet de Nestor et ripolinait chaque matin le véhicule qui menait la maîtresse de maison au Palace dans les salons duquel elle s’adonnait au bridge. Et puis il y avait l'Autrichienne, jeune nurse bien faite ma foi qui s’ennuyait un peu, lui aussi si bien que leurs liens se resserrèrent. La première semaine ne fut pas achevée que le précepteur se retrouva prisonnier du chalet à des heures qui dépassent les convenances. Il lui fallut donc sortir coûte que coûte avant le réveil de la maisonnée. L’Autrichienne le conduisit par la main sur le balcon en lui murmurant les milles folies qui réchauffent nos hivers. Mais pas d’échelle et deux étages à vaincre, ... fermez les yeux c’est fait. Ne voyez-vous pas l’amoureux qui s’éloigne dans la nuit ?
J’ai lu que le X-Seed 4 000 culminerait à 4 000 mètres et regarderait dans les yeux le mont Fuji. Un peu de haut puisqu’il le dépasserait de plus de 200 mètres. Il serait ancré dans l'océan au large de Tokyo et abriterait plus d’un million de personnes. Il compterait, dit-on, 807 étages.
Julien mon frère, que serions-nous devenus si ta Mathilde et mon Autrichienne avaient eu l’invraisemblable idée d'être de ce siècle ?
Jean Prod’hom
25 novembre 2010
C'était l'été | Michel Brosseau

Photo / JP
C’était l’été. Deux mois de vacances à passer le long d’une nationale. La 160, elle s’appelait. Une avenue maintenant. Avec zone commerciale et tout un tas de ronds-points. Finie la longue ligne droite pour sortir de la ville. Maintenant c’est par là qu’on y entre. À ça aussi, il faudra s’y atteler. Dans quelque temps. Quand un peu plus costaud pour aller creuser paysage et mémoire. Ce qui de strates sous les parkings des magasins. De soi et des autres. Des lieux qu’on quitte et des ciels qui vous poursuivent. C’était l’été. Et rien à faire sinon tourner en rond dans un jardin. C’est terrible un jardin. Même immense vous tombez toujours sur la clôture. Et quand celle-ci est nationale… Des paquets de voitures qui défilaient là. Ça descendait de partout jusqu’à la côte. Des banlieusards, des gars du Nord. Et puis de Tours, Orléans… De là où j’écris ces lignes aujourd’hui. Deux mois de vacances et une station-service pour voisine. Un oncle maternel qui la tenait. Une idée de la grand-mère. Au temps des premières bascules. Quand les bagnoles en masse et que déjà vendre le lait des vaches ne rapportait plus grand-chose. Du temps où c’était « à l’américaine » qu’il fallait vivre. Commencer à. Pompistes à casquettes avec logo de la marque. Ici, aux marches de l’Anjou et de la Vendée comme au fin fond de l’Arizona. Gamin, le plaisir que c’était de se déguiser avec. Taillée comme celle de La Fureur de vivre ou à peu près. Mais ça, c’est bien après qu’on l’a découvert. Quand enfin la nationale invitait à mettre les bouts. Bien plus tard. Bien après ces étés à jouer les grouillots sur la piste de ciment gris. Gratter les pare-brises. Faire la pression des pneus. Repeindre les bordures en blanc. Et puis des pleins et des pleins. Expliquer la route aussi. Pour Saint-Jean de Monts, c’était facile. Au premier feu rouge à droite. Après la casse automobile, juste sur la droite, c’était la vieille route du May. Celle-là, il fallait pas la prendre. Au feu rouge seulement, à droite !... Noirmoutier qu’était indiqué. Pourquoi pas Saint-Jean-de-Monts, ça moi j’en savais rien. De toute façon, à l’époque, la mer qu’était à une centaine de bornes de là, je l’avais vue quoi ? Deux, trois fois… Et encore, pour le Mont-Saint-Michel, j’avais été malade comme un chien. Une drôle de première fois. Et pour la mer et pour le restau. J’étais resté à l’arrière de la D.S. pendant que les grands étaient allés manger. À me reposer et grignoter des « paillettes d’or ». Des gâteaux tout légers qui passaient tout seuls… Dommage ! Parce que tout était bon, apparemment. À part peut-être les haricots. Jamais aussi tendres que ceux du jardin. Et puis les fils… Mais tout ça avait peu d’importance. Ce qui comptait pour moi à ce moment-là, c’était les dos d’âne et puis la suspension hydraulique. Et que le tonton, il avait le pied un peu lourd. Comme presque tous les mécanos à ce qu’on disait. Une bagnole, fallait qu’elle montre ce qu’elle avait dans le ventre… Qu’elle marche ou qu’elle dise pourquoi… C’était l’été, et les bagnoles défilaient sur la piste. Coffres chargés ras la gueule. Et accrochées derrière des caravanes. Elles qui me sont revenues en regardant cette caravane noyée dans le végétal. Et puis en tirant le fil. Lequel, des mots ou du souvenir, ne me demandez pas. C’est là et ça suffit. Matériau disponible et tout ce qui s’y rattache. Le temps de faire le plein, les femmes allaient jeter un œil dans les caravanes. Allaient y chercher une bricole, ou en ramenaient une. Les hommes, eux, tiraient sur l’attelage. Réajustaient le fil de la prise. Donnaient un ou deux coups de pied dans les pneus. « Et d’ici, pour aller aux Sables-d’Olonne… » Dans ces cas-là, j’appelais le tonton. « Ils voudraient aller aux Sables !... » Nous, on disait Saint-Jean, Les Sables… Les mots, à défaut des lieux, nous étaient familiers. Les Sables !... Certes pas le bout du monde, mais c’était avant qu’il aurait fallu tourner avant. Le boulevard périphérique qu’il aurait fallu prendre… À une centaine de mètres avant la station. Même si, pour les Sables, ils auraient aussi pu filer tout droit. Mais en théorie seulement ! Parce que traverser la ville avec ce qu’ils avaient au cul… Non, le mieux c’était de faire demi-tour. Une ligne blanche au milieu de la nationale, mais on avait le droit quand même. Si on regardait bien, on voyait qu’elle était pas tout à fait continue. Les gars de l’équipement ils avaient fait exprès de peindre comme une espèce de pointillés. Pas un vrai pointillé, mais pas non plus une vraie ligne continue. Comme quoi, en discutant autour d’un godet, on obtient plus qu’en allant remplir de la paperasse… Si ça circulait trop, le tonton se mettait en travers de la route en écartant les bras. Gendarme amateur. Une fois les bagnoles arrêtées, il faisait des grands signes pour qu’il passe vite fait, l’autre, avec sa caravane. « Allez, allez !... » Par pitié qu’il faisait ça. Parce que c’était quand même drôlement malheureux de voir des gars qui s’embarquaient sur des distances comme ça sans mieux savoir manœuvrer. Faut dire qu’on était bien placés pour voir ce que ça donnait tous ces gars qui conduisaient jamais autant que l’été. Il était allé en chercher combien le tonton avec la dépanneuse ? De ces gens de passage qu’avaient raté le panneau qu’indiquait Les Sables. Faut dire aussi que c’était mal foutu. La Roche, qu’ils avaient été mettre sur leur panneau. Pas Les Sables, La Roche-sur-Yon. Même si, en principe, quand tu pars comme ça, tu te notes toutes tes étapes sur un bout de papier et t’es tranquille. Mais non ! Tellement pressés de partir, tu penses ! Faut dire qu’on serait p’t’être pareils à vivre dans des appartements, machin… Toujours est-il qu’y en a combien qui se sont emmanchés d’aller faire demi tour pour récupérer le boulevard périphérique ? Et vas-y que je te tourne au beau moment où y en a un autre qui déboule ! Ah ! ça pardonne pas… Choc latéral, comme ils disent aux assurances. Et encore quand c’est que de la tôle… Mais t’en as qu’emmanchent drôlement dans la ligne droite… Alors là, j’te dis pas !... Le tonton, il remorquait les épaves jusqu’à la station. C’était pas la place qui manquait. Elles restaient là un bout de temps, en attendant que les experts viennent faire leur boulot. Je traînais autour quand il y avait pas trop de clients. Je jetais un œil dans les voitures. Des jouets des fois sur la banquette arrière. Parmi tout un tas d’objets en vrac. Et l’intérieur des caravanes éventrées… Ça faisait de quoi méditer tous ces chez soi fragiles. Ces destins en suspens. Peut-être ça que j’apprenais autour des caravanes. Que rien n’est aussi permanent qu’il n’y paraît. Ça et puis la mort. Cette façon qu’elle a d’être là sans avoir à se montrer.
Michel Brosseau

écrit par Michel Brosseau qui m’accueille chez lui sur son site à chat perché dans le cadre du projet de vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.
Et d’autres vases communicants ce mois :
![]() Daniel Bourrion et Urbain trop urbain
Daniel Bourrion et Urbain trop urbain![]() François Bon et Michel Volkovitch
François Bon et Michel Volkovitch![]() Christine Jeanney et Kouki Rossi
Christine Jeanney et Kouki Rossi![]() Anthony Poiraudeau et Clara Lamireau
Anthony Poiraudeau et Clara Lamireau![]() Samuel Dixneuf-Mocozet et Jérémie Szpirzglas
Samuel Dixneuf-Mocozet et Jérémie Szpirzglas![]() Lambert Savigneux et Silence
Lambert Savigneux et Silence![]() Olivier Guéry et Joachim Séné
Olivier Guéry et Joachim Séné![]() Maryse Hache et Cécile Portier
Maryse Hache et Cécile Portier![]() Anita Navarrete Berbel et Landry Jutier
Anita Navarrete Berbel et Landry Jutier![]() Anne Savelli et Piero Cohen-Hadria
Anne Savelli et Piero Cohen-Hadria![]() Feuilly et Bertrand Redonnet
Feuilly et Bertrand Redonnet![]() Arnaud Maïsetti et KMS
Arnaud Maïsetti et KMS![]() Starsky et Random Songs
Starsky et Random Songs![]() Laure Morali et Michèle Dujardin
Laure Morali et Michèle Dujardin![]() Florence Trocmé et Laurent Margantin
Florence Trocmé et Laurent Margantin![]() Isabelle Buterlin et Jean Yves Fick
Isabelle Buterlin et Jean Yves Fick![]() Barbara Albeck et Jean
Barbara Albeck et Jean![]() Kathie Durand et Nolwenn Euzen
Kathie Durand et Nolwenn Euzen![]() Juliette Mezenc et Loran Bart
Juliette Mezenc et Loran Bart![]() Shot by both sides et Playlist Society
Shot by both sides et Playlist Society![]() Gilles Bertin et Brigitte Célérier
Gilles Bertin et Brigitte Célérier![]() Michel Brosseau et Jean Prod'hom
Michel Brosseau et Jean Prod'hom
Jean Prod’hom
Dimanche 28 novembre 2010

Deux roses rouges ourlées de papier crêpe et coiffées d’un peu de blanc baissent la tête, elles avaient ce matin encore les lèvres bleues. Elles vont aller ainsi jusqu’à la fin de l’hiver, la vieille ne descend plus dans son jardin. Au fond des poches une douzaine de cacahuètes, une poignée de son et quatre mandarines, c’est comme un souvenir, une traînée plutôt, une traînée restée en arrière qui passerait subitement en coup de vent sur le chemin glissant.
Personne entre le Riau et la Goille. Il faut brasser la neige qui remonte jusqu’au ciel, on a beau avoir les yeux grand ouverts, on ne voit rien, ivresse sans vin. Les entailles dans la terre se croisent en tous sens, comme dans le ciel ou dans la neige, mais ne disparaissent pas. A l’Ecorcheboeuf un enfant crie à cause du froid. A quelques pas de lui ses parents pèlent la neige.
Au fond de la combe, le chemin du Creux exécute deux demi-boucles avant de franchir la Bressonnaz et rejoindre le Moulin. Et puis après? Je reviens sur mes pas, dans les parages de Photolabo où tous les jours sont dimanches depuis plusieurs années déjà, l’usine est à vendre : on y développait de la pellicule photos et on y réalisait des tirages papiers. Et puis après après ?
On a chauffé l’église de Mézière la veille déjà, si bien que nous ne sommes pas mécontents d’y entrer lorsqu’elle ouvre ses portes à 16 heures. Elle accueille aujourd’hui les élèves de l’Atelier de Musique, les enseignants, une organiste et les parents, les amis et quelques bénévoles. Le sacré prend un sacré coup de vieux et des allures enfantines : on sourit, on fait les choses à moitié, on saute, parle sans contrition, on se trompe, on recommence, c’est un peu carnaval : des ours jouent du violoncelle, le lait condensé s’écoule des flûtes en do, les flûtes en la font les institutrices, quant à la présidente elle a quelque chose de Jane Birkin. Derrière le coeur le crucifié ne voit rien, il a la tête dans les nuages.
L’organiste qui a ouvert la fête par la Sinfonia de J-S. Bach la clôt par la fugue en do mineur de Mendelssohn. J’aurais bien voulu demeurer un instant encore au chaud dans cette grande pharmacie repeinte aux couleurs des fêtes foraines, auxquelles me font immanquablement penser les trompette héroïques des orgues. Mais la maîtresse de cérémonie en a décidé autrement, elle remercie tout le monde, tout le monde sourit et Lili rit.
Jean Prod’hom
Il y a les châteaux de sable

Il y a les châteaux de sable
les écrous
il y a le vide dans les bibliothèques
les conducteurs de scooter
les structures élémentaires de la parenté
il y a la restauration des cathédrales
les requiems
les bouquetins du Creux du Van lorsqu’ils regardent la vallée des Ponts
il y a l’aubépine
Jean Prod’hom
La mort en ce jardin

Adossé à un muret de pierres sèches, le soldat au gilet vert songe aux façades du front de mer, aux mots salés de la femme au fardeau, il se souvient des volailles qui couvaient dans les dunes, la volonté sèche des enfants ne désarmait pas. A midi, pour peu qu’une bonne âme eût recueilli un peu d’ombre, les pâles fleurs des dunes baissaient les yeux; c’est seulement plus tard, à l’annonce de la nuit, qu’elles relevaient la tête pour une courte conversation. Saviez-vous qu’une seule courroie suffisait à faire tenir le tout ?
Ce soir le soldat désespère de l’ordre fébrile. Plus d’éclairage aux carrefours, c’est le même défi lugubre pour tous. Tandis que la langue du volcan frôle sa nuque, il s’agenouille, récite quelques strophes du grand poème de la cohésion avant de rejoindre la tête d’un cortège immobile, le regard tourné vers d’autres rivages.
Trop tard. On n’entend plus les cris des enfants derrière les dunes, on ne compte plus les fondrières, à peine quelques reflets dans le miroir de l’océan qui s’éloigne.
Jean Prod’hom
LXXXI

Demain, dernier vendredi de la journée. Grosse, très grosse fatigue. Avance ce soir dos au mur et reviens par les plates-bandes. Trop travaillé. Crains désormais de ne plus être en mesure de rattraper l’avance prise avant minuit. Mal pris.
Jean Prod’hom
Il y a les allocations familiales

Il y a les allocations familiales
les zones vertes
l’infaillibilité papale
il y a le chocolat chaud
les sentiers de moyenne montagne
Il y a Blaise Cendrars
la double crème
les sept jours de la semaine
il y a les fruits de l’églantier
Jean Prod’hom
Dimanche 21 novembre 2010

Le brouillard a tiré les rideaux et éteint les lumières bien avant qu’on ne se lève. Les bonnes volontés du dehors mises hors jeu, il a bien fallu faire avec et on a joué le nôtre à l’intérieur, à la lueur des réverbères. Les travaux de peinture allaient bon train mais on n’en menait pas large dans le long couloir repeint aux couleurs de l’hiver. Et lorsque le brouillard a fini par trouver les ouvertures de la vieille maison, s’est faufilé dans ses replis jusqu’à occuper la chambre des enfants, il a bien fallu qu’on songe à une issue.
Sortir donc, retrouver la brouille et se rendre compte que l’âme vit très bien sans corps dans un monde éteint : elle entend distinctement l’eau de la fontaine lorsqu’elle fait le dos rond, les chats s’affairent, dernières emplettes avant l’hiver, on les devine, la terre est noire, les taupes la retournent avant le gel.
Dans le vent on va tous les yeux fermés, je le sais, mais lorsque le visage prend les devants, ils y voient bien plus clair que ce qu’on croit. A tel point que je songeai, assis sur le banc de la Mussilly, qu’il ne serait pas si simple de me lever et continuer. J’hésitai plus d’une fois, le pâturage dépassait de dedans la terre comme une baleine dont on voit l’échine soulever l’océan, à mes pieds une bille de foyard aux flancs d’argent.
Mais le souvenir des sourires des enfants en a décidé autrement. J’ai laissé derrière moi la fraîcheur, deux bandes de vert et poussé devant moi un petit regret, celui de ne pas avoir su prolonger mon séjour dans la fraîcheur. C’est elle pourtant qui a éclairé le chemin du retour, celui qui conduit à d’autres saisons.
Jean Prod’hom
Elan brisé

Une fève
en un point de l’étendue
une fève multipliée dix fois
cent fois mille fois
une fève jetée loin de la tribu
une fève oubliée
le silence d’Oswald Sprenger
à ce sujet
en dit long
qui a glissé
derrière le décor
le fait incontesté
Oswald n’a pas hésité à se taire
ne rien dire
de cette route si singulière
qui a conduit
l’île
de la grandeur à la décadence
il a chanté
dans de longs poèmes restés secrets
les fruits du sorbier et ceux de l’églantier
les pensées raffinées et les regards pétrifiés
qui jettera les gants
hors les poches de l’amertume
pour dire un peu de vérité
pas tant que ça
un peu
un peu seulement
le tarissement des sourires
la rupture de la ligne d’horizon
les prodiges de la pensée
un instant
ont éloigné
la douleur
les doutes
mais la sève
d’un peuple épuisé
couvert de fleurs
qu’on sèche à la veillée
sèche et s’épuise
en peu de temps
Jean Prod’hom
Vendredi 15 octobre 2010

Là-bas, à 800 mètres sous terre, 200 invités triés sur le volet sabrent le champagne, le dernier pan de rocher est vaincu. Aujourd'hui une merveille industrielle est née au coeur du Massif du Gothard : 57 kilomètres d’un tunnel nouant solidement le sud avec le nord.
Là-haut, à la verticale du puits d'accès, un mineur prie les yeux tournés vers le ciel. Il a placé 7 mètres plus haut, dans la voûte de l’église de Sedrun, 50 kilos d’explosifs. Il veut honorer ainsi ses 9 amis morts pendant les travaux et nouer le bas avec le haut.
Lorsque tout sera oublié je reviendrai à Sedrun.
Jean Prod’hom
1 novembre 2010
Il y a les fumées bleues

Il y a les fumées bleues
la parturition
la Grande Peur dans la montagne
il y a les missions franciscaines
il y a les structures dissipatives
les fraises des bois
les jours fériés
le code pénal
il y a les tourbières
Jean Prod’hom
LXXX

On raconte que les charges des entreprises croissent avec l'augmentation de la production. Que dire alors de ces cafés bondés jusqu'à la gueule dont les propriétaires coupent le chauffage? Supprimons l’impôt sur la fortune et taxons avec plus de sérieux ces petites entreprises qui transgressent les lois de la production.
Jean Prod’hom
Dimanche 14 novembre 2010

Dans les prés maigres de la Grand Vy, quelques bouquetins et leurs petits broutent l’herbe de novembre. Des pancartes les ont avertis des dangers, mais l’ancienne décision de faire du Creux du Van une réserve naturelle ne les empêche pas aujourd’hui de rester sur leur garde. Les bouquetins ont une bonne mémoire. C’est en 1857 que David Robert, le propriétaire de la ferme du Creux, a liquidé le dernier ours de la région.
Ils sont une petite dizaine, comme nous. Vont et viennent comme nous, sans mors ni longe, mais ils vivent nus et sans un sou. Un petit franchit le mur de pierres sèches, les autres suivent, le vieux ferme la marche. Et tandis qu’on reste plantés-là, le troupeau s’éloigne à petits pas serrés sur la ligne d’horizon tendue entre le Tiltlis et le Mont-Blanc. Nous sommes plus inquiets qu’eux pour la nuit qui vient.
La ligne brisée des Alpes accapare notre attention un instant à cause de sa démesure, à cause de tant de regards hébétés qui s’y sont alignés. C’est de l’autre côté que règne le simple, sans gouffre ni sublime, à notre mesure, écrit pour l’étranger comme pour ceux du crû. Thomasset s’assure que le monde est bien en place, c’est dimanche, il cherche à voix basse l’or déposé dont les récits ne parlent pas.
La vallée des Ponts est un morceau du tendre haut perché qui déploie ses ailes comme une chauve-souris pour virer au-dessus de la vallée de l’Areuse. Pâturages vert pâle que tire à l‘est – et resserre – le col de Boinod. Tout autour les sapins noirs du Jura. Vallée sans ride, à peine marquée par le Bied qui prend sa source dans la Combe des Quignets. Le ruisseau recueille sans faire de vagues les eaux des tourbières avant de se perdre dix kilomètres plus loin dans l’entonnoir du Voisinage près des Ponts-de-Martel et mêler ses eaux noires, 300 mètres plus bas, aux eaux de la Noiraigue. Hors tout, un jardin suspendu.
Jean Prod’hom
Purification

Un affamé
à l’étoffe de plongeur
fouillait les fontaines
remontait les causes perdues
pour quelques sous
petite fortune
habits bon marché
quignon de pain
les forces de l'ordre l'accostent
la violence des coups lui ouvre
la mort dans le jardin
coeur scellé
avec quelques souvenirs
à côté du rucher
répartie de l'un des pandores
le plus poète des deux
à chacun sa charge précaire
Jean Prod’hom
Sublime élégance

Celui qui nous a quittés a invité 806 de ses admirateurs à l'accompagner au Père Lachaise.
Dernier coup de génie du bonhomme.
Il faut compter avec les morts.
Jean Prod’hom
1 novembre 2010
Il y a les réduits au fond des couloirs

Il y a les réduits au fond des couloirs
le protocole
le tram 9 lorsqu'il franchit l'Aar
les enclumes
les pommes dans lesquelles on croque
il y a l’indépendance d’esprit
les cartes au 1: 25000
il y a les questions posées à voix basse
les taies d’oreiller
Jean Prod’hom
LXXIX

Le sens du mot procrastination? n'en sais fichtre rien; je ne vois d’ailleurs aucune raison significative de m’en préoccuper aujourd’hui. Quant au sens du mot sérendipidité, je ne vous dis pas le nombre de fois que je l’ai cherché dans le dictionnaire : jamais trouvé. Mais je suis tombé à chacune de ces occasions sur d'autre mots, d'autres choses et je m’en réjouis.
Jean Prod’hom
Marabouts

Une quinte floche de magiciens désoeuvrés conçurent l’épouvante, la firent courir un matin de novembre de main en main : quelques jours suffirent pour faire d’une coque de noix un puits sans fond. C’est qu’on n’y voyait rien dans l’éprouvette, le soleil brûlait plus que de raison et les nuits raccourcissaient. Quelques illuminés sonnèrent l’alarme, rien n’y fit, les volontés s’écroulèrent, les insulaires se mirent à barboter dans les eaux troubles de la démence tandis que l’envie aveugle rongeait les dunes. Le roi enragea lorsqu’il vit ses fidèles lieutenants noyer leur peur dans le vin du désert, ils finirent comme il se doit à l’extrémité d’une corde, de l’eau morte dans les poches, aucun acolyte pour les sortir de là. N’y allez pas, une odeur de pourriture fleure derrière les roseaux et gagne à sa cause, jour après jour, l’iode de l’océan.
Les insulaires fêtèrent aigre la fin de l’épisode. Mains sur les genoux, instruments à terre, les musiciens tiraient de leurs arrière-pensées et du claquement de leurs doigts des hymnes nauséeux, rugissements de gorges, gongs fêlés, renvois acides. Les jours suivants, on évita soigneusement de faire la lumière sur les agissements des responsables si bien que l’épouvante ne quitta pas l’île et asphyxia les jeunes pousses de l’altérité. Les épines-vinettes envahirent la côte est, mêlées aux cirses, aux orties et à de minuscules désespoirs à fleurs lilas qui marcottaient les talus. Le vent d’est inondait la côte ouest de vapeurs saumâtres. Impossible de prendre une autre direction, de se lever même, car l’histoire s’affaisse lorsque les mots d’amour sont réduits à presque rien et qu’on arrose le jardin noir des magiciens.
Jean Prod’hom
Ecoles à Berne

En début de novembre 2010, la classe de 11VSB a eu l’occasion de passer une semaine au coeur de la ville fédérale, dans le cadre du projet Ecoles à Berne. Le but de cette association est de sensibiliser les jeunes à la politique afin qu’ils deviennent des citoyens actifs dans notre démocratie….
(la suite, c’est ici : ECOLES A BERNE-2010
Dimanche 7 novembre 2010

Personne au rendez-vous, pas l’ombre d’une foule au coeur de laquelle il était si réconfortant autrefois de mêler sa voix, aucune tâche, des promesses oubliées et des échos lointains. Les hommes se sont tus, le grand récit qui tient ensemble nos jours est allé de son côté avec la discrétion de la chouette au crépuscule. Lourd dans le matin gris, à côté de tout à côté de rien, sans la hauteur de vue des galets dans le lit du ruisseau sec, l’abandon des bris de roue du vieux moulin, la patience du désert.
Il serait déraisonnable d’user de la force – contre qui ? – , de se détourner – pour aller où ? –, tout au plus espérer un signe – mais qui y consentirait ? Alors on rêve, on rêve avec les dents : quelque chose glissera et roulera sur le chemin, on se penchera et on reviendra sur terre.
Soudain se lève un chant d’autrefois, sacré et familier, que nul n’a jamais compris, venu du fond de la nuit, mots cachés, mots ressassés depuis une éternité. Le chant vient par-dessous l’espace de plomb, le soulève et dans les plis de cette rengaine se fait entendre le silence, le silence qui pousse hors de lui le condamné avant de le déposer sur l’autre rive.
L’avenir est incertain mais l’horizon a les bras larges. Tandis que la nuit vient, le prisonnier navigue un instant vent arrière, dans les rebords du temps, un peu plus libre, avec à côté la foule anonyme et souriante des morts et des vivants.
Jean Prod’hom
Dans la collection bleue

A Franck Garot
Il y a le merveilleux
il y a l’irréfutable
il y a les divagations de l’esprit
les asiles psychiatriques
les grains de sable
les larmes qui ne servent à rien
il y a la programmation
l’agitation des poissons hors de l’eau
il y a l’ironie qui blesse
les biotopes
un Airbus dans le ciel du Pakistan
il y a ce qu’on ne comprend pas
les faveurs des puissants
il y a l’apostasie
la haine féroce
il y a quelques Peugeot
il y a le flou figural
une pelouse
il y a les vieillards mourants
l’horlogerie fine
la violence des vagues
les portes fermées du ciel
les tueurs en série
il y a les alcools forts
il y a le boulevard du Maréchal-Leclerc
il y a les stages de formation continue
il y a les amis
il y a les sept nains
le forfait des clepsydres
les coïncidences
il y a la mémoire qui flanche
les lourdes symétries
il y a les pneus dégonflés
ta langue dans ma bouche
les marguerites et les pâquerettes
il y a le fair-play
il y a la réticence
il y a les tard-venus
le temps d’avant la disparition de l’homme
il y a les cours de recyclage
l'ancien sigle d’un commerce de produits alimentaires
il y a la bise
les nuits d’amour
il y a l’expérience
il y a ceux qui cherchent du travail
il y a le calvados
il y a les carrefours
il y a les lieux auxquels on s’attache
l’allure des nombres
le régime sans sel
les bas de page
il y a les pépins en série
son numéro de téléphone
il y a l’argent jeté par les fenêtres
les mille-feuilles
le jaune
il y a les baies vitrées
le jeu des chaises musicales
il y a ce qui n’en finit pas de mourir
les urgentistes
il y a les restes de la vaisselle du monde
il y a les personnages secondaires
les élans mystiques
il y a les décisions qu’il faut prendre
les blagues qui tombent mal
les deux mots qu’on ne dit pas
les fins de série
il y a les sucettes à l’anis
il y a les galets plats hors de l’eau
il y a les préliminaires
il y a la face du monde qui aurait pu changer
il y a les nuits trop courtes
les retardataires
les œufs
les déménagements
il y a le pain sur la planche
les limites à la patience
il y a le lascar qui louche
le prix Nobel
les ronds dans l’eau
il y a le voyage autour de sa chambre
les ruses de la raison
il y a les frères et les sœurs
l’Arc de Triomphe
les réminiscences de choses idiotes
il y a les spectacles qui ne valent rien
les fuseaux horaires
il y a le cagnard
il y a l’ombre de la victoire de Samothrace
les corbeaux solitaires
il y a des types formidables
les cimetières
les sottes recommandations
la légende
il y a Lausanne
il y la convoitise
il y a le ciment à prise à rapide
il y a le fruit du hasard
il y le visage de Samuel Beckett
les injections létales
le premier café
le marchand de viande
il y a la bienveillance
les listes interminables
il y a la double digestion
le sacre de Charlemagne
le néant
il y a les pièges de la concision
le béton
il y a les recherches sur Google
les yeux grand ouverts dans la nuit
il y a les journées d’études
il y a les points à la ligne
l’assentiment
il y a les matches de boxe
les croissants frais sur le zinc
les pandémies
les condamnations
il y a les têtes des Jivaro
il y a les chiens lâchés
il y a les droits qu’on s’attribue
il y a Waterloo
il y a les excès
les fâcheries
les références authentiques
une machine à coudre et un parapluie
il y a les voyages en train
la magie
il y a la page 48
la doyenne de l’humanité
les tâches auxquelles on renonce
il y a les femmes qu’on n’oublie pas
la suffisance des prétentieux
il y a ce qu’on trouve bien
il y a les gros célibataires
les hurlements de Fellini
il y a les égarements de la providence
notre stupidité
le besoin d’absolu
les lettres d’excuses
l’ineptie des modes
les passagers du train Paris-Le Havre
il y a un saut d’eau salée
le sable
les maigres outils pour affronter la vie
Princesse Apocalypse
il y a le double visage de la réalité
il y a ce rien que nous sommes
le pied des murs
les fous rires
il y a une définition de l’aphorisme
quelques âmes charitables
la retraite d’un écrivain
la tour de Pise
il y a un huis-clos
le trèfle
une tondeuse à gazon
un poème de Paul Celan
le langage des charcutières
il y a les enfants des rues
les marches aux portes des palais
Marcel
les contrats à durée déterminée
les nouveaux riches
l’exclusion
il y a la critique littéraire
un crieur de bonnes nouvelles
l’amour courtois
le gazon de Wimbledon
le remboursement des dettes
il y a l’œil du coiffeur
il y a des bottes de paille
les haies
le désherbage
la main du Diable
des rediffusions
il y a une caisse d’anchois
les origines de la crise
les feux de l’enfer
des rustines
une moissonneuse-batteuse
il y a un compte à rebours
les relations contre nature
les lattes fatiguées d’un vieux lit
il y a même une fable
il y a le Président de la République
il y a les portes du Paradis
un mot de toi
ceux qui sont au pied du mur
il y a un ceinturon
les poches arrière d’un jeans
la mayonnaise
des agents spéciaux
il y a l’idée lumineuse d’un sergent
les premiers flocons de neige
l’aubier des arbres centenaires
il y a des pots de confiture
les reflets verdâtres du marais
les dompteurs de puces
les affaires pliées
les cœurs éclatés
les assoiffés du désert
un étrange mille-pattes
les marigots
il y a un nombre triste
un bouquet final
l’amour de la performance
la langue suédoise
les dimanches
les bayous
les livres qui ne se vendent pas
il y a la totalité des malheurs
de timides essais de conceptualisation
il y a les chuchotements
les chagrins qui sont à demeure
quelques enfants illégitimes
de l’allégresse
des suicides manqués
il y a une épitaphe extraordinaire
il y a des ascenseurs
il y a le sida
des claquements de portes
il y a l’autel des incertitudes
des chiffres et des lettres
il y a l’osier
les ascensions alpines
l’odeur de l’ambre solaire
il y a ce qu’on ne dit pas
il y a les objets perdus
les conjectures
l’arrivée au port
il y a la salade pommée
une kyrielle de moineaux
les rousses
le mercurochrome
il y a les bonnes manières
le mauvais temps
les cures d’amaigrissement
il y a des images de vierges
il y a une course d’escargots
le Q.I. des traders
le vieillissement prématuré
les mille et une raisons d’aimer
la première barbe
l’impatience du Chaperon Rouge
il y a les demandes inutiles
il y a ce qui a lieu mine de rien
les inséparables
l’obéissance des enfants
les longues attentes
l’abandon
il y a les proverbes
il y a des moutons à l’œil vengeur
la candeur
l’effet domino
une annexe aux traités de Tilsit
la burqa
il y a Madeleine Berger
les plages bretonnes
le souvenir de la bataille d’Eylau
il y a Yvonne et le Général
les commencements de l’Histoire
les 35 heures
le reniement de saint Pierre
le quarté
un marchand d’échelles
il y a la Mer Rouge
d’étranges royaumes
il y a les difficiles cohabitations
il y a les jours de pluie
le mouvement ouvrier
les étoiles
il y a la famille des ombres
le Mont-Blanc
les inusables chemins
l’évidence
il y a l’effondrement d’une tour
les rendez-vous manqués
il y a des prophéties
la douce folie
il y a celle qu’on voudrait cueillir au milieu de la foule
les diagonales
il y a les dimensions de nos vies
d’autres saisons
les merveilles du monde
des parkings
il y a demain
Indianapolis
des occasions
la tentation d’une vraie vie
il y a le mardi matin
les reconduites à la frontière
le temps des retraites
les obsessions
il y a l’illettrisme
le paysage du livre
le mois de mars
les trains qu’on a comptés dans la nuit
il y a Combray aujourd’hui
la vie d’étudiant
le fond du jardin
il y a l’allumeur de réverbères
la mauvaise herbe
il y a un fleuve
le Goncourt
les dés pipés
les vices et les vertus
une ceinture brodée
il y a ceux qui cherchent les poux
il y a une théorie des genres littéraires
la colère des lecteurs
le refus
il y a Pompidou
il y a aussi la dèche
une méditation sur l’avenir
les marges de l’histoire
la dureté du bois
il y a les écrivains qui tiennent à la gloire
les canapés au foie gras
les majorités relatives
le soutien psychologique
il y a les bonnes raisons
il y a les arnaques
des rêveries
le chapelet des idées reçues
les faux espoirs
il y a Orly le dimanche
l’histoire d’un Inuit
des nuits blanches
le tour du monde
il y a les lignes de fuite
il y a les fois prochaines
la plongée sous-marine
l’oubli
il y a Fedor Mikhaïlovitch Dostoïevski
il y a Cyrano
il y a un seul taulier
une tête coupée
les dernières secondes d’une vie
les files d’attente
il y a ce qu’on s’est mis en tête
un rêve de Joachim
les nymphéas
il y a les brutes zélées
l’indiscrétion du lecteur
des batailles
l’île Maurice
une lettre d’amour
le grain de la voix
il y a le désert
les horloges
les décharges
il y a les décombres
les regrets
une seconde vie
les éclats de rire
il y a celui qui n’est pas des nôtres
il y a un fringant jeune homme
la patience de Noé
Pluton au périgée
la grille derrière laquelle attendaient les réfugiés
les trains de la mort
les colonies de fourmis
les regards terrifiés
il y a les boiteries
la honte
le bob
il y a des mots rares
un gars tout seul au coin de la rue
la fierté
les constats affligeants
il y a la chasse au lièvre
une joggeuse
les punitions
les pièges du miroir
la position des tireurs
les soupirs
les boules de cristal
les cruelles certitudes
il y a Philémon et Tristan
il y a la grammaire
le libre accès
les mousquetaires
le vote électronique
il y a des manifestants
des messages d’insultes
le soleil qui fait grève
un psychanalyste à la retraite
il y a toi et moi
il y a une chanson de gestes
des apparitions
il y a Dieu
les choses de moindre importance
il y a la fatigue
le plagiat
les dimensions de la bêtise
la patience
les coups de chance
le bout des champs
il y a une pile de chemises
un Petit Larousse
des insomnies
le ciel au-dessus de nos têtes
le courrier du monde entier
la maladie qui vous cloue
les fumeurs et les autres
il y a l’Atlantide
il y a des faussaires
un porte-monnaie vide
il y a la commune de Fernoël
une approche avortée de l’infini
le voisinage
des contestations
il y a Noël
l’ami Pierrot
la réparation des injustices
il y a l’Internet
les noces de l’ennui et de la contrainte
il y a les paris
un écrivain gros et fier
la danse moderne et classique
les hommes à principes
les femmes de Casanova et Casanova lui-même
il y a une bande de désœuvrés
l’autre calendrier
le règne de Charlemagne
il y a sa liaison supposée avec Adalinde
les lettres de rupture
celle qu’on a retrouvé dans l’étang
des larmes
il y a les poèmes dont on ne se souvient pas
les brouillons
les pages blanches
les grains de beauté
les rondeurs démodées
le chef du casting
une femme de ménage
l’enfant qui réclame une histoire
il y a même les cuisses de Blanche-neige
le dernier voyage
il y a Jules Hetzel
ce qui persiste
deux policiers toulousains
les raison d’un refus
l’inhibition du pape
il y a les livres qu’on ne lira pas
le temps perdu
la sérendipité naturellement
la recherche du silence
il y a la république des livres
les statistiques
une bougie
les derniers jours
il y a la guérison
trois fois trois fois rien
il y a des opérations arithmétiques
il y a quelques tours de passe-passe
il y a le désespoir
il y a celui qu’on a oublié dans une prison
l’ombre de Ponce Pilate
il y a un wagon de cinglés
il y a les statuts
des jeux en ligne
il y a le temps des cerises
les défaillances humaines
des bouteilles
un concours d’orgasmes en couples
il y a l’un dans l’autre
il y a des péripatéticiennes
un amateur de chiffres ronds
il y a des langues inconnues
il y a de grosses bêtises
il y a la corde à laquelle chacun tire
un voyage sur Mars
il y a Don Giovanni
deux poussettes
il y a des huîtres
les années 30 à Chicago
les gâteaux à forme ridicule
Schrödinger
un chef-d’œuvre inconnu
il y a les rendez-vous
il y a les bien que
un puits au milieu des plates-bandes
les bourgeoises de Pont-l’Évêque
il y a un enfant de cœur
il y a le livre de trop
l’art contemporain
il y a ceux qu’on disqualifie
le tiercé
le poing dans la poche
il y a le loto
la haine sans raison
les excuses
il y a un huis sans serrure
il y a la météo
la télévision
il y a les réjouissances
les royaumes pourris
il y a un hérisson
un centre commercial
les dés pipés
il y a les instruments de domination
il y a le besoin de se renouveler
la bêtise
l’arrogance
les caresses
il y a sept corps dans un puits
l’ambiguïté
les occasions ratées
la générosité des mères
il y a les journées qui durent
le bonheur des pères
la petite forme
les anglicismes
la distance qu’on prend pour y voir clair
les nombres sans-grade
il y a bien plus
il y a l’infini qui guette
les ovations à Avignon
nos ignorances
les sévices
l’avenir qui donne tort
un manifeste poétique
le public
il y a les coups de main
il y a les préférences
les raisons de continuer
il y a les pourquoi
les fraises
la vie après toi
il y a la sobriété
le grand guignol
des grandes gueules
l’électricité
Tokyo
les pingouins du pôle Nord
il y a les promesses non tenues
Leonardo Fibonacci
un évêque
des taupes
il y a les cactus
les mises en examen
les effeuilles
la route entre Rome et Amsterdam
le désir de partir
un rond-point
une marquise
il y a les grosses colères
les quais de gare
il y a les appartenances
les illuminés de Salt Lake City
la reconnaissance
les miettes de pain
la longueur de la page
il y a la rage
il y a ce qu’on attendait depuis longtemps
les refus
le temps d’avant
les réincarnations
le harcèlement
un majordome
il y a les petites épiceries
les nœuds de vipère
une mercière
il y a les tragédies de la route
l’absence du père
il y a le château d’Oliferne
la saveur de certaines proses
l’aveu
les coups de pied qui se perdent
les équations sans réponse
des licenciements
il y a une chute vertigineuse
mille raisons de refuser
les estuaires
le travail recommencé
les ports
les noms d’oiseaux
la lisière des bois
il y a l’immortalité
les ronds de fumée
les changements de cap
les arrêts maladie
la nostalgie
les promesses d’éternité
des sources et des lacs
il y a les grand moulinets
les dispenses
les passages à tabac
les polars
les éliminations sommaires
il y a ta vie
les clés de Saint-Pierre
la tiédeur de l’enfer
les homélies pascales
il y a l’olivier centenaire
les passages à blanc
les habits de printemps
les justifications
il y a des imprécisions
il y a les retards
l’autosatisfaction
les degrés de l’humour
les rires
les agences de presse
les imitations qui mettent mal à l’aise
l’huile oubliée sur le feu
la vérité du Petit Poucet
l’enterrement du mouvement surréaliste
il y a les mouches
il y a la bravoure
le livre des records
il y a ceux qui passent à travers les murs
il y a ceux que l’imagination n’étouffe pas
les gants blancs
l’amour des comptes ronds
le vouloir dire
les petits réflexes câlins
les bons côtés
les supplications
un confessionnal
il y a les derniers cheveux
le bilans des gains et des pertes
les taches de rousseur
il y a des râteaux et une pelle
il y a les bonbons
Robert Desnos
les mensonges
le zéro
les examens
l’encre rouge
il y a le clin d’œil des étoiles
l’extrême onction
les frasques de coco
il y a des dépositions
il y a les mauvaises raisons
l’inutilité
le vieil Armand
le chapelet des petits emmerds
les aboiements
la tonsure des moines
il y a un père et sa fille dans un parc
il y a les petites pierres blanches
l’heure qui passe
la durée
le type qu’on fête
le geste tranchant des géants
les confidences
il y a un gâteau d’anniversaire
il y a des bougies
il y a l’agitation
l’assiduité
il y a ceux qui s’y croient
il y a un sonnet
il y a des vies minuscules
le réveil
l’Académie française
les prétextes
l’ordinaire
l’appel du 18 juin
il y a un hymne national
il y a les cortèges de sottises
ce vers quoi porte le regard
les constructions de demain
les curiosités linguistiques
les superstitions
les yeux des fous
il y a les gadgets
il y a les robes de mariée
la scansion
les pauvres espoirs
il y a les fiches de cuisine
les lamentations
le pressentiment
l’entassement des saisons
les manies inaperçues
les vieilles bouteilles
il y a les trompettes de la renommée
il y a ceux qui ont un chien
le pourrissement des morts
un rêve d’Ubu
l’herbe verte au retour du désert
les sifflements du vent
les pâtes de fruits
les crevaisons
il y a une cahute
il y a les trompe-l’œil vieillis
le Paic citron
il y a les recommencements
les jolies brindilles
les déjeuners sur l’herbe
les déclarations
la correction
les hérissons qui se hâtent sur le bitume
la crise
il y a les professeurs de philosophie
les arbres à came
il y a l’immanquable
la pagaille
les inondations
il y a des revenants
il y a des cactus
il y a les syllabes
l’âge mûr
il y a Shakespeare
l’ombre du maître
le cancer de la gorge
la Guilde des avocats de la ville de Dijon
le prénom oublié d’Alzheimer
les salariés au lendemain de leur licenciement
il y a l’hôpital Sainte-Anne
il y a les bonus
il y a ce que tu vois dans la glace
les sondages
les rencontres de Chaminadour
les restrictions budgétaires
les exigences tyranniques
l’oubli des proches
la ponte
les cueillettes
il y a le tournage d’un film
il y a les gargotes
les méthodes pour bien lire
une paire de bottes
les apôtres
les quelques secondes de trop
les exercices d’admiration
la contagion
le confort
il y a des réussites
il y a les poignées de mains
il y a ce qu’on oubliera
il y a les employés des douanes
les victoires qui lassent
la dépression
l’inlassable circulation des hommes
les cris de la victoire
il y a la fin des vacances
la démission des leaders
le cercle de l’horizon
il y a un bouclier de cuir à l’ancienne
il y a les mesquineries
les plaintes qui n’aboutissent pas
la relativité du temps
la princesse de Clèves
la jalousie
la nécessité
les 400 coups
il y a la roulette russe
la répétition des mauvais souvenirs
les airs fripons
il y a le ridicule
les excès
l’histoire qui défile
le découragement
la guérison
il y a le regroupement de militants fanatisés
les ravissements
le consentement au premier baiser
les habitudes qui franchissent les générations
il y a un billet de 1 000 dollars
la bouche qui te regarde
les séances chez le psy
il y a les tablettes d’argile
la récursivité
la rébellion de personnages en papier
il y a un ange dévasté
il y a cent mille milliards de poèmes
il y a les casse-tête
les allées du Père Lachaise
sept oranges à Alicante
la légitimité obtenue au forceps
le débarquement à Cythère
il y a l’avenir du livre numérique
il y a la preuve par l’absurde
la supériorité des formes brèves
les beautés en bikinis
le Boudpokistan
il y a l’inattention
les yeux dans le vague
les groupes des pression
il y a des poulets en vadrouille
il y a une élection
il y a les coups sur la tête
les recours à ce qu’on ne saurait disposer
les maux de dents
les bons perdants
le manque d’idées
l’évidence à laquelle on se rend
l’armée monégasque
les combats d’arrière-garde
il y a ce que tu me dis
le livre des records
il y a les excès de bière
les explications confuses
il y a une soutenance de thèse
il y a les gorges chaudes
les prés fauchés
il y a les charpentes
les révoltes populaires
il y a l’Afghanistan
les oui mais
il y a les engagements précieux
les fabuleux destins
les balades en bateau
il y a ce qu’il faut bien admettre
Jean Prod’hom
26 octobre 2010
Il y a les pâturages

Il y a les pâturages en novembre
les cendres chaudes
il y a l’eau lorsqu’elle se gargarise
les équilibres précaires
il y a les tèches de bois
le miel
il y a 1848
les âmes discrètes
il y a la récup
Jean Prod’hom
Dimanche 31 octobre 2010

Pour la quatrième fois cette semaine je monte à Pra Massin, quatre fois je m’étends sous les Chênes, à l’abri de la haie, vivace, bouleaux et frênes, un peu d’herbe verte sous la veste et l’orient à l’orient. Les collines font le dos rond et les lignes de fuite caressent le creux de leurs reins. La neige de la semaine passée coule le plomb sur les flancs de Brenleire et de Folliéran, quelques chats se hâtent sous les Tailles, dernières chasses aux mulots avant que la terre roussie ne durcisse. Je cherche les bêtes qui couraient il y a peu dans les taillis, un merle brasse les samares et fait les bonnes affaires. Bien loin dans la mémoire des silhouettes s’effacent, âmes solitaires qui raient le flanc noir des bois, vont et viennent dans les couloirs du purgatoire, raides sur des buttes, aux lisières ou assises sur des bancs. Elles guettent ce qui vient et se gardent de ce qui va, mais il est trop tard, on est de trop et c’est tant mieux, chassé de la bonne saison, à trente pas de tout et de rien, et le reste, avec autour le silence liquide, le léger frémissement du chemin d’erre, pas grand chose, la rouille des saisons, les amarres, un peu de fumée.
J’ai levé ce matin le plan de refuges dressés à l’insu des services de protection qui maintiennent en équilibre au coeur du caduc ce qui ne coûte rien. Quelques solitaires y demeurent à l’écart du cadastre, ils ont laissé quelques traces, nul mot de l’abandon, mais il est écrit dans le pré au milieu duquel ils brillent qu’un jour on sera invité nous aussi au festin, on verra les contours d’une possibilité intacte, être de dedans ce beau désastre. Ici c’est chacun son tour à la condition d’avoir su renoncer à temps, accueillir ce que personne ne veut et dont même l’aveugle se débarrasse. Je laisse filer les choses dans les bords et reste dans le calme du milieu.
Une grande vague soulève la terre, le merle a saisi une sauterelle et quelques promeneurs picorent la vie qui affleure. Pourquoi les seuls témoins de l’amont se sentent-ils coupables ? Une folle tout là-haut sur le banc, noir vêtue, un peu gênée par la vie qui vient en trop. Et à nouveau les cloches sur le chemin, la vie qui avance sur la pointe des pieds emmenant à ses côtés une cohorte de fantômes, le trop plein du purgatoire goutte dans le caniveau, les peurs infernales se sont tues. Il pleut, on aura demain les pieds dans la boue.
Jean Prod’hom
LXXVIII

A la lisière du bois Vuacoz, immobile sur un banc, une dame, petite dans son long manteau noir, serre dans le creux de sa main une idée noire. Elle songe, comme elle semble pâle, elle parle, seule, attachée à un maigre souvenir qui ne la quitte pas. J’approche de la rêveuse, aperçois une noirceur qui lui vrille la tempe, prends peur puis soupire. La belle téléphone à son coiffeur.
Des dindons glougloutent. Non! ce sont les copines de Malou avec Jean-Rémy qui boîte comme un canard.
Jean Prod’hom
Eaux mortes

Malgré la pression
les incessantes demandes
on ne termina aucun des aqueducs
prévus dans le plan directeur
on invoqua de secrètes divergences
la faible ingéniosité des ouvriers
juchés sur des draisines
d’un autre temps
on aménagea deux ou trois bisses
conduisant l’eau souillée des marais
dans des creux de pierres et de ciment
périodiquement curetés
situés en périphérie de la capitale
on y remplissait des jarres vendues en ville
d’eaux saumâtres
lessives sommaires
malgré de courageux essais
l’intelligence reculait
dans les sous-sols de la ville
l’équilibre était rompu
on se fourvoya
en avançant l’insuffisance des moyens
l’ambitions et les fins
on brisa tous les récipients en terre cuite
quelques désespérés
envoyèrent des émissaires
par-delà l’océan
comme toujours certains attendent leur retour
d’autres guettent les pierres utiles
à la réfection des chaussées
qu’ils emprunteront lorsqu’ils estimeront
qu’il est enfin temps de partir
Jean Prod’hom
Parabole

«Je cherche un homme» répétait Diogène en parcourant la ville d'Athènes avec sa lanterne.
À Œdipe qui se demande comment retrouver à cette heure la trace incertaine d'un crime si vieux ? Créon répond : «Ce qu'on cherche, on le trouve ; c'est ce qu'on néglige qu'on laisse échapper.»
Et toi pauvre insensé, que réponds-tu à celui qui te demande ce que tu cherches au cœur de ces lignes, et que tu ne trouves pas ? Dis, que réponds-tu ?
Jean Prod’hom
17 octobre 2010
Il y a les corps usés

Il y a les corps usés
la soupe aux lentilles
les boîtes à musique
il y a le trait qui unit Jésus au Christ
il y a les caméras de surveillance
la mort sans bruit
il y a l’eau de mer
les désillusions salutaires
le mélange des genres
Jean Prod’hom
Déplacement de populations

Les discussions
touchaient à l’occupation
de la vallée centrale
immense cuvette dont on ne voyait pas le fond
on voulut combler cette lacune
en déversant les bris de terre cuite
les morceaux de verre pilé
collectés dans l’île
on appela ce chantier
le chantier du siècle
ouvrage sec qui ne repoussa
ni les larmes ni la soif
malgré l’humidité
venue du large
les faibles variations
du meilleur comme du pire
on craignit que l’eau potable
prenne ses distances définitivement
on craignit une fois encore
la disparition de la lagune
on but la contradiction
jusqu’à la lie en subissant
les inconvénients de la sécheresse
les inconvénients des inondations
autrefois
la centrale suffisait largement
on répondait aux pannes
du tac au tac
on n’eut d’autre solution
cette fois
que d’alléger
la dimension des communautés
chefs capturés filles évacuées
lugubre souvenir que celui
des chants d’errance
hommes chargés de sel
réduits à l’aggravation de leur état
arbres renommés
rochers fendus au pied desquels
les sources savantes
avaient perdu jusqu’à l’idée même de pente
au fond de l’oeil des habitants de l’île
s’accumulait la haine des saisons
Jean Prod’hom
LXXVII

Jamais le travail n’est si séduisant que lorsqu’on est sur le point de s’y mettre ; on le plantait donc là pour découvrir la ville. Proposition séduisante certes, mais qui, j’en prends conscience aujourd’hui, ne se vérifie qu’à certaines conditions, nombreuses, difficiles à démêler et souvent difficiles à remplir.
A l’étroit, sot et sourd, agité, lourd, présomptueux, craintif, crédule et mou, Jean-Rémy rayonne. Je me détourne sur son passage et m’éloigne, inquiet, à petits pas serrés.
Jean Prod’hom
Dimanche 24 octobre 2010

La neige tombée pendant la nuit a sonné le glas des beaux jours, il faut s’y faire ce matin. Mais avant de s’engager plus avant dans la mauvaise saison, les Joratois ont encore à décider de l’allure de celle qui a pris fin. C’est parce que la mémoire n’y suffit pas et qu’aucune position ferme ne s’impose que les paysans, depuis l’aurore, traitent de l’épineuse question avec les premiers levés, quelques-uns du Conseil communal, les vieux et le laitier. Pas un mot ou si peu, les tractations sont secrètes. La décision est politique et relève tout autant du législatif que de l’avis éclairé de ceux qui chaque jour, au saut du lit, scrutent l’orient. Les uns et les autres pèsent les éléments, convoquent les souvenirs, les jours perdus, la grêle, les semailles, le soleil, le retard, les orages, l’humeur de la patronne, les labours, le niveau des sources, la qualité du lait, le fils, la fille,...
Lorsque j’arrive au café, les tractations ont bien avancé déjà, je le vois à la mine entendue de certains. D’autres pourtant s’en vont déçus, tête baissée, avec l’impression désagréable d’avoir dû se plier à ce qui s’est décidé sans eux – et un peu contre eux. Mais c’est la loi ici et aucun ne trahira la décision prise.
Au bar traînent encore les émissaires des villages voisins dans lesquels on a envoyé les nôtres. Ils se croiseront sous peu au giratoire de Sottens, il faut qu’à midi l’affaire soit pliée, d’Oron à Echallens, de Corcelles à Denezy. Quelques mots encore par-ci, quelques mots par-là, un dernier tour de table, silencieux, la sainte équipe se regarde toute proche de l’irrévocable décision. C’est fait ! S’installe alors le silence puissant de ceux qui font le beau temps, le silence du président du Conseil communal, du laitier et du secrétaire de l’Association des déchets carnés qui commande trois décis et trois verres, c’est son tour.
Un peu plus tard le laitier se lève, il me salue, je me risque et me lance.
– La neige est tombée bien bas cette nuit.
– On a eu une belle saison, faut le reconnaître.
Je cherche à me souvenir, je n’ai pas de vue d’ensemble, mais malheur à celui par lequel le scandale arrive. J’opine avec le sentiment de l’inéluctable, le laitier a raison, certainement raison, il sort du café un bonnet de laine sur la tête.
Jean Prod’hom
Mathesis universalis

L’imperfection de la création torture Jean-Rémy, qui ne peut imaginer des séries que parallèles et complètes ; peu importe d’ailleurs le nombre : 24 ou 26, 31 ou 36, Jean-Rémy est prêt à tout. Mais surtout, surtout mon Dieu, autant de dents dans la bouche de l’homme que de cantons dans la Confédération helvétique, de jours dans le mois que de lettres dans l’alphabet.
Si la découverte d’un mille-pattes n’en possédant que 807 a secoué il y a une année, on s’en souvient, la communauté des savants, celle récente d’un parterre de millepertuis aux feuilles perforées 403 fois seulement a mis en ébullition celle des botanistes. Ne parlons pas des pâtissiers qui sont au taquet avec leurs mille-feuilles auxquels plus personne ne croit et qui n’ont pas hésité à faire appel à la crème des avocats pour répondre aux plaintes qui affluent.
Sandra m’annonce fièrement que Lili sait compter jusqu’à cinq : Lili se prépare, Lili surveille sa main gauche grand ouverte, jette un coup d’œil à sa main droite avant d’appliquer chacun des doigts de la seconde à ceux de la première. Bien vu Lili, mais comment sais-tu qu’il y a cinq doigts dans ta seconde main ? Lili lève la tête, me considère incrédule, hésite, regarde successivement son pied gauche et son pied droit, soigneusement, Lili est prise de vertige, hésite encore, se penche, résiste, le temps passe. Lili sourit enfin, elle ne fera pas le pas suivant : c’est fait, Lili sait compter mais Lili ne sera pas contorsionniste.
Jean Prod’hom
5 juillet 2010
Dimanche 17 octobre 2010

Il est revenu de Gstaad pour un court week-end. Lui c’est les parquets, les planchers et la moquette. Deux mois déjà qu’il y est avec les autres, une bonne cinquantaine à travailler à la réfection d’un hôtel de luxe, douze millions c’est le prix, ou quinze c’est selon. Des menuisiers et des peintres, des appareilleurs et des électriciens, artisans sans lesquels les riches seraient des bons à rien. Ils conjuguent leurs forces, emboîtent leur temps, il faut tenir les délais, les pénalités sont chères. Une équipe soudée mais chacun pour soi, t’es pas dans les temps tant pis pour toi. Douze heures de travail pour gagner quelques tunes supplémentaires, on trouve un endroit pour dormir, un autre pour manger, pour une bouchée de pain sinon à quoi bon s’exiler. Une ou deux bières le soir pour aller jusqu’à minuit. Tu me dis qu’il te faudra deux mois encore avant de terminer les travaux.
Je rejoins Gstaad et mes employeurs qui occupent un chalet de maître entre la Lauenenstrasse et la Rotlistrasse, un couple de milliardaires parisiens en instance de divorce, une fillette et un garçon de dix et douze ans auxquels je vais enseigner le français, le latin et les mathématiques durant l’hiver 1974. Ecole le matin et cours de ski l’après-midi, rien à en dire, des enfants caractériels, un père absent, une mère qui monte au Palace en fin d’après midi pour y jouer au bridge et en redescendre au petit matin. Madame se lève un peu après midi et donne ses ordres depuis la tête de son lit, les traits tirés, pas beau à voir. On m’a trouvé une chambre dans un chalet tout proche.
Je travaille de concert avec un couple de Portugais qui dorment au sous-sol : elle cuisine, fait les lessives et s’occupe des chambres; il est chauffeur, fait les courses et endosse le gilet à raies jaunes et noires de Nestor à midi et le soir, ils sont au service de leur maîtresse depuis plusieurs années déjà, dociles.
Et puis, au coeur du dispositif, il y une Autrichienne de Salzburg, jeune nurse bien faite ma foi qui s’ennuie un peu, moi aussi. L’entreprise roule si bien que les liens du précepteur et de la nurse se resserrent. La première semaine n’est pas achevée qu’il se retrouve enfermé dans le chalet à des heures qui dépassent les convenances. C’est certainement un piège tendu par les Portugais.
Qui n’a pas pris la poudre d’escampette par les airs n’a pas fait le grand tour de l’amour, qui n’en est pas revenu mourra idiot. Il lui faut donc sortir coûte que coûte avant le réveil de la maisonnée. L’Autrichienne qui n’a pas froid aux yeux lui promet qu’ils prendront désormais d’autres précautions pour neutraliser les ennemis de leur passion et réchauffer leur hiver. Pour l’instant il faut traverser sur la pointe des pieds la chambre des enfants au sommeil tourmenté et rejoindre le balcon. Pas d’échelle mais deux étages à vaincre pour devenir un homme accompli. Fermez les yeux, c’est fait. Ne voyez-vous pas le héros qui s’éloigne dans la nuit?
Jean Prod’hom
Il y a les lacs d’altitude

Il y a les lacs d’altitude
le paysage qui s’éloigne dans le rétroviseur
il y a les poires à botsi
il y a le jour qui ne vient pas
le recto et le verso
il y a les voyages d’avant la cartographie
les rémissions
le bégaiement
il y a le grincement des portes
Jean Prod’hom
Rétrocession

A deux pas
des galeries à claire-voie
des administrations
autrefois prospères
trois préposés au livre
vendaient leurs allures
ils montaient et descendaient
les allées de la bibliothèque
jusqu’à l’épuisement
se livraient
à de farouches discussions
sur le passé et l’avenir du livre
le soir ils désespéraient
plus aucun animal de trait
pour transporter
les vieux livres
du magasin à la salle de lecture
les trois employés
rejoignaient alors
les préposés aux amendes
sur les rives du fleuve
aucun d’eux ne se plaignait
ni des fraudes
ni de leur maigre salaire
ils écoutaient accroupis
les dires de l’eau
le secret des impassibles contrées
l’éclat des disputes qui rôdent
les cris lointains de la foule
ils regardaient aussi
la ronde des fourmis
au pied de la haute tour
oh ça
ils ne s’en privaient pas
oubliés un instant
la litanie des regrets
l’abondance
les jours meilleurs
qui auraient dû converger un jour
sur les rives de l’île
de ce fleuve et de ce petit cercle de poètes
n’attendez pas d’autres précisions
ni le chiffre de sa destination
ni le moment de leurs désillusions
Jean Prod’hom
Disparition

Le directeur de l’entreprise Pleinfeu, Eric Jaquier, leader en Europe de l’allumette a disparu. On se perd en conjectures, on ne lui connaissait aucun ennemi.
Madame Zampiéri, boulangère dans le quartier de la Palaz est la dernière à l’avoir vu. C’était un nouveau client, il venait de temps en temps autour de midi acheter une demi-livre de pain. La veille de sa disparition, nous a raconté la commerçante, Monsieur Jaquier est entré dans sa boutique à 16 heures 30, il a regardé attentivement les pâtisseries. Après de longues hésitations, il s’est décidé pour deux tartes anglaises, il en restait une troisième.
- Je vous l’offre, personne n’en voudra.
Monsieur Jaquier a souri, l’a remercié avant de sortir.
Le lendemain, c’est-à-dire le jour de sa disparition, le fabricant d’allumettes est à nouveau entré dans le magasin. Il s’est approché du comptoir, a regardé les pâtisseries.
- Je l’ai vu alors trembler, il a prononcé de drôles de mots avant de s’en aller précipitamment les mains vides. Il était environ 16 heures 30, les client du tea-room lisaient religieusement leur quotidien, les enfants criaient dans le parc, un chien aboyait. Même qu’il me restait comme la veille trois tartes anglaises.
Jean Prod’hom
ORL

Oto-rhino-laryngologie, une spécialité à laquelle la profession de son grand-père d’abord, de son père ensuite le destinait. Mais cette appellation lui est restée tant de fois au travers de la gorge, l’a fait éternuer si souvent, lui a tant blessé l’oreille qu’il a été obligé de consulter.
Jean-Rémy renifle par petits coups brefs et réguliers, il essaie de ne rien perdre.
– 807 ! soupire-t-il satisfait avant de s'endormir.
Hier soir, la vieille a oublié de verser dans la coupelle de porcelaine la goutte d’essence de marjolaine qui, depuis cinquante ans, tient en respect les ronflements du vieux. On les a retrouvés morts ce matin, dans les combles, écrasés par la charpente de leur maison.
Jean Prod’hom
27 juin 2010
LXXVI

Le mercredi soir Jean-Rémy entrait au Paradou en marche arrière crachant et jurant qu'on ne l’y reprendrait plus.
Jean Prod’hom
Dimanche 10 octobre 2010

A Laurent Margantin
Au-dessus de la Moille Cherry les armatures d’acier des géants de la ligne Galmiz-Verbois perdent la tête dans la brouille qui s’est installée depuis deux jours sur le Jorat. J’avance sans consistance à travers prés, sans l’ombre qui accompagne nos étés. Le jour est émoussé. Deux boutons d’or restés en arrière s’étirent dans l’herbe grasse, au-dessus quelques feuilles d’érable soufflées par le vent ont franchi la barre d’étoupe, un peu de vert sur leurs ailes écornées, elles tournoient avant d’atterrir la tête en l’air un peu ivres sur le sol détrempé de rosée. Elles frémissent, s’essaient à quelques saut de cabris, s’immobilisent enfin les épaules prises entre deux brins d’herbe. Il faudra éponger, gommé l’horizon, d’autres odeurs, celle de la terre, celle du feu qu’il faudra allumer. La tête me tourne, j’ai beau chercher l’ombre qui attesterait de la présence d’un corps, de mon corps, rien. Un vertige seulement, celui de s’être approché trop près de soi, de ne faire plus qu’un, spolié du lointain et des réponses que promettent les échos, une boîte sans paroi, ni porte ni fenêtre. J’avance le nez sur de lourdes pensées, elles ne décollent pas, ni ne me reviennent, elles s’enlisent à mes pieds. Je pense à ceux qui vivent en altitude et au soleil qui va pour son compte sous leurs yeux.
Dans les sous-bois pourtant la vie continue, le bruit court, les secrets s’enfuient et chaque chose guette sa voisine. Je goûte au miel d’une poignée de chanterelles d’automne. On se réveille tard, les enfants font une cabane à l’étage, il ne sert à rien de prendre de l’avance.
Anne-Lise Grobéty est décédée, une photographie dans le journal local, le visage un peu triste de celle qui savait – c’est toujours ainsi qu’apparaît le visage de ceux dont la vie s’est arrêtée et dont le regard s’éloigne. Le journaliste tourne la page, c’est son travail, le silence tout autour. D’un coup tout a basculé.
Je songe alors à Sarah Kofman qui a vécu pendant plus de 15 ans encore alors qu’elle reposait avec des fantômes à quelque pas de Marguerite Duras au cimetière Montparnasse. Celle que je n’ai jamais vue, dont je ne sais rien, mais dont l’ouvrage lu en 1980 – Nietzsche et la métaphore – m’a tant aidé à y voir plus clair, à renouveler la question du langage, la place de celui-ci dans la possibilité même d’une généalogie de la morale. J’ai appris son suicide dans un billet de Laurent Margantin qu’évoquait l’infatigable Brigitte Celerier dans sa note du 9 mai 2010.
J’apprends, écrit Laurent Margantin en 1996, 97, 98 ou 99, le décès de Sarah Kofman, qui s’est suicidée. Je me souviens d’une petite femme chétive et nerveuse, et d’heures passés à la Sorbonne à l’écouter parler de Nietzsche. Elle était si petite qu’il fallait lui poser un annuaire sur la chaise de bureau que nous allions lui chercher chaque semaine au secrétariat du département de philosophie. Pendant l´heure de cours magistral, elle se tenait assise derrière la table, devant une centaine d’étudiants, les deux poings serrés sous le menton, parlant d´une voix grave, terrible avec les étudiants qui lui posaient des questions ineptes, ce qui arrivait fréquemment (je m’étonnais d´ailleurs du peu de capacité critique des étudiants français comparés à leurs collègues allemands). Elle analysait Ecce homo d´une manière simple et fluide, sans apparente difficulté, parfaitement préparée. Je me souviens que le jour où l’on m’avait présenté à elle, elle m´avait serré la main et regardé d´un air mystérieux en affirmant que nous nous connaissions déjà. A la suite de cette rencontre, je suis parti vivre quelques temps dans l’Aveyron, puis en Allemagne, et je ne l´ai plus jamais revue.
Lire ensemble cet automne Pour mourir en février, le premier livre d’Anne-Lise Grobéty, et Rue Ordener, rue Labat, le dernier livre de Sara Kofman.
Jean Prod’hom
Indigence

Vies écorchées
sans le cramoisi de la cochenille
et l’indigo de la guède
on se priva
des oléagineux
des galettes-vapeur
de la venaison et des chiens gras
les coeurs durcirent
aussi durs et froids
que le coeur de l’obsidienne
on brûla les plateaux en bois
la marqueterie avec
les poutres des anciennes charpentes
boues bues jusqu’à la lie
corps d’emplâtres errant sur la grève
l’écorce obstruait les pharynx
plus de friandises ni pipes d’écume
torches jetées dans les cendres
la mémoire vomissait sa bile
la vie gouttait aigre dans la nuit
dans le jour
un entassement inouï d’excréments
et de canots de peaux éventrés
non loin de là
le rire de la misère tournée vers le large
appelait l’assaillant
Jean Prod’hom
Paternité architecturale

Il existait une controverse sur le nom de l’architecte responsable de la construction de la célèbre tour penchée à Pise : Bonanno Pisano ? Giovanni di Simone ? Fabio Lante ? Alberto Rigoletto ?
Le procès-verbal d’une réunion de chantier, qui eut lieu en 1178 sur le Campo dei Miracoli, trouvé il y a peu dans les sous-sols du Campo Santo, redresse la vérité. On a en effet la preuve écrite que l’architecte responsable – dont le nom a été consciencieusement gommé –, aurait confié à son contremaître les mots suivants.
– Je t’avais dit 708, pas 807,... mais on continue, ça devrait tenir.
Aucun architecte n’a revendiqué, au cours des années qui suivirent, la construction du campanile devenu simultanément boiteux et orphelin. Ceci explique cela.
Jean Prod’hom
17 juin 2010
Friedrich Heinze de Rendsburg

Je rêvais en 1983 d’une série de récits coperniciens. Il n’y en eut qu’un. Voici à quoi aurait ressemblé le second si j’avais tenu parole.
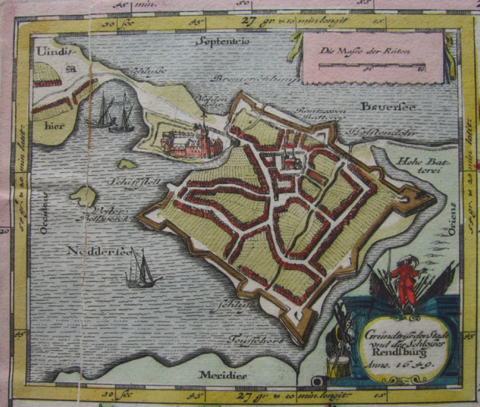
Rendsburg
Friedrich Heinze de Rendsburg rêvait enfant des merveilles du monde. Plus tard il lut assidûment les récits qu’en avait faits Marco Polo et rencontra quelques-uns des aventuriers de son temps. Il se mit en chemin le 8 mai 1650, à la conquête des pays du levant, avec l’espoir démesuré de rejoindre l’horizon et saisir en leur langue les légendes de la terre.
Il fit une première longue halte sur la rive droite de l’Oder, surpris par le sabir que parlaient les autochtones, une langue en quinconce qui avait bien un lointain air de famille avec la sienne, mais qu’il comprenait à peine et de travers. Il passa tout l’hiver à en faire façon, c’est-à-dire à s’y glisser et à la faire sienne. Il y parvint au printemps de l’année suivante et s’y trouva si bien qu’il demeura sur les rives du fleuve une année encore à deviser avec ceux qui s’y étaient établis. Il nota quelques-uns des nombreux récits qu’on lui fit. Il ne leva le camp et ne continua son chemin que lorsque les cigognes blanches installèrent leur nid sur les hauts clochers des villages de Silésie.
C’est à la fin du mois de mai que Friedrich reprit donc son havresac et marcha sans compter en direction de la mer Noire, jusqu’à l’hiver qui engourdit les innombrables bras du delta du Grand Fleuve où il fit halte. Les moeurs avaient changé, les yeux des femmes lançaient d’autres feux et les brumes paressaient certains jours jusqu’au soir. La langue aussi, un sabir encore, mais un sabir de sabir qui établissait sa grammaire en d’autres lits, faisait entendre des chants inouïs et creusaient des paysages éblouissants qui n’avaient rien à voir – ou si peu – avec ceux du Schleswig qu’il avait laissés derrière lui. Il s’arrêta là une paire d’années, s’y acclimata. Il apprit la langue, écouta les histoires tandis que la neige tombait comme jamais sur le delta.
Il reprit la route un printemps en laissant derrière lui les terres qu’il avait apprivoisées, une langue et des gens qu’il avait aimés.
Pour disposer de l’inconnu et des mots obscurs qui l’accueillaient au détour des régions où il fit halte, il lui fallut chaque fois déployer une attention nouvelle : nouvelle grammaire, nouveau lexique pour nommer les choses, écouter les épopées, demander un morceau de pain et goûter aux chants de la terre. Il suivit saison après saison la pente des langues, leur thalweg ou leur relief, s’éloignant ainsi toujours plus de la sienne dans le berceau de laquelle il était né, tant et si bien qu’il la perdit de vue et en fut comme desséché. Il voyagea ainsi en direction du levant, par terre et par mer trente ans durant avant de se retrouver aux portes de Rendsburg où demeuraient ceux qu’il avait quittés.
Ne restait ceint autour des reins du vagabond qu’un peu de maigreur avec un havresac vide et des lambeaux de souvenirs, quelques mots et un rien de bonheur, une béate ignorance en contrepartie de l’énigme qui ceinture la terre.
Les hivers et les printemps qui suivirent son retour ne lui suffirent pas pour apprivoiser la langue dont il s’était éloigné. Il demeura le restant de ses jours dans son pays pour y voir clair, faire façon de la langue la plus étrange, la plus extraordinaire, la plus inconcevable qui, à mesure qu’il en déchiffrait des pans, enfouissait plus profondément ses secrets.
On raconte que l’homme de Rendsburg aima comme au premier jour la femme qu’il avait quittée autrefois, cette femme qu’il ne reconnut pas et qui l’aima elle aussi, une seconde fois pour la première fois.
Publié le 1 octobre 2010 dans le cadre du projet de vases communicants chez Marianne Jaeglé (Décablog)
Jean Prod’hom
Il y a les Roms

Il y a les Roms
les pensées arrondies
le roulement du train dans la nuit
il y a ce qui se passe quand on n’est pas là
le petit ménage des pigeons
les roses dans l’éclat de novembre
il y a le lit défait
les plans directeurs
il y a les gamins qui font bande à part
Jean Prod’hom
Jours de fête

Les esclaves
servaient à leurs maîtres
des quartiers de viande
gros comme deux fois ton visage
ils traînaient leurs chaînes
sur le sable chaud
y traçaient des signes refermés sur eux-mêmes
images abrégées de l’interminable
pas de résignation sur leur visage de cire
des fibres d’aloes roui sur le torse
une corde de peau
autour du cou
les brutes épaisses dérobaient au retour
des épis de maïs
qu’ils rongeaient la nuit
yeux grand ouverts
dans l’obscurité d’un ancien boîton
c’est tout
Jean Prod’hom
Dimanche 3 octobre 2010

N’en peux plus à minuit du marteau-piqueur qui menace ma carcasse. Il a déjà mis à mal les fondations du refuge désuet dans lequel je me trouve. Avec Arthur à 900 mètres, au-dessus de la station de départ d’une installation de ski incomplète. Avant de devoir affronter le pire je me lève, hésitant et dépité, descends à l’étage où la fête bat son plein, celle des jeunes du Cornet, ivres ou morts c’est selon. Ils sont de Crémines, de Grandval ou de Moutier et fêtent la fête. Ils sont chez eux sans rien n’en dire ni même le savoir, chez eux depuis 1500 ans, dernier rempart burgonde au-delà de Pierre-Pertuis surveillant à l’est les Alémanes de Balsthal. Chemin faisant ils se sont éloignés des chanoines de Moutier-Grandval pour partager aujourd’hui avec d’autres pénitents d’autres croyances et d’autres supplices, buvant sans compter jusqu’au matin, jusqu’à l’extinction des feux qui clignotent un peu encore dans leurs yeux. Ils fêtent la fête et la fin de la guerre froide en avalant sans broncher de la vodka mélangée à du coca-cola.
Je retourne sur ma couchette en craignant le pire, me tourne et me retourne, écoute la voix de Cendrars – Qui êtes-vous Monsieur Cendrars ? – interrogé par Emmanuel Berl, Maurice Clavel, le docteur Martin et Jean-Pierre Morphé qui ne m’apportent ni les soins ni le sommeil espérés. Je crains à nouveau pour mon coeur, me tourne et me retourne. Tombe un peu par hasard sur la piste d’un ou deux 807 qui auraient pu m’apporter un réconfort. Mais je dois batailler encore, me débarrasser d’une fallacieuse idée : trouver une arme pour en finir avec eux ou avec moi.
Puis, alors que je n’espérais plus rien, le bruit des marteaux-piqueurs et les cris des suppliciés du Cornet ont cessé, le jour s’est levé, le soleil ensuite. Et mes voisins du refuge qui n’avaient pas dormi se sont éveillés à la queue leu leu, le menton sur le manche de leur pioche, une demi-paupière battant de l’aile et souriant du pire. Une nuit sans neige ni rêve qu’il eût mieux valu mettre au compte du samedi pour garder intact ce premier dimanche d’octobre dans les pâturages de Crémines qui dominent le Grand Val où coule la Rauss.
Et tandis que je remettais mon coeur à sa place, Arthur est apparu et le soleil s’est mis à faire flamber la toison des feuillus pour préparer leurs bras à accueillir l’hiver.
Jean Prod’hom
Effet collatéral

Grande fête samedi passé au coeur du Jardin Pixel, sur la délicate pelouse qui ceint la fosse à bitume, organisée par les Éditions du Transat à l’occasion de la parution des 807 dans sa collection bleue.
Agathe, Cornaline, Lili, Lou et les autres, les garçons aussi, les papas, les mamans, les amis, les amis des amis, tous étaient présents, 807 au total à l’ombre des tilleuls.
Quant à moi, en apercevant le nombre 807 tracé à l’encre bleue sur la face externe de la cuisse de l’un des agneaux que les amis Franck et Joachim préparaient, je pris conscience que toute entreprise littéraire avait ses limites et que plus rien ne serait jamais tout à fait comme avant.
Jean Prod’hom
8 juin 2010
Copie double | Marianne Jaeglé

Sophie et moi avons été amies. Après avoir été inséparables, deux années durant, après avoir écrit des poèmes ensemble, fait du théâtre ensemble dans la troupe du lycée, et aimé le même garçon (qui a opté pour elle, ce que je comprenais parfaitement et dont je n’ai nullement pris ombrage) nous avons vécu un premier clash. La troupe de théâtre amateur dont nous faisions partie m’a désignée pour tenir le premier rôle féminin dans Caligula et Sophie, qui se destinait alors au théâtre, s’est inscrite dans une troupe concurrente et a rompu toute relation avec moi. De cette rupture, qui m’a laissée très désemparée, j’ai beaucoup souffert.
Deux ans après cette fâcherie, nous nous retrouvons en hypokhâgne, loin de nos familles respectives, dans un établissement inconnu, parmi des élèves dont aucun ne nous est familier ; un rapprochement stratégique a alors lieu. Cette année-là, je ne peux plus rivaliser. Sophie est de loin la meilleure de la classe, titre que j’ai remporté sans effort tout au long de ma scolarité mais auquel je ne peux plus prétendre. A l’âge de 15 ans, j’ai sombré dans une léthargie qui semblait devoir durer toujours. Je n’ai plus de force pour rien, pas même pour lire. M’extirper du lit chaque matin réclame déjà un effort démesuré, alors les cours… J’ai pourtant été admise en classe préparatoire en raison de notes flatteuses obtenues au bac de français ; je vis sur mon passé de bonne élève.
Sophie elle, a de l’énergie et de l’ambition à revendre. Elle excelle dans toutes les matières et les profs chantent ses louanges. Ses copies remportent de loin les meilleures notes dans toutes les matières. Je les lis pour comprendre ce qu’il aurait fallu faire, ce que j’aurais dû écrire, moi qui n’y arrive plus. Je me souviens ainsi d’un de ses devoirs de philosophie (il s’agissait d’une dissertation consacrée à la nostalgie, littéralement la « douleur de ce qui n’est plus ») ; parmi les remarques flatteuses de l’enseignante justifiant l’excellente note qu’elle lui avait attribuée, quelque chose me brûle au fer rouge de l’envie. Je ne me souviens que vaguement des annotations consacrées à la rigueur du raisonnement, à la finesse de la démonstration et à l’érudition des références, remarques auxquelles, pour ses copies, je suis désormais habituée, mais quelque chose me fait tressaillir de jalousie, et vingt ans plus tard, je n’ai pas oublié cette sensation. « Le passage concernant le vieux meuble m’a donné à penser que vous devriez peut-être écrire » avait marqué madame Jeandot parmi ses commentaires. Après avoir lu cela, je parcours en hâte la copie de Sophie, cherchant le signe de l’élection que notre professeur a su repérer dans cette copie et qu’elle n’a hélas pas vu dans les miennes. En dépit de la dépression dans laquelle je m’enfonce, je n’ai pas cessé de penser à l’écriture comme à une planche de salut, de rêver à elle.
Le passage en question, accompagné d’un trait rouge dans la marge, est un paragraphe comparant la mémoire à un meuble d’autrefois, encombré de bibelots et de témoignages du temps passé. Je le lis à plusieurs reprises, non sans perplexité. Qu’est-ce que madame Jeandot y voit ? Il ne m’évoque rien d’autre que J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans. Je n’y vois rien de spécial, sinon des réminiscences de Baudelaire, que madame Jeandot ne peut pas ignorer. Je finis par me rendre à l’évidence : il y a là quelque chose que je ne sais pas voir, ce qui est une preuve de plus de mon insuffisance. Une fois encore, j’admets que je ne serai pas à la hauteur de ce à quoi j’ai aspiré. Une fois encore, je renonce à l’écriture.
Et ce souvenir cuisant en appelle un autre avec lui, où Sophie apparaît, encore elle, la même année. Nous sommes toujours amies, d’une amitié de surface, travaillée en profondeur par une faille béante, toujours agitée de secousses. Notre attachement est une glace fragile.
Nous sommes assises toutes deux au dernier rang de la classe, au fond à droite, mais pas côte à côte. Il y a deux places libres entre nous. Je suis assise du côté salle tandis qu’elle est du côté mur. L’année scolaire est déjà bien avancée et les rôles de chacun bien définis. L’an prochain, Sophie ira à Paris, dans une khâgne prestigieuse, à la conquête de l’avenir brillant qui l’attend. Elle intègrera ensuite Normale sup, cela ne fait de doute pour personne. Pendant ce temps-là, j’irai grossir les rangs des dilettantes et des gens au futur indécis à la fac de Lyon.
Ce jour-là, le prof de français rend les copies ; nous savons que, comme à son habitude, il les a classées et les distribue sadiquement par ordre décroissant : les premières vont aux bons élèves, puis, au fil des copies, les notes baissent. Ainsi, chacun sait où les autres et lui-même se situent dans la hiérarchie de la classe. Il s’approche de notre rangée dans l’allée centrale et, sans rien dire, pose la première copie devant moi. Je la saisis et m’apprête à la faire glisser jusqu’à Sophie, quand quelque chose retient mon attention. L’écriture sur la copie n’est pas celle, ronde et régulière, qui figure d’ordinaire sur ses devoirs. C’est une écriture heurtée et anguleuse, qui m’est familière. Je ramène le devoir devant moi, et commence à lire avec intérêt ce que le prof y a inscrit.
Monsieur Cara s’est éloigné, continuant à distribuer les dissertations. A ma droite, une voix sifflante, furieuse retentit : « Je peux avoir ma copie, s’il-te-plaît ? » Et les dernières apparences de notre amitié éclatent en mille morceaux dans ce sifflement de colère. Je lève la tête vers Sophie, je lui montre la feuille. « C’est la mienne » dis-je, tandis qu’elle se confond en excuses.
Aucun prof, à aucun moment de ma vie, n’a jamais écrit en marge de mes copies que je devrais écrire. A dire vrai, personne, jamais, ne m’a encouragée dans cette voie. Mais mon envie de l’écriture était si profondément ancrée en moi qu’elle a fini, comme ces plantes minuscules qu’on voit parfois en montagne pousser dans l’anfractuosité de la roche, à force d’obstination, par surmonter les obstacles les plus durs, par croître, vivre et fleurir au grand jour.
Bien des années plus tard, j’ai appris ce que Brel pensait du talent. « Le talent, disait-il, ça n’existe pas. Le talent, c’est l’envie qu’on a de faire les choses. »
Marianne Jaeglé

écrit par Marianne Jaeglé qui m’accueille chez elle dans le cadre du projet de vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.
Et d’autres vases communicants ce mois ![]() Brigitte Célérier http://brigetoun.blogspot.com/
Brigitte Célérier http://brigetoun.blogspot.com/ ![]() Lambert Savigneux http://aloredelam.com/
Lambert Savigneux http://aloredelam.com/![]() François Bon http://www.tierslivre.net/
François Bon http://www.tierslivre.net/![]() Daniel Bourrion http://www.face-terres.fr/
Daniel Bourrion http://www.face-terres.fr/![]() Michel Brosseau http://àchat perché.net
Michel Brosseau http://àchat perché.net![]() Joachim Séné http://www.joachimsene.fr/txt/
Joachim Séné http://www.joachimsene.fr/txt/![]() Christophe Grossi http://kwakizbak.over-blog.com/
Christophe Grossi http://kwakizbak.over-blog.com/![]() Christophe Sanchez http://fut-il-ou-versa-t-il.blogspot.com/
Christophe Sanchez http://fut-il-ou-versa-t-il.blogspot.com/ ![]() Christine Jeanney http://tentatives.eklablog.fr/
Christine Jeanney http://tentatives.eklablog.fr/ ![]() Piero Cohen-Hadria http://www.pendantleweekend.net/
Piero Cohen-Hadria http://www.pendantleweekend.net/![]() Cécile Portier http://petiteracine.over-blog.com/
Cécile Portier http://petiteracine.over-blog.com/![]() Anne Savelli http://fenetresopenspace.blogspot.com/
Anne Savelli http://fenetresopenspace.blogspot.com/![]() Juliette Mezenc http://juliette.mezenc.over-blog.com/
Juliette Mezenc http://juliette.mezenc.over-blog.com/ ![]() Louis Imbert http://samecigarettes.wordpress.com/
Louis Imbert http://samecigarettes.wordpress.com/![]() Michèle Dujardin http://abadon.fr/
Michèle Dujardin http://abadon.fr/![]() Jean-Yves Fick http://jeanyvesfick.wordpress.com/
Jean-Yves Fick http://jeanyvesfick.wordpress.com/ ![]() Guillaume Vissac http://www.omega-blue.net/
Guillaume Vissac http://www.omega-blue.net/ ![]() Pierre Ménard http://www.liminaire.fr/
Pierre Ménard http://www.liminaire.fr/![]() Marianne Jaeglé http://mariannejaegle.overblog.fr/
Marianne Jaeglé http://mariannejaegle.overblog.fr/ ![]() Jean Prod'hom http://www.lesmarges.net/
Jean Prod'hom http://www.lesmarges.net/![]() David Pontille de Scriptopolis http://www.scriptopolis.fr/
David Pontille de Scriptopolis http://www.scriptopolis.fr/ ![]() Running Newbie http://runningnewb.wordpress.com/
Running Newbie http://runningnewb.wordpress.com/ ![]() Anita Navarrete-Berbel http://sauvageana.blogspot.com/
Anita Navarrete-Berbel http://sauvageana.blogspot.com/ ![]() Gilda http://gilda.typepad.com/traces_et_trajets/
Gilda http://gilda.typepad.com/traces_et_trajets/ ![]() Matthieu Duperrex d'Urbain trop urbain http://www.urbain-trop-urbain.fr/
Matthieu Duperrex d'Urbain trop urbain http://www.urbain-trop-urbain.fr/![]() Loran Bart http://leslignesdumonde.wordpress.com/
Loran Bart http://leslignesdumonde.wordpress.com/ ![]() Geneviève Dufour http://lemondecrit.blogspot.com/
Geneviève Dufour http://lemondecrit.blogspot.com/ ![]() Arnaud Maisetti http://www.arnaudmaisetti.net/spip/spip.php?rubrique1
Arnaud Maisetti http://www.arnaudmaisetti.net/spip/spip.php?rubrique1 ![]() Jérémie Szpirglas http://www.inacheve.net/
Jérémie Szpirglas http://www.inacheve.net/![]() Jacques Bon http://cafcom.free.fr/
Jacques Bon http://cafcom.free.fr/ ![]() Maryse Hache http://semenoir.typepad.fr/
Maryse Hache http://semenoir.typepad.fr/![]() Candice Nguyen http://www.theoneshotmi.com/
Candice Nguyen http://www.theoneshotmi.com/ ![]() Nolwenn Euzen http://nolwenn.euzen.over-blog.com/
Nolwenn Euzen http://nolwenn.euzen.over-blog.com/![]() Olivier Beaunay http://oliverbe.blogspirit.com/
Olivier Beaunay http://oliverbe.blogspirit.com/
Jean Prod’hom
Il y a les gares

Il y a les gares
les bus à deux étages
l’odeur de la résine
il y a les plans d’affectation du territoire
la peau des coquelicots
les portes cochères
la baguette du sourcier pendue dans le couloir
la blancheur laiteuse de l’aube
Il y a le lac démonté
Jean Prod’hom
Dimanche 26 septembre 2010

Louise et Lili grignotent un petit pain au lait sans prêter la moindre attention à la Venoge qui serpente dans un fouillis de frênes, de peupliers, de saules et d’aulnes entre Vufflens-la-Ville et Cossonay. Le train de 10 heures 45 est presque vide.
Dans le compartiment qui jouxte le nôtre une dame, vieille, écrit dans un petit carnet à anneau. Je la surveille d’un oeil avant qu’elle ne se lève et s’assoie dans le compartiment suivant. Je guigne par-dessus mon épaule, elle se penche à nouveau sur son carnet, écrit soudain quelques mots. Le manège se poursuit une seconde puis une troisième fois, elle se lève, se penche, écrit, récrit, se repenche avant de s’enfoncer à l’arrière du wagon.
La vieille dame réapparaît sur le quai 1 de la gare d’Yverdon, on dirait Alice Rivaz. Elle arrache immobile la feuille de son carnet à anneau qu’elle jette rageusement sur la voie. Je la ramasse discrètement et, tandis que Lili et Louise courent et crient sur la place de jeux, lis les mots suivants :
Se connaît-on vraiment mieux à partir de ce qu'on écrit, puisque en écrivant il arrive qu'on s'invente? J'aurais voulu naître près d'un océan plutôt que dans un pays aux paupières lentes. Un insuccès prolongé fait parfois craindre le succès comme on craint, l'âge venu, un trop grand changement dans ses habitudes. Seuls comptent ces moments de paix intérieure qu'apparemment rien n'explique, ni ne prépare. Pourquoi, Seigneur, permettre, et pire encore, vouloir que soient effacées une à une, inexorablement, toutes vos effigies? Le plus étonnant : nos deux yeux promenant leur regard à partir de leurs petites niches, selon des angles de vue limités, mais uniques.
Au retour Louise et Lili suçotent des bonbons en comptant soigneusement les voitures vertes et les camions jaunes. Elles se désintéressent de l’homme qui soliloque dans une langue qu’elles ne comprennent pas. Quant aux passagers du train de 16 heures 54 à destination de Lausanne, ils feignent de ne pas écouter. A l’inverse je tends l’oreille et entends distinctement : Ich probiere Geschichten an wie Kleider. Peu après le tunnel d’Entreroches, alors que défilent les bâtiments du tri de la poste, j’entends : Empfinden Sie die Erde überhaupt als heimatlich ? J’opine. Sur le quai de la gare CFF de Lausanne l’homme aux lunettes cerclées d’écaille, une allure de Max Frisch, disparaît dans la foule.
Jean Prod’hom
Consolations

Ecoute
le cri de l'archer
lorsque la flèche est sur le point d'atteindre son but
écoute sa détresse
car ce qu’il y a là-bas entre saules et aulnes
n'appartient à personne
pas plus que les étoiles
lorsque la seconde flèche disparaît dans la nuit
les vers des poètes
venus sur le tard
ont rongé les racines du petit matin
si bien que la lune ne se confie plus aux marécages
pas plus que l’eau aux sourciers
ils ont abandonné la partie
mangent désormais des cactus
et chantent sur la cime
le refrain des consolations
va ton chemin sans plus t’inquiéter
la route est droite et tu n’as qu’à monter
portant d’ailleurs le seul trésor qui vaille
et l’arme unique au cas d’une bataille
la pauvreté d’esprit
Jean Prod’hom
Les chemins de la création

Alors que je me promenais dans un quartier de l'ouest de la Roche-sur-Yon, j'aperçus derrière un treillis un homme qui faisait les cent pas. Je le reconnus d’emblée, c'était une des étoiles montantes de notre littérature. La propriété était charmante, tuyas et mimosas chatouillaient le muret de clôture. Plus loin sous une tonnelle un groupe d'amis faisaient bombance. Était-ce sa propriété ? je ne le crois pas, qu'importe d'ailleurs. Heureux de l'aubaine je me cachai derrière un vieux hangar et observai discrètement les faits et gestes de celui qui, à coup sûr, sera demain l'égal des immortels.
Soudain il s’allongea, posa un coude à même la pelouse grasse – elle aurait mérité, je dois le dire, d'une sérieuse tonte – qu'il scruta avec une profonde attention, comme saisi par une inspiration divine. Le poète avait visiblement pêché un gros. Je le vis alors de mes yeux s'avancer sur le sentier de la création, avec un soin et à un rythme qu'il semblait dicter aux brins d’herbe eux-mêmes qu'il écartait un à un. Trop éloigné pourtant, je ne pus accéder à la vraie source de la création, à son allure, à sa couleur, à son chiffre qu'il semblait murmurer du bout des lèvres. Malheureux je dus me satisfaire du compte des brins d'herbe qu'il pinçait délicatement. En vérité il en compta 807 exactement avant de se relever comme effrayé par un abîme. Il commit un petit hennissement avant de s’éloigner et rejoindre les amis qui l’attendaient.
J’aurais donné cher, très cher pour connaître le détail d'une aventure spirituelle qui avait certainement mené ce demi-dieu à partager le repas des dieux.
Jean Prod’hom
31 mai 2010
Il y a les regrets

Il y a les regrets
la somnolence des chemins creux
il y a l’Orcia au pied de Bagno Vignoni
le dernier ours blanc de la banquise
les images qui rodent autour de l’absinthe
le futur antérieur
les jeux qui sont restés dans l’armoire
les poches trouées de la raison
Il y a disais-tu plus de deux ans déjà
Jean Prod’hom
LXXV

Jean-Rémy a conçu un système infaillible pour éloigner les merles, les corneilles et les moineaux de ses cerisiers : crécelles, lambourdes, rubans d’argent, épouvantails, cliquetis, drapeaux tibétains,... Il a si bien réussi qu'il n’ose plus sortir de chez lui.
Jean Prod’hom
Dimanche 19 septembre 2010

Ce ne sont pas tellement les bras nus de Rachel Kolly d’Alba sur la scène de la place de l’Europe rejoignant les premières mesures du concerto pour violon de Tchaïkovski avec devant le soleil et derrière les ombres de la foule frigorifiée, ni non plus l’insouciance des jours fériés flottant tout autour des tables dressées devant le refuge des Fontaines à midi, ni l’or des vignes entre l’Avançon et la Gryonne un peu avant qu’elles ne se jettent sans se retourner dans le Rhône, sous Antagnes, à deux pas de Saint-Triphon, ni le lac qui écartait les bras cette après-midi-là comme jamais, au large de Treytorrens avec en face Meillerie, ni la présence de Ramuz ni les géraniums sur le ponton sous la voie ferrée, mais d’être là dedans avec les autres, un peu perdu sans projets ni regrets, les pieds attachés et la tête perdue à égale distance de la terre et du ciel, flottant, confondu aux forces d’en haut et à celles d’en bas, d’avoir été invité le même jour et à plusieurs reprises à la table de ce qui se suffit, sans rien souhaiter retenir sinon la possibilité même de tenir debout, soutenu par rien, avec pour voisins des inconnus auxquels on sourit et des noms de lieux qu’on murmure pour gagner par le détour des cols et des montagnes à petits pas l’invisible lieu, y demeurer sans fin avec le soleil et le ciel violet dont on dira plus tard que, s’ils avaient bel et bien facilité l’accès à la sagesse rédemptrice de celui qui n’a rien, n’interdisaient pas qu’on songe en contrepoint à la pluie et aux bourrasques qui reviendraient, qu’il serait toujours temps de se rappeler qu’on s’était dit alors avec la voix du dedans que le temps qu’il fait, ce qu’on est et le lieu qu’on occupe n’y sont pour rien, et que cela il ne fallait si possible pas l’oublier.
Jean Prod’hom
Bouvetages

Des plumes sur l’eau
impossible de s’en aller
image profane au pouvoir accru
à la lisière du bois
le chant d’un oiseau
dans une cage les dépouilles d’un tigre
capturé puis oublié
des sonnailles pendent
aux poutres du cabanon
ce sont les restes d’un décor grandiose
les bienfaits se déployaient en nombre
les outils d’artisans adroits
ciselaient les pièces uniques
que des doigts délicats ajustaient
sur la nuque des fortes têtes
on venait de toutes les îles
pour goûter aux herbes de confidence
et malgré la confusion de leur approche
on aimait la naïveté des peuples de l’ouest
qui ne rataient pas une occasion
de faire main basse sur nos secrets
tel était le cadre des représentations
il aurait suffi d’une autre mise en scène
mais c’eût été celle de la suffisance
c’est aussi et à son insu
le tableau général de l’imaginaire
d’un provincial terrassé
par les dimensions de son entreprise
les quelques jalons
d’une aventure improbable
Jean Prod’hom
LXXIV

C’était un homme des maquis, un aventurier du temps des colonels, un enfant, résistant, poursuivi, torturé, réfugié.
Voûté en raison d’une vilaine sciatique qui le taquine, il est aujourd’hui contremaître d’une petite entreprise de services. Il a gravi les deux marches qui l’ont conduit aux portes du commandement mais il n’a pas franchi le pas, le pouvoir il n’aime pas, il ne peut pas, pensez donc! mais qu’on ne lui en veuille pas, l’hidalgo cherche la paix, qu’on ne l’ennuie pas, débrouillez-vous et pourquoi pas.
Mais le rescapé sourit d’aise, il croit dur comme fer que son rang lui est dû, courage et mérite. Il ignore qu’on s’est tous cotisés pour faire taire son silence, l’aider à oublier ses frasques et qu’on n’en parle plus.
Regardez-le manoeuvrer en silence, l’homme ne fait couler aucune encre. Il est devenu à tout petits pas le lieutenant qu’il a combattu autrefois, on est tous désarmés. Il empoisonne doucereusement la vie de chacun en distribuant satisfecit et somnifères. Derrière ses paupières une indéfectible présomption fait la roue, il n’écoute pas mais dort.
Chaque été il change d’univers, plonge dans les eaux de la mer Rouge pour y laver sa nonchalance. L’homme n’est plus tout à fait vivant, englouti dans une nuée de poissons multicolores et les souvenirs de ce qu’il a été.
Jean Prod’hom
Il y a les vendanges tardives

Il y a les vendanges tardives
les pâturages boisés derrière Peuchapatte
il y a l’obstination
il y a les noces des voies ferrées et de la camomille
les mots immenses qui nous maintiennent en semi-liberté
l’odeur de la poussière après la pluie
les chemins de halage
le simple qui préserve l’énigme
il y a dans les bois des filets d’eau auxquels on n’a pas donné de nom
Jean Prod’hom
LXXIII

Le philosophe glissait palier par palier le long des abruptes parois de la connaissance, ponctuant sa descente aux enfers d’au fond... au fond qui donnaient le vertige. Il allait toucher le fond quand, levant la tête, il s'avisa qu’on barbotait à la surface en attendant le moment des petits fours. On s’inquiéta, il pâlit. Il se hâta sans consulter ses tables de décompression, on dut appeler le SAMU.
Jean Prod’hom
Hospices généraux

Dans la plaine
nue
ni érable
ni verne
melons cultivés en vain
dans la plaine nue pelée par les vents
dans la plaine nue rongée par le sel
on planta
des abricotiers
bien au-delà des dunes
on aménagea
des mines désaffectées
soustraites au regard
au fond desquelles
l’ombre retrouva sa vigueur
on ajouta sur le perron
des devantures de soie
et des grappes de monardes
il suffisait d’une retraite là
disait-on
d’une robe de bure
au charme désuet
de quelques sous
pour soigner ses reins
son mal à l’âme
ses tics adultères
les notables retrouvaient le goût du luxe
les anciens la paix
les déprimés une solide stupeur
les financiers leurs dettes
et tandis que dedans
on chantait grave
on apercevait certains soirs
le culs de deux jars s’éloigner
de l’auge vernie
au-dessus tournoyait un geais
prêt à payer son tribut
pour quitter ce quart du soir
aux faux rouages
et aux étais de fortune
plus de doute ici
on aura beau affiner
ajouter des outres au jour
endosser un tricot d’immortalité
il ne faudra compter
sur aucune aide
sinon peut-être
sur celle de ce char abandonné
de hauts épis luisants avec
Jean Prod’hom
Dimanche 12 septembre 2010

Tu serais née dans les quartiers nord de Tirana et tu serais arrivée il y a 15 ans en Suisse: la Chaux-de-Fonds d’abord, Tramelan-dessous ensuite. Tu aurais trouvé là une chambre et un emploi tout près de la gare, à l’Hôtel de l’Union, pour faire la plonge, t’occuper des chambres et assurer le service du petit déjeuner le dimanche matin lorsque l’hôtel est fermé. Tu n’aurais pas rencontré tout de suite parmi les 4500 habitants que compte cette ville du Jura bernois l’homme de ton pays, né à Lezhë au fond de la baie de Drin. Il serait arrivé là pourtant peu après toi, à Tramelan-dessus plus exactement, à la suite de brèves haltes à Bâle et à Tavannes. Il aurait été engagé pour des travaux de pelle et de pioche dans la carrière Huguelet. Vous ne vous seriez rencontrés que l’été suivant à l’occasion d’une fête de la musique et vous vous seriez mariés peu après. Plus tard les Huguelet auraient encouragé ton mari à passer un permis poids-lourds et l’auraient bien aidé en cela. Tu l’aurais toi aussi encouragé. Vous auriez eu ainsi les moyens de louer un petit appartement dans l’une des barres qui blanchissent l’herbe au-dessus de Tramelan-dessous, posées à même les pâturages. Et ce matin, parce que cela fait exactement 15 ans que tu es là, tu te serais souvenue de la truite et des pommes de terre en neige goûtées un soir d’hiver à l’auberge de la Theurre, de ces instants sur la terrasse de l’Union le matin avant l’ouverture de l’hôtel, des pierres tombales entassées rue Jeanbrenin, de l’or de la carrière les samedis soir de soleil, de l’étang de Gruère avec tes deux enfants le dimanche après-midi. Tu aurais dit ne jamais t’être intéressée à la question jurassienne, à mille milles des démocrates chrétiens des Franches-Montagnes et des socialistes bernois. Tu aurais ri en évoquant les noms des hameaux de la Large-Journée et de la Chaux-d’Abel. Nous aussi.
On t’a vu dimanche matin, tu t’es assise à notre table, et tu nous as parlé dans un français rudimentaire de la vie qui t’a menée là, une vie suspendue comme celle de chacun d’entre nous entre Tramelan-dessus et Tramelan-dessous, comme si personne n’était encore arrivé à bout de l’hiver qui revient avant même qu’il ne soit terminé.
Jean Prod’hom
Derniers instants

Hier soir, il avait dû compter 807 moutons avant de s’endormir. Ce matin il a beau chercher, dans tous les coins des verts pâturages et près des eaux paisibles. Il en manque un. Il appelle, appelle, appelle, appelle...
Quand tu seras mort, je serai où ? demande Lili.
Tout se joue en définitive à un rien : tu meurs de bonne humeur, en prenant le temps, sous un beau soleil de printemps, et l’éternité devient un enchantement ; tu meurs dans la précipitation, un soir d’arrière-automne pluvieux, alors que tu ne te souviens pas si tu as fermé la porte du poulailler, et l’éternité devient un véritable cauchemar.
Jean Prod’hom
23 mai 2010
Revenir là où on n’en a pas fini d’aller

Cette image forte m’est restée, tout ce que j’ai ensuite appris de ce jour-là s’est accroché sur elle.
Jean-Loup Trassard, La Déménagerie, 2004
Poivrons, pommes, courgettes et aubergines au croisement du Valentin et de Riant-Mont, abricots, oignons et cerises, fraises et melons au gré des saisons, c’était notre Sicile à nous, celle de Zappelli, un modèle réduit de Borgo Vecchio, une île exotique au pied de locatifs en cale sèche et de studios modernes vieillis prématurément. L’homme ouvrait son épicerie dès l’aube, elle fleurait le sud bien au-delà du quartier, c’était Palerme alentour à toutes les saisons.
La mère chargée comme une mule remonte du centre-ville, elle tire d’un côté sa poussette de marché, de l’autre un enfant qui s’attarde devant les merveilles, il faut se hâter, bientôt midi. Le petit tend la main et saisit une paire de grosses cerises, belles, rouges et craquantes, croque et boit le soleil retenu dedans, il est aux anges. La mère s’est retournée, elle a surpris l’enfant mais ne dit rien. Ils continuent, passent devant la boulangerie, montent les marches qui conduisent à l’appartement. Et tandis que l’enfant croque le cœur de la seconde cerise, sur le pas de la porte, la mère range les courses au fond des placards de la cuisine. Et puis elle se penche vers son enfant et lui explique ce dont ses demains seront faits, il ne comprend pas. Elle s’étend sur les règles du monde, la loi des échanges, il ne comprend toujours pas, mais il voit quelque chose qui s’éloigne, ce n’est pas grave, lui dit-elle, ce n’est pas un crime mais quand même. Elle lui souffle alors le texte qu’il devra servir tout à l’heure à l’épicier, dans lequel il est question d’excuses et de pardon. Il commence à comprendre et semble deviner qu’on le conduit dans l’antichambre d’une histoire sans fin, elle ferme la porte des placards, celle du frigo et de la dépense. Les fers du grand portail claquent. L’enfant sent qu’il a basculé dans l’autre monde.
Monsieur Zappelli, les mains dans les poches de son tablier bleu, écoute avec bienveillance l’enfant qui lui dit ce que chacun d’entre nous dit depuis qu’il est sorti du jardin. L’enfant n’est pas triste, il fait son devoir. La mère surveille soulagée que tout se passe finalement si bien. Ils sont tous les trois sur le trottoir, ils sourient presque, avec tout près les aubergines, les abricots et les cerises qui n’ont pas cessé de lancer leurs éclats. L’enfant est heureux d’être parmi eux, il ignore encore ce qu’il a perdu. Eux s’en rappellent, et sur les visages immobiles de l’épicier et de la mère apparaît un sourire qui exprime un sentiment inconnu. Ce n’est pas un sourire, à peine une trace, la trace de ce qui coule au-dessous des souvenirs et qu’il leur a bien fallu tenir à distance. Une porte se ferme encore, et voici l’enfant, l’épicier et la mère à la rue.
Car on n’échangeait rien au jardin, en tous les cas rien de main à main, les bruits du vent peut-être et un peu des poussières du ciel qu’on remuait sans qu’on le sache. On ne touchait à rien, ou on prenait tout, on se touchait à peine, ou on ne faisait qu’un. On demeurait toujours à respectable distance les uns des autres et on arpentait l’île sans se lasser. Qui était-on ? A peine des coques de noix chahutées sur une mer qu’on ne partage pas. On ne se parlait pas, on suçotait le trèfle, on faisait fuir l’hiver, on disait ce qui était. C’est l’écho de nos proférations que renvoyaient les façades des immeubles qui définissait les limites de notre royaume, abrité par les hautes frondaisons de deux acacias et d’un tilleul, par des sureaux, par les ronces qui s’enroulaient autour de fers acérés, invisible limite au-delà de laquelle nos mots ne revenaient pas. Aucun mur ne nous a jamais retenus, c’était curieux comme on avait tout dans les mains et qu’on ne s’y trompait pas. On est tous partis lorsqu’on nous a fait comprendre qu’il était temps d’aller de l’autre côté. Le grand portail que surveillait la mère Niquille a claqué une fois encore derrière Michel, François, Claude-Louis, Edith, Lilas et les autres. On a tout perdu. Et le royaume qu’on avait sous la main, on a essayé de l’obtenir, chacun pour soi, morceau par morceau, en suivant le parcellaire levé par d’anciens propriétaires et la dure loi des échanges, en vain.
Chaque fois qu’une porte s’ouvre désormais, je guigne pour savoir si l’enfant que j’étais n’a pas réintégré le jardin qu’il a quitté, celui d’avant les échanges sans lesquels il ne serait pas devenu celui qu’on attendait. J’aperçois toujours la même ombre et les fleurs d’un cerisier, je serre alors, conservés au fond de mes poches, les tessons qui m’ouvrent les portes de ce qui n’aurait jamais eu lieu autrefois si je n’y retournais pas.

Publié le 3 septembre 2010 dans le cadre du projet de vases communicants chez Joachim Séné (Fragments, chutes et conséquences)
Jean Prod’hom
25

S'extraire du fleuve qui nous emporte, tirer derrière soi une ou deux choses qui sont restées dans le filet du langage et, comme Héraclite, bricoler une image en usant des moyens mis à notre disposition par la tradition, avec des échéances, comme un artisan.
Ça y est. C’est fait. Ça y ressemble un peu.
Jean Prod’hom
Il y a les fleurs des châtaigniers

Il y a les fleurs des châtaigniers
les beaux jours de l’arrière-été
les reins de la terre soulevés par les fers de la charrue
l'insouciance des idiots
il y a Vaduz
il y a ce qui s’est passé là-haut et dont on ne sait rien
les seigneurs de la nuit
les histoires auxquelles on croit encore un peu
il y a la foi des petits artisans
Jean Prod’hom
Jeux

L’intendant prépare
dans l’arrière-boutique
des couronnes de laurier
qu’il glisse dans une corbeille
salix viminalis
il dresse au fond d’une niche
les javelines
dont les pointes sèches
sont fichées
au coeur de lourdes pastèques
derrière les parois des huttes
et les ourlets de la gêne
des métèques frictionnent
le dos des combattants
héros encensés puis niés
plus tard occis
ils se mirent dans de larges bracelets d’or
on chante c’est un mélange de liesse
de labours et de musc
jours de fête
étranglés par la pince
des princes et du temps
vil hochet
placé entre les mains
d’hommes peu scrupuleux
il n’y eut pas de répit pour les condamnés
je hèle, ils déraillent et tu brodes
avant que les mailles ne s’emmêlent
et rendent l’insurrection impossible
on servait à la cantine
de la gnôle et du lait
on avait viré l’honneur
qui se vautrait au fond de niches empaillées
fallait pas se fier au nombre de box
les juments et les pouliches
depuis longtemps déjà
avaient abandonné la partie
assis et seul
près de la haie
l’enfant de l’un des colosses
pleure
il voit les larmes de son père
goutter sur l’arène
Jean Prod’hom
Dimanche 5 septembre 2010

Au clocher d’Hermenches l’horloge n’avait qu’une aiguille – qu’une main. Pas de minutes, de belles heures toutes rondes, jamais mordues.
Gustave Roud
![]()
Le vent officiait très haut à l’heure du culte et le ciel était nu. Daniel avait labouré le champ de blé rentré il y a une semaine et l’horizon s’était abaissé d’un bon mètre. Il avait passé la herse la veille si bien que la terre était montée – avec des crêtes de chaume – jusqu’au pied du potager, elle léchait même ceux du banc sur lequel j’étais assis. Une faible bise, orientée est-nord-est, a fait monter soudain le tintement sourd des cloches des villages en contrebas. Un tintement lointain, à peine perceptible, assez toutefois pour réveiller ceux qui ne dorment pas et les débarrasser des petits soucis qui guettent ceux qui n’ont rien à faire.
Des aiguilles, les horloges n’en avaient plus aucune ce matin, et le temps s’est mis à écarter les bras, et tous ceux qui tendaient l’oreille se sont mis à espérer que les cloches, lorsqu’elles faisaient mine de se taire, rajoutent une mesure à Carrouge ou à Mézières, pour creuser un peu plus encore la campagne, jusqu’au silence qui règnerait cet après-midi dans les déserts, les beaux et précieux déserts de nos dimanches.
Jean Prod’hom
Guide de l'Imrie I Joachim Séné

PSTOPH
Imrie, Province du Pnou
32 000 habitants (Pstophiens)
Ville à éviter + + +
Ils n’ont ni plus ni moins de colère que nous, ni plus ni moins de bonheur que nous et pourtant les Pstophiens crient sans cesse. Leur ville est située dans l’Enclave de Cône, petite cité dans la montagne au sud du Pnou, tout au fond d’un cirque impraticable. D’après l’ethnologue Roba Silmour, le volume sonore de leur voix est le résultat d’une longue sélection sociale. Les puissants organes des Fanors, lignée de chefs, furent chassés du pouvoir comme ils y étaient venus : au cri. Ce jour là, vers 500, le peuple dans la rue cria, et parmi les crieurs les plus puissants furent envoyés devant. Aussitôt que les Fanors eurent abdiqués ceux de devant prirent leur place. Leur facilité à parler fort leur permit de s’imposer et de durer tout en faisant taire les oppositions, de plus faible volume. Après quelques années de tyrannie la population compris son erreur et on procéda de nouveau au cri vociférant et insurgé qui propulsa sur le trône de nouveaux crieurs qui surent et remplacer le pouvoir en place et faire comprendre au peuple son intérêt à les laisser là. Etc. La pratique du cri devint la pratique politique, puis la pratique sociale. Sans cri, pas de pouvoir. Sans cri, pas de place au théâtre. Sans cri, pas de place à l’école. Sans cri, pas viande fraîche au marché. Sans cri, pas de bon salaire. Sans cri, pas de place dans le bus, pas d’allocations familiales, pas de cadeau d’anniversaire, pas d’essence, pas d’eau, pas de café, rien ; sans cri pas d’existence vraiment.
Cela dure encore. Aujourd’hui, le volume sonore moyen d’un seul Pstophien est plus fort qu’un chœur de quatre de nos ténors. C’est à dire qu’ils parlent ainsi, naturellement, comme nous ne pouvons même pas hurler à mort. Sans s’en rendre compte, ils tendent les muscles de leur cou, ouvre la bouche en faisant descendre la mâchoire jusqu’au bas du cou, ont le visage rouge, les yeux exorbités, et cela pour vous indiquer seulement l’heure ou vous demander de leur passer le sel. On remarque aussi les larges épaules, les cages thoraciques développées, les ventres ronds et les nez proéminents où résonne la parole.
Roba Silmour n’a pu visiter longtemps cette ville, victime d’une extinction de voix chronique et ayant perdu plus de la moitié de ses capacités auditives en quelques semaines.
Il arrive qu’un Imrien sourd parte s’exiler là-bas. Aucun n’est jamais revenu, ils préfèrent y rester. Parfois c’est un Pstophien muet qui s’en va, chassé par la force des choses, ignoré, exclu, banni de fait. Il ne nous raconte rien, incapable de répondre à des questions qui ne sont pour lui que vagues murmures.
Lors d’une randonnée le long du Cône, sans même aller vers la cime de la chaîne circulaire qui enserre l’enclave, vous entendrez une rumeur incessante qui déboule le long du versant et descend mourir en roulant dans la vallée : ce sont les conversations de la ville qui émergent continûment, comme les fumerolles suivent l’éruption.
Joachim Séné

écrit par Joachim Séné qui m’accueille chez lui dans le cadre du projet de vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.
Et d’autres vases communicants ce mois ![]() Christine Jeanney et Pierre Ménard
Christine Jeanney et Pierre Ménard ![]() Joachim Séné et Jean Prod'hom
Joachim Séné et Jean Prod'hom ![]() Michel Brosseau et Christophe Sanchez
Michel Brosseau et Christophe Sanchez ![]() Kouki Rossi et Florence Noël
Kouki Rossi et Florence Noël![]() Anita Navarrete Berbel et Piero Cohen Hadria
Anita Navarrete Berbel et Piero Cohen Hadria![]() Maryse Hache et Florence Trocmé
Maryse Hache et Florence Trocmé![]() Anne Savelli et Loran Bart
Anne Savelli et Loran Bart![]() Daniel Bourrion et Brigitte Célérier
Daniel Bourrion et Brigitte Célérier![]() Arnaud Maïsetti et Stéphanie K
Arnaud Maïsetti et Stéphanie K
Il y a le chant du coq à midi

Il y a le chant du coq à midi
les vieux qui font la sieste
les couleurs des crépis passés
la dernière marche de l’escalier monumental qui monte au Congrès
il y a les bons comptes
il y a la pile de chemises de celle qui ne reviendra pas
les hanches larges des lourdes péniches
la pierre ollaire les soirs d’automne
il y a les galets de Lambi
Jean Prod’hom
Plus jamais ça

Dans un récipient d’épines
deux vautours tisonnent
un feu d’idées faisandées qu’ils jettent
dans le coeur des poètes
mélangées à de la pénitence
avec du sacrifice
tandis qu’au confluent des ruisseaux
et des eaux usées
aux yeux laids
des poissons anémiques
répondent
ceux de la belle inconnue
le nombre harassé
a la corde au cou
exit les clés du rêve
de la dernière combattante de l’été
nous saurons bientôt
les éclairs litigieux
aperçus au fond des apories
de l’austérité née là
de la combinaison de six dés ivres et noirs
vivre avec eux soit
mais plus jamais
à l’ombre
des divinités vertueuses
loin de la vaillance des orties
et des lampes au rais douteux
c’est c’est là c’est là
ramez c’est par là
Jean Prod’hom
Dimanche 29 août 2010

- Dis, toi tu connais vraiment beaucoup de monde étanche ?
- Non ! quelques-uns seulement, et quelques-uns qui le sont qu’un peu. Quant à dire complètement étanches, ça non, je peux pas le dire, c’est rare. Disons deux ou trois, j’entends de vraiment étanches, Michel est étanche.
- Ouais, Michel c’est sûr. Roby est étanche aussi, et toi je crois que t’es aussi étanche.
- Ouais pour Roby, mais son frère, ça jamais. La Raymonde non plus n’est pas étanche. Sur beaucoup j’ai changé d’avis, t’as trop de gens que tu crois étanche, et puis ce que tu as dit un jour, tu l’entends dans la bouche d’un autre, déformé. Ça c’est dur. Pierre-Georges n’est pas étanche, Armand n’est pas étanche, Mais sais-tu ce qu’il m’a dit l’autre jour à Vulliens ? Tu devines ?
- Qu’est-ce qu’il a dit l’Armand ?
- Il a dit que t’étais pas étanche. Tu te rends compte un peu le salaud. Après ce qu’il t’a fait.
- Ah tu le savais?
- Tout le monde le savait.
- Ah bon ?
- C’est là où le bât blesse. Si seulement celui qui n’est pas étanche parlait à un type étanche. Mais c’est jamais le cas. Trop de gens qui sont pas étanches. Bryan n’est pas étanche, Loïc pas étanche. Et ta femme ?
Ma femme est presque étanche. Mais pas assez, je m’en suis rendu compte, pas parce qu’elle redzipète ce que je lui ai dit, mais parce qu’elle transforme ce que je ne lui ai pas dit. Non ma femme n’est pas étanche, je ne lui dis plus tout ce que je sais et ce que je pense, ma femme c’est un peu comme la tienne.
- Exact collègue ! Moi aussi j’aime les gens étanches. Mais disons qu’il faut pas être étanche comme Roger qui ne dit rien.
- Ecoute, ils auraient mieux fait d’éteindre la sono.
Des vrombissements montent de devant leur ventre bedonnant, des grondements de caverne, nocturnes, humides. Ils sont trois côte à côte derrière l'école de Vulliens, chemise blanche, cheveux gris, la rondeur des sages. Ils ont laissé au repos leur bras droit, une main morte au bout; ils tiennent de l’autre, par le collet, un cor des Alpes descendu de Villangeaux, qu’ils vissent et dévissent pour approcher le fragile équilibre des harmoniques. Ils soufflent avec soin, retiennent le tonnerre, tendent l'oreille à gauche et à droite pour tenir ensemble les rênes de voix qui ne veulent en faire qu'à leur tête. Ils y parviennent un peu et c'est encore plus beau ainsi.
A la fin ils demandent un peu d’emploi à leur bras droit pour éponger leur visage. Il s’en vont le cor sur l’épaule, la main gauche dans la poche de leur pantalon, lentement, comme des cow-boys.
Jean Prod’hom
Ligatures

Un être humain sans ombilic, c’est évidemment inconcevable ! Mais j’avoue qu’il m’est plus difficile encore d’imaginer que ma mère ait pu en posséder un avant ma naissance. Pensez donc. À moins d’admettre, évidemment, qu’elle ait donné naissance à un autre moi avant moi.
Quatre girafons et un lama, des tigres et des tigrons, deux pandas et leurs petits, une coccinelle et un yéti, oursons, loups, chiens et chats,... 807 peluches. Trop c’est trop. Mais qui les nourrira petite Lili ? Viens vite, prends avec toi Jeannot Lapin et Antilopa. Assieds-toi là, près de moi. Il est temps, je crois, de t’enseigner comment castrer un lapin papillon et ligaturer les trompes d’une gazelle de la reine de Saba.
Jean-Rémy en avait rêvé depuis toujours, être chez lui, vraiment chez lui et ne rien devoir à personne. Sitôt qu’il le put, il acheta une petite maison dont il condamna aussitôt les ouvertures, il fit dresser des palissades tout autour du jardin, il renonça enfin au téléphone, à l’électricité, à l’eau, bien trop intrusifs.
Mais ce matin Jean-Rémy souffre, un couteau sur le ventre. Lui reste la plus délicate opération : se débarrasser de ce que sa mère lui a laissé, un petit morceau de chair, cet ombilic qui ne lui appartient pas.
Jean Prod’hom
13 avril 2010
Etoile filante

Une triplette habitée par le nombre d'or, sur laquelle le poète s’était penché des années durant, une triplette du tonnerre de dieu, élancée, 807 au garrot, une triplette sans tenon ni mortaise, inimitable bijou, de jade et d'or, une triplette solide comme le Mönch, l'Eiger et la Jungfrau, liquide comme les Trois-Lacs, aérienne comme un long courrier.
Le poète la confia au maître d'oeuvre, qui la refusa. Pas dans la ligne, disait-il, pas dans la ligne. Mais dans la ligne de quoi, la ligne de quoi, pour qui se prenait-il cet aiguilleur du ciel, pour qui se prenait-il, pour qui ?
Gilooly retrouva le divin objet au milieu d’une poignée d’autres triplettes refusées, mêlées à des feuillets du Cantique des Cantiques et du livre de Job, dans la carlingue d’un long-courrier qui avait piqué du nez dans le sable de Choir. On connaît la suite.
Jean Prod’hom
16 mai 2010
24

Débiter le réel, dégrossir le complexe, trancher le protéiforme, dérouler l'insaisissable, mettre en ligne l’ensemble des fragments de gauche à droite et de haut en bas sur une portée aux innombrables lignes de fuite. Puis abouter les chutes, les dyslexier hors toute hiérarchie, quitte à les bredouiller, les bégayer; accueillir les sosies, libérer la page de la page, creuser des galeries, inviter les taupes, gauchir. Faire voir les conséquences, c’est-à-dire les feux d'artifice, c’est-à-dire les paysages insensés devant lesquels la page s'est embrasée.
Jean Prod’hom
Il y a le pardon

Il y a le pardon
la courbe des chemins à double ornière
les hirondelles
les chiens qui ont déserté leur niche
il y a les lieux-dits qui tiennent parole
il y a les engagements qui allègent
la main courante de Riant-Mont
les groseilles des sorbiers
il y a les ombres avec lesquelles on devise
Jean Prod’hom
Migration des hirondelles

Pendant plusieurs décennies
les sages tentèrent en vain
de fixer de l’intérieur
les traits des diverses catégories
ils débouchèrent
malgré les précautions
sur les enfers du car et du mais
les savants déchus
grandes gueules
aux crocs émoussés
affalés au creux du chemin
qui serpentait alors
dans l’axe de la contrainte
se nourrirent des dépouilles des damnés
et des restes de la jeunesse
qui courbait l'échine
devant les héros
et leurs impérieuses manies
malheur aux guerriers mous
qui se contemplent
dans le tain déformant de la nuit
fatiguées des maigres rondeurs
sur lesquelles
les flots avaient baissé les yeux
les hirondelles
au corselet blanc
cotte haut-plissée
s’enfuirent dos au vent
Jean Prod’hom
Dimanche 22 août 2010

Aujourd’hui comme il y a quelques jours j’ai maintenu un bref instant, en équilibre et dans la fraîcheur, l’humeur gagnée sur le cortège des contrariétés qui me guettaient dès l’aube. J’ai avancé réconcilié sur le chemin qui monte à la Mussilly en longeant celui qui traverse l’extrémité du bois Vuacoz et celle du bois Faucan jusqu’à la Moille-au-Blanc, avec le sentiment qu’aucun événement n’aurait raison de mes nouvelles dispositions dont je savais pourtant par expérience que le temps était compté. Chacun de notre côté mais faits du même bois. L’aboiement de chiens en semi-captivité et de leurs maîtres aux abois, la menace des petites taches sombres de l’avenir qu’on s’invente, les impolitesses de nouveaux riches présomptueux que suivaient deux demoiselles au sourire servile n’ont pas entamé la tranche de belle insouciance, simple et fragile, dans laquelle je m’étais retrouvé. Tout cela ne tenait à rien, mais tenait, se poursuivait même, en partie peut-être par la résolution prise en cours de route de partager ce qui ne m’appartenait pas en tenant à bonne distance ceux qui n’avaient que l’allure des rois. Equanimité d’un seul instant mais qui laissait quelque part dans le paysage l’assurance qu’il pouvait en être ainsi si je gardais à l’esprit – comme on le fait avec une prière – l’assurance que le règne d’un horizon guéri du prurit de l’avenir, sur lequel le dedans et le dehors avancent en équilibre, n’est pas le règne des fins.
Dans tout cela l’écriture n’y est pour rien. Elle n’est qu’une autre ligne d’horizon, sans importance réelle, dans laquelle l’horizon vrai se mire parfois et trouve une image réconfortante de l’avenir, elle est alors comme l’au-delà réduit de l’horizon vrai nettoyé des scories de l’histoire.
Jean Prod’hom
C'était comme une île en terre ferme

Mais souviens-toi, personne ne t’a obligé – lorsque cette place occupée depuis toujours te fut octroyée – de chercher, et trouver peut-être, une issue aux trop évidents égarements de ceux qui nous ont précédés. Chacun a tenté de son plein gré l'impossible, a bataillé les moulins, tendu des pièges aux fantômes. Tu as déminé les ritournelles et les mauvaises habitudes des souvenirs, tu as écarté les nuages et les paradis artificiels jusqu’à te satisfaire du petit lait. Je n’ai pas hésité de mon côté à concevoir d’autres conditions initiales et des plans imprévus, tu as écarté mes vaines croyances. Bref on a tout donné en espérant que nous serions en mesure sinon de régler la folie du vaisseau sur lequel nous étions embarqués, tout au moins de le détourner de l'impasse vers laquelle il se dirigeait ou de ralentir sa course. Sans succès. On a ajouté de la brouille à la brouille. Comment aurait-il pu en être autrement ? Il le fallait toi et moi.
Et puis d'échec en échec, las des défaites, on s’est pris à croire que nous étions des incapables tout juste bons à laisser derrière nous cette agitation, à la glisser sous le tapis et à rejoindre les idiots. On a pris un peu d'avance, on s’est extrait du cortège et on a proposé à notre corps et à notre esprit en déroute l'espoir qu'on pourrait se débarrasser de leurs arriérés. Et à la fin, à la fin seulement, on a commencé ce qu'on avait toujours différé. Tu as sorti le cou, je me suis débattu, on n’a pas vu le bout mais on a respiré enfin. Tu as écarté les brouillards comme le poisson le fait avec la mer et je suis allé en haut, plus haut que les hauts pâturages, ces pâturages dont le berger avait interdit l'accès à ces moutons, là où il n’y a de place pour personne, plate-forme dernière qui ne mène nulle part. Je me suis trouvé seul sous le ciel qu'on devine derrière le ciel, avec pour seul compagnon le sourire flottant des linaigrettes. Il n'y avait rien sur cette île inconnue de tous, mentionnée nulle part. J’y suis resté un bref instant. Je me suis rappelé soudain tout ce que j’avais laissé en arrière et les mots par lesquels tu m’avais averti que je ne ferai rien sans eux.
Et nous sommes redescendus, et on a construit au milieu du continent une île au fil de l'eau, et on s’est tus, on n’a pas bougé pour ne rien embrouiller. On savait que ce qui n'avait pas encore commencé, ou qui avait commencé sans nous, referait surface et commencerait enfin. Et on a laissé aller en avant ceux qui reviendraient là où s'enlise le secret de soi seul, le retour du même. Tu ne voulais pas plus, moi non plus. L'éternel du même est d’un temps, tu as raison, il n’y plus rien après.
Jean Prod’hom
23

Sache que lorsque tu t'enrichis, quelqu'un s'appauvrit là-bas. C'est tant pis pour toi.
Jean Prod’hom
Il y a les îles

Il y a les îles
le ruisseau qui se gargarise
les dernières heures du capitaine Nemo
les fenêtres ouvertes des maisons vides
il y a le bus de la poste qu’on avait cru déjà passé
il y a les dettes sans contour
l’empreinte de la main du père
les fraises des bois tiédies par le soleil d’août
il y a le banc du chemin des Tailles
Jean Prod’hom
Giratoire

Au centre du premier cercle
clos humide envahi par les ronces
se dresse une pile colossale
entourée de vénération
de pierres précieuses
de gazon
de bijoux
voici le second cercle
celui de l’à-peu-près
y serpentent jusqu’au canal
une nuée de laissés-pour-compte
qui suivent le tracé de la piété
fortifiée
par l’usage des armes
voyez à la fin le préposé
qui éponge
le trop plein
de catégories
qui s’écoulent
dans le troisième cercle
Jean Prod’hom
Dimanche 15 août 2010

De la brouille monte des fonds de la vallée de l’Eau Froide et plonge dans la grisaille les collets du Tarent et du Para, jusqu’à leur tête, la mienne aussi. Inutile de chercher le refuge des Grenerets sous le col du Seron, on n’y voit rien. Un peu plus loin pourtant, du côté du levant, on distingue des mouvements au-dessous de la nappe grise qui s’effiloche, ce sont les moutons de Valentin descendus des Arpillettes qui paissent entre deux torrents, une coulée de points blancs s’égoutte entre la Cape au Moine et la Chaux, elle rejoint le gros du troupeau. Ils resteront là suspendus dans la pente tendue, sous le sentier qui monte à flanc de coteau d’Isenau et se perd dans des plis lointains. Ils remonteront tous ce soir talonnés par les chiens jusqu’au plateau des Arpillettes, avec son refuge tout neuf financé par la commune des Ormonts, à cause des deux chèvres tuées il y a une année par le loup sous Derborence, à cause de ce même loup, ou un autre, qui rôdait à Pâquier Mottier au fond de l’Etivaz.
Je resterai donc aujourd’hui dans la brouille, en bordure de ce qui est, dans mon giron, comme Valentin et ses moutons, comme nous tous en définitive : le gros du réel ne nous appartient pas et on passe immanquablement à côté. Je m’enfoncerai pourtant plus encore dans le puits sans fond, en grimpant les 400 mètres qui me séparent du ciel, plus haut, en haut la Palette, avec l’insensé espoir d’y trouver le soleil, le lac d’Arnon par une trouée, la flaque du Chalet Vieux et le premier anneau des alpes bernoises. Mais toujours rien, aussi haut et loin que je lève la tête, pas même les restes d’Isenau et de sa mi-été, pas un bruit. Ou à peine quelque chose, quelque chose comme un vertige engendré par la brouille et la fatigue, un miroir qui ne renvoie rien. Dans l’herbe pourtant, lourde et humide, une ribambelle de linaigrettes, tignasses soyeuses au vent, sourient légères à leurs voisines, sérieuses et immobiles.
Et moi, possédé par l’idée d’un possible retour du soleil, sans crainte jusque-là des représailles, fatigué d’être monté si haut, je roule en bas les Lués qui plongent sur le lac Retaud, inquiet soudain d’avoir fait le loup, d’avoir quitté le groupe un instant – mais il le faut bien si l’on veut retrouver le gros de l’affaire, et goûter à l’autre festin, l’autre jour, l’autre nuit, avec les linaigrettes qui clignotent dans la pente raide.
Une verveine sur la terrasse vide en attendant les remontrances de ceux qui ne me veulent que du bien, la pluie mitraille l’avant-toit, le lac se creuse. Je suis en retard, j’ai été à côté, je suis un mauvais père. Un convoi passe et m’emmène sous le déluge. La journée se refermera sur l’autre nuit, celle qui accueille ensemble les enfants et leurs parents.
Jean Prod’hom
22

Des moineaux déroulent dans la haie quelques mesures du chant du monde. Le papillon applaudit au-dessus du trèfle.
Jean Prod’hom
LXXII

Aimer les autres c’est, je crois, la clef de l’existence, nous explique l’auteur du best-seller de l’été. Le sage ajoute pour éviter tout malentendu et s’assurer qu’on a tous bien compris... mais pour aimer les autres il faut naturellement s’aimer soi-même, et c’est comme une seconde clef, car s‘aimer soi-même n’est possible que si on aime les autres.
Pas sûr que cette affaire nous délivre le sésame du bonheur. Je crains que chacune des clefs proposées n’ouvre qu’une seule et même porte ouvrant sur le vide.
Jean Prod’hom
Application des couleurs

L’axe est-ouest de l’île
se composait
de quatre sections
puis cinq à cause des pluies
limitée chacune par un ruisselet
et une pile de grès
une tête peinte
sur chacune de ses faces
bleue
d’un bleu très ancien
couleur de l’océan
au large de la dernière section
les habitants de l’île
avaient établi
une huitrerie
à la charpente flottante
peinture rouge
dans laquelle l’eau crénelée
des marées
allait et venait
on craignait que cet endroit
au coeur des tropiques
hissé jusqu’au très haut
ne résiste pas à la lourde charge
des matériaux
choisis pour durer mille ans
les papillons
disait-on pour rire
avaient l’affaire bien en main
mais on devinait mal
comment ils allaient s’y prendre
on ignorait surtout
qui les avait peints
avec tant de couleurs
Jean Prod’hom
Dimanche 8 août 2010

Deux ou trois choses qu’il est impossible d’embrasser d’une seule fois, mais qui mises ensemble permettent peut-être à celui qui en était comme à celui qui n’en était pas de comprendre ce qui se superpose dans la mémoire d’un seul à la mi-été et de lever le secret de certaines des parties qui nous font, en approchant l’infatigable tout dans lequel nous sommeillons.
Des renouées rose pâle bordent le miroir d’un lac de montagne. Non, pas le lac Noir, ni le lac des Chavonnes, mais l’autre, si près des commodités qu’on n’y croit pas tout à fait. On aurait même préféré des nénuphars et ce ne sont que des renouées, une nuée de renouées. Je les croyais jusque-là bistortes et des prés, je les découvre amphibies, accrochées derrière le tain de boues du lac de Bretaye. Elles longent en rangs serrés le rivage, mais comme si cela ne leur suffisait pas, elles colonisent de polygone en polygone la rive sud du lac. Un rang de prêles couleur bouteille les suit, avec derrière les maigres pâturages d’août dans lesquels se dressent quelques gentianes tête basse et des rumex boudés par le bétail. Plus haut, par une trouée entre les Chaux et le Col de la Croix, au pied du Mont Culan, j’aperçois Taveyanne, ou plutôt le souvenir de Taveyanne, une quarantaine de chalets mourant les jours d’été, petites taches noires qui ont roulé des Rochers du Vent. C’est là-bas que j’aurais voulu être tout à l’heure, dans l’ombre longue de son nom, lorsque les Muverans, la Dent Favre, la petite et la grande Dents de Morcles cisailleront le ciel dans mon dos, lorsque le soleil se couchera de l’autre côté et que se réveilleront de ce côté-ci les bruits des bêtes livrées pour une nuit à leurs affaires.
Jean Prod’hom
Il y a le vent

Il y a le vent
les alentours qui sommeillent
il y a les rêveries
l’insouciance des manèges
les souvenirs sur lesquels se penchent les morts et les absents
il y a les silences qui sont comme des mines
les plombs qui dessinent la nuit sur la peau du sanglier
les images restées accrochées aux mains de l’enfant
il y a le tronc de l’arbre autour duquel s’enroule le lierre
Jean Prod’hom
A quoi bon reprendre le train en marche

à Juliette Zara (Enfantissages)
Se méfier comme de la peste du défilé ordonné de ce qui est à faire et lever la tête. Tant qu’à faire regarder la lune, le train qui passe, les enfants qui jouent, applaudir les fourmis qui ne lâchent rien. Sais-tu que les mêmes nuages reviennent ? Remets à plus tard la tâche pour laquelle le premier venu fera l’affaire et rejoins un instant la réalité suspendue comme un beau jardin. Les gens vont, affairés ou désoeuvrés. Ce soir je ne mettrai rien en avant, personne ne sait demain, supposer l’inverse encanaille nos vies.
J’assure l’immobilité, celle des idiots de la terre ou des pierrots de la lune, je ralentis les rotations et console des vertiges. Rien n’est fait sur terre pour ceux qui n’y sont pour rien.
Jean Prod’hom
Noir et blanc

Une ombre sautille ce matin dans les gravats, entre pré et bitume, avec une bergeronnette attachée à ses basques. Je revois la mariée au loup d’encre sous le soleil de midi, pas troublée le moins du monde par son reflet dans la flaque, enchaînant les génuflexions pour se désaltérer. Plus tard un leurre lancé par un milan noir tissera sa toile dans le trèfle; ne manqueront au crépuscule ni les corneilles ni la pie du pin.
Jean Prod’hom
Se séparer

Assise à l’arrière, elle me confie en rentrant de sa semaine à Orges que loin de nous ça n’a pas toujours été facile, avec cette tristesse qui revenait, surtout le mercredi lorsqu’elle nous a téléphoné. Et le soir.
- Le soir surtout, lorsque la nuit tombait, juste avant de m’endormir. Alors je pleurais, mais je ne pleurais pas comme les autres, je pleurais en silence. Tout au fond de mon sac de couchage, en cachette.
- Moi aussi, sais-tu, rien que d’y penser, à t’entendre à l’instant, ça me fait pleurer. T’imaginer là-bas dans la nuit, étendue sur un lit de paille, avec des inconnues pour voisines. Te savoir seule, pour la première fois loin de nous, huit ans seulement, à peine huit ans et condamnée à grandir, toi si...
- Papa, j’ai jamais mis mes pantoufles.
Jean Prod’hom
Superstitions

Boire d’un trait
les bols de feu
éviter
les naissances par le siège
sous le lit
glisser l’oeuf
et puis le duvet du canard
tout laisser
mais se donner
l’occasion de revenir
au diable les vieux
va pour la guerre
orner les origines
de plumes
au-dessous et autour
confondre les genres
user de figures flottantes
pour obtenir des volumes
au centre de gravité incertain
traduire les ensembles
par double signes
et broderies fines
et recommencer
Jean Prod’hom
Dimanche 1 août 2010

C’est accomplir une action honorable et profitable au bien public que de prédire selon les formes consacrées le retour des beaux jours au commencement du mois d’août. Mais la pluie a tout bousculé et rien ne parle plus à l’âme attendrie. La fête nationale hoquette dans le bois noir et les discours s’enlisent dans les vains bruits de la plaine. La liberté est un rêve, importun souvenir, les droits des hommes vaincus. Lorsque les deux jumelles rappellent le serment, personne ne les écoute et la foudre éclate avec bruit, le pasteur a quitté les lieux depuis longtemps sous prétexte d’officier dans le village d’en-bas.
Que des gens bien, de bonne volonté, décidés à défendre et maintenir dans leur intégrité leurs vies et leurs biens, mais dépassés par la malice du temps, par des histoires commencées il y a bien longtemps. avec des espoirs à la peine, si bien qu’ils sortent de la route à tout bout de champ. Ce soir pourtant on ne ménagera ni nos vies ni nos biens, mais on le fera aux frais du voisin en dépit des serments pris en toute bonne foi. Levons notre verre, c’est le geste consacré, loyauté envers nos employeurs, honneur à ceux qui ont osé payer leur charge de quelque manière, soit en argent soit à quelque autre prix. La suite, vous voulez la suite, vous n’en saurez rien, plus personne n’écoute les deux enfants chargées de lire le pacte, elles disparaissent derrière la tribune au fond de la boîte à musique. Tout le monde se tait une nouvelle fois, la fanfare fait le reste avec le canon et l’écho de nos montagnes.
A l’ouest les deux Toitoi portatifs pour plus de confort, plus de fonctionnalité boudent, on se serre les coudes à la lisière du bois, les artificiers interdits de séjour se regardent par-dessus la bossette pleine à craquer pour écraser le feu qui rayonne.
Jean Prod’hom
Les chemins de la connaissance

La fenêtre était ouverte et on entendait le froissement des feuilles des hauts arbres du fond du jardin battus par le vent. Nous étions ma soeur et moi agenouillés sur le double lit matrimonial et notre décision était prise, rien ne nous arrêterait, nous voulions en avoir le coeur net. Le soleil était de la partie, c’était je crois le printemps. Elle tenait le bébé des deux mains, elle le secoua une dernière fois pour s’assurer qu’il y avait bien quelque chose à l’intérieur, il fit le cliquetis habituel. Je me saisis alors de la paire de ciseaux que l’on avait discrètement prise dans le tiroir de la table de la cuisine. Nous devions avoir 5 ou 6 ans. J’ai enfoncé ses pointes dans le bas ventre de l’enfant qui ne bougeait pas. J’ai sectionné non sans peine sa poitrine de bas en haut, jusqu’à son menton, je dus m’y reprendre à plusieurs fois, on se taisait. Nous avons plongé alors chacun notre tour la main dans son ventre, une seule fois aurait suffi. J’ai essayé pourtant de le retrousser, comme un gant, Elisabeth aussi. Il fallait bel et bien s’y faire, il n’y avait rien à l’intérieur.
On a jeté le bébé mouilleur dans la poubelle de la cuisine, caché sous des restes de nourriture et des pots de youghourts vides avant de s’enfuir au fond du jardin. C’en était fait de nos naïvetés, il nous faudrait user d’autres armes pour savoir la vérité. Quant à nos recherches elles prirent des directions différentes.
Jean Prod’hom
21

L’emprise des lieux qu’on aime sur les choses qui les entourent est telle qu’elle les empêche de fuir.
Jean Prod’hom
LXXI

Ils se font face mais un abîme sépare l’homme qui hurle et la femme qui n’entend pas. Alors ils se tournent le dos, et chacun voit distinctement à l’horizon la distance qui les sépare et l’interminable voyage qu’ils devront entreprendre pour se parler peut-être à nouveau.
Jean Prod’hom
Fin des travaux

On réalisa par la suite
quelques aménagements
des pierres
amenées à l’aide de cordes
reliées par un trait au ciel
des escaliers
descendant d’une plate forme
mais n’y montant pas
le dessin sur le sable
d’un carnage
quatre corps
deux héros soumis
qui se dressent
deux enfant révoltés
qui s’effondrent
on adossa la chronologie
aux nuages
qu’on relia au sommet du toit
on fixa sur l’horizon
quelques amers
des bateaux en feu
des flammes et des souvenirs
plus haut
on peignit en bleu
le vol des hirondelles
Jean Prod’hom
Dimanche 25 juillet 2010
Les cloches entendues ce matin des quatre coins du Jorat, lointaines, ont creusé des poches dans lesquelles la campagne s’est glissée pour prolonger un bref instant ses rêves.
Les gitans lèvent le camp à Mauvernay, à la queue leu leu, lunettes de soleil sur le nez. Quelques femmes rameutent à l’arrière leur progéniture, cris colorés des enfants qui jouent dans le pré, ils ne veulent pas décamper.
Les grands sont partis, Arthur pour Gryon et Louise pour Orges. Pourtant dans la maison retentissent encore leurs cris, ils rient des jeux naïfs de Lili avec la voisine. Et puis je les vois dans le compartiment du train avec des inconnus qui sourient. Cette histoire est à eux, et les mots adressés derrière la vitre à ces nouveaux amis avant le départ du train les projettent dans l’avenir et laissent derrière eux un silence qui fait de nous de nouveaux orphelins.
Plutôt à la traîne qu’à l’avant-garde. Pas de raison de me plaindre.
Jean Prod’hom
Comme un vieux tricot

Aller, chercher, observer, s’obstiner, parier, défendre, penser, séduire, provoquer, évaluer, foncer, raisonner, comparer, ruser, s’égarer, revenir enfin et, le moment venu, rapatrier sa vie. Car tout peut encore arriver ou se prolonger, mais combien de temps ? Il convient d’écrire alors ce qu’on comprend de travers et qui dépasse nos facultés, pour lire enfin autre chose que ce que nous voulons entendre, cette chose sur laquelle chacun est invité à se pencher un jour d’une manière ou d’une autre : ce qui aurait pu être mais qui n’est pas, mais l’écrire d’une traite et sans regret, parce c’est ainsi qu’on s’approche au plus près de ce qui se trouve à notre portée : ce qui aurait pu être.
Jean Prod’hom
Les hommes et les dieux

Les aspirations des hommes
sont au diapason de celles des dieux
les dignitaires confièrent à des logiciens le soin
de déduire de ce principe l’ensemble des théorèmes
d'en calculer la puissance
d'en forclore les contradictions
d’en garantir la complétude
on confia à un groupe d'aventuriers
la tâche d’inventorier les aspirations des dieux
et d’habiles architectes conçurent le dispositif
qui devait permettre l’accès au ciel
malgré les tribulations des maîtres d’oeuvre
les travaux furent poursuivis
on y associa les populations voisines
plus ou moins volontairement
elles amenèrent les matériaux
se chargèrent du transport de la chaux
de la taille des pierres
on prit des sanctions contre les récalcitrants
on avait le sentiment que c'était la même chose
mais on espérait pourtant qu'il allait en être autrement
cette fois
on a beau dire mais les saisons reviennent
c'est ainsi que s'élevèrent trois rampes d'escaliers tressées
pierres de granite aux joints de sable mélangé à de la chaux
ces trois rampes devaient compter chacune un total de 269 marches
égal au nombre de jours de paix de l'année
moins les 9 jours maudits du bout de l'an
c'est-à-dire qu'ensemble la triple rampe avait 807 marches
l'oeuvre fut inaugurée au printemps de la troisième année
dura un printemps avant de s'effondrer
elle dure pourtant encore dans l'esprit des rêveurs
ils montent la nuit sur la plate-forme
d'où ils planifient la construction
d'une nouvelle triple rampe
qui devrait les conduire un jour
dans les étages intermédiaires du ciel
on peut se demander si tout cela a un sens
mais le peuple est fier et craint par-dessus tout le principe du déclin
Jean Prod’hom
20

Tout autour des peines et des plaintes. Alors la vieille s'éloigne pour écouter celles du vent. Elle se souvient du corps de la baleine et du ventre des cathédrales. Faudra-t-il renoncer aux successions pour entendre enfin quelque chose aux choses ? être ailleurs, résolument ailleurs, ou l'avoir été?
Jean Prod’hom
Sans famille

Sous ta douceur couve une rage mise en veille. Et ce qui t'a été dérobé, ceux à qui on t'a arraché, ce dont il a fallu te détacher laisse un manque que tu ne combleras pas. Et pour peu qu'aucun tiers n'ait pris soin de ménager à ton intention un lieu pour calibrer ce manque – urne, tombeau ou mémoire –, tu ne t'y feras pas. Et tu seras de partout et de nulle part, ange et démon.
Il n'y a pas de place pour toi, pas de place pour moi, il n'y a jamais eu de place pour personne, sinon dans les terrains vagues de ta mémoire d'orphelin et dans le récit incomplet des successions auquel je suis enchaîné. A toi les oasis, l'étendue de la paix, la rage sans fond. A moi la descente des rivières, l'île mystérieuse, les obligations de la liberté.
Jean Prod’hom
Dimanche 18 juillet 2010
Martin, frappé par la lèpre dans les dernières années du septième siècle, ne put continuer à exercer son ministère d'évêque à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Il décida donc de se retirer à la campagne, chez un ami, dans une ferme foraine de Taulignan, dans un coin de pays qu'on appellera plus tard le quartier de Saint-Martin.
Avant d'entreprendre ce voyage, Martin étudia avec soin les cartes qu'il avait à sa disposition pour couper au plus court. Il prépara son sac : un morceau de pain, quelques habits de rechange et trois fois rien.
Il rejoignit le lendemain par la D 59 puis la D 71 Monségur-sur-Lauzun où il s'arrêta dans une grange pour la nuit. Le lendemain il reprit sa route, la D 71 b jusqu'à Charavan. C'est peu après le bois de chênes verts jouxtant cet ancien domaine qu'il se glissa dans le lit du Lez. Il lui suffit alors de mettre un pied devant l'autre, c'était l'été, les eaux étaient basses. Il laissa à sa droite Colonzelle, à sa gauche Chamaret. Il parvint aux environs du village provençal actuel à l'est de Grignan où il fit étape. La matinée du lendemain lui suffit pour rejoindre au fil du Lez la D 167 qui le conduisit au perron de chez son ami de Taulignan. Il passa des jours heureux, il guérit même de la lèpre mais n'en dit rien. Il préféra vivre là, loin de la surcharge de travail que lui aurait immanquablement amenée les habitants du diocèse de Saint-Paul.
C'est à sa mort seulement qu'on apprit qu'il avait découvert sous des ormeaux une source qui guérissait les maladies de la peau. On l'éleva derechef au rang de saint et on cultiva ses restes qu'on enchâssa dans un reliquaire d'or placé au fond d'une petite chapelle édifiée à côté de la source. On n'hésita pas à organiser des processions en temps de sécheresse ou de canicule. Et le Lez profita des miracles de saint Martin des Ormeaux. On s'y baignait jusqu'à Bollène.
Un temps seulement, car on s'arracha ses reliques qui voyagèrent de Taulignan à La-Roche-Saint-Secret, de La-Roche-Saint-Secret à Valreas. La volonté des habitants de Taulignan de récupérer leur bien amena tant de désordres que les Valréassiens renoncèrent à sortir les reliques de leur saint lors de la procession du 23 juin. En 1504, ils substituèrent au culte de saint Martin celui de saint Jean Baptiste fêté le 24 juin.
On peut voir aujourd'hui les reliques de saint Martin des Ormeaux croupir dans l'obscurité d'une chapelle au sud du chevet de l'église paroissiale de Valreas. Les fonds baptismaux sont secs, l'église aussi. Quant aux eaux du Lez, elles broient du noir chaque jour davantage.
Jean Prod’hom
Colères

Au bar du Casino de Valreas, avant qu'Espagnols et Bataves ne croisent le fer à Johannesburg, j'observe mon voisin, petit homme au visage avenant, adouci par un strabisme rieur, tonsure de modeste. Il semble tout aimer, son hamburger débordant de frites, la bière qui le fait rire, moi à qui il sourit. On parle.
C'est un enfant de la DDASS. Né à Marseille, abandonné par son père et sa mère, il connaîtra plusieurs familles d'accueil. La dernière dont il sera l'hôte reconnaissant, ici dans le Vaucluse, il y a trente ans, au coeur de cette enclave des papes qu'il ne quittera plus. Il fait bon y vivre, heureux de tout, du temps qu'il fait et du temps qu'il fera. L'homme a la quarantaine, il est bon, timide aussi, et poli, il a la beauté de ceux qui se satisfont de l'essentiel, il est l'image de celui qui a réussi sa vie et je me surprends à l'envier.
Il me confie qu'il vient voir le match au café pour ne pas être seul et rencontrer du monde. Bien sûr, la télévisison il en a une chez lui. Non, non il ne manque de rien. Il ajoute pourtant, un instant avant que le match ne commence, qu'il a une petite préférence, il s'en excuse presque, une petite préférence pour les Pays-Bas, il souhaiterait même que ceux-ci remportent la finale, il sourit. C'est la dernière fois que je le verrai sourire.
Derniers préparatifs de l'orphelin, rectification des positions, celle de la bière, celle du hamburger, celle de sa chaise dans l'axe de écran, il réajuste une dernière fois ses lunettes avant le coup d'envoi.
Et puis tout s'enchaîne, il ne faudra que quelques minutes pour que la bête qui sommeille en lui prenne les commandes. Au revoir la douceur, la beauté, la vie réussie. Les Espagnols sont des menteurs, des tricheurs, des vauriens. L'homme crie et se défend. Il faut que les Pays-Bas les écrasent, et ils le feront, je serai ainsi vengé. Une heure et demie ne suffira pas toutefois à exaucer ses voeux
Lorsque les Bataves encaissent le but qui va plonger dans le deuil tout un peuple, d'Eindhoven à Groningue, je le vois trépigner, écumer, vomir l'arbitre, l'équipe d'Espagne et le peuple espagnol dans son ensemble, il cherche désespérément quelque chose à quoi se raccrocher. Il hurle, hors de lui. Et je crains tout autant pour ma vie que pour la sienne. Il cherche l'Espagnol responsable de ce désastre, il me regarde l'oeil assassin. Je me lève et m'enfuis.
Si bien que le lendemain matin, lorsque j'écoute à 7 heures au bar de Grillon un petit homme raconter à deux clients son histoire, je suis averti. De père et de mère inconnus, l'homme est recueilli dans une famille de paysans sur les contreforts de la montagne de Lure. La vie est belle là-haut, un prêtre à qui il lui doit tout l'aide à obtenir son certificat d'études. C'est grâce à lui qu'il pourra faire carrière dans l'armée française, et vivre aujourd'hui retraité et satisfait, apaisé. Un bémol pourtant dans sa vie, sa belle-mère. Elle prétendait qu'il était un vaurien, un bon à rien. Une salope celle-là. C'était une .... Je le considère, stupéfait, je connais la suite.
C'était une Calabraise. Tous les Calabrais sont des vauriens, des menteurs, des tricheurs. La Calabre est un pays qui devrait ne pas exister. Je m'inquiète. Je sais qu'il sait que je l'écoute. Et vous, êtes-vous calabrais? C'est lui ou moi. Prudemment je m'éclipse.
Jean Prod’hom
Allons enfants de la patrie

Ils arrivent de nulle part, des Forts peut-être ou de l'Espace Roumanille. L'Echo du Roc de Pierrelatte vient en tête, suivie des vieux médaillés qu'on a sortis malgré la canicule, j'espère qu'on n'aura pas à le regretter, voûtés, habits du dimanche en berne, bannières d'Arlequin au vent.
Au second rang les notables, de la ville et de la région. Et puis, à mesure qu'on s'éloigne de la grosse caisse qui a pris les devants, les moins notables, les inconnus. Les derniers de classe enfin, mêlés aux moins que rien qui n'ont rien à faire ici, mais qui suivent de près le cortège pour profiter dans un instant du verre offert. Car aujourd'hui on fête la République.
Il doit être un peu plus de 18 heures à Nyons, la piscine est encore bondée et la Place de la République est encore déserte. Deux gerbes de fleurs sont cachées derrière le monument aux morts.
L'harmonie de Pierrelatte cède bientôt la place à un officier de police heureux d'accueillir Monsieur le sénateur, Monsieur le sous-préfet et Monsieur le maire. Et la cérémonie peut commencer.
Monsieur le sous-préfet raconte les premières heures de la République, le peuple courageux, les privilèges abolis, mais personne ne sourit. Monsieur le maire fait ensuite l'inventaire de ses oeuvres. Monsieur le Sénateur, c'est le plus gros, n'a rien à dire. D'ailleurs les deux gerbes de fleurs cachées derrière le monument ne sont pas pour lui. Ce sont les deux autres qui auront l'honneur de les placer au pied d'une République à l'habit kaki, bras nus, qui invite ces messieurs à aller de l'avant. Ils refusent et restent dans le rang où il y a déjà tant à faire pour y demeurer. Le sénateur a bien compris, il attend que ça passe.
Tous au garde à vous, bling bling, c'est le jour de gloire. L'Echo du Roc rameute ses troupes, ceux qui n'ont pas de lunettes à soleil lèvent les yeux au ciel. Le maigre public a redressé la tête, ça se fait. Sauf Lili, assise sur le rebord du trottoir, qui regarde émerveillée le chapeau de la dame aux lunettes sombres placée au premier rang entre le sous-préfet et le sénateur, une double bande de Moebius qui lui cache le visage. Mais à qui est-elle ? au sénateur ou au sous-préfet ? A l'un et à l'autre? Et je comprends d'un coup la vie difficile des notables de nos villes de province.
La cérémonie est terminée, ils remontent en rangs dispersés l'espace Roumanille où l'harmonie s'apprête à offrir un concert. Je salue au passage Monsieur le sénateur et Monsieur le sous-préfet, et tous ceux qui les suivent. Sauf un petit homme tout de blanc vêtu, béret vert, l'homme n'a pas d'âge. C'est un ancien de la légion étrangère, huit fois blessés, six fois médaillés. Je le salue, il me salue et me raconte ses exploits : le Tchad, le Liban, la Somalie, l'Afghanistan... Déçu, guère à l'aise dans le maquis de la Provence il boude les apéritifs. J'aurais voulu lui demander pourquoi ses médailles étaient si petites, je n'ai pas osé, je n'ai aucun exploit comparable à lui raconter. On se quitte, il boîte. Il habite en haut de la rue des Grands Forts.
Jean Prod’hom
Optique

Le soleil court à l'amble
sur une chaussée déserte
enveloppée par des volutes de fumées noires
il suit le tracé
qu'il a choisi à l'aube
arpente les étages du ciel
occupés par les dignitaires
d'une époque révolue
éblouis par sa face impériale
ils tiennent le calendrier des saisons
méprise d'en-bas
on ne voit que l'astre nu
badigeonnant d'or
les statues debout
les pierres couchées
le désordre
on attend pourtant d'autres lumières
pour donner à ce qui est ci bas
de la grandeur et du volume
assembler par deux
les instances suprêmes
les couronner
sur le pavé nouvellement jointoyé
on tient buvette au crépuscule
dans ce pays chauffé à blanc
avec l'appui des tenanciers des auberges de la ville
la foule s'échange des vêtements chatoyants
yeux dans les nuages
coiffes multicolores
quelques plumes précieuses s'élèvent au vent
l'élan combine avec l'horizontalité tranquille
la perspective sans fin d'un règne
bannière au poing
Jean Prod’hom
Une fois encore

C'est le dernier jour, on se quitte comme chaque année devant la maison, près du treillis, rue Pierre Cernize, à côté du sac d'ordures qu'on lui a laissé. Elle retient ses larmes, bien digne dans les bras de S. à laquelle elle confie ses craintes, celles des personnes âgées, imperceptibles secousses. Depuis cinq ans c’est la même chose. Elle lui dit tout encore une fois, mais elle lui fait comprendre qu'elle le fait peut-être pour la dernière fois.
Et lorsqu’on remonte la rue Joanny Desage, on l’aperçoit à travers les arbres du jardinet de son voisin. Elle est sur le perron, dites-lui au revoir les enfants, c'est peut-être la dernière fois. Elle rentre la tête dans les épaules, comme une enfant timide, ou un hérisson, elle sort la main droite de la poche de sa blouse bleue à pois blancs et l'agite lentement comme un enfant. Bon voyage. A la prochaine fois. Sa main gauche sert un mouchoir, elle va rejoindre l’ombre qui l'attend dans sa cuisine.
Lorsqu'on prend la route de Saint-Galmier pour rejoindre Saint-Etienne, je l’imagine alors debout, les pieds dans une cuvette d’eau fraîche. Il faudra monter en ville, faire quelques achats, ramener le journal qu’elle partage avec son voisin. Le temps passe si vite, l’an prochain est déjà bientôt là. La vie a repris, pleine d’oublis, elle ne dit rien, elle fait, elle va.
Jean Prod’hom
Dimanche 11 juillet 2010

La piscine publique située au croisement de la D541 et de la D414 mériterait toute l’attention des inspecteurs de l’UNESCO. Il y a d'abord le vaisseau solaire de Grignan, il guigne au-dessus de la visière de ma casquette dans le ciel de la Drôme, pareil à un satellite géostationnaire – ou à un OVNI, ce qui revient au même. On ne s'en s'étonne plus autour du bassin communal, pensez donc, 35 degrés à l'ombre.
Il y a ensuite le long bâtiment à claire-voie, décati, nu, parpaings sans crépi, qui date à n'en point douter d'avant la construction du château. A l'une de ses extrémités quelques cellules qui devaient permettre autrefois au baigneur de se changer à l'abri des regards, des sanitaires ensuite, à l'abandon. Puis le local dans lequel le baigneur, aujourd'hui encore, laisse ses vêtements en dépôt à l'intérieur d'une boîte en plastique rouge qui fait penser à un télésiège alpin des années 1960. A côté, la loge du gardien principal, absent depuis le début de la saison. Plus loin un maigre local pour stocker du matériel de sauvetage qui invite à la plus grande prudence. Au-delà l'espace colonisé par les habitués, qui se prolonge jusqu'à la buvette de plomb importée des plages de Normandie. On y réchauffe des crêpes.
Mais il y a surtout le rassemblement des gens qui ne disposent d'aucune piscine privée, – de moins en moins chaque année –, ils observent à fleur de peau le spectacle vrai et effrayant des corps, ceux des célibataires et des gens de passage, des veuves, des enfants buissonniers et des amoureux. une galerie d'un autre temps au pied de la collégiale, des corps presque nus se disputant, les pieds dans l'eau, l'enfer et le paradis. Pour deux euros seulement au croisement de la route de Rochecourbière et de l'avenue de Grillon.
Jean Prod’hom
L'hôpital

Aux urgences, section observation, deuxième sous-sol, un infirmier m’accueille. Je l’ai déjà vu mais où ? Il m’avertit d’emblée que c’est son premier jour dans ce service en tant qu’infirmier de liaison. L’homme est bègue, il me demande de patienter tandis qu’il s’assied dans le box voisin au chevet d’une vieille dame qui lui raconte sa vie : son mari, sa nièce, son veuvage, la mort de sa cadette, son appartement, son indépendance. Lui se tait, l’écoute et prend des notes. Je lis sur sa blouse l’étiquette qui précise son identité : Patrick Modiano, infirmier de liaison.
Le patron du service en connaissait un bout sur la nature de l’homme. Il avait en effet déniché, Dieu sait où, une dame au museau de bouledogue et à la voix de corbeau qu’il avait installée dans le fauteuil de la réception. Cette dame – faut-il dire secrétaire ? – eut tôt fait de saisir les rudiments de l’aboiement. Elle apprit également à convaincre le client qu’il devait s’être trompé d’adresse, qu’il n’était, quoi qu’il en soit, pas chez lui et qu’il aurait pu choisir un autre thérapeute et surtout un autre moment. Elle effrayait si bien le patient que celui-ci se retrouvait somme tout très satisfait, heureux même, lorsque, échappé des mains de l’animal de garde et parvenu dans le cabinet du médecin, celui-ci lui annonçait que la situation était grave, désespérée même.
Jean Prod’hom
Moineaux

On entend ce matin 807 moineaux qui piaillent sans discontinuer, puis le cri lugubre d'un seul corbeau. Non ! C'est Jean-Rémy qui se racle la gorge.
Le chant rauque du coq, le cri lugubre du corbeau et huit cent sept moineaux qui nichent dans la tête vide de Jean-Rémy.
Jean Prod’hom
9 août | 22 août 2009
Désencombrement du jour

Je voudrais avoir payé mon dû avant même d’entrer dans le jour, pour entreprendre librement et sans vaine espérance cette traversée à laquelle je suis convié quotidiennement. Je voudrais inverser les habitudes : un mot bref en guise d’écot, – une prière ? – pour affamer d’emblée mes attentes et me livrer libre et bienveillant, mains nues et sans idées derrière la tête, à l’enchaînement de mes tâches quotidiennes. Je voudrais ne pas avoir à traiter avec l’espérance, telle qu’elle se donne lorsque la nuit tombe pour racheter autant que faire se peut l’immanquable déception à laquelle nos vies nous conduisent à la fin. Je voudrais avoir régler le sort de mes journées avant même de les avoir commencées pour en disposer comme de quelque chose qui n’a pas de nom et qui ne figurera dans aucun bilan, un espace sans enjeu au sein duquel je n’aurais qu’à prêter mon oreille, offrir ma main, répondre aux voeux. Je voudrais recommencer ainsi chaque matin de telle manière que mes jours ne comptent pour rien. Je voudrais au fond avoir chaque jour un jour d’avance, pour disposer d’un jour sur lequel je n’avais pas compté, au-delà du temps, un jour imprévu et que je traverserais sans arrière-pensée, en lisière du temps, comme l’envers d’un revenant.
Jean Prod’hom
Topiques

A une époque postérieure
mais de peu
un scribe donne
dans une narration volontairement imprécise
une idée grossière
de l’emploi du temps
des fonctionnaires impériaux
assujettis au code des parcellaires
tenir constamment à jour
sur papiers d’agave
la répartition des négligences
représenter sur le sable
les divisions des familles
dresser dans le ciel
le plan des coïncidences
manque la description de leurs travaux
sur une conception du raisonnement
qui ferait enfin l’économie de l’analogie
et conduirait aux conclusions
gravées sur le mur des offrandes
manquent aussi le compte-rendu
de leurs réflexions sur les fioritures enfantines
l’exposé de leur méthode
d’étayage définitif de l’éphémère
trois fragments précieux à l’évidence
que le souvenir d’un seul atteste
avec les difficiles espaces libres
irrésolus
qui se font face
Jean Prod’hom
Dimanche 4 juillet 2010

On ne demeure pas sur le seuil par complaisance, mais par devoir, celui de laisser la possibilité à ce qui se présente de contenir autre chose que ce qu’on a déjà vu, de laisser à cette autre chose les coudées franches, quitte à la maintenir hors de notre portée et à la laisser s’enfuir par la fenêtre grand ouverte comme elle ne manque jamais de le faire.
Je pensais aller jusqu’à l’étang, j’y suis allé et puis la chaleur m’a arrêté à tout bout de champ. Le silence aussi, inaudible en marchant.
Efforts démesurés de l’homme, inouïs et sans fin, pour se libérer du Sisyphe qui l’habite.
N’écrire que ce qu’on peut relire, c’est-à-dire ce qu’on ne comprend pas.
Si l’on s’écarte, si l’on éprouve le besoin d’être seul, c’est peut-être un peu par misanthropie, mais c’est d’abord pour régler son compte à celui qu’on est pour être en mesure d’être tout entier aux autres. C’est ce que j’explique à Louise, bientôt huit ans, en laçant mes chaussures. Elle me sourit malicieuse avant de m’accorder cette liberté en me tournant le dos. Le faisant elle fait un grand pas vers la sienne.
On ne sait pas exactement ce qu’on espère, quel visage, quelle main viendront combler l’attente dont on est habité. Mais une chose est sûre. On attend quelque chose ou quelqu’un, d’emblée...
Pierre Bergounioux, La Ligne
Bonne nouvelle, quelques élèves ont fait l’école buissonnière. Mais j’apprends qu’ils sont allés se faire couper les cheveux dans le salon de coiffure de la mère de l’un d’eux, consentante par surcroît. Déception.... à moins que... et je les imagine alors la tête sous le foehn méditant à d’invraisemblables exploits.
La grande cure : pas de café aujourd’hui! Et demain?
Jean Prod’hom
Et pis

– La décision d'interrompre le compte des brins d'herbe d'une pelouse après le 807e brin ne relève pas du hasard mais d'une secrète nécessité – de quelque nature que soit cette pelouse – cachée dans la série infinie des décimales de pi. Voici.
3,14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459
230781640628620899862803482534211706798214808651328230664709384
460955058223172535940812848111745028410270193852110555964462294
895493038196442881097566593344612847564823378678316527120190914
564856692346034861045432664821339360726024914127372458700660631
558817488152092096282925409171536436789259036001133053054882046
652138414695194151160943305727036575959195309218611738193261179
310511854... 807 !
– Mon Dieu !
Jean Prod’hom
16 novembre 2009
LXX

Hier en fin d’après-midi, très haut dans le ciel, muet, un gros porteur filait en direction de Genève, tandis que là-bas, à quelques pas du chêne, deux corneilles bataillaient.
J’apprends à l’instant par la radio locale qu’un Piper J-3 de couleur noire est parti en vrille sous la Dent de Brenleire : deux disparus. Je lève alors les yeux : c’est le crépuscule, un jeune milan disparaît souple et raide derrière la Montagne du Château, il plonge en direction de l’étang.
Jean Prod’hom
Juste rapport au temps

Une propension maladive à surévaluer la quantité d’énergie et de temps nécessaires à l’accomplissement des quelques tâches qui assurent la consistance des groupes dans le champ social, la survie des uns et des autres et auxquelles on ne saurait échapper que par lâcheté.
Mais voilà qu’aujourd’hui, frappé – encore? – par le sort, j’éprouve la sensation à bientôt minuit d’avoir accompli des travaux herculéens. Tout simplement parce que ce nouvel imprévu ne m’a pas laissé le temps de trop anticiper, m’a obligé de faire vite et juste avec le temps, de répondre à ras de terre et de me rapprocher pas à pas des gestes qui caractérisent la condition qui est la nôtre, avec pour voisin l’effondrement qui guette et à deux pas la peur qui paralyse le corps jusqu’au petit doigt.
Même qu’il me reste quelques minutes pour écrire ces mots avant minuit, tandis que les enfants dorment, que le tambour de machine à laver le linge turbine et que ma femme épuisée se rétablit en de bonnes mains.
Jean Prod’hom
Extension de la ville

Cité satellite
construite à la va-vite
sur une piquante proposition
des dirigeants du troisième canton
de l’autre côté du volcan
à l’intersection
du canal inachevé
et de l’ancienne chaussée
qui avait conduit
les nouveaux arrivants
de l’océan
aux rives du lac
on construisit là
simplement
en guise d’assurance
une tour et une redoute
elles se faisaient face
à l’extrémité d’un pan ruiné
murailles percées
portes dominantes
ouvrant sur la dune
semblable insouciance
ne s’était plus présentée sur l’île
depuis la mise au pas
de ceux qui avaient planté
sur les fonds argileux
des rangées de pieux parallèles
en prévision du siège de la capitale
mais l’insoumis
je le sais
bâtit en profondeur
il recueille l’eau des digues
chargées d’interrompre sa passe
ménage des accès à la nuit
pose des jalons
dans le va-et-vient des passions
c’est ainsi qu’un jour peut-être
il rendra à la terre
le mystère qui fuit
sur le dos de l'imagination
rétive et captive
Jean Prod’hom
Dimanche 27 juin 2010

Pierre Alechinsky cite Cioran qui aurait écrit – ou dit un jour – que tout nous vient du dehors. Ce n’est pourtant pas la teneur de cet aphorisme qui m’enchante et dont je partage au fond l’évidence, mais la voix lointaine de cet homme de 83 ans, dont le grain et l’allure attestent le chemin à suivre pour distinguer et faire entendre ce qui vient lorsque le chemin disparaît dans la lande, lorsque le dehors se confond avec le monde qui a bien voulu de nous une saison, lorsqu’on est en mesure de faire entendre le silence : la voix du dedans.
Ce que les pierres retiennent

Amené à rompre avec la supposée continuité du temps au risque de succomber à un vertige, non plus celui du temps qui fuit, mais celui du temps qui est resté bloqué là-bas.
Si les images, les photographies, les souvenirs vieillissent, c'est parce que, incapables de retenir ce qui demeure, ils laissent filer le temps qui seul compte. On le voit dans les corps passés, on le voit aux visages, aux mains trop lourdes, aux jambes trop cassantes sous le poids des souvenirs qui se défont. Le gros du temps reste en arrière, par-delà les images qui ne retiennent que des ombres.
Rien n'a changé, on voit simplement les choses d'un autre lieu. Mais il aura fallu pour l’atteindre nous extirper de la glaise dont on est fait, faire ce pas de côté, et réaliser quelques voyages de circumnavigation pour retrouver les choses telles qu’elles sont, ce miracle en tiers qui nous est offert lorsqu’on revient bien après. Nous éloigner donc, nous égarer même, souvent, pour considérer enfin les choses en leur lieu, c’est-à-dire de ce lieu que l'on n'a jamais tout à fait quitté, aperçu pourtant comme un phare oublié qui nous fait supporter de manquer ce pourquoi on avait appareillé, sans regret, mais dont il faut bien s’approcher pour être enfin un peu avant de n’être plus.
Jean Prod’hom
Gueule de bois

C’était le temps où ça y allait, le temps des Chevillard-Camaro, des Peugeot 807, des Nisard-Gloria et des Toyota Prius, des liseuses et des nuisettes, des pokes et du pacs. Je peux vous l’assurer, ça roulait et on ne se faisait pas de cadeaux. D'ailleurs les uns ont fini dans la fosse à bitume, les autres contre le mur.
La baronne de Rothschild avait prédit, sur un plateau, l’avenir du révolu. On aurait dû la croire.
Quant aux visionnaires, dopés par leur statut et la promesse du succès, ils en avaient pris plein les dents, et avec eux leurs courtisans. C'était pas net, on écouta les justifications contrites des premiers, on assista à la débandade des seconds. On para au plus pressé et on recommença, on en est là.
Jean Prod’hom
27 mars 2010
LXIX

Hier soir, la vieille a oublié de verser dans la coupelle de porcelaine la goutte d’essence de marjolaine qui, depuis cinquante ans, tient en respect les ronflements du vieux. On les a retrouvés morts ce matin, dans les combles, écrasés par la charpente de leur maison.
Jean Prod’hom
A vau-l'eau

Les plumassiers
s’attaquaient au gros oeuvre
en plein air
si bien que le duvet
des nouveaux-nés
poussé par le vent
dans le lacis des rues
frémissaient
sur les pavés de briques
dans les entrepôts ouverts
autrefois occupés par des négociants
peu d’espaces dégagés
d’un bout à l’autre des bateaux
tirés sur des ponts de poutres mal équarries
galets alignés sur la terre battue
devant les huttes
les acacias imputrescibles
mêlaient leurs senteurs
au fenouil sauvage
dans les cours intérieures
pas de fleurs à bulbe
mais de l’eau dans les caves
la passion pour les affaires privées
avait pousser les derniers arrivants
à concevoir de grandes places
sans verdure
traversées seulement par des canaux
aux rives solides et bien travaillées
dressés les uns contre les autres
mais que l’eau enclose
dans les lacs artificiels du pied des collines
ne parvenait pas à ravitailler
canaux inutiles donc
on avait atteint le point du non retour
les esprits s’enlisaient
il était loin le temps où les hommes
entraient dans leurs maisons
à la proue de leurs bateaux
couronnés
la capitale de l’île allait à vau-l’eau
et la demi-circulation généralisée
allait précipiter les événements
par-dessus bord
Jean Prod’hom
Dimanche 20 juin 2010

Qui se souvient de l’ermite, du fils du prince Berthold de Hohenzollern, Meinrad de Sulgen qui renonça à tout au pied du Mont Etzel? Louis Veuillot? C’est une sagesse aux vertus secrètes qui l’obligea à se nourrir des peines de ses hôtes. Il rumina chaque jour son ignorance dans une forêt sombre où il voulut se cacher pour aller plus avant. Rien n’y fit. Deux manants – qui ne possédaient guère plus que lui – lui retirèrent la vie le 21 janvier 863.
Il est cinq heures à Einsiedeln, trente ermites rassemblés pour l’heure font entendre les voix du ciel, procession d’oiseaux noirs au long cours qui déambulent. Pure merveille. Ils chantent pour maintenir ensemble les débris de nos vies qu’ils emportent dans leurs cellules lorsqu’ils nous tournent le dos, ils conçoivent des morceaux de liberté dans des retraites closes, raboutent les mauvais jours aux siècles de gloire. Le feu fait le reste. Autour du monastère une nuée de moineaux s’affaire, c’est le prix qu’il faut payer.
Il pleut sur le lac de Sihl. Deux corbeaux avancent dans la tourbière parmi les orgueils sauvages et les iris d’eau.
Jean Prod’hom
Va-t'en te perdre où tu voudras

Quelques flaques sur les bas-côtés
les restes d'une ondée noire
dans le miroir desquels flambent
les éclats d'un soleil de glace
d’innombrables vers luisants clignotent dans le pré
l’or fond liquide sur les marches de pierre
le silence a creusé son trou
mais il y a loin très loin
le grondement sourd d’un animal
qui s’éloigne rassasié
c’est le grondement du tonnerre
qui poursuit sa route les yeux fermés
orage satisfait tout à l’ouest
il gronde sans discontinuer
longues respirations de satisfaction
avant d’attaquer la plaine que personne n’a daigné avertir
à mes pieds lessivés pris dans les boues du sommeil
veillent les ombres du feu et de la nuit
l’écho des craquements sur lesquels on ferme les yeux
la belle empreinte de la bête qui s’éloigne
la gueule ouverte derrière l’horizon
et je tremble un peu
délicieusement épargné
Jean Prod’hom
LXVIII

Deux collègues pleurent le temps passé en chantant la belle l’époque, le temps des petits Larousse dont elles énumèrent les innombrables vertus. Elles se disputent un peu à propos de la couleur de la couverture: rose, beige, rose-beige, rose-saumon,... elles rient, elles se taquinent, mais c’est pour rire. Elles se rappellent surtout de la page des bannières, étonnées et heureuses d’avoir pris conscience, tels Leibniz et Newton, simultanément, que toutes les bannières du monde étaient rectangulaires, toutes, excepté celles de la Suisse et du Vatican.
Les yeux embués, elles regrettent le beau temps des voyages sur la moquette, tout a tellement changé. Elles au moins découvraient le monde. On avait, soupirent-elles, une toute autre façon de voyager, une vraie. Et mine de rien on se coltinait le réel, la Suisse, le Vatican, les gardes suisses. Magiques ces bannières! Réellement magiques!
J’opine avant de reprendre ma lecture de l’Anthologie des voyageurs français et européens de la Renaissance au XXème siècle, avec le sentiment désagréable que cette anthologie mérite déjà de solides compléments.
Jean Prod’hom
LXVII

Je ne l’avais pas revue depuis trente ans, mais je la reconnus aussitôt. Ele s’était pourtant cachée derrière un visage de vieille qu’elle avait consciencieusement plié, froissé, creusé tout au long des années, sans faute de goût, pour garder secrets ses secrets. C’est ce masque achevé de la vieillesse derrière lequel elle s’était barricadée qui avait préservé sa jeunesse intacte, enfouie derrière un visage miné et des yeux prêts à s’allumer.
Jean Prod’hom
Abandon des terres basses

Dans les faubourgs parallèles
aux canaux rectilignes
les maisons mal bâties
de base rectangulaire
deux étages pas plus sur pilotis
étaient vouées à l’abandon
la foule ne levait plus les yeux
vers le va-et-vient
des aigles dans le ciel
des cygnes dans l’étang
elle se maintenait à peine
vivante au-dedans d’elle
celui qui s’en serait approché
aurait distingué
les minuscules vies secrètes
forcloses
dans les cours intérieures
car il suffit parfois de suivre
quelques traces
les empreintes soufflées par le vent
les impressions laissées par des témoins
pour que les folles rumeurs
se réveillent
transpirent des huttes abandonnées
toits de roseaux mélangés à la terre
des cris
des rires
des souvenirs
mais rien à acheter rien à vendre
la foule migra
suivie de près
par les dignitaires de l’île
fuyant les quartiers luxueux
du front de mer
rongés par la malaria
la foule ouvrit de place en place
des échoppes
à l’arrivée des riches exilés
à l’évidence
le bourdonnement des activités urbaines
les ravit
et dans des ateliers
sis autour du vieil arsenal
qu’on appelle encore
le collège des Âges
l’activité des plumassiers
les cris colorés des joailliers
le soin des orfèvres
le noble entretien des lieux
soulevaient haut
les rues de la vieille ville
recouvertes de paille et d’herbe
plus de places disponibles
nulle monotonie à tout cela
l’île flottait sur la mer
comme au temps des origines
mais là-haut se dressait la ville nouvelle
pour longtemps encore
sans doute
Jean Prod’hom
Dimanche 13 juin 2010

Au réveil, par la petite fenêtre des combles – qui restera ouverte, j’ose l’espérer, les cent jours que dure ici la belle saison –, me parvient le concert d’il y a une semaine, avec le soleil de juin déjà haut dans le ciel, le même ou la suite, qu’importe je ne l’entends guère. C’est que je me réveille avec au-dessus de moi une main à large paume qui me ramène promptement au-dedans de mon crâne, comme le ferait un ressort tendu, chaque fois que je tente une sortie à l’air libre. C’est qu’au-dedans sommeille une inquiétude familière, aux formes diverses et imprévisibles dont je ne prends connaissance qu’au réveil et ne perçois le contour que lorsque elle se dissipe.
Une de ces inquiétudes dont on on ne voit pas le bout, qui se retire tout un jour avant de vous harceler le matin suivant, sans crier gare. C’est une inquiétude liée à celle d’un enfant qui se demande pourquoi les choses ont pris un tel tour un jour, qui ne comprend pas pourquoi la vie parfois sort de ses gonds. Son inquiétude s’est glissée dans la mienne dessous la boîte crânienne, c’était en janvier 2008, deux ans et demie déjà, elle a pris le temps d’étendre son empire. Elle agit en moi à l’image des questions qui agitent l’esprit de l’enfant. Et c’est de cette image qu’il me faut me délivrer, sans succès jusque-là. Et c’est vers ces images qui noircissent et alourdissent chacune de mes pensées que la main à large paume repousse ce matin, en un geste bref, chaque fois que je mets le nez dehors, la tête d’épingle courageuse qui s’essaie à rejoindre l’avant-garde du jour.
Dehors il fait beau, un cheval, un vrai, roule ses sabots sur le bitume, on entend la cavalière qui lui parle, lui il secoue la tête. Le vent souffle du sud-ouest si bien qu’il ne portera pas jusqu’ici, à neuf heures, les neuf coups du village; le coq embarqué par le renard ne chantera pas trois fois. Un milan noir passe dans le rectangle azur du velux, je l’accompagne un bref instant avant que l’inquiétude ne me reprenne. C’est ainsi chaque fois que je m’éloigne, comme si elle voulait que je lui reste fidèle. Puisse-t-elle cesser de me secouer, devenir ce simple souci, liquide tiède mélangé au sang de mes veines, vrai réconfort pour l’enfant qui en a besoin.
La trotteuse du réveil nous rappelle que le temps qui passe s’obstine dans des impasses. Seules les choses vont, viennent et parfois s’éloignent un instant dans le silence. Il convient de prendre de la hauteur, assez haut pour qu’on puisse considérer notre sort avec le même état d’âme et avec les mêmes égards que ceux qui nous portent à considérer celui du premier venu. Convient-il de parler de tout cela ici, est-ce bien de la sorte qu’on prend de l’altitude et que, nous éloignant, nous approchons de la possibilité d’offrir quelques noms à ce qui n’en a pas encore? L’inquiétude perdra-t-elle ainsi son insidieuse lourdeur pour devenir ce souci large et accueillant qui allège en nous conduisant à la hauteur qu’il faut, là où il convient d’être?
Je parie que l’enfant saura un jour, dans le langage qui nous oblige, prononcer les paroles qui m’offriront la paix et le lanceront entier sur la voie qui est la sienne.
Jean Prod’hom
Saisons

Certains d’entre eux écrivaient leur volonté dans le ciel au lance-flammes, ils brûlaient des pans entiers de la nuit pour éclairer la route des jours suivants. Mais rappelez-vous, ils crevaient, et les éclairs se joignaient au tonnerre. Ils voulaient, disaient-ils, infléchir le cours des choses, les arracher des mains de ceux qui en avaient fait le fond d’un vilain commerce; prendre les devants, écarter les injustices, établir l’égalité, partager les richesses, supprimer les privilèges. Se reposer enfin avec un rêve, celui de revenir un jour au jardin de l'hypothétique origine. Et ils chantaient des refrains entêtants : un peu d’humanité, la sieste, quelques cacahuètes, un coin d'ombre. Des bartasses, de l'eau aussi, et un peu de vide pour respirer. Ils se sont battus rageurs, pierres, arbalètes, épées à simple ou double tranchant, flèches, boulets hurlants, pavés dans le ciel, de la brusquerie parfois, et un peu de haine au fond des yeux. Les éclairs et les orages se mêlaient à leurs cris. Ils avaient l’impression que ça avançait, et qu’ils y parviendraient. Pas eux bien sûr, mais leurs enfants ou leurs petits-enfants au moins. Ils alignaient chaque matin sur la table de la chambre les deux ou trois raisons pour lesquelles ils se levaient en sifflotant. Parfois le sang coulait et ils changeaient le monde, et le temps était de la partie.
Les voici tout près du couchant, toujours rien, manquant de tout. Adieu le siècle des Lumières, raté le rendez-vous pris à l’âge de la raison avec l'âge nouveau, amour et loisirs : le volcan crachote des confettis, révolution des oeillets, révolution de safran, de velours, révolution des roses, l'orange, celle du cèdre, celle des tulipes.
Ils n’ont plus rien, plus même d'habitudes, l'histoire s'est retournée sans qu'on le veuille et le temps s'est retiré. Pieds dans la glu d’un dernier tour qui fait vis sans fin, bouleversement silencieux, profond, invisible. Et on cale, la volonté abolie, en panne de l'avant, condamnés à nous retourner – lorsqu’on y parvient – et à nous adosser au jour qui s’en va. On aperçoit alors au levant les éclairs qui se joignent au tonnerre, et on voit se lever les commencements dont il nous reste à décrypter le chiffre. On se détourne de l'histoire épuisée, du couchant qui l’emmène dans son lit, et on va à reculons en faisant le dos rond, avec pour seule lumière celle de l’aube qui éclaire les pas qui nous ont amenés là, flux tendu qui ne mène nulle part. Dans notre dos le soleil se couche et les pavés sont dans la mare, le pire est arrivé, l’histoire n’a pas tenu ses promesses, elle quitte le devant de la scène. Il nous faudra désormais faire sans son vacarme et accueillir une version inédite du temps.
Publié le 4 juin 2010 dans le cadre du projet de vases communicants chez Jeanne (Chez Jeanne)
Jean Prod’hom
Construction de la ville

La demoiselle s'indignait l’autre jour auprès d’un monsieur bien mis qu’une dame, enseignante de français, fît lire à ses élèves des textes traduits. Le trésor de la littérature française lui paraissait "suffisamment inépuisable" et il faut, disait-elle – vieille rengaine –, étudier ceux de chez nous avant de lire en traduction ceux que les autres immanquablement ânonnent. La demoiselle sous-entendait qu’un texte traduit est par définition qualitativement inférieur à ce même texte en langue originale. Outre que cette vérité n'a jamais été absolument établie, précisément parce qu'il est à craindre qu'un tel examen conduise à l'établissement de la proposition inverse, le monsieur et la dame auraient eu beau jeu d’en appeler à Jaccottet, Baudelaire, Proust – autre rengaine – et tous les autres traîtres qui ne se sont jamais posé de telles questions. Ni le collègue de la demoiselle ni la dame, absente vous l'aurez compris, n’en appelèrent à qui ou quoi que ce soit et se turent. Quant à moi, voisin silencieux, j’hésitai à prendre la défense des textes traduits qui, somme tout, contiennent à l’évidence infiniment plus de richesses que les textes dont ils sont la traduction, ne serait-ce que parce qu’ils recèlent d’une manière ou d’une autre, mais absolument, non seulement la totalité des premiers mais bien d’autres choses encore, et peut-être l’ensemble des livres. Finalement je me tus.
C’est lisant un texte de l’Anthologie des voyageurs français et européens de la Renaissance au XXe siècle, Le Voyage en Suisse (édition établie par Claude Reichler et Roland Ruffieux) que cette conversation m’est revenue à l'esprit. Il s’agit d’un texte écrit en latin entre 1431 et 1439 par Æneas Sylvius Piccolomini alors qu’il séjournait à Bâle au moment du concile. Le futur Pie II y décrit la ville de Bâle d’avant la Réforme. Ce n’est donc pas en latin que j'ai découvert ce texte – je m’y entends mal – ni dans la traduction allemande qui circulait à la fin du XVIe siècle – je m’y entends mal encore – mais dans la traduction française de Philippe-Sirice Bridel qui a disposé, c'est sûr, de la version allemande. Cette traduction du texte d’Æneas Sylvius Piccolomini figure dans l’ouvrage intitulé la Course de Bâle à Bienne par les vallées du Jura, publié à Bâle en 1789 et que le Doyen Bridel conçut sous forme de lettres destinées à un public suisse.
La situation est admirable* et la polyphonie s'épaissit encore lorsqu’on lit en avant-propos que la grande diversité des états de langue dont relèvent les textes rassemblés dans cette anthologie nous a conduits à rendre homogènes l’orthographe et la ponctuation selon l’usage actuel. Nous n’avons en revanche modifié la syntaxe que très rarement, lorsque la compréhension l’exigeait pour certains auteurs anciens.

![]()

![]()

Æneas Sylvius Piccolomini | Philippe-Sirice Bridel (Doyen Bridel) | Claude Reichler
![]()
Voici donc un extrait de ce texte écrit au XVe siècle par Æneas Sylvius Piccolomini, traduit par le Doyent Bridel au XXIIIe siècle et présenté par Claude Reichler à la fin du XXe :
La largeur du Rhin est de deux cent cinquante pas, à l’endroit où le petit Bâle est joint au grand par un pont de bois. Il arrive quelquefois, quand les grandes chaleurs de l’été fondent les neiges des Alpes, et en versent les torrents dans le fleuve, qu’il inonde les rues, renverse le pont et rompe toute communication entre les deux villes : nous ne dirons plus rien du Rhin, si ce n’est qu’il abonde en toute espéce de poissons, surtout en saumons, que les Bâlois préfèrent à tout autre, à cause de leur délicatesse exquise.
Plus loin :
Tout récemment on a embelli la ville de plusieurs promenades, semées d’arbres verdoyants et couvertes d’un joli gazon: les branches des chênes et des ormes, artistement étendues et projetées en dehors, produisent des ombrages épais; rien n’est plus agréable pendant les grandes chaleurs, quoique l’été n’y soit pas long, que de se retirer sous ces frais bocages, pour se mettre à couvert des rayons du soleil.
C’est exquis et on renonce à rendre la justice. On pense plutôt au Pierre Ménard auteur du Quichotte, auquel on revient toujours. Tout a changé et tout demeure, Bâle est enfin sous nos yeux, non pas la ville de Peter, Jacques ou Giovanni, celle d'avant-hier, hier ou aujourd’hui, mais une ville infiniment plus complexe et riche quand bien même les saumons et les ormes ont disparu. C'est Bâle, la belle inconnue, qui s'éveille aujourd'hui à la fin du jour, dans un texte aussi dense et ancien que la ville qu'il a fait naître en la nouant pas à pas au lieu d’un commencement qui s’ignorait et dans lequel elle était tout entière, comme une promesse qu’on tient.
Jean Prod’hom
![]()
* Il faudrait poursuivre le déchiffrement du feuilletage lorsqu’on sait que le Doyen Bridel est issu d'un milieu protestant mais éprouve de vives sympathies à l'égard du catholicisme, celui d'Æneas Sylvius Piccolomini qui n'est pas en reste d’ailleurs. Celui-ci a en effet commencé une carrière dans le domaine diplomatique et a participé au concile de Bâle en tant que secrétaire. Il sera de la dissidence et demeurera dans cette ville lorsque Eugène IV transférera le concile à Ferrare. Il soutiendra Amédée VIII de Savoie élu pape en 1439 sous le nom de Félix V, intronisé en 1440 dans la cathédrale de Lausanne et dont il devient le secrétaire, couronné poète en 1442 par l'empereur Frédéric III pour son œuvre poétique et romanesque, dont il devient le secrétaire. En 1445, au cours d'une mission, il choisit de se rallier au pape légitime de Rome, Eugène IV, et abjure devant lui ses erreurs. Il deviendra pape lui-même en 1408 sous le nom de Pie II. Ce qui n’est pas le cas du Doyen Bridel, né en 1745 à Begnins. petit fils de Philippe, pasteur pendant plus de 50 ans dans la vallée de Joux, où il introduisit la culture de al pomme de terre.
LXVI

Une communauté de biens, ça fonctionne toujours mieux lorsque le frigidaire est vide.
Jean Prod’hom
Hydrologie

Beauté défaite
chargée de marchandises
offertes à la nuit
ligne d'horizon aménagée
avec autant d’ordre que de dérangements héréditaires
on se hâta de diligenter une enquête
les bergers du centre
échaudés
par la splendeur froide des montagnes
ne manquèrent pas
de livrer aux ingénieurs orgueilleux
l’eau douce descendue des cimes
elle entrait en gesticulant dans la ville
déambulait de place en place
laissant aux hommes le temps de se désaltérer
elle sortait en chantant
serpentait dans la campagne
jusqu'aux berges du lac
des soldats surveillaient le réseau
on entendait
des par ici
des par là
qui répondaient aux par où des insulaires
exilés sur la plate-forme terminale
admirables raisons
admirables prisons
au sommet des rues larges
les chiens pissaient
au pied des oratoires
et des bastions
dans les pâturages de l'aval
les fleurs fanées maudissaient
l'aqueduc à trois chaussées
le canal à double circulation
sur lequel nous étions arrivés
et sur lequel nous allions repartir
sous le soleil
un moment encore
les yeux tournés vers la lagune
Jean Prod’hom
Dimanche 6 juin 2010

On s’y trouve engagé à demi, sans qu’on le veuille vraiment, couché et immobile alors que le soleil s’est levé depuis longtemps, mais on renonce à prendre les devants. Dehors la rumeur prend de la consistance, avec par-dessus bientôt du cristal, les moineaux, un rouge-queue, les rires des enfants qui préparent la table du déjeuner, des éblouissements. Tiens, le vent a tourné, pas de cloche ce matin, pas de chant non plus : le coq s’est tu. Le renard qui l’a croqué la veille rodait depuis quelques jours dans le pré fauché, chassant le mulot mais visant du meilleur; il attendait que le blé ait levé assez haut pour vider le poulailler. C’est fait, pas besoin ce soir d’attendre la nuit avant d’aller me coucher.
En retrait donc, retenu d’aller droit devant au plein. Pris à parti pourtant trois fois, par les pleurs d’un enfant, le claquement d’un volet libéré de son arrêt, et le souvenir ce soir d’un vieil homme aperçu la veille dans un café de Lausanne, dégingandé mais d’une belle élégance. J’ai cru le reconnaîte. La foule souffrait au soleil, il était à l’ombre avec une vieille femme à laquelle il souriait. Il semblait venir de très loin et était sur le point d’y retourner. Comme s’il était venu faire un saut parmi les hommes, rassasié mais gourmand encore, lorsque le soleil brûle et qu’un courant d’air traverse de la cour au jardin. Cet homme presque aveugle, rencontré un jour dans une bibliothèque, n’avait pas vieilli.
Et tandis que je suis encore loin de l’autre bout de la journée, je songe au chemin qui me permettra de rejoindre au plus court ce qui est resté en arrière ce matin, l’autre moitié. J’y songe avec un sentiment de plénitude, celle d’avoir traversé sans peine un pays arasé, sur un tapis volant au-dessus d’une belle journée à laquelle je n’aurai pas touché, une de ces journées qui en définitive ne comptent pas, d’autant plus étranges et merveilleuses qu’il n’en reste rien, d’un seul tenant, sans relief, accrochées à deux demi-rêves.
Jean Prod’hom
Entrer dans le jour | Jeanne

je n'y arrivais pas
je me refusais d'entrer dans ce jour
je voulais attendre (si je l'atteignais) la nuit
les couleurs se seraient atténuées
la lumière tamisée
j'y verrais sans doute plus clair
mais là, non, je ne pouvais pas être de ce jour
rien pour changer d'avis
rien autour
et la nuit s'est glissée là
heureuse rencontre
et la nuit s'est posée là
dans ces marges
et tout est revenu
comme si je m'observais d'ailleurs
à me souvenir des heures passées en douces compagnies
à entendre (et pouvoir entendre) de nouveau ces rires
alors
j'ai fermé les yeux
et j'ai vu ces grands champs fleuris de jonquilles que j'aurais pu ne jamais connaitre
me suis retrouvée sur quelques chemins rêvés menant aux clairières isolées
de ma besace ouverte où m'attendaient patiemment quelques livres
j'en ai sorti le plus usé, le plus écorné - celui qui me laisse écrire dans ses marges
celui qui me laisse là, dans son espace littéraire
je me suis assise là, à l'ombre d'un saule pleureur (pour sa fraîcheur et son chant dans le vent)
quelque crayon à la main, précieusement, j'entrais en lecture
ce soir, cette nuit
je sais
je le sais
je ne peux évidemment qu'être là
dans ces champs de mots pour éviter qu'ils ne brûlent, éviter qu'ils ne me brûlent
je préfère les laisser glisser (pas en torrent)
les laisser être de ces ruisseaux qui s'écoulent lentement
qui, certains de leur place, passent paisiblement près des saules pleureurs
ces espaces, si vastes.. si conquérants..
je suis conquise - toute entière à leurs causes
je ne veux, ne peux être qu'en eux
entre ces lignes..
et.. tout autant..
dans leurs marges..
Jeanne
![]()

écrit par Jeanne qui m’accueille chez elle dans le cadre du projet de vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.
Et d’autres vases communicants ce mois :![]() Christine Jeanney et Jean-Yves Fick
Christine Jeanney et Jean-Yves Fick![]() Tiers livre et Dominique Pifarely
Tiers livre et Dominique Pifarely![]() Joachim Séné et Urbain, trop urbain
Joachim Séné et Urbain, trop urbain ![]() Morgan Riet et Murièle Laborde Modély
Morgan Riet et Murièle Laborde Modély ![]() France Burghelle Rey et Denis Heudré
France Burghelle Rey et Denis Heudré ![]() Florence Noël et Anthony Poiraudeau
Florence Noël et Anthony Poiraudeau ![]() Anne-Charlotte Chéron et Christophe Sanchez
Anne-Charlotte Chéron et Christophe Sanchez ![]() Maryse Hache et Pierre Ménard
Maryse Hache et Pierre Ménard ![]() Louis Imbert et Arnaud Maïsetti
Louis Imbert et Arnaud Maïsetti ![]() Michel Brosseau et Brigitte Célérier
Michel Brosseau et Brigitte Célérier ![]() Jeanne et Jean Prod'hom
Jeanne et Jean Prod'hom
Jean Prod’hom
In fine

Que nous acquerrions quelques connaissances, quelques outils ou bienfaits, bref des bénéfices, au détour des actions qui nous ont permis de faire ce que nous devions faire en vertu des impératifs de la conscience, tant mieux. Que tout nous glisse entre les doigts, sable, eau et dollars, qu'importe en définitive. Que nous perdions de vue l'horizon qui veille sur le passé et le seuil de la maison qui nous a vu naître, et le monde qui se trouve à égale distance de l'un et de l'autre, ce serait se placer sur une voie sans issue. Mais que nous n'atteignions pas à la fin l'équanimité désirée en dépit de nos efforts constants et obstinés, c'est ce qui peut nous arriver de pire.
Jean Prod’hom
Anniversaire

Il faut qu'aujourd’hui encore je m'y colle puisqu’il ne s’est trouvé dans le zinc du 807 aucune âme assez généreuse pour me rédiger une triplette assez ronflante le jour de mon anniversaire.
On aurait pris conscience à cette occasion de ce qui distingue les essais disgracieux de 807 nains du geste tranchant d’un géant.
Quoi qu’il en soit, avoir disposé sans bourse délier de 807 nègres, dociles et besogneux, qui auront oeuvré 807 jours durant à l'établissement définitif de votre renommée, n'est-ce pas là le signe avant-coureur du génie ? Faut-il les en remercier ? 807 fois ?
Jean Prod’hom
18 juin 2009
Fond de l'île

Personne n’était arrivé indemne
dans les bas-quartiers de l’île
poches vides autrefois
occupées dès les premiers jours
par des exilés
au statut indéterminé
des choix arbitraires
qu’on déplore
aujourd’hui encore
mais qu’on admet faute de mieux
n’en parlons plus
nous n’y étions pas
banlieues sur pilotis
réduites mais placées en nombre
au-dessus des eaux dormantes du marécage
satellites de bambous
bien entendu
on y tournait en rond
le gouverneur les appelait
dépendances autonomes du centre
on ne craignait pas les paralogismes
des régions prospères
aux dires de certains
des régions aux mains vides
désoeuvrement en boucle
on gobait les oeufs
des oies sauvages
on enrubannait
les arbustes rabougris
de la dune
on faisait sécher au vent
les linges de lin
dans des bouquets de genévriers
des rêves
sous les ruines en construction
de pierres sèches
des idées perdues
ce n’est pas ainsi qu’on ferait face
à l’envahisseur
derrière le chant rauque
des oiseaux camouflés
patientaient de nouveaux arrivants
aucun témoin
on voyait là pour la dernière fois
des choses jamais vues
Jean Prod’hom
Dimanche 30 mai 2010

Il est un peu plus de midi et je traîne depuis ce matin dans l’un de ces culs du bout du monde dont on croit toujours que le destin va vous épargner la visite et auxquels on touche pourtant deux ou trois fois dans sa vie par une succession de hasards. Il faut donc s’estimer heureux, pour autant qu’on ait l’esprit libre et qu’aucune passion ne vienne allumer le regret d’avoir perdu son temps : ce n’est pas tous les jours qu’on a la chance d’être l’hôte des locataires d’une impasse d’après la fin du monde.
Il a plu tout le matin et je n’ai vu personne encore dehors. Terres autrefois gagnées sur les bois noirs qui bordent la rivière, elles n’ont vu pendant des siècles qu’un ou deux fermiers aux commandes de fermes cossues. D’autres défricheurs sont venus depuis, ont épilé la vallée, bosquets, haies y ont passé. Ils ont déroulé le bitume et construit des villas par dizaines que les nouveaux riches des petites villes voisines ont dessiné à l’image de leurs constructions enfantines : laides et originales, murs épais et crépis talochés, projetés, écrasés, grattés, gros grains, pierres apparentes. Bleu, rose et vert pâle, toutes à bonne distance les unes des autres. On a sombré dans la laideur, impossible que la vallée s’en remette. Tout est déjà en ruines, ils pourriront là.
Deux grosses dames mangent une assiette de crudités. Elles sont du coin. Assises face à face, elles concassent comme des noix leurs amies d’hier à la table ronde de l’auberge du village, dans un dialecte qui désarticule leurs mâchoires. Leur front dégouline, je ne comprends rien. La méchanceté fait briller les verres de leurs lunettes aux montures noires et droites. elles ont écarté le quartier de melon qui a la couleur du saumon, trop mou à leur goût, rien à ronger. D’ailleurs on ne voit pas leurs petites dents acérées sous la menace desquelles les deux sorcières ouvrent la bouche pour faire gronder des sons gutturaux et des voyelles grimaçantes. Elles serrent dans leurs mains dodues un verre de bière. Elles en veulent beaucoup à leurs amies, mais la plus grosse plus que l’autre.
Elles étaient là quand je suis entré, je ne les verrai pas sortir, il vaut mieux. Dedans et dehors le spectacle est terrible. Et je ne vois pas d’issue
Jean Prod’hom
Conciliabule

Plus rien ne colle exactement et les choses qui ont entraîné dans leur sillage les restes d'une journée à peine commencée sont toutes déjà là-bas, adossées à l’horizon, grégaires sans l'être, pas un mot, nulle complot, nulle conspiration, aucun avertissement non plus. Elles se sont éloignées comme les nuages dans le ciel poussés par le vent, et c’est tout. Lorsqu’elles auront basculé derrière la ligne d’horizon, ce sera trop tard. Que faire en attendant? Il serait fou de ne pas réagir, de se laisser happer dans le vide qui se creuse sous nos pieds, impossible pourtant de rejoindre les nuages dans le ciel. Comment durer jusqu'au soir? Comment lier le soir au matin?
En faire trop les ferait fuir, courir derrière elles ne conduirait à rien. Plutôt maintenir coûte que coûte cette distance sans rien vouloir changer pour l’instant, ne rien corriger, maintenir la tension vivante. Il serait naïf de penser qu'elles pourraient répondre à notre appel, se retourner et nous attendre, mais ça on le savait déjà avant, on s’en rend compte aujourd'hui avec une espèce de frisson qui leur rend dignité et loyauté. Naïf aussi de leur prêter une voix qu’elles n’ont pas, au mieux leur prêter une voix qu'on ne connaît pas.
Ce n'est pas qu’elles se taisent, mais on n’est pas avec elles. Elles murmurent même, le vent, la lumière, les éclats, mais elles sont à leurs affaires – on n'y est pas –, dans un halo qui les maintient à l’écart et fait trembler notre raison. Il convient de tenir bon et de s’en satisfaire. Les choses sont retournées à l’ancêtre d’un récit sans queue ni tête, dévastation muette, et laissent debout celui qu'elles ont débarqué avant le lever du soleil, passager hébété qui a trop posé de questions, debout en voie de disparition, effaré de ne pas être de la partie, statue de ciel. On ne s'est pas retourné à temps et on a laissé filer le vaisseau, planté dans le pot au noir d'avoir trop marché avec les choses, mais à reculons, manquant de ce courage d'aller avec elles dans le sens qui est le leur. Mais qui nous a enseigné ce courage?
De nous être retourné continûment sur ce qu'on croyait nous avoir été donné, de ne pas être allé de l’avant dans le vide qui nous salue à l'aube, le silence qui accompagne le froissement de nos semelles sur le chemin de terre, nous a mis, lorsqu'on s'est enfin tourné vers ce qui s'en allait devant, l'enfer dans le creux de la main. C’est à prendre ou à laisser et on prend. Plus d’élégie ou de lyrisme mais un bateau qui s’éloigne et nous en rade, qu’il ne s’agit ni de rejoindre ni de retenir, parce que le silence qui s’enfuit, c’est aussi celui qui est là. On aura à prendre son parti et le parti des choses, et dire avec les mots qui nous restent ce qui manque, c'est-à-dire ce qui est, et le disant mieux dire ce qu’elles sont.
Jean Prod’hom
André Dhôtel : La Vie d'Arthur Rimbaud

On y va d'un bon pas et on en revient dépaysé, léger, raccommodé, à mille milles des sommes habiles, intelligentes, brillantes parfois, complètes naturellement, mais trop lourdes pour ne pas tomber des mains. C’est un livre écrit gros pour les derniers de classe, incapables de lire des livres qui ne ramènent pas le plus étrange sous la plante de leurs pieds. C’est un livre d’André Dhôtel qui a déroulé une première fois La Vie d'Arthur Rimbaud en 1964. Les Éditions de l’Œuvre rééditent aujourd’hui ce texte qui s’effeuille comme une marguerite et qui fait voir feuillet après feuillet le destin d’un égaré généreux, dans les Ardennes d’abord, n’importe où ensuite. Il fait voir ce destin deux fois, c’est-à-dire enfin, deux fois Charleville, deux fois Vouziers, deux fois Attigny, deux fois la Meuse, deux fois Roche où, lorsqu’Arthur Rimbaud y rejoint les siens pour trouver un refuge, une île, un trou pour écrire enfin un vrai livre, André Dhôtel le talonne et raconte.
Rimbaud avait dû faire une demi-douzaine de kilomètres à pied depuis Amagne, par la route qui longe la vallée à travers Attigny. Entre Attigny et Roche la route entre les cultures était absolument vide, sans un buisson, avec un arbre de loin en loin, et elle redescendait vers un bas-fond, où se cachait le hameau. De loin on apercevait seulement le pigeonnier de la ferme des Cuif. Toutes les autres habitations étaient cachées dans le verger. Un lieu sans vie apparente. Rimbaud alla frapper avec hésitation à la première porte. Il trouva sa mère avec Frédéric et ses deux soeurs (Vitalie avait quatorze ans, Isabelle douze).
La maison qui restait vide pendant l'hiver était encore imprégnée d'humidité. L'herbe envahissait la cour intérieure. Après Londres et ses banlieues peuplées et nettes, riches en beaux arbres, c'était le pays perdu, dépourvu de tout caractère. Un ruisselet au bout du hameau, après une prairie marécageuse. Rien que des terres fertiles mais désertes à perte de vue sur le plateau.
Et c’est au bout de ce chemin qui descend au hameau de Roche – où l’attend une mère dont enfin quelqu’un nuance l’allure et le rôle –, dans la cour pavée des Cuif, vide, sans vie apparente, que le vieux sage relève quelques lignes d’un feuillet à l’allure évangélique au verso duquel le jeune fou commença d’écrire un brouillon de Mauvais sang.
Jésus dit : "Allez, votre fils se porte bien." L'officier s'en alla, comme on porte quelque pharmacie légère, et Jésus continua par les rues moins fréquentées. Des liserons, des bourraches montraient leur lueur magique entre les pavés. Enfin il vit au loin la prairie poussiéreuse, et les boutons d'or et les marguerites demandant grâce au jour.
Dhôtel je l’aime bien – les deux autres aussi –, j’aime le maigre feu sur lequel il souffle, sa bienveillance, sa patience qui l’a conduit à faire bande à part, les fleurs ses alliées, loin des excès, au voisinage de la désobéissance. En voilà un qui est allé de son côté sans demander son reste, comme l’autre qu’il a accompagné, en donnant à tort et à travers. Chacun de son côté, à la ville et à la campagne, place vide et place pleine, les pieds dans la peine, la gorge entre les pavés, à l’image des liserons et des bourraches, et une soif inextinguible en les déserts, en les chemins qui descendent comme des cathédrales, en ces cours vides, ces cours qu’on connaît bien, et qui nous obligent à chercher à la fois la liberté et le salut.
Jean Prod’hom
André Dhôtel, La Vie de Rimbaud, Éditions de l’Œuvre, Paris, février 2010
Arthur Rimbaud, « Proses évangéliques » in Oeuvres complètes, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1979
LXV

L’intelligence qui a présidé à la création de l’homme est admirable jusque dans ses moindres détails. Tenez, pensez par exemple à l’écartement des narines, à celui des yeux, à la distance entre l’oreille et la bouche!
Mais pourquoi diable, se demande Jean-Rémy, Dieu a-t-il fait patienter l’homme si longtemps, avant de mettre à sa disposition le pince-nez, les lunettes et le téléphone? N’était-ce pas couru d’avance?
Cette question nuit à la vie paisible de notre philosophe et le torture. C’est elle qui le retient d’adhérer sur le champ à l’un des mouvements créationnistes qui sévissent aujourd’hui dans notre région. Jean-Rémy est certain d’ailleurs que, si c’était à refaire, Dieu aurait lancé dans la bataille un homme muni dès le commencement de tous les attributs que l’histoire lui a délivrés au compte-goutte. Un homme avec pince-nez, lunettes et téléphone à la naissance, ça n’aurait-il pas fière allure?
Et pour notre bonheur à nous, des histoires, Jean-Rémy en aurait fait moins.
Jean Prod’hom
Après le solstice

Lorsqu’on eut terminé
les grands aménagements
on attribua
à chacune des saisons
ce qui restait
le partage de la double équinoxe
l’éclosion des quartiers de la lune
les éphémères
les jours surnuméraires
on remplaça encore
le ruban
rouge sang
qui séparait le jour et la nuit
par une bande de dentelle
aux multiples valeurs de gris
que les passementiers
exécutèrent l’hiver qui suivit
on répondit
aux dernières questions
quand célébrer
les héros de l’île
où dresser la statue du héron
quand faire pivoter l’an
à l’évidence
l’administration d’un tel réseau
de difficultés superposées
à la multiplicité des noeuds
que leurs prédécesseurs
n’avaient pas tranchés
donna une valeur
toute particulière
centrale et militaire
au volontariat
on boucla enfin les comptes
aucun recensement
cette année-là
une estimation seulement
cent vingt foyers
autour du grand palais
pas même une maison des jeunes
aucun autre atout
Jean Prod’hom
Dimanche 23 mai 2010

Le frelon s’agite en tous sens, mais il suffit de lever une paupière pour se rendre compte qu’il ne réfléchit pas beaucoup. Visiblement il attend un coup de main, on ouvre tout grand la fenêtre, trop difficile encore, il faudra patienter une bonne demi-heure avant qu’il ne trouve enfin la sortie, il vrombit alors une dernière fois et disparaît en creusant un boyau ouaté dans lequel les pépiements des moineaux profitent de s’engouffrer, en sens inverse, jusqu’à nous. A l’arrière se détachent, lointains, déteints, les neufs coups du battant de la cloche de l’église qui teinte dans le désert. Et puis, venu de plus loin encore, le silence qui rejoint le soleil sous le toit, il adoucit et rafraîchit le drap dans lequel on se vautre comme des rois.
Elle l’observait sûrement depuis un moment; il y a dans les yeux de quelqu’un qui a eu le temps de vous examiner toute une image de vous, retirée, hors de portée, et pourtant bien présente.
Henri Thomas, John Perkins, Gallimard, 1960
![]()
Derrière la maison la bise fait onduler la prairie, lourde et grasse, nourrie au grain. Les années du marais de la Montagne du Château sont comptées, la terre a gagné la partie. Demeure pourtant tout à l’est une large étendue d’eau secrète où vivent et dorment trois colverts. Les petites habitudes auraient-elles laissé la place à l’habitude tout court?
Jean Prod’hom
La menace

Rester en rade alors que le monde appareille, sans que rien pourtant ne s’éloigne vraiment – sinon le souvenir d’images qui s’entassent en arrière de la tête – , sans que l’on recule non plus. Ne rien avoir à dire à ce propos, ou un mot, à peine un mot qui resterait au travers de la gorge, et qui dirait tout, d’un coup. Mais ne le dire que plus tard, peut-être, lorsque la menace se sera éloignée ou qu'elle aura trouvé en nous la place qui lui revient, avec ce mot qu’on cherche et qu’on ne trouve pas, parce que ce mot est un mot de notre langue. On est là, et on ne sait pas par quel bout commencer, parce qu’il n’y en a pas de bout, que tout est demeuré en l’état. Tout ça bien sûr devait arriver, on le sait, et on se retrouve enfin dans l’impossibilité de différer plus avant cette menace, grosse d’avoir été écartée. Et de la différer encore un peu pour qu’elle puisse continuer sa tâche, nous accompagner lorsqu’on s’attellera à la nôtre, qu’on sait au-dessus de nos forces, tout reprendre, comme un livre dont aurait commencé la lecture il y a des années, et qu’on reprendrait en raison d’une ou deux phrases sur lesquelles on aurait buté et qui nous aurait obligés à aller de ce pas.
Ce qui semble nous maintenir à l’écart, mais qui nous accueille aujourd’hui encore quand bien même on se trouve dans l’impossibilité d’y entrer, sur le seuil de quoi on se dresse comme un pantin, un étranger, un malotru, n’a pas changé, c’est bien le monde dont on vient et dans lequel on a cru pouvoir demeurer, un monde reconnaissable à la traîne qu’il laisse, à quelques souvenirs qui courent devant, à la mélodie qui s’est tue et qui accompagnait notre réveil. Méconnaissable pourtant, non pas qu’il soit défiguré, ou en lambeaux, mais à cause des couleurs passées, qui maintiennent à distance les noms dont l’affublaient les récits qu’on se racontait pour lui assurer par des couleurs vives sa consistance. Les choses ont repris ce qui leur revenait, inquiètes. Le doigt sur les lèvres, elles demandent un peu de silence. Désormais restent dans ma gorge des mots orphelins, durs, sourds, décollés de ce qui les animait et de ce qu’ils faisaient vivre, pierres dans un tonneau, squelette dans un habit trop large. Les mots ce matin font bande à part.
Jean Prod’hom
LXIV

Depuis qu’il est à la retraite Jean-Rémy tue le temps. Il a fait installer une caméra sur la façade nord de sa maison pour surveiller les allées et venues des hôtes d’un monde qu’il a toujours voulu à sa main.
Chaque matin il sort discrètement de chez lui, se rend à la boulangerie acheter un morceau de pain. Au retour il passe devant chez lui en jetant un regard furtif en direction de la maison vide, admiratif, ému. Il passe une seconde fois, puis une troisième avant de rentrer incognito par la porte de derrière.
Et le soir, lorsqu’il visionne les images du jour, Jean-Rémy se réjouit de l’efficacité de son dispositif. Il se ronge pourtant les ongles chaque soir davantage lorsqu’il voit passer un homme au regard envieux et vitreux, une fois, deux fois, trois fois, un homme qu’il reconnaît à peine, un homme louche qui lui paraît de soir en soir toujours plus suspect.
Depuis ce matin Jean-Rémy est armé.
Jean Prod’hom
A Bertrand Russell

« Les 807 » est le brin que tu as choisi pour réunir les 807 brins de ton entreprise. C'est dire qu'elle va échouer. Fais tes comptes Garot. Tu ne t'es pas arrêté à temps, tu as péché par arrogance, tu ne connais pas le monde, tu auras beau reprendre le décompte. Mais où en étais-tu Nemrod ? Impossible de te le rappeler. Tu vas donc repartir du premier. Parvenu à 808, désespéré, tu t'arrêteras. La pelouse est vaste encore : 809, 810, 811...
Jean Prod’hom
14 novembre 2009
Exogamie

On précipitait
dans les gouffres
du sud de l'île
la femme turbulente
la soeur pleine de dédain
comprenez
on supportait mal
la promiscuité
on précipitait
les mères affligées
qui faisaient tousser
le commerce prospère
de la guerre
on précipitait
les hommes mûrs
ceux des groupes alliés
lorsqu'ils refusaient
pour le prix d’une flèche
de céder
l’une ou l’autre de leurs soeurs
dans la vallée des alliances
malgré des vagues d’aigreur
on avait sacrifié
mis en pièces
l'unique communauté
on tient pour certain
ce sujet obscur
on organisait
au printemps
sur le rivage
une combinaison d'échanges
à cycles longs
à cycles courts
bilatéraux et croisés
les mésanges sur les joncs
les roseaux dans la prairie
l'eau blanchâtre sur les flanc de la colline
les joncs et les roseaux
la prairie sillonnée par l'eau blanchâtre
l'autre côté de la colline avec les mésanges
c'était l'occasion
de prolonger
les belles journées
d'améliorer
le réseau des canaux
dans lesquels s’écoulait la sueur
les femmes étaient éconduites
dans des barques
silencieuses
tout autour
les eaux libres
et des terre-pleins secondaires
le crépuscule
avait la forme
du labeur
Jean Prod’hom
Dimanche 16 mai 2010

Ce matin le soleil a jeté un paquet de lumière par l’étroit châssis à tabatière des combles dont il a fait fuir, le temps d’un éclair, l’obscurité crue. Puis plus rien. Je veux pourtant, idiot que je suis, me souvenir un peu de cet éclair pour le maintenir brûlant, faire flamber la vieille charpente et éclairer notre dimanche.
Nous sommes à la mi-mai, dehors le jaune du colza et celui orangé des pissenlits étoilent le vert des prés lourds. Le printemps n’a pas tenu ses promesses et ne laisse filer entre ses doigts que des couleurs passées, un peu de rose. celui du liseron au bord du chemin et les fleurs détrempées des Boscop dans le verger du Chauderonnet, les hautes herbes pâles près des haies, les nuages sans forme qui ne désemplissent pas le ciel. A quoi bon s’apitoyer, on patiente en haut de la Mussily main dans la main.
Plus tard dans l’après-midi une flambée de soleil réveillera les abeilles sur le qui vive depuis le début de la semaine, quelques promeneurs souriants et les cris des enfants auront raison de notre humeur. Mais dans le poêle le feu veillera jusqu’au soir.
Jean Prod’hom
Hors jeu

Il ouvre les yeux sur un jour sans attrait. Alors il baisse les paupières qu’il glisse sous l’oreiller et il se terre. Forclos, rideaux tirés, chassé dès le réveil, c’est clair il n’en sortira pas. L’éprouver et le dire n’y change rien, la lumière insiste, il remue à peine, incapable d’en appeler au courage. Ce matin le jour est fané.
On devra se rendre à l’évidence, aucune transaction n’écartera le soleil de sa course, il faudra faire avec ce qu’il traîne derrière lui, les besognes auxquelles la vie parmi nos semblables nous oblige pour être des leurs. Ça durera ce que ça durera, jusqu’au soir peut-être. On hésite même à plier bagages, à solder l’entreprise, pour se débarrasser enfin des tâches fastidieuses qui nous incombent, au risque de finir sa vie plus tôt que prévu, avant le crépuscule. Pourquoi ne pas fuir sur le champ les humiliations promises ? Mais un peu de raison nous rattrape : il en faudrait du courage pour s’engager sur cette voie et s’y tenir, sans que les regrets et la mauvaise conscience ne nous rejoignent avant midi.
On se lève donc parce qu’on sait que ce soir, pour autant qu’on y parvienne, on pourra retourner dans le tambour de la nuit qu’on aurait voulu ne pas quitter, pour y être à nouveau enfermé, tourné, retourné, préservé, lavé. On se lève donc en sachant qu’on n’ira nulle part. On fera pourtant comme si on en était et personne n’en saura rien. On se fera petit, tout petit, invité surnuméraire : ne toucher à rien, n’entrer en matière sur rien avec qui que ce soit, demeurer muet calé dans l’ombre, mais y demeurer avec tous les égards que le rien doit à ce qui est et à ceux qui s’y sont embarqués. A bonne distance, ne pas en être, refuser toute invitation et survivre jusqu’au soir. Un sourire ici, un autre là, une politesse en guise de viatique, pas plus, pour ne pas casser.
On s’y essaie, on sème nos petites lâchetés pour donner le change et passer inaperçu, cacher sa misère. Mais qu’on ne nous accable pas, on essaie simplement de garder la tête hors de l’eau, un ou deux sourires à ceux qu’on croise, sans y toucher, fonds de poche que celui qui n’a rien à perdre dépose dans la main de celui qui veut tout, ni victime ni coupable, innocent de n’être rien, au diable les plaintes. Tout à l’autre par calcul, tout aux autres pour sauver sa peau. On se rend compte alors que ceux-ci sont comme nous, mais ils sont dedans et on est dehors, on ne bronche pas et ils sont ballottés. Et voici qu’ils répondent à nos sourires, sourient à leur tour, nous remercient de notre sollicitude et de notre bienveillance alors qu’on n’a pas quitté le rivage, ancré à l’inavouable. Mais ça ils ne le savent pas et on ne le leur dira pas. On les voit batailler pour rester debout dans la tourmente du jour et notre misère souriante est à leurs yeux comme un réconfort. On est resté dans la nuit, ils sont dans le jour. On ne voulait rien, défait, vidé, et nous voilà élevé au rang de contrefort.
Et soudain, de don modeste en modeste don, de sourire en sourire monte la sensation d’être présent comme jamais, dedans le monde sans qu’on le veuille, avec en face ceux qui bataillent pour ne pas succomber ou être chassés. On se prend à en faire plus qu’on n’en a jamais fait, sur un mode qu’on ignorait, simplement pour que ces inconnus courageux ne s’effondrent pas. On leur cache un peu de la vérité, on ferme les yeux, on souhaite qu’ils atteignent vivants la fin de la journée.
Ce soir je suis comme une plaie vivante que la brise et l’ombre viennent caresser, je me retourne, heureux d’avoir passé debout ce qui aurait pu être un enfer, l’air glisse sur la peau, avec la lumière, ma raison est au point mort. Ce que j’ai laissé en arrière, la nuit, le fond du jardin, les racines auxquelles je m’agrippais pour remonter le talus n’ont pas changé. Le temps s’est arrêté là-bas, par delà les jours, les images, les souvenirs qui ne retiennent que ce qui se défait. Les chemins durent bien après qu’on les a quittés.

Je me retrouve sur le chemin de la Mussily, indemne, étonné d’être là. Tous les jours pourraient être ainsi, n’est-ce pas ? On demeurerait sur le seuil, on ne toucherait à rien, parce qu’au fond on n’y croit guère. On n’en serait pas, on aiderait d’un sourire ceux qui sont embarqués et on cueillerait quelques rameaux pour en être un peu.
On n’y voit bientôt plus rien, je rentre, dépose mon ombre au pied du lit, me glisse dans le grand tambour de la nuit avec le sentiment crépusculaire d’avoir encore une fois sauvé ma peau et la fierté de ne jamais avoir été aussi généreux, solide et transparent que ce jour où je ne fus pas.
Publié le 7 mai 2010 dans le cadre du projet de vases communicants chez Arnaud Maïsetti (Journal | contretemps)
Jean Prod’hom
LXIII

J’ai rencontré hier au marché une amie, physicienne de formation. Je ne l’avais pas revue depuis longtemps déjà. Elle est en colère contre son mari, ébéniste, et ses deux filles, cinq et sept ans, qui décidément ne la comprennent pas. Je l’invite à boire un verre sur une terrasse. Elle me raconte le visage défait comment la veille, alors qu'elle était attelée à des problèmes qui dépassent mon esprit étroit - le mien comme celui de la plupart des mortels -, elle en est arrivée à devoir chercher sans succès sa machine à calculer.
Elle soupçonne naturellement ses enfants. Précisons que ce cerveau a formé ses filles aux dures lois des nombres dès leur sortie du berceau, mais prévenante elle les a initiées aussi toutes deux à l'utilisation de la machine à calculer qui préserve la fraîcheur de leur intelligence en leur permettant d’éviter les effets dévastateurs des tâches fastidieuses.
Elle est donc sur le point de piquer une grosse colère, mais se ravise. Cette disparition n'est-elle pas le signe tangible de la réussite de ses principes éducatifs? Elle prend une feuille, un crayon et se résigne à exécuter avec le sourire d'interminables calculs.
Neuf heures bientôt et la nuit tombe. Etonnée du silence qui règne dans la maison, la mère monte à l'étage et retrouve ses trois filles vautrées, les yeux fermés devant la télévision insérée dans l'armoire vaudoise que son mari a promis de réparer depuis plusieurs années. C'est chose faite, l'équilibre précaire dû à l'absence du pied antérieur gauche a été enfin rétabli! Mais la mère a beau regarder sur l'écran de la machine à calculer qui étaie le meuble, aucun nombre n'indique la charge supportée ou la résistance du pied de fortune. Pas même l'heure à laquelle les trois petites qui se sont assoupies souhaitent être réveillées. Rien. C'est naturellement et logiquement la faute de son mari qui n'est pas encore rentré de l'atelier, mais c'est surtout la défaite de l'esprit de conquête.
Je la console en vain. Pourvu que l'incomprise retrouve au plus vite le goût de vivre.
Jean Prod’hom
Trop c'était trop

Si Gérard Genette admire « le nombre d'ensembles où l'on dénombre trois-cent soixante-cinq items dès qu'on a un peu de mal à les compter, en trichant toujours un peu : les fromages français, les îles de l'archipel de Chausey à marée basse, les châteaux du Bordelais, les pièces et les horloges de l'Elysée, les romans de Simenon, les députés de la droite élus en 2002, les voitures brûlées en banlieue par semaine... » et conclut que « ce nombre symbolique, clairement calqué sur celui, plus sûr, des jours de l'année non bissextile, signifie simplement, et avec tout le flou figural qui convient : beaucoup », j'ose aujourd'hui espérer que huit cent sept précédera bientôt les items de tout ensemble incomplet – y compris l'ensemble inachevé des huit cent sept – et signifiera in fine, avec le même flou figural qui convient : trop c'était trop.
L'entreprise engagée par Franck Garot et ses amis sur ce site se doit donc de ne pas aboutir pour réussir, c'est le prix. Elle doit s'interrompre impérativement avant le huit cent septième huit cent sept, j'y veillerai.
Et pour donner l'exemple : pas de huit cent sept aujourd'hui.
Jean Prod’hom
22 septembre 2009
Travaux de titans

Derrière le monticule
en arrière d'une large baie
que souligne
un arc d'argent
jalonné de zones d'ombres
les restes
d'une tentative plus récente
ultime défi
si l'on en croit les légendes
des premiers habitants de l'île
qui entreprirent
l'impossible tâche
de séparer
le liquide du solide
ils creusèrent
des canaux
dans la vase
endiguèrent
les bras de mer
conçurent des levées
des quais
des complexes de galets
des ponts et des chaussées
des lacs
qu'ils parquèrent
avec les eaux dormantes de l'intérieur
à la terre ils arrachèrent
la terre
l'eau à l'eau
la boue profonde aux bancs de sable
sans succès
les larmes ne coulaient plus
sur les visages
mais demeuraient avec les glaires
au fond de leur gorge
ô solitude
mêlée de grandeur
ô peuple malheureux
dévoré par de folles ambitions
ô peuple insatisfait
dévasté par l'échec
et le ressentiment
aucun chemin
ne resplendit aujourd'hui
le miracle de l’opiniâtreté
n'a pas pas eu lieu
le souvenir dans les mémoires
seulement
d'un insatiable orgueil
on le voit
on ne réforme facilement
ni les choses
ni les usages
si bien qu'on accepta sur l'île
mais à contre coeur
mélanges et marécages
et les hommes se remirent à pleurer
Jean Prod’hom
Dimanche 9 mai 2010

Je ne suis pas loin de penser avec Pierre Guyotat qu’il faudrait, pour refaire le temps mais en bien, rendre le couteau à la meurtrière qui a osé « commettre ce dont brillent nos tragédies, nos poésies, et nos romans, et nos tableaux et nos opéras, et que leurs artistes façonnent avec tant de soin, et de plaisir, et que nous devons étudier avec application ».
Pour des raisons assez analogues il faudrait ouvrir tout grand les portes de nos écoles afin d’obliger nos enfants à faire l’école buissonnière, sur les traces du Grand Meaulnes et de tous les héros désobéissants qui nous ont fait rêver. Pour replacer le mystère dans la vraie vie et pas dans l’autre.
Jean Prod’hom
Des marges | Arnaud Maïsetti

Du centre, je ne saurai rien dire ; rien que le silence dans lequel vautré le matin au réveil qui me prend — rien que. Et du centre, au cœur, le terrain des batailles politiques rangées des idées qu’on se lance ; non, rien : le centre, ils savent bien qu’il est à eux, alors moi, à contretemps qui pèse la lumière du jour, qu’est ce que je pourrais : et quand je les regarde, dans les repas le soir où parfois je suis, que je les entends dire la pensée du monde figée depuis ce centre qu’ils occupent, je pense à ce qui s’en va, loin du centre où — du centre centré au milieu des villes, c’est le vide, c’est là que les flux se rejoignent, s’arrêtent, cessent, enfin. Moi, c’est ailleurs, où les flux vont, et d’où ils partent, que je vais.
Du centre, je sais bien, oui : que c’est là qu’est la moyenne, que les discours se font — mais pas la parole, que les discours — c’est là. Où Dieu habite, la pensée de Dieu telle que le formulent ceux qui au centre, sont au centre et décident, planifient, rédigent pour nous les pactes du siècle, concluent pour nous les poignées de mains et les tarifs, et les peines, les planchers, la hauteur de la lame qui viendra tomber sur celui qui ; du centre, non, quand on me demanderait mon avis, je me tairai bien pour les années qui viennent.
De la morale éteinte en moi, de la religion éteinte en moi, du souci de la politique : des centres d’intérêts qui fondent le centre autour duquel : je ne sais dire que cela m’échappe. Je ne saurai prétendre lui échapper. Et surtout, je ne voudrait pas m’en plaindre. Mais. Les choses mortes comme de la peau, on ne les regrette pas : on gratte, et si ça saigne, on aspire un peu pour ne pas laisser de trace — et on frotte, on essuie. On met son doigt dans la plaie, et comme Thomas, on fouille pour vérifier le corps ; et le corps est bien là. Loin du centre, on marche, on est déjà loin, ça peut s’appeler Arar, ou Breschwiller, ou plus loin encore, état des lieux du réel, chaque pas nous en éloigne, du centre : et on va.
On se trouve de l’autre côté où les choses prennent la vitesse du temps ; on n’est plus dans le silence : on le parle, depuis le centre, arraché vraiment. On tombe sur une place vide, derrière le palais royal, les jardins de boue, il y a une église où on entre parce qu’il pleut. Il y a des chants au-dedans, qui viennent se heurter à la croyance de mon adolescence comme une paroi effondrée, et l’écho pénètre dans le vide qui l’absorbe. C’est Bach, c’est au-delà de moi, c’est en plein de centre du monde, pile où je ne suis pas.
Dans les marges sans contours que j’arpente jusqu’à mourir (je le sais bien, je l’accepte), à force de les écrire parce qu’en moi tout l’exige, noter les bruits du monde qui m’entoure — et puisque ces bruits ne peuvent s’entendre qu’aux marges, marges fracassées dans le crâne (et de plus en plus, ces maux de tête qui me cernent : marges là encore : prix à payer, je m’en acquitte, sans ciller) — des chants de Bach, des voix qui percent, n’en saisir que la morale possible : la morale d’une beauté sans Dieu ; arracher Dieu à cette beauté qui seule me maintient là, pulsation du temps que je bats sous les doigts, un mot après l’autre, dire un peu dans sa propre bouche le monde tel que dans les marges il afflue hors.
Au centre rien ne bouge, dans les marges, il y aurait la force de ne pas habiter, nulle part, et d’aller au pas qui l’emporte, les mondes possibles que les voix défrichent : musique sans mélodie, nappes de voix qui parlent allemand une langue impossible et qu’on ne comprend pas — mais combien chaque mot avance l’impossibilité même d’y prendre part : et comme on avance en eux, le monde qui recule, et au bout du premier pas, c’est dans les marges qu’on est : on ne se retourne plus.
Arnaud Maïsetti
![]()

écrit par Arnaud Maïsetti qui m’accueille chez lui dans le cadre du projet de vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.
Et d’autres vases communicants ce mois :![]() France Burghelle Rey et Morgan Riet
France Burghelle Rey et Morgan Riet ![]() Anna de Sandre et Francesco Pittau
Anna de Sandre et Francesco Pittau![]() Anthony Poiraudeau et Loran Bart
Anthony Poiraudeau et Loran Bart![]() Mathilde Roux et Anne-Charlotte Chéron
Mathilde Roux et Anne-Charlotte Chéron![]() Michèle Dujardin et Daniel Bourrion
Michèle Dujardin et Daniel Bourrion![]() Christophe Sanchez et Le coucou
Christophe Sanchez et Le coucou![]() Antonio A. Casili et Gaby David
Antonio A. Casili et Gaby David![]() Michel Brosseau et Christine Jeanney
Michel Brosseau et Christine Jeanney![]() Matthieu Duperrex et Pierre Ménard
Matthieu Duperrex et Pierre Ménard![]() Joachim Séné et Franck Garot
Joachim Séné et Franck Garot![]() Tiers livre et Kill me Sarah
Tiers livre et Kill me Sarah![]() Juliette Mezenc et Ruelles
Juliette Mezenc et Ruelles![]() Marianne Jaeglé et Brigetoun
Marianne Jaeglé et Brigetoun![]() Florence Noël et Juliette Zara
Florence Noël et Juliette Zara![]() Soupirail et Jeanne
Soupirail et Jeanne![]() Cécile Portier et Luc Lamy
Cécile Portier et Luc Lamy![]() Chez Jeanne et MatRo7i
Chez Jeanne et MatRo7i![]() Landry Jutie et Notes&parses
Landry Jutie et Notes&parses![]() Piero Cohen-Hadria et Pendant le week-end
Piero Cohen-Hadria et Pendant le week-end
Jean Prod’hom
C'est ici

Il n'essaie pas plus de rejoindre le pays d'où il vient que l'autre pays, celui dont il a rêvé, car il est désormais d'ici, davantage chaque matin, dans le pré ou là-bas à la lisière du bois. Il démêle jour après jour les images issues de ses rêves, les épuise, la brise légère se charge du reste et dissipe les innombrables fantômes qui sommeillent dans le tracé glorieux des chemins. Il attend d'y voir clair ne s'appuyant sur rien, sinon ce presque rien, muet, qui apparie les choses élémentaires. Et soudain le pays se dresse tout entier, la terre ondule, les secrets fleurissent, des traînées dans le ciel, l'ombre sous les frênes, la rivière.
Certes, il y a ce vers quoi on va lorsqu'on revient sur ses pas et ce vers quoi on va lorsqu'on y va de ce pas. Mais de ce lieu, qui sait s'il en vient ou s'il y va? L’enfance est l'autre nom de l'avenir, c'est ici, on y va et on en vient.
L'engourdissement auquel l'a conduit son éducation a épuisé son poison. Il prend conscience alors qu’attendre est consubstantiel à son heure. Que veulent-ils savoir? Il l’ignore, alors il se tait pour laisser la place à ceux qui savent, pour que ceux-ci puissent parler et se taire, et entendre à leur tour l’immense rumeur sur laquelle les puissantes conventions ont étendu leur empire. Chacun n'occupe qu'un instant la place de celui qui la lui a cédée. Il la laissera à son tour à celui qui ne perd rien pour attendre.
L’aurore sommeille. S’il s’agite trop, il ne sera pas à même d'aller à sa rencontre derrière les Vanils, il la guette, à peine une lueur poussant par dessous le voile qui ne résiste pas, elle ouvre alors sa paume et étend ses doigts de rose. Lui il ne bronche pas. A côté, devant, derrière, en lui la terre frémit. Et le soleil se dresse, et l’ombre se glisse discrètement aux côtés de l'homme seul.
Jean Prod’hom
LXII

C'est la fête à l’auberge, l'apéro est offert par Lionel, le charpentier, il nous annonce que son fils est né la veille au soir.
– Nous l'appellerons Nathan! annonce l'heureux père. Nous l'avons attendu depuis tant d'années! Santé!
– Des Nathan, tempère le contremaître de chez Progel, j'en avais trois dans mes équipes l'année passée, plus aucun aujourd'hui, on a dû débaucher.
Lionel s'assombrit, l'assemblée aussi, Lionel se tait, il boit un verre, c'est son talon d'Achille, un second, un troisième... Mais Lionel ivre finit par se ressaisir et déclare d'un ton décidé.
– Nous l'appellerons Vin... Vincent! Oui, Vincent!
Je crains que cette décision ne suffise pas à faire bifurquer le destin du nouveau-né?
Jean Prod’hom
Concentrations

Un bouquet de fleurs
en lieu et place
d’un tas de pierres
un tas de bois
des formules rituelles
pour remplacer les cris
le souvenir de l’ibis
une île autrefois sacrée
une terre fertile
un marais au milieu
le portrait
à demi renversé
des aigrettes
en colère
parlant la langue
des canards
et tout autour
l'infranchissable
le ronflement des rancunes
les collets montés
une seule fois
ils se sont baignés
tous plongèrent
après une interminable cérémonie
au lieu où se concentrent
l’être et la concordance des règnes
rien n’y fit
les prairies gorgées d’eau
ne surent rivaliser jamais
avec l’indigence des hommes
battant le pavé
ni les plaintes du vent
ni les aulnes ni les charmes
ni les nuages
ni les parades et les ornements aquatiques
pas même les princes et leur chasse-mouches
les insulaires ne parvinrent
à dégager
aucun des grands axes
qu’il eût fallu
pour que le ciel daignât
leur délivrer
une ou deux éclaircies
Jean Prod’hom
Dimanche 2 mai 2010

Il n'a pas de vie intérieure. Où en a-t-Il pris conscience? Il ne s'en souvient plus. Il sait seulement qu'il était debout et au vent.
Jusqu’à ce jour elle le tenait en respect, immobile et pathétique, dans un silence contrit, il périclitait. Le courage lui est venu de je ne sais où, de la lassitude peut-être ou d'un peu de sagesse. Il a suspendu courageusement les égards qu'il croyait lui devoir, elle s’est évanouie en quelques heures. Un peu seul d’abord, fébrile aussi, et puis vite embarqué.
Il avance aujourd’hui à tâtons, pauvre, allégé d’innombrables arrière-pensées, dans une profusion renouvelée et un monde habité par les dieux, un peu ivre, dans un dédale imprévisible balayé par le vent.
Jean Prod’hom
Hameau

Le soleil levé avant l’aube essore le ventre gras de la compostière, Corentin est au bois. À Pra Massin les fenêtres sont grand ouvertes, c’est le printemps, la grande affaire. Personne dans la maison, les rideaux font le dos rond, caressent en retombant la tablette de la fenêtre, un signe de la main, c’est le cru de la cave qui monte prendre l’air. Mais on respire là-dedans, les braises rougeoient et on devine, enveloppés d’ombres, la veste de Corentin, le linge à mains près de la cheminée, un semainier, l’évier de porcelaine ébréché. La nappe sur la vieille table en bois, quelques fruits, un marron et un gland, des clous sortis du fond des poches. Personne pourtant, les rideaux faseyent, c’est le monde immobile qui appareille. Dehors, c’est comme dans les livres, mais la terre a le ventre mou, les crocus et les nivéoles sont détrempés. Les mésanges bataillent, les pierres sonnent creux, le ruisseau sort de son lit. Repousser les mots, ne pas prolonger pour l’instant une intrigue qui n’a pas commencé. Il sera assez tôt lorsque le soleil déclinera d’effeuiller les images, décoller morceau par morceau les lambeaux des récits qui tiennent debout nos vies. Quelques mots devraient suffire à la fin, lorsque l’ombre se sera dérobée, lorsqu’on verra s’éloigner les nuages et le vent, et le dedans aller dehors. Deux ou trois choses laissées là pour rappeler la légende de mars, comme s’il y eût quelqu’un autrefois, mêlé aujourd’hui aux ombres des noyers sur la pente qui mène au ciel. Avec derrière une autre maison, les volets fermés, dedans une vieille qui a tout laissé dehors, comme si elle allait y retourner.
Mais lorsqu’on lève les yeux pour reprendre à la ligne, plus bas, les yeux n’obéissent plus. Est-ce ainsi ? est-ce bien ainsi ?
Publié le 2 avril 2010 dans le cadre du projet de vases communicants chez Juliette Zara (Enfantissages)
Jean Prod’hom
Gros pépin et petits emmerds

À entendre tous les jeudis soir le récit des 708 ou 807 petites souffrances que s'échangent les habitués du Liseron, j'en viens à me demander si un gros pépin autour duquel graviterait toute une vie ne vaudrait pas mieux que le chapelet des petits emmerds qui la rongent morceau par morceau.
Jean Prod’hom
16 juin 2009
Sauver les apparences

à Anthony Poiraudeau (Futiles et graves)
Une jeune femme virevolte au milieu de la cafétéria, toute pimpante dans sa robe à volants savamment étagés; elle laisse deviner des formes dont elle est visiblement fière et que considère à la dérobée ses collègues de travail. Elle s’immobilise soudain, se penche pour saisir les désagréables plis que font ses collants sous son habit de reine, des plis qu’elle remonte tant bien que mal sous le mille-feuille de ses tissus, des plis qu’elle tente de dissimuler ensuite en les lissant tout autour de sa taille de guêpe, avant de se redresser et de virevolter à nouveau.
Je songe alors à l’histoire de l’architecture, aux solides églises romanes de Bourgogne qui joignent sans à coup ni césure le dedans et le dehors; aux architectes des cathédrales de l’ìle de France qui ont été amenés à concevoir des contreforts aux dimensions de leurs ambitions babéliennes; aux basiliques relookées du XVème siècle toscan enfin, à celle de Santa Maria Novella que termina à Florence Leone Battista Alberti en 1470, fixée avec de la colle au vaisseau rustique des frères Sisto et Ristoro, à toutes ces façades de la Renaissance italienne qui, derrière le clinquant, laissent apparaître des coutures bricolées, des raccords, des mauvais plis, bref l’immoralité.
Tout en me baissant pour remonter mes chaussettes, un aphorisme de Nietzsche me revient en mémoire, il conseillait en 1878 à ceux qui bâtissent : Pour exciter l'étonnement, il faut enlever les échafaudages lorsque la maison est construite (Le Voyageur et son ombre, § 335). Si j’avais osé compléter la parole du maître, j’aurais ajouté que, par bonheur, l’histoire restaure à notre insu le dissimulé. Mais ça il n’aurait pas aimé : un peu trop hégélien.
Jean Prod’hom
Economie de subsistance

Emerveillement au-delà du marécage
le canot conduit
au seuil d’une caverne sacrée
dans laquelle dit-on
pleuraient les dieux
pas loin
un abri sous roche
et tout contre les parois
des restes de madriers
des pierres des planches
autrefois
des sauvages lacustres
la douleur à marée haute
s’y rassemblaient
pour se consacrer à l’essentiel
à l’aube
ils rejoignaient les rives
d’un lac d’altitude
avec les teignes
les vers et les asticots
c’est à ces hommes qu’on doit
la pêche à la ligne
au filet
la pêche au coup
à la mouche
la pêche à la bombette
la pêche au toc ou à rôder
à midi ils rabattaient les oiseaux aquatiques
égarés dans les touffes de roseaux
et les échangeaient en plaine contre des babioles
plus tard ils érigèrent
à deux pas de la caverne
un petit oratoire dans laquelle s’est perpétuée une tradition
y priaient ceux qui avaient attrapé
de la main gauche
un poisson une grenouille
une écrevisse un serpent d’eau
une mouche aquatique
un ver de lagune
un canard ou un cygne
les gauchers se multipilèrent
c’est dire que l’oratoire
qu’on appela
la chapelle de la main aux merveilles
ne désemplit pas
Jean Prod’hom
Dimanche 25 avril 2010

Au fond, qui ne souhaiterait pas mener la vie d’une locomotive, une belle locomotive au museau froid et rond; filer tête baissée sous le soleil ou dans les éclairs, siffler, souffler, puis aller au pas dans la campagne déserte, parmi le colza ou le blé, recevoir des soins en fin de semaine dans un hangar aux allures de cathédrale, sommeiller les yeux grand ouverts dans un réduit de province ou une immense gare de triage; et pour terminer, disposer d’une retraite utile chez un ferrailleur, ou insensée au bout d’une voie de chemin de fer abandonnée, les pieds dans les herbes hautes, près d’un bois, enlacée par le lierre, loin des regards indiscrets.
Jean Prod’hom
Sonogno-Frasco-Gerra-Brione-Motta

à Nathanaël Gobenceaux (Lignes du monde)
Jusqu’au milieu du dix-neuvième siècle les loups étaient nombreux au Tessin. Ils causaient de nombreux dommages aux paysans en décimant les troupeaux de chèvres et de brebis. Pour les éliminer, les paysans creusèrent dès le Moyen-Age des lüére, fosses tapissées de pierres sèches à l’intérieur desquelles ils déposaient un appât vivant pour les attirer et les y faire tomber. On trouve non loin de la petite plaine triangulaire de Brione deux témoignages de ces pièges conçus de telle manière que le loup pouvait y entrer mais, après avoir dévoré sa proie, ne pouvait plus en sortir. Il était aisé alors au paysan de tuer l’animal, de lui sectionner une patte en échange de laquelle les autorités lui donnaient une récompense.
De ses sources jusqu’au Lac Majeur dans lequel elle disparaît, la Verzasca ne s’embarrasse de rien, elle embarque tout dans son lit: la caillasse qui roule du Pizzo Barone, de la Cima Bianca et du Mezzorgiono; les vieux mélèzes, les châtaigniers épuisés, des hêtres; la terre rare que ravine l’eau de la fonte, les restes compostés de fougères, d’edelweiss et de rhododendrons, l’eau des cascades, celle des affluents à laquelle s’abreuvaient autrefois les brebis quand ces anonymes avaient un nom, Efra, Motto, Poncione d’Alnasca; l’eau qui ruisselle, l’eau qui glisse, celle du Val d’Osola, les eaux qui ont eu raison des bergers, bientôt colporteurs ou ramoneurs en Lombardie, éleveurs de bétail ou vignerons en Californie, ouvriers au barrage de Contra levé en contrebas du village de Vogorno noyé aujourd’hui dans le lac de rétention, employés de bureau à Locarno, à Bellinzone ou à Ascona.
La Verzasca a tout embarqué mis à part les immenses blocs de pierre, schistes, micaschistes, gneiss et granite blanc en couches transversales, contre lesquels le torrent toujours plus gros vient buter et hurle continument, une immense rumeur, une rumeur caillouteuse comme si le torrent avait des galets dans la bouche.
Il a fallu des siècles aux Verzaschesi et leur bétail, cheveux blonds et yeux bleus pour atteindre Sonogno, le dernier village de la vallée, au confluent du Val Redorta et du val Vigornesso, en tenant ménage en plusieurs endroits, cultivant maïs et vigne jusqu’à Vongorno, seigle, chanvre et pommes-de terre plus haut dans la vallée. Les truites prospèrent à Gerra. Le châtaignier vigoureux a nourri leur sobriété, un chemin à double ornière, une route enfin construite entre 1868 et 1873. Aujourd’hui il ne faudra à l’hôte de Tenero qu’une paire d’heures pour boire un café au Grotto Redorta et revenir.
Et tandis que je descends sur le chemin qui longe la rivière, tandis que je glisse sur cette pente, avec la terre, les vieux mélèzes, j’entends monter la folle rumeur de la Verzasca, comme celle d’une résistance, une promesse qui ne lâche pas. Il n’est pas aisé de remonter les murs de pierres sèches, de retenir les habitants, impossible de dresser l’eau, mais le bruit monte, remonte là-haut, là où sont les merveilles, au sources, à contre sens, là d’où vient cette rumeur, là où on n’entend rien.
Au XIXème siècle, pas moins de 246 loups furent capturés dans les vallées tessinoises. Dans la Valle Verzasca la présence du dernier loup remonte à 1908. En 2001 le loup a refait une apparition, tout là-haut près du lac Barone. Au-dessus les nuages, immobiles, on n’entend rien, presque rien, quelque chose comme un songe, celui d’un sage qui rêvasse, à Porte Tolle, entre Venise et Ravenne, au bout du Pô.
Jean Prod’hom
Journée sans

Que dire de ces journées que l'on pousse devant soi avec ceux de son espèce dedans et qui s’achèvent enfin lorsque la grille de l’atelier grince? Rien sinon qu’on est soulagé. On ne dispose pourtant d’aucune poignée d'épluchures à lancer dans la basse-cour, pas même des cris d'un fou qui ricocheraient contre les fûts des bois noirs.
Les nuages de basse altitude déguerpissent. Ceux du haut s’embrasent et les sapins de la crête du bois Vuacoz plient.
Tout au long de la nuit un petit homme famélique surveille l'entrée d’une cathédrale. Il va vomir continûment au pied d'un lampadaire pisseux dressé au centre d'un carrefour désert. Un peu plus loin, deux grosses femmes au dos nu tatoué grimacent à l'entrée d'un bâtiment en ruine, elles fument pour combattre le froid de l'hiver qui a rongé le peu de volonté qui leur reste, elles grimacent, elles ricanent, elles racontent à tour de rôle la même sale histoire. Dans la cour au bitume fissuré, des enfants amaigris, orphelins – cela se voit – crient. Quelques-uns essaient, sans succès, de s'arracher des griffes d’une bête immonde qui ronge leurs mains. D'autres – adolescents plutôt – dansent autour d'un monument aux morts en béton décrépi, ils se passent un objet incandescent qui fait saigner leurs mains et leur arrache la peau. Tout ce joli monde finit par me regarder en souriant.
Jean Prod’hom
Dimanche 18 avril 2010

Je possédais autrefois un gros livre que je feuilletais quelquefois et chacun de ses chapitres avaient pour titre le nom de l’une des saisons. Dans cet ouvrage on ne comptait pas les ans, pas plus que les jours qui n’ont pas grainé.
Aujourd’hui, à gauche du chemin défoncé qui mène à l’étang, là dans la terre pauvre, damnée, aussi dure que le caillou, dans laquelle l’eau ne s’attarde pas, terre hostile sur laquelle les vipères ne font que passer a éclos une nuée de tussilages. En face, dans l’ombre des feuillus, au-dessus de la rigole qui draine les eaux de ruissellement rampent des pervenches portées par d’innombrables guirlandes de petites feuilles, ovales, coriaces et généreuses. Je m’agenouille pour les observer et les prier de durer.
Tout va si vite, d’autres fleurs préparent leur éclosion, les mélèzes tendrissent. Il faut te satisfaire de n’avoir qu’elles jusqu’à la fin du jour. Sois prêt à désoeuvrer en leur compagnie pour ralentir l’inexorable venue du crépuscule. Imagine le jour comme ces tapis de fleurs éphémères que tu traverses, le jour aura les coudées franches et s’étendra dans toutes les direction. Et lorsque le soleil aura malgré tout quitter la partie, ne te hâte pas de rentrer pour raconter ce que tu as vu. N’écris rien, ou plus tard et dans la peine, dans la prolongation du jour, non pas peur de la nuit mais pour te préparer à la succession en rafale des beaux jours. Demain d’autres fleurs t’inviteront à te pencher, chacune à son tour, hors tout décompte, la camomille bientôt, dans les remblais, et derrière les couronnes rampantes des pervenches les fières épilobes, et le printemps reviendra et prolongera de quelques pages le gros livre que tu feuilletais autrefois.
Jean Prod’hom
A l'aube

Là-bas
dans l’étroite bande de terre
qui borde l’océan
les premiers hommes
dessinent
dans le sable
quoi
ils ne savent pas le dire
ils tranchent à même le temps
deux morceaux
ce qui fait trois
deux monstres et un fantôme
dans le ciel
les prophéties s’amoncellent
ils font tout
pour rabouter les chemins sectionnés
pour rameuter les bois
recoller la tête du condamné
raccommoder les cours d’eau
ils y vont au courage
la tâche est sans fin
chemins mal raboutés
cavernes lacs et montagnes
noeuds du monde
accidents des interminables travaux
au cours desquels
nous sommes nés pour la seconde fois
issus d’une trame
plus ancienne
sur laquelle on ne revient pas
ils font et tissent ensemble
ce qu’ils ont séparé
au confluent
parfois pourtant
des esprits éclairés
aperçoivent derrière la brume
un frémissement
la lumière et l’ombre
ils se souviennent
du temps sans personne
où nous étions de n’être pas
et leur voix tremble
Jean Prod’hom
Fin de partie

Il suffit parfois de se laisser glisser à l'arrière du cortège et de s'accrocher confiant à sa traîne tandis que la nuit tombe, aller comme un automate en prêtant une oreille étonnée mais bienveillante aux cris de ceux qui en veulent, lèvent le poing, de ceux qui allongent le pas devant. Oublier ainsi un instant les lourdeurs qui collent aux basques et les doutes qui alourdissent les pas. Tourner le dos au choses qui avancent et qui ne vous attendent pas, secoué - bercé - par les cahots de la terre qui a lancé son second demi-tour. Temporiser en songeant, à peine, au tas de mauvaises herbes et aux pétales des roses fanées qui reculent dans la nuit du jardin, aux oiseaux tapis dans les haies, au renard qui erre, aux chatons emmêlés dans la corbeille à linge. Temporiser à la queue du cortège jusqu'à ce que le sommeil vous ravisse et laboure tour ça.
Le matin, les yeux s'ouvrent sur les montagnes à l'orient, tout est rincé et on ne se souvient de rien. On aura beau chercher à s'en rappeler, à vouloir en fixer les étapes, histoire d'en tirer une leçon pour le lendemain. Rien. Rien n'en ressortira lorsque dans deux saisons l'analogue se présentera à nouveau, il ne servira à rien de vouloir se souvenir – de quoi? –, aucune expérience n'y fait, il faudra à nouveau se glisser à la traîne du jour qui file à l'ouest et cet abandon suffira peut-être encore.
Jean Prod’hom
Le regard éloigné

à Brigitte Celerier (Paumée divagations)
La ruelle qui monte au parking du collège est déserte, personne sous le soleil, des reflets seulement, pas de trottoir, quelques couleurs, deux ou trois choses sans nom qu'on apprend à nommer à l'école, et tout autour, jusqu'au ciel, ce léger désordre dont on on n'a jamais su trop quoi dire.
Les fenêtres sont ouvertes, Lucas, Mathilde et les autres travaillent. L'air libre dehors s'agite, ou plutôt frémit, si bien que la fraîcheur entre dedans avec le soleil, le ciel et la fraîcheur d'avril, celle qui désaltère au contact de la laine rousse et brûlante. Le corps ne s'en défend pas, elle me confond et me tire dehors, où suis-je?
C'est quelque chose qui vient de je ne sais où, mais auquel je me livre sans reste; quelque chose qui me conduit comme chaque fois en des lieux laissés pour compte, parce qu'il n'y a pas de place pour ça ni dans le monde ni dans la mémoire, parce que ça ne prend pas de place, ça a toujours été là, ça n'attend pas. Me voici ravi dedans et dehors, hier demain et aujourd'hui.
J'ai terminé mes devoirs – abscons, inutiles, bâclés – et je file devant, dans un espace immense et vide, ou plutôt un espace que je n'ai pas eu le temps de remplir, c'est avant le repas du soir, entre cinq et six et il fait beau, c'est au mois d'avril. Les recommandations de ma mère se sont perdues dans le long couloir, derrière aussi la porte de l'appartement qui claque, je suis en avant de tout, le garde corps de la première volée d'escalier a fini de gronder, le saut par-dessus la seconde volée est derrière moi, ça résonne comme dans une église. Reste la lourde porte d'entrée si difficile à faire bouger, sur laquelle il fallait s'arc-bouter mais dont jamais personne ne s'est plaint; ni pêne ni serrure, ni gâche ni clé ne bougeaient plus, seul quelques grincheux espéraient qu'il en fût autrement. Je demeure immobile sur le perron, un pied sur son vieux marbre piqué, l'autre accompagne le mouvement de la porte qui se referme lentement derrière moi, comme si c'était son poids qui la ralentissait, le nez dehors, à deux pas du monde avec son soleil immense, avec derrière dans la nuit de la cage d’escalier des chaînes, et devant le silence d'avant quoi que ce soit. Je n’attends rien et ça dure une éternité. Et puis, après – mais quand? –, la porte accouche d'un claquement, sec et effaré, à peine audible, et on va de l'avant pour toujours.
Mais aucun verrou ne peut barrer la route à notre désir d'être, sinon le désir de mourir. Et plus tard, lorsque l’imprévu nous rappellera à l’ordre, on sera libre de commencer avant qu'il ne soit trop tard la mise à jour de ce dont la vie nous a éloigné pour que, guéri de l'exil – le mal nécessaire –, nous parvenions au printemps suivant à y goûter un peu à nouveau, le regard éloigné.
Jean Prod’hom
Ratés

J'ai écouté hier soir un exposé remarquable d'un penseur brillant. Il a su me faire entendre dans un français limpide et avec des mots qui étaient à la fois les miens et les siens ce que nous ne pouvions pas manquer de partager à la fin. Je n'ai pas tenu la distance,.... je me suis assoupi et j'ai pris le large, manquant de cet air qui doit nous maintenir à bonne distance et permettre au monde de s'installer en tiers.
En écoutant Clarisse parler en un français approximatif, bancal parfois, je me suis approché tout près de ce à côté de quoi elle passait, sans espérer pourtant jamais parvenir à faire autre chose que de l'effleurer. C'est le maintien de la distance entre ce qu'elle essayait de dire dans une langue qui n'était pas la sienne et ce que cela supposait vouloir dire dans sa langue maternelle qui me ravissait et offrait la possibilité de l'avènement d'une réalité et d'un sens.
En acceptant de dire ce à côté de quoi elle allait immanquablement passer en usant d'une langue à double foyer, Clarisse faisait entendre l'insuffisance de nos langues maternelles et les accidents de nos pensées. C'est par le creusement de cet espace indéterminé rythmé par les ratés de nos deux langues que nous disposons d'un milieu.
La disparition accélérée des langues est une tragédie, le règne d'une seule une catastrophe. Comment voudrais-tu que j'aperçoive la densité de ce qui m'entoure si tu uses des mots de ma langue? On ne naît au monde que par la médiation de la langue de l'autre.
Jean Prod’hom
Où sont les pigeons?

Si la sagesse populaire nous rappelle qu’une hirondelle ne fait pas le printemps, Mao Tsé-toung nous a également enseigné que 807 hirondelles peuvent aisément, si elles se donnent le mot, inverser la ronde des saisons.
Depuis que la nouvelle loi sur la protection des animaux est entrée en vigueur, plus moyen de joindre par téléphone le vétérinaire ou le marchand de volailles, le réseau est saturé : poules, oies, poulets, canards, dindons, tous téléphonent à leur avocat.
Le chardonneret dans les mains du souverain, l'ancolie et le lys aux pieds des rois-mages, et pour nous le chemin boueux.
Jean Prod’hom
20 mars 2010
Le jour du glyphe

Des quartiers
il y en avait des quartiers
et ces quartiers
sur l’île
avaient un nom
cinq quartiers
cinq noms
sans fond
et pourtant
exempts de secret
l’empreinte du cactus
au milieu du milieu
le bouclier à la flèche perdue
le repère des aigles
le nid du serpent à plumes
ces quartiers correspondaient
à des entailles
dans le temps
et on racontait les hauts faits
de leurs habitants
seule l’étendue d’eau
vers laquelle
coulaient
les ruisseaux de l’île
seule la lagune
qu’un long môle
de pierres cyclopéennes
tenait éloignée
de l’océan
demeurait à l’écart du grand partage
on a essayé disons-le
d’entailler cette étendue
mais rien n’y fit
aucun récit ni ciseau ni flèche
n’entama la lagune
on lui donna simplement
le nom de glyphe
ce sont les goélands et les cormorans
sur le môle immobiles jours et nuits
qui firent le reste
une fois par année
au jour du glyphe
ils ouvraient leurs ailes
s’ils s’envolaient
du côté de la lagune
les enfants juchés
sur les épaules des vieillards
poussaient des cris
précipitaient
les vieillards gueulants
au milieu des joncs
des roseaux
les corps mourants
dérivaient alors
sur la lagune jusqu’au môle
s’ils prenaient
la direction de l’île
on portait les vieillards en triomphe
jusqu’au pied du figuier
et les enfants leur tendaient des fruits
à la pleine lune qui suivait
quoi qu’en aient décidé les augures
on jetait les armes
dans la lagune
et c’en était fait d’une génération
je n’ai pas trouvé plus fidèle image
de la précipitation des premiers hommes
Jean Prod’hom
Dimanche 11 avril 2010

Un bout de haie maigre sous le soleil en haut du talus qui borde la route des Chênes, à deux pas de Vers Chez les Porchet: quelques fines tiges de noisetiers sous des frênes, et des ronces, un bouleau aussi, décapité et manchot. Je m'agite, n'ai-je pas d'autres choses à faire? des choses plus sérieuses? La raison pique du nez, je fais demi-tour et grimpe sur le talus. Avec une légère appréhension, faudra-t-il attendre encore?
Je tâte la terre et m'y assieds pour la première fois cette année, j'aperçois de plus près les jeunes ronces que se partagent équitablement les bourgeons neufs et les piquants acérés. Le dispositif est sommaire mais il me protège de la bise. Nulle traîtrise, la terre est sèche, meuble, chaude, des promesses et du bonheur. Tout autour le lierre résistant, vert, luisant, et les reliefs de l'année dernière dont la neige, le froid et la pluie ne sont pas venus à bout: les brindilles se cassent comme des allumettes, les feuilles mortes s'émiettent comme du tabac. Trop de soleil pour accueillir les crocus, les pervenches ou les anémones, la haie est grise.
Je tâte la terre et m'y couche pour la première fois cette année, j'aperçois en haut les branches innombrables d'un chandelier, c'est un long frêne qui ondule sous la bise, mèches encore éteintes. J'entends à côté de moi un froissement ténu, c'est une coccinelle à la tâche, elle a bien six ans d'âge, mais on n'est décidément pas aux mêmes dimensions, j'ai beau m'approcher, lui prêter mon assistance pour franchir les innombrables obstacles, elle m'ignore. Impossible de la comprendre, sa paire de lunettes jaunes semblent lui suffire dans l'obscurité. Je m'acharne, continue mes observations idiotes, elle s'obstine elle aussi avant de s'envoler.
Je somnole, est-il bien raisonnable de rester là couché à ne rien faire? continuer? mais continuer quoi et m'en aller où? Me voici soudain ramené au rang de la bestiole: que faire dans cette obscurité qui semble me satisfaire et dans laquelle je m'endors? Et qui est prêt à me donner un coup de main?
Sans savoir comment, me voilà debout, le long du pré qui descend jusqu'au bois. Je cherche sans y croire les deux ou trois morilles que j'ai vues il y a quelques jours dans les mains du Grignanais près du Lez. Mais n'y crois pas, pas la tête à ça, mais la tête à quoi, la tête à rien. Je continue ma promenade, il n'y a bientôt plus rien, du gui qui colonise les vergers et moi en trop. Et soudain, sans savoir exactement comment ni pourquoi, je rejoins la coccinelle qui avait pris une grosse avance sur moi, je m'envole, pour rien, là-bas, sur les hauts de Mézières et de Ferlens.
Jean Prod’hom
LXI

Cathy m'a prié de donner un coup de main à son neveu en difficultés scolaires. Il peine tout particulièrement en mathématiques et en physique. Je me trouvais donc en cette fin d'après-midi à la table du personnel du café, aux côtés de Georges qui avait à résoudre pour la semaine prochaine un devoir lié à la question de la poussée d'Archimède.
Je lui explique donc qu'un corps plongé en tout ou en partie dans un fluide soumis à un champ de gravité subit une force particulière, je tente ensuite de lui faire comprendre que cette force provient de l'augmentation de la pression du fluide avec la profondeur, que la pression, étant plus forte sur la partie inférieure d'un objet immergé que sur sa partie supérieure, il en résulte une poussée globalement verticale orientée vers le haut... Mais je m'interromps quand je m'aperçois que le corps de Georges est emmêlé dans le filet de mes explications, les yeux grand ouverts, bouche bée: je crains que son esprit n'ait pris la poudre d'escampette, je me sens bien seul.
Je change alors mon fusil d'épaule et décide de lui proposer une approche plus intuitive du problème, une approche qui devrait, je l'espère, le rapatrier parmi nous et lui permettre d'accéder à l'essentiel. Je me lance...
– C'est dans sa baignoire qu'un beau jour Archimède se rend...
– Ah! non, pas ça, pas lui! C'est un vrai cave ce gars-là! Changer une ampoule dans un hôtel d'Alexandrie le cul dans une baignoire, faut le faire! Un inculte pire pas des nôtres!
Je prends ma respiration, ferme les yeux et coule à pic!
Les pénitents de Valréas

Nefs latérales en demi-berceaux financées par d’anciennes familles; chapelles en couronne; fleurs, pétales; un moine et un sanglier dans le feuillage; dessus un campanile octogonal à baies trilobées coiffé d’une couverture conique; cinq pans rectangulaires renforcés par des pilastres à chapiteaux. Et l’orgue, de la même grosseur et ton de ceux de Cavaillon, et le bois travaillé en bosses, positif de douze jeux et un pédalier; harpies, dragons, anges sonnant, putti et végétaux.
Dedans douze pénitents de notre temps, attelés à la misère du monde, sacs à main glissés sous le banc, obéissants, ils prient et chantent – il reste tant de choses à faire pour améliorer le sort des hommes, les accompagner à l’échafaud, les ensevelir, en délivrer quelques-uns, se consacrer aux malades, lancer quelques prières, assurer les soins, proclamer sa foi, processions et charité. Ce matin les pénitents de Valréas accompagnent en pensées et en louanges ceux de la paroisse qui sont partis en car pour Lourdes, ou en train pour l’Île de France. Avec une intensité variable, une douzaine, je l’ai dit, ce sont des pénitents gris, avec une jeune femme tout devant, pâle, à sa droite un prêtre, blanc, tristes à mourir. Soudain une voix d’alto sort de derrière un pilastre, tout se réchauffe, les paupières se soulèvent. Il aura suffi d’une tierce pour que le vaisseau s’envole.
Dehors une ville grise, cagoulée. fatiguée de tirer derrière elle des siècles de petites gloires, maisons fermées, stores baissés, des reliefs d’industries, quelques souvenirs, des remorques sur des plots, des oiseaux sans personne pour les écouter.
Jean Prod’hom
Dans la marche

A côté des prêtres et des guerriers
qui se partagent
le fruit des travaux
de ceux qui n’ont bientôt plus rien
à côté des agriculteurs
des marchands et des fonctionnaires
spoliés et bientôt exténués
un paysan
il refuse net
de payer l’impôt
et se retire dans les marches de l’île
accueille les pauvres errantes
dans sa hutte
avec lesquelles il chante
confectionne des manteaux
en fibres de maïs
les amoureux les rejoignent
qui l’a vu se souvient
de l’éclat de sa patience
de ses mains creusées
par les heures
d’un labeur
obscur mais inévitable
de son pagne bigarré
brodé
presque rien
pas de bijou en or
de petites récoltes
et deux mots interdits
hégémonie et ascension
pas d’autre célébration
un verre de fermenté
au jour des ligatures
et un hymne
au jour de la pénombre
lui et ses compagnons
vécurent des bienfaits
que sécrètent les horizons étroits
je le dis
mais qui l’aurait dit
c’est eux
qui enrayèrent
sans qu’ils le veuillent
la désertion des bois
en plaçant un labret d’ambre
dans les mâchoires des loups
et en offrant leur liberté
aux bêtes de la basse-cour
trop longtemps captives
trois générations
se succédèrent
dans cette région de l’île
et puis plus rien
le chroniqueur
évoque la vie
de ce singulier personnage
en marge du récit
de la disparition
des petits dieux locaux
il ne dit rien d’autre des circonstances
la mémoire est oublieuse
Jean Prod’hom
Memento mori

Ne pas mourir n’offrirait qu’un avant-goût assez quelconque de l’éternité. Pour y goûter pleinement, il faudrait non seulement ne pas mourir, mais encore ne pas être né. Et ça, c’est pas à la portée de n'importe qui.
Jean-Rémy, militant actif d’Economie et propreté, a exigé de son entourage que le parti puisse disposer un jour de ses cendres pour confectionner un savon. Je voudrais de mon côté qu’on me cède celui-ci, un seul instant, pour effacer soigneusement les traces de son passage.
Une paire de ciseaux et un noeud en huit pour le séparer de sa mère, un harnais en collier sur lequel il aura tiré toute sa vie, la faux oubliée qui l’attend au bout du chemin.
Jean Prod’hom
4 avril 2010
Dimanche 4 avril 2010

Les voix qui, hier en fin d’après-midi, avaient mêlé leur grain au vent après que celui-ci eut forci, avant de s’en séparer – il s’était mis à pleuvoir –, et de se retirer un café à la main dans la maison close puis, à la nuit, plus profondément encore, de murmures en murmures, dans les chambres à coucher, se lèvent l’une derrière l’autre ce matin, s’assurant par de timides saluts croisés qu’elles sont bien vivantes. Elles s’éprouvent l’une l’autre tandis que le soleil entame sa course sans se retourner.
Je le sais, je les entends ces voix, m’en réjouis même, mais n’y touche pas, tout occupé que je suis à faire tenir debout, au bout de la nuit, sur un écran flottant dans la dépression d’un rêve, une figure constituée de deux parties : à gauche quelque chose comme un texte de six ou sept lignes, à droite l’image d’un autre texte, légèrement décalé vers le bas et plus court. Je les lis une fois, deux fois, étonné par leur équilibre, leur matière aussi, je me promets alors de les transcrire sitôt éveillé. Je les lis encore à plusieurs reprises, consciencieusement, sans jamais pourtant distinguer chacune de leurs parties. J’ouvre un oeil, à peine un oeil, le referme, me retourne pour vérifier que je suis en mesure de tirer ces deux objets hors de la nuit. Je sais la tâche difficile, vont-ils survivre au changement de milieu? Je me décide et lève une paupière, ils sont là, au guichet du sommeil. J’avance encore un bout en entrouvrant la seconde paupière... Trop tard, la figure s’échappe, les mots aussi, le sens même de l’ensemble. Demeure la certitude qu’ils existent bien de l’autre côté de la barrière
Je ne renonce pas, malgré une voix qui me souffle que la partie est condamnée d’avance. Je me retourne, ferme les yeux une nouvelle fois, et me rendors en prenant garde de ne pas entrer trop loin dans la nuit dont je suis, quoi qu’il advienne et quels que soient mes efforts pour y demeurer, en train de m’éloigner. Je somnole sur le seuil, me retourne. J’aperçois alors, au-delà de l’arrière de mes yeux, les traces de mes deux images. Je les lis à nouveau en me promettant de ne pas bouger tant que je ne serai pas assuré de pouvoir les emporter du côté du jour. C’est finalement fait, j’en ai la conviction, je crois en avoir le contrôle, fais un pas à l’extérieur, soulève une paupière, un pas encore. Mais je sens alors que les deux images s’apprêtent à se glisser dans l’ouverture par laquelle le sommeil vient le soir et s’en va le matin. La haute pression du réel ne fait qu’une bouchée du tout dont la consistance supposée ne résiste pas, tout se dilue, ne reste rien.
Je repars pourtant en campagne, obstiné, la partie ne me semble pas perdue, j’y retourne les yeux fermés encore une fois, sachant bien que je ne pourrai pas réitérer une infinité de fois l’opération. Je sens mes forces qui diminuent, les portes se fermer, les stores se baisser. Les caractères des images s’estompent – dans la nuit ? dans le jour ? Les textes deviennent illisibles. Je force, mets la main sur un groupe de trois mots placés en tête du second texte qui sont restés en arrière – en italique ? en gras ? soulignés ? – auxquels je m’accroche, et que je sors de force. Ils se laissent faire: cliquetis des épitaphes. J’ouvre les yeux, satisfait d’abord de n’être pas rentré les mains vides, déçu pourtant de la fadeur de ce groupe, pire, doutant même de l’origine nocturne de chacun de ses constituants. Ainsi j’aurais été incapable de retenir les bribes d’un rêve, qui m’auraient fait gagner sans effort ma journée? Rien n’y fait, on n’y peut rien.
Il faut tourner la page, j’entends les oiseaux et me mets à picorer. J’entends le vent qui a forci depuis la veille, mais dont le régime s’est inversé. Le vent du nord a fait la lessive, refoulant quelques nuages sales au dessus de la vallée du Rhône qui disparaîtront cet après-midi. Quelques voix se croisent en bas, je goûte à l’odeur du pain qui monte à l’étage, à la chaleur de la nuit et à celle que j’aime, à l’air cru dehors qui chatouille le nez, j’aperçois les gouttelettes de condensation sur les vitres, je passe en revue le visage de ceux qui dorment, j’entends les rires retenus des enfants et le vrombissement des voitures sur le pont du Lez, je m’aventure en faisant coexister quelques-uns des morceaux du réel.
Une porte claque en bas, et la fenêtre de la chambre d’en haut s’ouvre en réponse, apportant la preuve que les choses conspirent. Les morceaux ramassés appartiennent à un ensemble dont je devine les grandes lignes. Et je souris aux civilités d’avant le déjeuner, au cliquetis du dispositif de fermeture de la porte de la salle de bains.
Ne faudrait-il pas sortir de la nuit par une autre porte que celle qui nous y conduit? pour en sortir les mains pleines, ne faudrait-il pas prendre la porte qui est à l’autre bout du couloir?
Jean Prod’hom
Le déclin du jour | Juliette Zara

Au fond, je vis comme sur une île.
Louise était appuyée contre le garde-corps. Le vent, un peu insistant, faisait danser devant son visage les mèches qui avaient échappé à leur lien.
J'ai le corps englué dans les choses et l'âme aspirée par l'horizon. Encerclée. Quelque chose doit poindre là-bas. Quelque chose, oui, quelque chose. Je dévore l'horizon et toujours elle, toujours elle qui point. Cette attente. Jamais ici, toujours là-bas. Jamais maintenant, toujours plus tard. La vie à attendre que quelque chose se passe, la vie, une série de buts à atteindre à perte de vue. Un désir de terminus.
Louise, Louise... dans sa vie bien rangée cherchait le terme et le sens. L'attente sonnait en rythme les percussions de ses heures, de ses jours, de ses années. L'attente était l'ogresse qui dévorait toutes ses offrandes, sa vie. Conjuratoire. Être là. Impossible pour Louise, enracinée dans ce lancer de pierre, ricochet suspendu au-dessus des eaux. Être là, appuyée au garde-corps. Le vent, un peu fort, semblait complice de cette succion de son âme vers d'invisibles lointains qui ne viendraient jamais jusqu'à elle.
Les jours passent, vacants. Retirés. Dans le silence qui précède ce qui doit arriver et qui n'arrive jamais. Je passe, en souffrance, comme un corps que personne ne vient réclamer.
Oh ma Louise, je le regardais ton horizon et c'est à une étonnante pavane que j'assistais. Une ligne se démultipliait et se tordait en volutes au loin devant nous, dans la pulsation colorée du soir. Le ciel fondait tout entier dans les grandes orgues d'un brasier aussi pénétrant que ton regard. Je frissonnais au trissement des hirondelles qui racontaient leurs voyages dans les terres australes. Et ta silhouette se découpait sur ce décor, dans le crépuscule. J'apercevais tout juste le coin de tes yeux à l'affût, qui brillaient au reflet de cet effondrement de tout espoir toujours recommencé, le déclin du jour.
D'un jour qui renaît chaque matin.
Juliette Zara
![]()

écrit par Juliette Zara qui m’accueille chez elle dans le cadre du projet de vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.
Et d’autres vases communicants ce mois :
Kouki Rossi et Luc Lamy
Pendant le week-end et Ruelles
Marianne Jaeglé et Anthony Poiraudeau
Cécile Portier et Loran Bart
Christophe Sanchez et Murièle Laborde Modély
Christine Jeanney et Kathie Durand
Sarah Cillaire et Anne Colongues
France Burguelle Rey et Eric Dubois
Fleur de bitume et Chez Jeanne
Mathilde Rossetti et Lambert Savigneux
Antonio A. Casilli et David Pontille
RV.Jeanney et Jean-Yves Fick
Brigitte Giraud et Dominique Hasselmann
Guillaume Vissac et Juliette Mezenc
Michel Brosseau et Arnaud Maïsetti
Florence Noël et Brigitte Célérier
François Bon et Laurent Margantin
Michèle Dujardin et Olivier Guéry
Juliette Zara et Jean Prod’hom
écrit par Juliette Zara qui m’accueille chez elle dans le cadre du projet de vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.
Jean Prod’hom
Dimanche 28 mars 2010

Rien pris aujourd'hui rien laissé non plus, en transit sur tous les chemins empruntés, de nulle part à nulle part dans des lieux sans qualité. On met de l'ordre sur les terrasses pour l'arrivée prochaine de ceux qui nous font vivre et qu'on fait vivre, donant-donnant, on évoque les mêmes lendemains, à l'école les élèves préparent l’avenir, des forains maussades chargent les camions qui emmèneront la fête plus loin, on a fermé l'église pour s'épargner des frais et des peines. Nous vivons le règne des causes efficientes.
Rien n'est fait ici pour rien. Quelque chose tire chacun vers cette autre chose qui lui manque, dont on ne sait rien et qui nous pousse. On parle, on promet, promesses tenues promesses oubliées qu'importe, on n'en voudra à personne. L'affaire est moins pathétique qu'on ne le croit, c'est un principe d'ici-bas, tout s'y fait pour autre chose, comme au purgatoire, mais ne le dites pas.
Et on est là comme un étranger, presque invisible, à l'image de ceux qu'on croise dans une vie et qui trop lointains comptent pour rien. On mange quelques cerises, on s'assied sur un banc en face d'un calvaire, un tilleul a étendu son ombre, et c'est bien agréable de ne pas être tout à fait de la partie, ou d'en être mais du côté de sa fin, et de ne pas avoir ainsi à en dire quoi que ce soit.
Jean Prod’hom
Pâques

Nul ne sait pourquoi, mais on se mit à parler cette année-là d’un inconnu, l’inconnu de la concession 807 du cimetière de La Roche-sur-Yon. Un article à son sujet parut dans le journal local, puis un second, d’autres ensuite qui se multiplièrent. Rien dans sa vie minuscule ne prédisposait pourtant cet homme à une telle gloire posthume. Mais ce n’est pas tout, cette même année on évoqua la vie d’un autre inconnu, enseveli dans le cimetière de Cholet, concession 807 encore. Puis ce fut au tour de Niort, Nantes, La Rochelle... et ainsi de suite. Les plumes les plus avisées joignirent leurs voix à ce concert de louanges posthumes. De proche en proche une foule immense se leva, qui peupla les allées des pelouse grasses et satisfaites de la littérature.
Sous un parapluie, Margot et le croque-mort de Sète, enlacés sur un banc public.
Il avait tant neigé que tout le monde était resté à la maison, et dans le cimetière du village le souvenir des morts avait disparu sous une épaisse couche de neige. Je me trouvai décidément bien seul au milieu de toute cette éternité.
Jean Prod’hom
6 mars 2010
Déplacement de populations

Les mères accouchent
sur les plages
de l’extrême ouest
et du nord-ouest de l’île
le sang coule
et se mêle aux eaux de l’océan
on préfère durablement
tenir à distance l’innommable
avec les tortues
du temps il en faut
avant l’établissement des preuves
et lorsqu’on déclare indubitable
le lien qui noue
la naissance avec le désir
on prend peur
on accuse le vent
châtie la terre
en vain
les premiers grands aménagements du territoire
commencent alors
on rapatrie les parturientes
au centre de l’île
où l’on creuse des niches
dans les sous-sols volcaniques
à côté des morts
le théâtre des naissances
à l’inverse on interdit
les manifestations publiques du désir
on codifie on légifère
les réfractaires sont envoyés
dans une parcelle au sud de l’île
s’y rendent les garnisons
victorieuses ou défaites
s’y établiront plus tard
les commerce de la parure
le marché de l’ameublement
et la petite restauration
on appelle ce temps celui de la grande bascule
Jean Prod’hom
Le chemin des Meilleries

Il maintenait à bonne distance la Corbassière de la Possession, en déroulant ses naïvetés au pied d’une haie de noisetiers, de sureaux et de jeunes bouleaux, longeant un pâturage assiégé par les ronces et les lampées qui glissait en pente douce jusqu’au Rio de Nialin. On l’appelait le chemin des Meilleries. C’était un chemin de terre à double ornière, bordé par deux talus qui se faisaient face tout au long, pas mécontents en fin de compte de cette saignée. Et lorsque le soleil de mars avait chassé la neige, le chemin et les deux talus rasés de près se réveillaient, et ça c’était beau à en pleurer.

De la boue dans le creux des ornières, trois flaques pour recueillir autant de fois le ciel et nourrir nos printemps, deux talus qui nous enseignaient la voie à suivre en offrant un refuge aux coquelicots, aux bleuets, aux fleurs qui refusent d'obéir. Guère plus.
Le chemin des Meilleries semblait ne jamais devoir vieillir, il ne craignait ni l’abandon ni le passage des épareuses. Quant aux talus ils faisaient l’école buissonnière jour et nuit, un peu d’herbe sur les épaules, ou de la neige, ou des graminées, un reste de colza, rien même parfois, et des enfants assis dessus qui tiraient des plans dont ils riaient avant même d’entreprendre quoi que ce soit. En mai, tandis qu'on chassait les papillons ou qu'on explorait la haie, les moineaux rejoignaient en grappe les rives du Nialin, Jean-Pierre, Elisabeth, Claude-Louis, Corentin, Edith, Dominique, tous on levait les yeux au ciel et on riait à tire-d’aile.
Au coeur même de cette ferveur le chemin restait discret et les talus souriaient à peine, ils nous enseignaient la bonne distance. Sans doute avions-nous tendance à choisir le plus court, mais il convenait de choisir parfois le plus caché pour être entre nous. Pas d’indicateur de direction, qui donc pouvait savoir où on était et où on allait?
Une seule et ancienne saignée, un chemin creux d’un seul tenant, sans raccords, dans lequel on entrait sans sésame, une végétation d'espèces modestes, le cri du geais pour rameuter ceux qui s’éloignaient et chasser ceux qui s’approchaient. Et les moineaux, encore, qui indiquaient la direction que nous suivrions un jour.
Sur le talus on construisait des châteaux, on tissait d’idée en idée d’improbables itinéraires faits de noms, de rêves traversés par des sentiers qui faufilaient de nouveaux domaines selon les lignes de nos désirs. Rien ne s’y insérait, rien ne s’y emboîtait, tout s’y déplaçait comme des plaques tectoniques vives. M’en restent un rythme, des souvenirs et quelques détails nichés dans des morceaux de langue, des mots de laine : l’arc des frênes, la rouille des ormeaux, les fleurs de l’acacia, les fruits noirs du merisier, les samares et la pluie de l'été.
Tout était à notre disposition et on suivait sans raison l’inclinaison la plus ténue pour nous livrer sans retenue à des aventures qui duraient quelques jours. Après l’école on vivait sur les pentes d’un volcan.
Le chemin des Meilleries en valait un autre, et c’était tant mieux, la haie et la pente du pâturage nous préservaient des méchantes envies. On avait tout. Mais on ne se souvenait pas de tout, pire, le soir on se souvenait de rien. C’est pour cela qu’on y retournait chaque jour. Et chaque jour on y fendait la mer, et la mer se refermait derrière nous, on se balançait d’un pied sur l’autre et on volait de talus en talus.
On regardait parfois en direction des villages immobiles de l’autre côté de la Broye, on voyait bien les chemins qui y conduisaient. Le nôtre on ne le voyait pas, pas même un trait entre rien et rien, mais un immense pétrin d'où levèrent nos plus belles histoires.
Le chemin des Meilleries a disparu, il a disparu lorsqu’on a rectifié le tracé de la grande route. Je baisse les yeux, un coup d’oeil par dedans pour me souvenir de quelques-uns des signes de nos printemps, à ce qui a été, aux feuilles mortes qui fusaient lorsque le soleil revenait, aux reflets du ciel dans les flaques qu’on barattait, à la lumière et aux ombres avec lesquelles on montait au paradis, au craquement de la glace, au pâturage désert, à la maison abandonnée, aux Gibloux enneigés, à Brenleire et à Folliéran.
Plus une trace, pas même le silence assourdissant qu’on entend le long des voies de chemin de fer à l’abandon, ou le silence de guillotine des sentiers qui s’arrêtent net, ou celui sans fond des carrefours. Rien, seulement un souvenir, le souvenir d’une invraisemblable épopée.
Une dernière ondulation fermait l’horizon, aux confins de notre territoire où se dressait un frêne sans âge. Là on se redressait un instant, on oubliait nos jeux et on levait la tête par-dessus les montagnes. On aurait aimer aller au-delà, c'était impossible, plus loin ce n’était plus chez nous. On s'en retournait, mais je crois que cette impossibilité on l'aimait bien.

Un jour on quitte tout pour s’assurer de la secrète cohésion du monde, repérer les motifs qui le constituent, écouter les gémissements de la terre, la rumeur qui porte le tout. Plus tard on revient sur nos pas et on devine enfin ce qui nous a porté la première fois.
J'ai choisi un caillou avant de prendre le chemin d’Emaney, je l'ai poussé du pied d’une ornière à l’autre en le faisant rebondir sur les talus. Je l'ai mené aussi loin que j'ai pu, jusqu’au pied du Luisin, avant de le glisser dans ma poche.
C’est lui qui m’attend ce matin sur le perron, c’est lui que je serre lorsque le chemin s'enfonce dans les herbes hautes.
Publié le 5 mars 2010 dans le cadre du projet de vases communicants chez Nathanaël Gobençaux (LES LIGNES DU MONDE)
Jean Prod’hom
Un jour sans fard

Le dimanche matin, sans que personne ne nous l’ait jamais demandé, on s’apprêtait dès le réveil à porter un masque. Mais on s’y préparait depuis la veille déjà, dès six heures du soir, lorsque les cloches de la cathédrale secouaient la ville et que celles de Notre-Dame suivaient. Disons qu'on était invité ce jour-là à quelque chose qui nous demeurait inaccessible les autres jours de la semaine, et qu'il allait falloir qu’on se comporte comme il se devait, pour qu’on puisse espérer être, peut-être, au rendez-vous. Ce masque, on n’en parlait pas, on n’en savait rien ou pas grand chose, sinon qu’il nous enjoignait en secret de nous faire petit, tout petit, discret, de nous taire autant que faire se peut. Et on s’y essayait dès le réveil, avec sincérité et bonne volonté. C’était ainsi qu’on se préparait au grand rendez-vous, en parlant le moins possible, juste le nécessaire : bonjour, s’il te plaît, pardon, ce n’est rien, merci, je t’en prie.
Et ce masque, préparé tout au long de la journée, transfigurait le monde, nous faisait voir les choses autrement. C’est comme s’il nous repoussait en arrière de nous-mêmes, en ce lieu où nous n'étions pas encore tout à fait, heureux simplement d'être bientôt. Quant aux choses, elles avaient une autre façon d’être ce jour-là, il faut bien le dire, car les choses aussi étaient averties que c’était dimanche, et je crois bien que tout le monde le savait, les commerçants avaient tiré les rideaux de fer, on ne claquait pas les portes, les cafés étaient fermés, on avait endossé nos habits de baptême. Restait la ville avec ses maisons bien espacées, les marronniers, les places, l’odeur du pain, l’affairement des moineaux dans les haies. C’est que les choses gardaient si bien leur distance qu’il y avait plus de place entre elles, jusqu'aux fers du portail du jardin à travers lesquels on pouvait glisser la main. Les voitures tenaient enfin leurs promesses, elles étaient toutes de couleur différente, bien garées, elles ne se serraient pas les unes contre les autres. Du silence entre les choses, un silence qui leur laissait les coudées franches.
On était un peu seul le dimanche, livré à nous-mêmes, perdu parmi les choses, inconnu parmi les inconnus. Il faut dire qu’à Riant-Mont les choses se réveillaient plus tôt le dimanche, et elles nous attendaient tandis qu'on se frottait encore les yeux. D’emblée on était surpris de la façon dont elles nous regardaient, sans rien cacher pourtant de leur grandeur. Elles nous dévisageaient, et on savait que c’était nous qu’elles dévisageaient, puisqu’on était seul avec elles. Elles ne faisaient pas grand cas de notre présence, ne devaient-elles pas déjà répondre d'elles-mêmes? Elles allaient leur bonhomme de chemin, elles étaient là et nous avec elles, on les traversait, elles nous traversaient, belles et massives, rien d’autre qu’elles et nous, elles et nous comme des bêtes apaisées.
C’était un joli masque qu’il fallait mériter et qu’on voulait mériter, mais il n’était pas si simple à porter, à tel point qu’il vaudrait mieux dire qu'on s'y essayait, parce que, en vérité, on avait besoin de tout le dimanche pour y parvenir, et même qu’à la fin on n’y arrivait pas, et on le savait dès le début qu'on n'y arriverait pas, qu'il nous aurait fallu des semaines et des semaines. Et on les a eues ces semaines, mais on n'y est pas parvenu. Si bien que, le soir, c’était facile de le déposer, parce que le masque, on ne l’avait pas vraiment porté. Il était resté bien en avant de visage. On le mettait alors de côté, là tout près, on le gardait sous la main, parce que le dimanche suivant, on avait à nouveau rendez-vous.
Tout le dimanche on se préparait à porter un masque, de l'aube au crépuscule, le masque qui aurait dû nous ouvrir les portes du grand rendez-vous, sans qu'on n'y parvienne jamais. Et c'est de cette impossibilité répétée qu'on est entré dans la partie, le monde s'est glissé là où on ne l'attendait pas, il nous est apparu neuf, tout neuf, vrai et entier, les choses avec l'espace tout autour, leur liberté, leur bienveillance, et nous qui ne comptions pour rien. C'est par la grâce des dimanches que notre corps et notre visage réconforté par un masque dont nous différions constamment le port, ont compris que le monde ne voulait pas nous tromper, c'est par la grâce des dimanches que nous avons renoncé enfin à porter un masque sans pour autant renoncer à l'élémentaire précaution de le garder sous la main, comme pour ne pas perdre de vue une vieille promesse qui se réalisait à nos dépens.
J'aime les dimanches déserts qui avancent au pas, le samedi à six heures du soir lorsque la campagne tonne, et tous les jours qui y affluent, là où le temps se fait source et delta.
Jean Prod’hom
Dimanche 21 mars 2010

Il y a du grabuge dans l’existence de cet ami. Il se débat, s’enlise, peine à passer. Alors il parle sans compter à ceux dont il est l’hôte, il parle de ce dont il n’arrive pas à se défaire, d’images, d’une image, d’une image qui lui colle à la peau, de l’image d’une femme et des circonstances de son règne. Il essaie, en filant d’innombrables métaphores qui l’enchantent, se croisent et se mêlent, de faire barrage à la douleur qui a colonisé son existence et à laquelle la raison prête son concours.
Il sourit de pouvoir prendre ce soir un peu de hauteur, heureux que des mots puissent l’élever au-dessus du champ sans ailleurs des opérations qui le rongent depuis des mois, dans lequel il a tourné et s’est retourné. S’il s’offre une vacance en inventant l’interminable récit de ce qui l’a rendu aveugle, celui-ci lui offre en même temps la plus belle et raisonnable des justifications, la raison poétique est devenue sa pire ennemie. La nuit avance.
Mais voilà qu’un petit garçon, dix ans peut-être, interrompt le compte-rendu de ce désastre. L’ingénu court-circuite ce qui aurait pu ne jamais finir. Mais de quoi parlez-vous, je ne comprends pas. L’ami marqué par des nuits sans sommeil lui répond que c’est de la vie qu’il parle. Le garçon fronce les sourcils, la vie? la vie? L’ami se baisse et lui tend la main, et pour toi pour toi, c’est quoi la vie? Un rond? un carré? Le visage du garçon s’éclaircit, il prononce voix douce un seul mot : nénuphar.
Et la vie recomposée acquiesce.
Jean Prod’hom
En haut la côte

Tu t’en approches à vive allure et tout s’enchaîne, c’est un rêve, s’emboîte, c’est un puzzle. Tu espères même y toucher avant de parvenir en haut la côte, tu te dis même qu’il le faudrait, de toute urgence, c’est une condition, ne pas freiner, y parvenir avant d’arriver au col, avant que tout ne s’arrête puis disparaisse, le temps est compté, la vérité se tient là, tout près, en équilibre, il faudrait que tu y parviennes avant de tout oublier, le montage est ténu, il te faut tout risquer à présent, surtout ne pas perdre en un éclair ce qu’un autre éclair, un concours de circonstances et deux pierres d’angle t’avaient fait entrevoir et que l’exigeant labeur de la pensée t’avait permis de rabouter, te hâter, une pièce encore, un enchaînement, tu a mis la main sur le bon filon, c’est certain, tu peux sourire, tu touches bientôt au but, il suffit de glisser la clé de voûte, dépêchons, tu reprendras le tout demain à l’aube, promis, petites suppressions et finitions, polissage, un ou deux contreforts peut-être, pas trop, le retrait enfin des échafaudages. Au crépuscule se dressera la vérité toute neuve, la nouvelle façade de Santa Maria Novella et tu en seras l’architecte.
Mais avant même d’arriver au col, à mi-pente déjà, ou peu après, tu t’aperçois que tu es précisément en train de manquer le but, tu t’en éloignes même, plus rapidement encore que tu ne t’en approches, il ne sert à rien d’accélérer, de siffler les chiens pour qu’ils rameutent des pensées flottantes, mal établies, trop tard, tout se défait, part en fumée, eau de boudin, le convoi s’en va, ce n’était rien, moins que rien.
Tu découvres alors de l’autre côté de la colline un horizon immense, avec des montagnes immobiles, démesurées, rien à voir avec ce que tu avais cru pouvoir réduire et disposer par des signes, te voilà chassé, abandonné, vidé. Où t’es-tu égaré? Tu pourrais tout regretter, te terrer, t’attaquer au mirage qui t’a mené là, en vouloir aux chicanes, débusquer les leurres. Mais tu te prends à penser qu’il en va autrement, cette croisade qui a tourné court t’a allégé. Te voilà au sommet de la côte avec ce qui ne tient pas dans les mains de la raison, avec ce qui ne tient nulle part, ce qui déborde de partout. Derrière toi l’obstination, devant toi la confiance, tu peux désormais aller dormir.
Jean Prod’hom
Premier établissement

Avant la conquête
le ciel
la nuit
les vagues
massives et gauches
butant sur l’île
nue et amaigrie
lettre de guingois
vue du ciel
fenêtres grand ouvertes
sur les grains
sur les vents
courants d’air et pluie
bois blanchis
bestioles à plumes compostées
coques nacrées écailles bris
os et caillasse concassés
mais voici les goélands
rescapés d’un interminable voyage
maigres et faméliques
les cormorans
idées étroites idées noires
ils cherchent à s’établir
le claquement de leurs ailes
le reflet de leur trajectoire
dans le miroir de l’océan
les tiennent
éloignés de l’île
ils s’installent à deux pas
sur un îlot de rien
pas la force de repartir
qui les aurait vus
les aurait vus aller et venir
puis plus rien
rien de neuf
sur l’île mourante
des années durant
c’est aux oiseaux de la mer
que l’on doit
ces quelques images
de l’île d’avant la conquête
à eux aussi la suite
ils préparent leur retour
cris insupportables
affûtent
retroussent leurs paupières
ils partagent
d’abord le ciel
les constellations
avant de tirer des droites à la verticale
de chacune de leurs hésitations
ils repèrent sur l’île
les ronciers et les vasières
établissent des nichoirs
sur tout le territoire
colonisent les terres
toutes
jusqu’aux confins
procédure stricte
reproduction des conditions
réaction du milieu
étude de l’impact
apport des modifications
avant d’astreindre le tout
aux fins prévues
chacun dans son quartier
tout fut réglé
tambour battant
du plan de la mosaïque
au prix de la dot
localisation des sources
établissement des droits de passage
constitution de réserves
contrôle des influences
nomination des autorités de substitution
loi sur le contingentement
asservissement du solde
le récit des oeuvres
des oiseaux de la mer
allège aujourd’hui encore
la tâche des chefs de provinces
en peine de justifications
on appelle cette année-là
l’année du grand partage
c’est aux oiseaux de la mer
qu’on la doit
et sur l’océan
la lettre de guingois
reprit un peu de caractère
Jean Prod’hom
Jour de fête

Accoudés au zinc du café du Cygne, Jean-Rémy et ses amis font une partie de 421 en pataugeant dans le vin blanc.
– Lorsque l’un d’entre vous aura obtenu 807, j’offre la tournée.
Ils retroussent leurs manches et se mettent à l’ouvrage. Je repasse en fin d’après-midi, ils ont dessaoulé et le visage des morts.
– T’as pas plus simple !
« Se dépasser, se dépasser, se dépasser... » murmure tristement le cheval blanc du manège sur la place du village.
Les moineaux jouaient à cliclimouchette tandis que derrière le battoir un jeune homme aux idées noires fourbissait ses armes.
Jean Prod’hom
25 février 2010
Grande santé

A la maison, on n’était jamais malades, et quand on l’était malgré tout, ce n’était pas comme chez les autres, si bien que ça ne comptait pas vraiment, on restait au lit, simplement, et ça passait. Il faut dire que l’usage même du mot maladie était proscrit à la maison, et malade n’y sonnait pas de la même manière que chez nos amis. A ce propos je dois noter qu’on n’avait pas d’amis, on était si bien entre nous et les choses étaient tellement plus simples ainsi.
Jamais malades ou presque, et les maladies qu’on avait, ce n’était que des bonnes maladies, celles qui rendent plus fort, celles qui rendent justes, celles qui sont dans l’ordre des choses, les maladies qu’on ne soigne pas, que personne ne soigne, surtout pas nous. C’était un peu comme si on les enfantait, c’était les nôtres. On n’allait donc pas chez le médecin, parce que nos maladies n’étaient pas dues au hasard, c’était un signe du ciel, un message des saisons auxquelles on obéissait. Mais attention, on y obéissait librement, car on savait que c’était toujours au meilleur moment qu’elles allaient faire leur apparition, qu’elles allaient faire leur chemin et s’en aller, ni vu ni connu. Il était donc bien inutile qu’on nous les vole.
Elles tombaient toujours bien, pendant les vacances ou le vendredi avant le week-end, ou à des moments qui convenaient à tout le monde. A ces moments-là on avait le feu vert et on laissait la maladie venir, avec le sourire, tout le monde était content. Malades ensemble, c’était encore le meilleur plan, on y arrivait la plupart du temps. Mais attention, c’était exclu qu’on ne se lève pas, qu’on manque l’école ou que papa ne se rende pas à l’usine.
A la maison on ne parlait pas de remèdes, car les remèdes c’était fait pour les malades, et on n’était pas malades. La maladie c’était pour les autres. Nous on était cinq. Un verre d’argile suffisait, c’était notre cure de printemps, une feuille de chou sur le front ou sur la nuque les soirs où on avait la tête pleine, une cuillère de sucre candy macéré dans de la rave sur un radiateur lorsqu’on avait mal au cou. Et c’était tout, des graines de moutarde à la rigueur si on toussait, du blé au printemps quand l’herbe repoussait dans les prés, du blé que maman faisait germer un jour ou deux dans des coupelles jaunes et on était armés pour le reste de l’année.
On avait un modèle à la maison, un grand-père maternel. Il soignait, disait-on en secret, un rhume chronique en avalant à l’aube des limaces crues, il assommait son arthrose en se faisant des bains d’orties près du poulailler. Lui il en savait sur la nature, les plantes et la lune, mais il ne nous en parlait pas, c’était secret, lui aussi était secret, et il avait un mauvais caractère. Et puis il y avait maman, maman à laquelle mes soeurs et moi on doit presque tout, disons qu’on lui doit un peu plus de la moitié de ce qu’on est. Maman était panthéiste, je crois, panthéiste sans le savoir, et je crois même que nous cinq on n’imaginait pas le monde autrement que sous la forme d’un immense organisme respirant, tous panthéistes, même mon père, malgré ses velléités monothéistes, panthéistes et immortels.
C’est beaucoup plus tard que j’ai compris que nos jours étaient comptés, bien après que Michel ne se jette avec sa draisine rouge sur les bas-côtés du chemin qui menait au fond du jardin en criant, sourire aux lèvres : accident mortel. J’ai eu une enfance au grand air, saine et immortelle.
Jean Prod’hom
Lendemain de carnaval

Que vous donniez le bras au porte-drapeau, que vous soyez l’un des fier élus à la tête du cortège, ou que vous alliez clopin-clopant ratisser les mégots nichés entre les pavés, il ne restera rien lorsque la foule se dispersera. Ou si peu : les colonnes vides des pertes et des gains, des confettis, le ciel bleu d'airain contre lequel le temps bute, la bière âcre. La pluie a remis les compteurs à zéro, les nuages nous saluent avant de filer à Saint-Jacques ou pousser jusqu'à Jérusalem.
Oubliée au pied du réverbère, pas effrayée pour un sou, serrée dans les mâchoires d'une invisible nécessité, la graine de l’an passé s’est enhardie. Trois petits bourgeons épongent le tintamarre des cortèges de la veille et font oublier l’omniprésente pauvreté.
Tu t'assois sur le banc, secoues un rameau qui traînait là, le trempes dans la poussière pour écrire sur le macadam quelques lettres, hésitantes, flottantes, qui s’envolent bien vite.
Jean Prod’hom
Dimanche 14 mars 2010

On se penche vers ce qui s’entrouvre, on devine, ça tire et ça pousse par en dessous. Avec le soleil qui descend, pour la première fois, tout droit depuis en haut, oui c’est sûr, la besogne sera vite terminée.
La terre – mais est-ce bien le nom qui lui convient en mars? – bombe le ventre et creuse les reins; elle efface les derniers signes de l’hiver que plus personne ne tente de déchiffrer, le grand texte blanc est troué de toutes parts, demeurent quelques grands caractères aux allures de gingembres fantomatiques qui se recroquevillent imperceptiblement, avant de gesticuler comme ces bâtons de guimauve lorsqu’on les approche des flammes : ils moussent et bavent, c’est la débandade.
On aimerait déjà s’asseoir, appuyer le dos contre les mousses et rêver, mais tout est détrempé; sur le chemin, le trop plein d’eau goutte dans de petites vasières que le vent remue; lorsqu’on aura le dos tourné, les moineaux et le merle qui guettent un peu plus loin viendront à tour de rôle y frotter le bec.
Le langage lui aussi monte par en dessous, il vient au bord des lèvres, on voudrait tout dire, vite, trop vite dits, taisez-vous mots mous, laissez la petite débâcle terminer son ouvrage.
Je vais, ma tête s’enfonce dans la terre meuble, un peu d’immobile tout autour, j’y crois dur comme fer, c’est sûr, on a passé bonne espérance. C’était lundi après-midi du côté des Censières, du côté du Bois Vuacoz, à la Mussilly, partout, il n’y avait personne, on n’en parlait pas, ça avait lieu, débâcle aux couleurs pâles, sous le bleu coupant du ciel conquérant.
Jean Prod’hom
Confusion

Ça tournait vite
mais dans le vide
rien pour stopper l’hémorragie
aucun tiers
nul butoir nulle corniche
les souvenirs s’altéraient
rongés par le va-et-vient
des rameaux de l'arbre des pendus
sous lequel végétaient
les sans droits
talon contre talon
épaule contre épaule
tenaces
les mémoires prenaient l’eau
l’après rongeait son frein
incapable de rejoindre l’avant
les effets repoussaient les causes
on allait en vain
en tous sens
c’était luttes feutrées de successions
sur les traverses des échelle dynastiques
cachés dans une tour d’angle
dévorée par le lierre
ceux qu’on appellera
les poètes les philosophes
les buissonniers parfois
qu’importe
s’interrogeaient
sur la domesticité
sur la primauté de la terre
racontaient le ciel avec la mer et la terre
tout
ils risquaient gros
tous ceux qu'on associait
aux tourbillons des consciences
on les pendit
on les craignait tant
qu'on les passa au fil de l’épée
avant de les glisser
morceau par morceau
dans les tiroirs de la nuit
on déplaça les bergers
des montagnes dans la plaine
qui séparait près de l'isthme
les deux océans
on les boucla d’une ceinture d’acacias
on enferma à double tour
les chasseurs et les nomades
confinés sur la côte méridionale de l’île
isolée par un arc de chausse-trapes
on leur offrit l’indépendance
et la liberté des alliances
l’enclave ou l’emboîtement
plus rien en guise d’amer
pas même l’errance
les commencements fuyaient
j’aurais tant voulu embrasser les premiers alinéas du monde
Jean Prod’hom
Les seigneurs de la nuit

La nuit tombe, c’est un samedi soir de l’année 1961 ou 1962, ou 1963. Je monte au stade de la Pontaise, la main dans la main de mon père en suivant la collectrice du Valentin dans laquelle cinq ou six drailles sorties de nulle part déversent des grappes d’inconnus. Mais la foule ne grossit vraiment qu’aux Anciennes Casernes, une foule taiseuse, concentrée, qui se prépare à faire face à quelque chose qu’on n’était tous bien incapables de penser. Une folle rumeur monte du puits que creusent les faisceaux bleu acier des projecteurs. On a de l’avance, on regarde l’heure, tout monte, monte. Mais il faut attendre, nous taire encore, contenir notre agitation, nos espoirs, avant que la grande affaire n’ait lieu. Ils entrent enfin dans la lumière.

On les appelait les Seigneurs de la nuit : Künzi, Grobéty, Tacchella, Schneiter, Hunziker, Dürr, Armbruster, Eschmann, Kerkhoffs, Hosp, Hertig. Chacun d’eux incarnait à sa manière l’un des onze attributs de l’être.
Jean Prod’hom
Hostie

Au petit déjeuner, à Riant-Mont, on terminait toujours le pain de la veille, ou s’il en restait, le pain de deux jours, même le dimanche. Ce n’était pas l’effet d’un de ces étranges concours de circonstances qui se répètent quotidiennement et qui alourdissent nos existences, mais l’application stricte d’un des articles essentiels d’une doctrine dont nous étions les dépositaires, les seuls peut-être, un article qui nous soudait, nous constituait même, à tel point qu'on n'imaginait pas qu'il puisse exister ailleurs d'autres doctrines. Une vérité simple, sans déclinaison : chez nous on ne mange pas de pain frais, c’est tout.
Ma mère achetait du pain chaque jour, chaque jour ou presque, mais on n'y touchait pas, on attendait patiemment qu’il vieillisse, un jour au moins. Il le fallait pour qu’il livre tous ses bienfaits et soit bon pour notre santé. On ne s’en plaignait pas, c’était ainsi. Comment vouliez-vous donc qu’on ait une telle idée, se plaindre?
C’était comme un pacte, un ancien pacte sans origine connue, sacré en cela, un pacte continué, assuré par un silence sur lequel on ne s’appesantissait pas. Mais c’était aussi un signe distinctif qui faisait de nous des êtres un peu prométhéens, un luxe et une puissance, voyez-vous? Mais un luxe discret, puisque personne d’autre que nous n’en savait rien. L’ostentation on ne connaissait pas, ou si peu, un petit peu quand même, c’était comme une petite ostentation rentrée qui nous aidait à garder la tête haute mais que personne ne devait voir.
On ne voulait endoctriner personne, car on n’avait besoin de personne, cette doctrine nous obligeait même à nous couper des autres, même si on se disait au fond du coeur que les autres auraient mieux fait de savoir tout ce qu’on savait à propos du pain. Mais ça on le disait tout bas, l’a-t-on d’ailleurs dit même une seule fois? à qui que ce soit? en a-t-on même parlé un jour entre nous?
On savait bien sûr que le pain frais ça se mangeait, mais ailleurs, et ailleurs qu’est-ce que c’est? On savait aussi que certaines personnes prétendaient que le pain frais, blanc de surcroît, c’était bien meilleur que le pain, ça aussi on savait que certains le disaient. On pensait au fin fond de nous qu’ils le disaient pour nous narguer ou éprouver la doctrine. Mais ces gens, fils de boulangers ou de riches, on ne les écoutait pas, on les entendait à peine, c’était tellement insensé.
On admettait toutefois qu’il en soit ainsi chez les autres. Qu’ils mangent donc du pain blanc, du pain frais, des croissants et des petits pains au lait. Qu’ils assument, c’était pas notre affaire. On savait que chez les autres c’était pas comme chez nous, on pensait simplement qu’ils habitaient un autre monde, voisin de celui des fous, et qu’ils paieraient un jour leur inconscience de leur santé. Qu’ils restent entre eux et nous entre nous, ils n’avaient en définitive pas été choisis pour entendre toute la vérité sur le pain, tout simplement.
Nous sommes descendus une ou deux fois en famille à Ouchy donner du pain sec aux poules d’eau, aux cygnes et aux canards. Je me demande bien aujourd’hui d’où il nous venait? s’il y avait un traître parmi nous, ou s’il s’agissait d’un geste de ceux de l’autre monde. Car à la maison, en principe on n’avait pas de restes, on avait seulement du pain sur la planche.
Jean Prod’hom
Veillée

Lourde insomnie cette nuit malgré l’application consciencieuse des techniques mises au point par Ravel. À minuit pourtant le sommeil avait pointé son nez, mais l’air du boléro a joué des coudes et le sommeil a foutu le camp.
- Je me demande bien si j’ai dormi cette nuit.
- Mais enfin ma Lili, tu as dormi comme tout le monde, n'est-ce pas ?
- Je sais pas, je ne me suis pas réveillée une seule fois.
Jorge Luis Borges ferme les yeux et il voit un troupeau de moutons. La vision dure une seconde, peut-être moins. Leur nombre était-il ou non défini ? Le problème enveloppe celui de l’existence de Dieu. Si Dieu existe, le nombre est défini, car Dieu sait combien de moutons il a vus. Si Dieu n’existe pas, le nombre n’est pas défini, car personne n’a pu en faire le compte. Dans ce cas, il a vu un nombre de moutons, disons inférieur à 810 et supérieur à 805, mais il n'a pas vu 806, 807, 808 ni 809 moutons. Il en a vu un nombre compris entre 810 et 805, qui n’est ni 809, ni 808, ni 807, ni 806, ni 805,... Jorge Luis Borges s’est endormi le 14 juin 1986 à Genève.
Jean Prod’hom
18 février 2010
(FP) Le champ de Tityre

Rien n’a changé depuis plus de vingt ans, les élèves et les enseignants vont et viennent d’un pas régulier, affairés, sérieux, puis les portes se ferment et le silence revient. Je suis assis sur la troisième des cinq marches qui conduisent à la nouvelle bibliothèque du collège, pour la première fois. Par la baie vitrée à l’ouest, j’aperçois les crêtes enneigées du Jura, longues et lointaines, au pied desquelles s’égrènent des villages que je connais bien. A vrai dire je les devine, plus proches et vivants que jamais. Je murmure leur nom : Bérolle, Mollens, Montricher, L’Isle, La Coudre, Mont-la-Ville, La Praz, je demeure immobile, un instant encore, le regard tendu, l’oreille aussi, le corps, je crois, là-bas. Je songe à Paludes.
"Paludes, c'est spécialement l'histoire de qui ne peut voyager; – dans Virgile il s'appelle Tityre; – Paludes, c'est l'histoire d'un homme qui, possédant le champ de Tityre, ne s'efforce pas d'en sortir, mais au contraire s'en contente; voilà..."
Je serais volontiers resté un instant encore accroupi sur ces escaliers, comme autrefois sur les escaliers de Chandieu, sur les escaliers de pierres du Buisson, ceux du jardin de Riant-Mont, de Colonzelle, sur ceux du grenier de Bursins, sur les escaliers Hollard, sur ceux du parvis du dôme de Montepulciano, sur tous ces escaliers, souches et bancs de pierre, sur tous ces murets et ces perrons qui m'ont fait l'égal de Tityre : un champ et m'en contenter. (P)
Jean Prod’hom
Nuit de Walpurgis

Un anonyme rédigea
à la demande des prêtres
le compte-rendu des méfaits
du responsable des mines
pour sauver sa tête
on acheta
les témoignages d’indigènes
qu’il fallut ensuite
et par précaution
tailler en pièces
on jeta les procès-verbaux
dans un feu immense
qui éclaira le festin au cours duquel
on fit tomber les masques
on laissa libre cours aux propos de table
la femme du responsable des mines
chanta même dans la nuit
abondance et apanage
t’en souviens-tu
et les choses tues
foulées sous les tréteaux
par les convives
mélangées à la boue
devinrent comptines
chansons paillardes et rengaines
pas d’image complète de l’affaire
mais on la colporta en l'état
dans la vallée
où on l’enrichit
de vaille que vaille et de quoi qu’il en soit
tant et si bien qu’elle ne se perdit pas
dans l’agitation tricéphale
des égoïsmes des peurs et des ça va de soi
tout porte à croire que
les à-côtés du procès du responsable des mines
joints aux emprunts et aux anachronismes
soient également aux sources des hégémonies
qui fondèrent le droit des fous
à devenir sur tout le territoire de l’île
les dépositaires des clés des allées
les détenteurs du texte de justification des grands lacs
et lorsque le temps l’exigea
les rédacteurs de l’appel au retrait des grandes crues
néanmoins le ciel et les nuages
en vinrent aux mains
si bien qu'il fallut quelques têtes brûlées
pour détourner des sources empoisonnées
la transparence de l’eau
et tirer de la terre fumante
des poignées de glaise
c’est par ces actes de courage
que les héritiers se souviennent aujourd’hui
qu’il aurait pu en être autrement
Jean Prod’hom
Dimanche 7 mars 2010

Dans les villages autrefois, on chérissait les idiots qu’on autorisait à rôder aux alentours des habitations avec les chiens errants. Ils vivaient libres et dormaient chez une tante éloignée, un vieux ou une vieille, dans une grange abandonnée, sur la margelle d’un puits, dans la paille ou des sacs de jute. On les éloignait certes, mais on leur offrait un peu de soupe et un peu de pain pour les inclure dans la création et proposer ainsi un avant-goût du paradis. Souvenez-vous de Corentin le bienheureux.
On les chasse aujourd’hui, avec les tantes éloignées, les vieux et les vieilles au-delà des limites de la création, on les enferme dans des maisons de redressement, des atelier protégés, des centres de tri ou des asiles dans lesquels ils sont nourris comme des oies, pour nous offrir un aperçu de l’enfer auquel nous sommes destinés.
Jean Prod’hom
Autogéographie | Nathanaël Gobenceaux
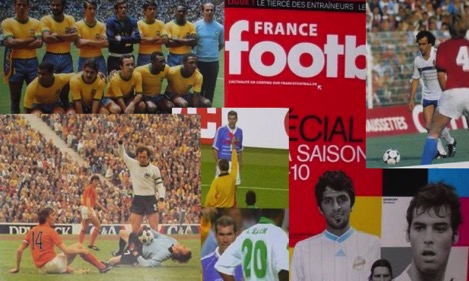
Montage : Nathanaël Gobenceaux
Autogéographie en footballeur
(JE ME SOUVIENS des années football)
… Lausanne Sport – Neuchâtel Xamax - Grasshopper – Zurich – Servette Genève - AJ Auxerre - Girondins de Bordeaux - D’aussi loin que je me souvienne, j’ai dû m’intéresser au foot vers mes 7 ou 8 ans… - US Boulogne CO - Grenoble Foot - Le Mans UC 7 - …j’ai acheté nombre de France Foot que je ne me résous pas à jeter et qui encombrent ici ou là… - RC Lens - Lille OSC - FC Lorient - Olympique lyonnais - JE ME SOUVIENS DES ECUSSONS DORES QUE NOUS COLLIONS SUR UNE CARTE DE FRANCE ; LES VILLES ET LES CLUBS, GEOGRAPHIE ET FOOTBALL ; ASSOCIATION SPORTIVE DE MONACO, FOOTBALL CLUB DE METZ, OLYMPIQUE MARSEILLE, ASSOCIATION DE LA JEUNESSE AUXERROISE, RACING CLUB DE LENS, STADE RENNAIS… - Olympique de Marseille - AS Monaco - Montpellier HSC - AS Nancy-Lorraine - OGC Nice - …les plus anciens doivent dater de la fin des années 1980’… - Paris SG - Stade rennais - AS Saint-Étienne - FC Sochaux - Toulouse FC - …je me rappelle particulièrement, à chaque intersaison (l’intersaison en foot correspond aux mois de juillet et août, quand les joueurs sont en vacances et en profitent pour changer de club)… - Valenciennes FC - M'gladbach – Nuremberg- Leverkusen - JE ME SOUVIENS, LISANT LA GAZZETTA DELLO SPORT DANS UN IMMEUBLE DE SCANDICCI, DEVANT LES RESULTATS DE LA COUPE UEFA, ETRE TOMBE SUR UN CERTAIN BAYERN MONACO. BIZARRE, Y AURAIT-IL UNE AUTRE VILLE QUE LA PRINCIPAUTE A AVOIR CE NOM ? J’ENQUETE, FEUILLETTE LE JOURNAL JUSQU’A LA PAGE DU CHAMPIONNAT ALLEMAND ET LA JE COMPRENDS : EN ITALIEN, MUNICH SE DIT MONACO. – Wolfsburg - Stuttgart – Hambourg - Bochum – Hoffenheim - … des cartes présentant les différentes villes & équipes en compétition pour l’année à venir… - Hanovre - Werder Brême - Hertha Berlin – Mayence - Bayern Munich - …peut-être mes premières cartes non scolaires… - Borussia Dortmund – Schalke 04 – Cologne – Francfort - JE ME SOUVIENS DE GUY ROUX, LE MANAGER D’AUXERRE, DISANT AVANT UNE RENCONTRE DE COUPE D’EUROPE CONTRE LA FIORENTINA DE BAGGIO, QU’IL VOULAIT BIEN ENLEVER LE PONTE VECCHIO DE L’ARNO POUR LE METTRE SUR L’YONNE. – Fribourg - Man. City - Bolton - Portsmouth - Sunderland - Wigan - Stoke City - …c’est ainsi que j’ai appris que Rosario était en Argentine, que Santiago du Chili abritait le club de Colo Colo… - Fulham - Burnley - Arsenal - Liverpool - Aston Villa - Man. United - …qu’Anderlecht était un quartier de Bruxelles… - West Ham - Birmingham - Wolverhampton - Tottenham - Blackburn - Hull City - Everton - JE ME SOUVIENS DE PISE, DEVANT LA TOUR PENCHANTE, CHEZ DES MARCHANDS AMBULANTS, D’Y AVOIR ACHETE LES FANIONS DE PLUSIEURS GRANDES EQUIPES EUROPEENNES : CEUX DE L’AJAX AMSTERDAM, DU MILAN AC, DE LA FIORENTINA, DE L’AS ROMA ; JE ME SOUVIENS QUE PLUS TARD ON M’OFFRIT CEUX DU SPORTING LISBONNE ET DU REAL MADRID DE CHENDO, MICHEL ET BUTRAGUEÑO. – Chelsea - Genk - Lokeren - Zulte-Waregem - Roulers - La Gantoise - …c’est ainsi que j’ai appris à situer Glasgow, Cologne ou Eindhoven sur une carte… - Saint-Trond - Courtrai - Cercles Bruges - Westerlo - Charleroi - …c’est comme ça aussi que j’ai appris qu’Auxerre, bien que grand club de foot n’est en fait qu’une petite ville de 40 000 habitants… - FC Bruges - Standard Liège - Anderlecht - Malines - Aberdeen - Celtic - Hamilton - JE ME SOUVIENS AVOIR PRIS PARTI POUR LE BARÇA PLUTOT QUE POUR LE REAL LE JOUR OU J’APPRIS QUE LE REAL ETAIT LE CLUB DU ROI, L’ANCIEN CLUB SOUTENU PAR FRANCO ALORS QUE LE FC BARCELONE REPRESENTAIT PLUTÔT L’ANTI-FRANQUISME. - Motherwell - Hearts - Falkirk - Kilmarnock - St Johnstone - St Mirren - Dundee United - Rangers - Hibernian - …que le PSG est le club des quartiers Ouest de Paris, que le Red-star 93 est celui des anciennes banlieues communistes… - Gijon - Valence - Xerez - Real Madrid - Villarreal - Athletic Bilbao - Espanyol - La Corogne - Valladolid - Saragosse - …je situais donc tout cela sur la carte, sur la mappemonde ou dans l’atlas… - Getafe - Almeria - Santander - Malaga - FC Séville - Osasuna - Atlético Madrid - Barcelone - Tenerife - Majorque - JE ME SOUVIENS D’UN AMI ME RAPPORTANT D’ANGLETERRE UN MAILLOT ROUGE DE MANCHESTER UNITED. - Milan AC - Udinese - AS Roma - Palerme - Sampdoria - Fiorentina - Cagliari - Bari - Catane - Atalanta - Chievo - Sienne - Juventus - …je parcourais le monde des Andes à la Yougoslavie, de Tromso (Norvège) à l’Ajax Cape Town (Afrique du Sud)… - Genoa - Livourne - Bologne - Parme - Lazio Rome - Naples - Inter Milan - NEC Nimègue - NAC Breda - Vitesse - FC Twente - Heerenveen - Ajax - ADO Den Haag - Willem II - AZ Alkmaar …j’apprenais ainsi que les noms en –ic viennent de l’ex Yougoslavie, ceux en –ev de Bulgarie, les noms en –ski de Pologne, les en –sky plutôt de Russie… - Roda JC - Utrecht - Feyenoord - Groningen - Waalwijk - Sparta Rotterdam - VVV Venlo - Heracles - PSV - P.Ferreira - Sporting - Benfica - Belenenses - Leixões - Porto - Leiria - Setubal - Academica - JE ME SOUVIENS D’UN VOYAGE EN ANGLETERRE ; J’ACHETAIS DES MAGAZINES DE FOOTBALL, J’APPRENAIS DES MOTS -QUI NE M’ONT PAS SERVI DEPUIS- TELS QUE ‘WINGER’, GOALKEEPER OU ENCORE LEFT BACK ; PLUS TARD, J’APPRENDRAIS LES TRADUCTIONS ITALIENNES DE BUTS : RETI, GARDIEN : PORTIERE, ENTRAINEUR : TECNICO OU ALLENATORE. - Olhanense - Nacional - Rio Ave - Braga - Maritimo - Naval - V.Guimarães - Sion - St-Gallen - Lucerne - Aarau - Bâle - Bellinzona - Young Boys….
Nathanaël Gobenceaux
![]()

écrit par Nathanaël Gobenceaux (géo-graphe. Il égrène sont auto-géo-graphie-s ici et là sur le net et tient les blogs Les lignes du monde et Balzac (par de petites portes) qui m’accueille chez lui dans le cadre du projet de vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.
Et d’autres vases communicants ce mois :![]() Mariane Jaeglé et Gilles Bertin
Mariane Jaeglé et Gilles Bertin ![]() Eric Dubois et Patricia Laranco
Eric Dubois et Patricia Laranco![]() Lignes électriques et Chroniques d'une avatar
Lignes électriques et Chroniques d'une avatar![]() Christophe Sanchez et Yzabel
Christophe Sanchez et Yzabel ![]() Luc Lamy et Anna de Sandre
Luc Lamy et Anna de Sandre ![]() Futiles et graves et Kill that Marquise
Futiles et graves et Kill that Marquise ![]() Christine Jeanney et Arnaud Maïsetti
Christine Jeanney et Arnaud Maïsetti![]() Michel Brosseau et Juliette Mezenc
Michel Brosseau et Juliette Mezenc![]() Frédérique Martin et Denis Sigur
Frédérique Martin et Denis Sigur ![]() Pierre Ménard et Anne Savelli
Pierre Ménard et Anne Savelli ![]() Juliette Zara et Kouki Rossi
Juliette Zara et Kouki Rossi![]() Nathanaël Gobenceaux et Jean Prod'hom
Nathanaël Gobenceaux et Jean Prod'hom![]() Florence Noël et Lambert Savigneux
Florence Noël et Lambert Savigneux![]() Hublots et Petite racine
Hublots et Petite racine ![]() Pendant le week-end et Quelque(s) chose(s)
Pendant le week-end et Quelque(s) chose(s)![]() François Bon et Commettre
François Bon et Commettre![]() Scriptopolis et Kill Me Sarah
Scriptopolis et Kill Me Sarah![]() RV. Jeanney et Paumée
RV. Jeanney et Paumée![]() Anita Navarrete Berbel et Anna Angeles
Anita Navarrete Berbel et Anna Angeles
Post-scriptum
La nuit tombait sur Lausanne, un samedi soir de l’année 1961 ou 1962, ou 1963. Je montais au stade de la Pontaise, la main dans la main de mon père, en suivant la collectrice du Valentin dans laquelle cinq ou six drailles sorties de nulle part déversaient des grappes d’inconnus. Mais la foule ne grossissait vraiment qu’aux Anciennes Casernes, une foule taiseuse, concentrée, qui se préparait à faire face à quelque chose qu’on n’était tous bien incapables de penser. Une folle rumeur montait déjà du puits que creusaient les faisceaux bleu acier des projecteurs. On avait de l’avance, on regardait l’heure, tout montait, montait. Mais il fallait attendre encore un peu, nous taire encore, contenir notre agitation, nos espoirs, avant que la grande affaire n’ait lieu.
On les appelait les Seigneurs de la nuit : Künzi, Grobéty, Tacchella, Schneiter, Hunziker, Dürr, Armbruster, Eschmann, Kerkhoffs, Hosp, Hertig. Chacun d’eux incarnait à sa manière l’un des onze attributs de l’être.
Jean Prod’hom
La vieille de Pra Massin

L’affaiblissement de ses forces et la perspective de la mort effrayaient moins la vieille depuis qu’elle se rendait avec son chien à Pra Massin sur les hauteurs du village, chaque jour ou presque. Elle s’asseyait sur le banc que la commune avait mis à la disposition des promeneurs et elle se taisait, laissant son regard chercher, puis lentement se fixer sur l’un des villages attachés au flanc des collines qui longent la rive droite de la Broye.
On racontait qu’elle y avait laissé autrefois un amour, auquel elle s’était mise à repenser depuis la mort du père de ses enfants et du mépris que ceux-ci affichaient à son égard. Ce n’était qu’une rumeur sans fondement colportée par ceux qui ont renoncé à comprendre quoi que ce soit du mystère dont nous sommes les hôtes.
En réalité la vieille venait s’asseoir pour s’attendrir et accepter enfin ce qui lui avait été octroyé. Elle disait à qui voulait l’entendre, d’une voix blanche, ferme pourtant, que le paysage là-bas ne se dérobait pas, malgré la danse des saisons, la neige, les coupes dans les bois, les feux d’automne, le brouillard empoisonné. Elle fixait, disait-elle, un point du paysage, toujours le même, en contrebas de l’un des villages, un vallon vers lequel elle sentait converger de proche en proche la terre entière et tous ses habitants comme au milieu d’une grande respiration. Elle ajoutait que ce lieu lui semblait en même temps répandre son secret dans toutes les directions, sans perdre jamais cette singulière étrangeté pour laquelle elle venait à Pra Massin. Elle disait en souriant qu’elle se sentait un peu plus prêt de l’éternité.
Lorsque je regarde aujourd’hui les villages et les clairières sommeillant au dessus de la Broye que survole et caresse son âme libre, je songe aux dernières années de sa vie suspendues à la petite éternité que durait sa halte à Pra Massin et je l’envie.
Jean Prod’hom
L’abri

La nuit prend si vite ses quartiers le soir que les hommes se retirent promptement, fanfarons parfois, sur les îles qu'ils ont aménagées le jour. Depuis le temps la débandade est organisée.
La nuit ne laisse rien au hasard et s'insinue partout. Seul le ciel noir mité comme une feuille de millepertuis clignote de toutes parts, c'est qu'une fête se déroule là-bas, au-delà des Sablonnières. Plus rien n'est à craindre ici, les maisons sont calfeutrées et derrière leurs paupières les hommes s'abandonnent confiants à ce qui ne se voit pas. Dehors l'obscurité accroupie sur le seuil attend sagement, les écorces enlacent le coeur des grands échassiers qui sommeillent les yeux grand ouverts.
Demain à midi, lorsque la nuit ne sera qu'une ombre, je jetterai un coup d'oeil du côté du couchant et me réjouirai du soir, lorsque la nuit tombe à verse.
Jean Prod’hom
Da capo

J'avance somnanbule dans un monde strié par le va-et-vient du jour et de la nuit, vêtu des lambeaux d’un récit rapiécé qui enchante cependant ma vie. Il raconte, drapeau blanc, mon appartenance à l'espèce mais ne me réchauffe guère.
Il me faut aller tête baissée dedans le brasier, lever la tête qui est dans ma tête, regarder à gauche, regarder à droite, prendre et déposer comme l'abeille le fait avec la fleur du pommier cet autre dont j’ai besoin, dans un monde sans image, et ensemencer la page qui peine à faire voir le feu dont on est fait.
Le roncier s'est refermé derrière moi, je ne reverrai plus la clairière patiemment dégagée. Il me faut recommencer.
Jean Prod’hom
Dimanche 28 février 2010

L'eau noie les songes creux et dissémine les pensées qu'on croyait éternelles. Demeurent nos vies qui s'allègent jusqu'à la ruine et pour lesquelles on mendiera un jour encore.
J'aperçois le vieux qui brasse la neige, seul dans le bois, il va à la lisière visiter ses abeilles qu'on entend lorsque le soleil guigne. Les ruches enflamment une dernière fois les alentours. Sera-t-il avec elles ce printemps?
Comment rassembler les promesses qui débordent avec les mots d'avant? Comment contenir ce qui va sans se retourner? Je demeure en retrait et assiste à la poussée de ce à quoi je serai peut-être convié.
Jean Prod’hom
Vent debout

J'ai fait ce soir la connaissance d'un poisson aux écailles bleues et aux reflets d'argent, arc-bouté dans un aquarium domestique, debout contre le courant engendré par un moteur à quatre-sous. Sa nageoire caudale, soyeuse, qui allait et venait sans discontinuer, le maintenait immobile au milieu de l’aquarium, il ne ménageait pas ses efforts pour demeurer dans cet équilibre précaire. Sans relâche. Mais qui donc a osé mettre en scène cet édifiant spectacle?
Courageux, je songe un bref instant à vider l'aquarium pour abréger une vie qui n'en a que le nom. Mais que dirait le propriétaire? Je m'approche alors de l'animal, me penche et, à voix basse, le supplie de bien vouloir fermer les yeux sur ce que je ne suis plus en mesure de supporter : sans succès!
Je quitte l'insensé, défait, remonte la Rue de la Farce jusque chez moi, sous la pluie et contre le vent, les yeux rivés aux pavés qui brillent comme des miroirs. J’entends devant la boulangerie le bruit d’un moteur, c’est celui d’un pétrin.
Jean Prod’hom
LX

La planète s'est réchauffée encore un peu pendant la nuit, les entreprises sont sous perfusion, les bourses prennent l'eau et une borne Airport a été installée au café. Les mauvaises nouvelles de ce matin ne m'empêchent pas d’en boire un à la table ronde, il est 9 heures. Un commercial qui a une chambre à l'auberge descend prendre son petit déjeuner. Il ne connaît visiblement pas les habitudes du lieu et s'assied à ma table, rapproche le cendrier et allume une cigarette. Rien, pas un mot, je doute subitement de mon existence. M'a-t-il vu?
Il sort son ordinateur, renifle deux ou trois fois, rit grassement à la lecture de ses messages, bâille, rit, rerit, renifle et rebâille, la table tremble, il frappe sur son clavier comme un sauvage, envoie des ronds de fumée! Je m'inquiète sérieusement. Quand va-t-il pisser au pied de ma chaise?
Jean Prod’hom
L’un dans l’autre

On dit du hasard qu’il est la rencontre de deux chaînes causales. Voici donc le hasard auquel nous sommes tous assujettis, voici le maillon à double appartenance, à double valeur, le chiffre, le nombre : 807. Vicaire il est d’ici et de là-bas : là-bas le huit cent septième brelan d’as du maître, ici ce même brelan rapporté, premier des trois brins d’une poignée qui tient à peine dans le creux d’une main pleine.
« Et quoique l'eau interceptée entre les poissons de l'étang ne soit point plante ni poisson, ils en contiennent pourtant encore. » Cette proposition de la Monadologie placée en tête d’une invitation de la Société de philosophie a mis en colère les membres de l’Association romande des pêcheurs professionnels. Décidément de qui se moque-t-on ?
Lili trouve que c’est vraiment une grande chance qu’elle soit née le jour de son anniversaire.
Jean Prod’hom
11 février 2010
Peut-on illuminer un ciel bourbeux et noir ?

On rêva enfin
d'un monde où
il n'y eût rien à ajouter
ni avant ni après
dès l’aube
on se penchait
sur les termitières
avec les yeux fixes
des rois et des reines
on cueillait
dans le ciel
les signes des hirondelles
et les bois sur la grève
on envoyait des colonnes
pour explorer
la mémoire de l'océan
on descendit
au fond des puits
là où sommeillent
le souvenir des armes
l'or et les légendes
dont on tira une pile
de fragments couleur d’os
ligaturés par le silence
valeureuse têtes
jamais revues
je l'ai dit
il eût mieux valu
rester dans le rang
ne rien écrire
ne rien chercher
ne rien comprendre
laisser ce ramassis
de mots rances
croupir dans une langue estropiée
nous livrer
sans délai
à l'inestimable
au mot rivage
au mot galet
à la miraculeuse aurore
Jean Prod’hom
Dimanche 21 février 2010

Bernard et ses trois frères sont debout depuis plusieurs heures, une canne à pêche sur l’épaule et un casse-croûte dans la musette. Ils ont marché depuis le haut du Valentin, emprunté l’escalier en colimaçons jusqu’au Tunnel avant de monter dans le tram. Une petite heure a suffi pour les conduire jusqu’à Bressonnaz.
C’était aux alentours du café de la Gare qu’à la belle saison, Bernard et ses trois frères passaient le dimanche avec leur père, sur les rives de la Corcelette, de la Carouge ou de la Broye, à taquiner la truite. Mais tout cela je l’ai su beaucoup plus tard, parce que chez nous, la pêche, le casse-croûte, la Broye, on n’en parlait pas le dimanche.
Le dimanche, on se préparait dès le réveil et en silence, on se préparait chacun de son côté, quelle que soit la saison. Mais si l’un d’entre nous le demandait on se donnait un coup de main, on se parlait vraiment gentiment le dimanche matin. C’est que tout à l’heure hé! hé! il y avait le culte. C’est à cause de lui qu’on allait, qu’on venait, des chambres à la salle de bains, de la salle de bains aux chambres, en pantoufles, inspirés, sans précipitation, par le long couloir sombre et étroit de l’appartement.
Il était huit heures et demie lorsqu’on se retrouvait tous les cinq autour de la table de la cuisine, recouverte d’un inusable formica bleu piqué de petites taches blanches, trop nombreuses pour que l’un d’entre nous ait entrepris un jour de les compter. Et on déjeunait ainsi tous ensemble, dans le grand ciel bleu, baignés dans le sacré, sans que personne ne le sache ni même ne le soupçonne. Mon père rasé de près sentait bon l’eau de Cologne. Non! C’était plutôt le monde entier qui sentait l’eau de Cologne, le monde entier qui était un dimanche, un beau dimanche avec au milieu une famille qui se réveillait unie dans le silence, la retenue, la bienveillance, la gentillesse. C’était rare qu’on mange tous ensemble le matin, même si dans nos esprits c’était tous les jours qu’on mangeait ensemble. Ça on nous l’avait transmis pendant la nuit et par la force des sentiments, c’était nos parents qui avaient placé cette idée sous nos oreillers, une idée qui venait du bout de leur lignée.
J’étais assis sur le banc, un banc qu’on avait trouvé sur un quai de gare désaffectée et qu’on avait repeint blanc crème un samedi matin. Mes deux soeurs portaient une jolie robe à carreaux, mon père une belle chemise blanche, une cravate rouge profond, avec un noeud qui dansait. Ceux qui le voyaient à l’usine pendant la semaine ne l’auraient pas reconnu, il semblait appartenir à un monde céleste. Et tandis que ma mère, en robe de chambre, debout bien avant nous s’affairait devant la cuisinière, mon père volait un petit moment au silence pour prier : Notre Dieu notre Père nous te bénissons pour cette nourriture que tu places devant nous. Donne-nous des coeurs reconnaissants. Amen.
Ce jour-là ni mon père ni ma mère n’avaient besoin de nous demander d’être sages, car on était sages, c’est sûr. On mangeait nos tartines avec la même conviction que nos amis catholiques d’Ancône qui suçotaient l’ostie. C’était ainsi, c’était beau, aucun grincement de dents. Mes soeurs et moi on savait tout ça bien avant notre venue au monde, c’était facile puisque nos parents l’avaient eux aussi appris bien avant la leur, personne s’était donné le mot, c’est dire qu’on était bien unis.
Le dimanche ça servait d’abord à ça, à être sage. Et quand il y avait une petite bagarre, parce que ça arrivait quand même une petite bagarre, on disait pouce, et ça comptait pour beurre. Mais attention on ne le disait pas, ça aurait tout faussé, le dimanche les faux pas ça n’existait pas, on ne devait même pas y penser, c’est pas qu’on croyait en quoi que ce soit, mais le dimanche quelque chose nous enveloppait et nous dépassait tous, une chose hors de laquelle il n’y avait rien.
Jean Prod’hom
Pour demeurer enfin quelque part

Pourquoi nous en aller alors que les nécessités qui talonnent ceux qui n’ont rien ne nous y obligent pas ?
Lorsqu’il arriva dans les parages de ce qui devait lui apparaître presque aussitôt avec les traits de l’accompli, il se mit à croire. Croire qu’il avait rejoint le pays rêvé dans lequel il allait désormais vivre, un pays sans heurt et sans couture, avec dedans le silence, l’herbe, les couleurs, les plis des pâturages, quelques habitants, guère plus. La modestie des lieux, leur étrangeté convenue, leur retenue aussi, tout concourait à le retenir. C’était un dimanche, l’invitation semblait ferme. Sa décision fut irrévocable. Quand bien même aucune place ne lui était destinée et que personne ne l’attendait, il conçut le projet d’y demeurer, proche des lisières, à l’autre bout des préjugés, sans rien toucher. Il se fit un nid de fortune et vécut là sans que rien ne lui appartienne.
Il voulut maintenir le pays à bonne distance de son coeur pour en disposer toujours. Mais rien n’y fit, ni les égards ni les ruses. Il s’en éloignait à mesure qu’il y demeurait, incapable de résister aux habitudes qui se glissent dans nos vie – alors qu’on s’était promis de tout faire pour leur interdire l’accès. Il avait l’impression de disparaître à l’intérieur de ce qu’il voulait protéger, comme le fer des clôtures que les arbres avalent. Pris au piège au coeur de ce qu’il avait voulu laisser intact, il se mit à rôder pour retrouver plus loin dans les prés, plus profond dans les bois ce qu’il avait laissé filer, il emprunta le chemin des pâtures en grignotant des biscuits de sésame, s’enfonça dans les ronciers, cartographia les bois, épuisa les carrefours, leva des plans. Il s’y employa avec passion mais c’en était trop, il ne put rien contre les attaques de sérieux dont il lui fut de plus en plus difficile de se déprendre.
Le paradis escompté fondait et ce qui l’avait amené à jeter son dévolu sur ce pays le fuyait. Il ne renonça pourtant pas et s’enfonça plus loin encore dans les bois, il allait à petits pas, ne désespérant pas de rencontrer ailleurs ce qui lui avait filé entre les mains près de sa demeure. Mais c’est l’empire du familier qu’il cadastrait par cercles concentriques, il tirait derrière lui des ruines, comme le parachutiste son barda, il s’empâtait et la peau de chagrin qui grandissait sous ses pas allait l’étouffer.
Il faudra un imprévu sec, l'implacable, la maladie d’un enfant et le sentiment d’abandon qui suivit pour endiguer cette crue. Un matin avant l’aube il infléchit le destin en déposant l’inadmissible dans une mandorle, rendant vie à ce qu’il avait voulu taire ou tout au moins tenir en laisse. Ce jour-là il écrivit pour la première fois, des mots qui le font trembler encore aujourd’hui.
Cette mandorle est toujours là, c’est la porte par laquelle chaque jour ouvrable il quitte un bref instant sa demeure pour retrouver cette autre demeure d’où il considère intact ce qui n’a jamais disparu, le pays de la première heure dont on s’éloigne immanquablement lorsqu’on veut vivre – et on le doit – avec les siens. Il s'arrête d’aller, ramasse un tesson, une miette, celle qui est là ou une autre, pour retrouver dans la mesure de ses moyens, de mot en mot et de proche en proche, comme une prière, le lieu d’où il vient et où nous ne serons bientôt plus, improbable mosaïque, petits voyages successifs, collier de babioles.
Dans cette autre demeure – en est-il d’autres ? – , on n’est presque rien, un filet d’eau, une rumeur transparente, à peine une ombre qui passe, assez maigre pour ne plus faire écran à ce qui fait la joie d’être: pays sans heurt et sans couture, avec dedans le silence, l’herbe, les couleurs, les plis des pâturages. Voici la montage de Lure, la Pierreuse, la dent de Brenleire, le ballon de Servance, voici l’Aigoual, le mont Amiata, j’y suis depuis le début, j’y reste jusqu’à la fin, pays non plus rêvé mais pays de la première heure, de nulle part et partout à demeure, j’y suis comme un plus qui ne compte pas. Ici chez vous ou là-bas chez moi, quelques instants de veille sur un monde qui va qui va. Nous sommes des surnuméraires et c’est bien comme ça.

Publié le 5 février 2010 dans le cadre du projet de vases communicants chez Brigitte Célerier (Paumée)
Jean Prod’hom
Dimanche 14 février 2010

C'était quelqu'un qui, en fin d’après-midi, tandis que ses camarades pianotaient à l'étouffoir sur les clavecins de la salle d’informatique ou bouclaient leur sac à peines, demeurait assis en arrière du brouhaha, dans une poche de lumière, bien droit face à la table grise. Ce jour-là il ne restait que quelques mots sur le morceau de journal noirci de coups de feutre noir épais, il semblait surpris, inquiet même. Mais il a suffi de lui dire oui, de lui dire un oui qui dit oui, pour qu’il soit réconforté et aille jusqu'au bout de l’entreprise qu’il avait initiée, jusqu'au bout.
C’est la fraîcheur qui parle
d’une même voix
dans le pré
et sur mon visage
Il se faufilait discrètement parmi ses camarades agglutinés devant le bureau pour faire voir un bref instant son travail. Il s'en excusait presque. On n’avait qu'à confirmer la voie qu’il avait prise. Et comme chaque fois lorsqu'on relevait la tête, il avait disparu, craignant de prendre trop de place, de s'incruster. Un seul signe, un pauvre signe semblait le rassurer, il ne s’appesantissait sur rien.
Il imaginait des solutions inventives et élégantes, savait recycler tout ce qui se présente, faisait la preuve quotidienne que la rigueur ne relève pas d’un genre particulier, mais s’applique tout autant à la lecture, à l’écriture, à l’histoire, au calcul. Il démentait le grand partage qui faisait des deux cultures des adversaires irréconciliables. Peut-on accéder à la réalité sans disposer un peu de l’une, un peu de l’autre?
On se réjouissait d’apercevoir les textes au sommet de la pile: toujours la même rigueur, les mêmes exigences, aucun relâchement. Mais si au commencement on plaçait ses textes au sommet de la pile, c'était au-dessous qu'on les glissait à la fin. On les gardait pour le dessert.
Il se demandait parfois ce que les maîtres voulaient de lui. Eux, de leur côté, ils se demandaient ce qui lui manquait. Il n’y a pas de mot pour dire le manque qui nous manque. Cet inconfort faisait avancer le maître et l’élève.
C'était quelqu'un qui était sur le point de découvrir la liberté.
Jean Prod’hom
Abandon

Peut-on sincèrement se réjouir du talent de celui qui est parvenu, sans qu’on le lui demande, à ne pas faire usage de la lettre e dans un récit de près de 300 pages, sans simultanément porter aux nues celui qui réussit à l’instant à ne pas mentionner le nombre 807 dans un exercice qui l’exige ? Je vous le demande, sincèrement ?
Il est cruel de songer qu’à l’instant de notre naissance il n’y avait aucune place de prévue pour nous sur terre, qu’il a fallu nous battre pour obtenir ce qui en tient lieu, et de nous entendre dire avant que nous disparaissions à tout jamais qu’on laissera une place vide dans le cœur de ceux qui nous survivent, une place que rien ne saurait combler. À quoi donc bon dieu aura-t-on servi ?
Lili joue jusqu’à la nuit à cache-cache avec son ombre. Je l’entends pleurer au fond du jardin.
– Mais la partie est finie, reviens, reviens.
Jean Prod’hom
3 février 2010
L’invention de l’histoire

Il fallut inventer les lointains
laissés en arrière avant d’embarquer
– on ne s’en souvenait déjà plus qu'à peine –
les plonger nus dans les jungles épaisses
on architectura des temples
qu’on livra aux assauts des plantes
on façonna quelques paradoxes
pour retrousser le temps
et remonter haut le passé
lui offrir une digue
bientôt une pente
la construction de la retenue dura
aussi longtemps
que les temples n’eurent pas disparu
dans les ronciers
on patienta tant bien que mal
à l’abri des intempéries
on planta des porte-greffe
conçut des baumes
cadastra l’utile et l’inutile
neutralisa quelques aventuriers
on appela ce sursis
le temps du milieu
ou le temps des procédures
les prêtres se royaumaient
d’infatigables discoureurs
des amateurs de poésies
épaulaient leur désoeuvrement
les papiers et les paperasses
jamais très loin
voyez le descriptif des rituels
pris dans les mailles
de figurations inédites
pas de plan des lignées
pas de cartes des litiges
rien qui n’offrit appui au doute
on n’a jamais écrit l’objet
des contestations de cette époque
il y en eut pourtant
sauvages dedans
hésitantes dehors
à la fin de cette période intermédiaire
quand le barrage fut achevé
ceux de l’avant-garde
annoncèrent la nouvelle ère
ils tranchèrent le noeud de retenue
et par le pertuis
le temps se mit à couler
jusqu’à la niche des prêtres
attentifs désormais aux présages
jetant loin devant
les sorts
entourant de lianes
la jungle des contes
séparant les récits profanes des récit malheureux
on brûla les derniers doutes
on brûla ceux qui résistaient
ceux qui grimaçaient
ceux qui se disputaient les terres
on mêla si bien l’obscurité pleine
conservée dans les angles morts
au vide du dépit promis
que l’avenir qu’ils inventèrent
ce fut leur passé
t’en souviens-tu
on croyait en avoir fini
et tout recommençait
on croyait pouvoir enfin commencer
et on n'en avait fini avec rien
Jean Prod’hom
Nuit à Bray

L’aiguille des petites vanitées rejoint celle des heures, leurs pointes lancéolées indexent le ciel et lancent douze coups qui tétanisent les contreforts de l’église, derrière son chevet une ombre famélique se hâte. Mais le pathétique n’émeut pas la nuit qui attend son tour. Quelques cris mêlés au vin âcre montent des souterrains du fond de l’impasse et sonnent le glas des dernières espérances : blasphèmes de comptoir, silhouettes brisées, ivresse, échos trébuchants, malheureuses certitudes. Les feuilles mortes ont cessé de danser au pied du réverbère et le clown immobile derrière la devanture du joaillier sourit. C’est le moment que la nuit choisit pour se déplier, et ses plis libèrent une étrange odeur qui rappelle celle du fer et de l’eau, et avec le fer et l’eau les longs soupirs argentés des cathédrales en ruine. Et le fer et l’eau, et les soupirs poussent, poussent, montent de dessous le bitume, serpentent le long des caniveaux, chassent les brumes, balaient les repentirs, font saillir les seuils. Et la nuit confond le paysage en lui reprenant les choses confisquées, un instant seulement, le temps de les disjoindre, de les redresser une à une et de les remettre à leur place, à bonne distance les unes des autres. Plus rien désormais ne demeure en tiers, chaque chose retrouve les coudées franches et les bords que le jour leur avait dérobés, elles retournent à l’insubordonné, buissonnières et mortelles. Tout avance de concert, ensemble et séparément, les aiguilles de l’horloge ont desserré leur étreinte, les cloches leur décompte, chaque chose s’avance nue tête et sans défense. Et la rue bouclée autrefois par le jeu des dépendances s’entrouvre, les panneaux indicateurs qui commandaient le sérieux de nos heures deviennent les majordomes austères d’un songe aux perspectives infinies, les trains ne circulent plus, on marche dans le vif du sujet, dans l’étendue retrouvée.
Convenait-il de construire si haut lorsqu’on veut simplement aller au bout, voir de nos yeux l’effacement des ombres, vivre buissonniers et mortels ?
Publié le 1 janvier 2010 dans le cadre du projet de vases communicants chez Pierre Ménard (Liminaire)
Jean Prod’hom
Pierre Ménard

Une image, quelque chose comme lorsqu’on va d’un pas ferme, la tête haute, et qu’on se maintient un bref instant au sommet, en équilibre, avant de s’incliner et de basculer dans le vide sans y être prêt. Par bonheur on se rétablit en trouvant ce presque rien qui survient à chaque coup, qu’il suffit d’accueillir mais sur lequel on ne saurait s’appuyer. On passe là où n’existait aucun passage. Il ne sert à rien pourtant de se retourner, les traces sont effacées. Le monde se remet d’aplomb un court instant, on se redresse et on va de l’avant, marche précaire de celui qui ne revient pas sur ses pas, qui ne craint ni les nuages ni l’acier, qui avance libre et liquide comme une imprévisible méduse.
Jean Prod’hom
20 septembre 2009
LIX

Le jeune pasteur qui officie dans notre paroisse fait régulièrement une halte au café pour s'aviser de l'état des moeurs de ses paroissiens, il regrette que le vin y coule à flot. La situation n'a guère changé, il a du pain sur la planche.
Il croit en outre dur comme fer – et j'en souris moins – que les réformateurs de la première heure étaient des hommes purs et durs, les égaux au moins des saints dont ils avaient voulu abolir le culte. Je le taquine et, pour la paix des ménages de notre commune qui abrite aujourd'hui autant de catholiques que de protestants, je tente à chaque occasion de réhabiliter les papistes pour lesquels j'ai au fond une tendre admiration, notamment ceux de l'époque de Matthieu Schinner qui n'étaient pas que d'invétérés fêtard et qui avaient surtout de solides raisons d'en vouloir aux Luthériens et aux Zwingliens qui furent plus d'une fois les rois des coups fourrés.
Relisant la vie de Thomas Platter, je tombe sur un passage qui devrait sonner le glas de son révisionnisme, je le lui remets ce matin.
Un matin que Zwingli devait prêcher avant l'aube dans l'église de Fraumünster, je me trouvai sans bois; les cloches commencèrent à sonner. Tu n'as pas de bois, pensai-je, mais il y a tant d'idoles dans l'église!" Celle-ci était encore déserte; je courus à l'autel le plus proche, empoignai un Saint-Jean et le fourrai dans le poêle: "Allons, dis-je, tout Saint-Jean que tu es, il te faut entrer là-dedans!" La statue commença à brûler avec de grands pétillements. à cause des couleurs à l'huile dont elle était enduite. "Doucement, doucement murmurai-je, si tu bouges (ce dont tu te garderas bien) je fermerai le poêle et tu n'en sortiras pas, à moins que le diable ne t'emporte. A ce moment, la femme de Myconius passa devant la salle, se rendant à l'église, et me dit: "Dieu te donne une bonne journée, mon enfant! As-tu chauffé?" Je fermai la porte du poêle et répondis: " Oui mère, tout est en ordre." Je me serais bien gardé de faire la moindre confidence, car elle aurait peut-être jasé et l'aventure, une fois connue, pouvait me coûter la vie. Au milieu de la leçon le professeur me dit: "Custos, il paraît que le bois ne te manquait pas aujourd'hui?" Et je me dis: "Saint-Jean a fait de son mieux." Comme nous allions chanter la messe, deux prêtres se prirent de querelle; celui qui avait trouvé son autel dépouillé de la statue criait à son collègue: "Chien de Luthérien, tu m'as volé mon Saint-Jean!" La dispute dura un bon moment, Myconius n'y comprit rien et le Saint-Jean ne fut jamais retrouvé.
Le guide spirituel de notre village lève la tête et me regarde effrayé. Se fera-t-il catholique? Va-t-il entrer dans les ordres? Il commande finalement une bière et un sandwiche pour lui tout seul. Maigre consolation qui pourrait raviver les guerres de religion.
Jean Prod’hom
Rapport aux bêtes

Les archives en témoignent : le taupier de Pra Massin a pris 807 taupes au mois de mai 1919. Vendues deux sous, elles étaient destinées à habiller les dames de la ville qui manquaient de tout. On a fêté le taupier. Soit. Mais n’est-il pas excessif qu’on m’envoie aujourd’hui devant le juge pour avoir piégé la taupe qui a retourné ma pelouse l’été dernier, et avec la peau de laquelle j’ai confectionné un joli porte-monnaie pour Lili ?
C’est par respect des bêtes que Jean-Rémy se sent obligé de parler à ses deux chiens comme s’ils étaient la chair de sa chair. Et c’est, je crois, pour obéir au principe de réciprocité qu’il aboie contre mes enfants chaque fois qu’il les voit.
La femme du médecin regrettait parfois de ne pas avoir épousé un vétérinaire.
Jean Prod’hom
28 janvier 2010
Quartiers de l’île

On n'aurait pas pu atteindre
le bout de l’île
sans sauf-conduit
le noyau dur des occupants
s’y était établi dos aux marais
ils avaient foi en leur domination
buvaient au fond du jardin
des alcools forts
et crachaient un épais venin
aux confins
de l’autre côté
du côté du jour
ceux dont on avait fait couler le sang
et qu’on avait laissés sans sépulture
gisaient anémiques dans la boue
quant aux nouveaux arrivants
oubliés
démunis
qui avaient porté haut le noyau dur
ils manquaient de la promesse d’un lieu
pour y arrimer leurs rêves
et y planter leurs fragiles raisons
le nombre des cadavres
vint à s'accroître
si bien que les laissés pour compte
les entassèrent au pied du col
qui entaillait les montagnes
du centre de l’île
ils se rendirent alors
en direction de l’autre mer
sur les rives de laquelle
ils se prirent à rêver de saisons
t’ensouviens-tu
Jean Prod’hom
Dimanche 7 février 2010

La porte s’ouvrait et se refermait sur des corps trapus qui vivaient depuis toujours à contre-jour, tous à la même enseigne au bout du monde, des corps de pierre qui répondaient au nom de Marc, Luc ou Jean. L’air froid et les soupirs avaient investi les lieux si bien que l’après-midi n’allait certainement pas se prolonger, le patron ramassait la vaisselle qui traînait, les clients qui avaient réservé la table près de la fenêtre n’étaient pas arrivés. Quelques anciens meuglaient par atavisme des formules de politesse avant de s’éclipser sur la pointe des pieds, d’autres riaient gras, un bref instant avant que le silence ne se mêle à l’air sec, aucune femme, tout était en morceaux.
Il fallut que je souffle sur les braises pour qu’on se souvienne comment tout cela s’était terminé il y a une quinzaine d’années à la lisière du bois, une ferme isolée à laquelle on pouvait discrètement accéder par derrière, en haut de la pente qui descendait jusqu’au moulin. le feu, les flammes hautes qui avaient rongé la charpente et qui s’étaient élancées glorieuses dans le ciel, jetant haut la cause morte que les adeptes de l’ordre défendaient, innocents et crédules, nous n’en étions pas. Et quelques heures plus tard, avec le cri des sirènes qui s’éloignaient en toile de fond et le rouge panique des causes sottes, plus rien. Aujourd’hui le café désert, les bois noirs avec l’empreinte effacée de la déraison, derrière le foyard couleur de rouille, là-haut, plus haut, le regard perdu des villageois qui ne se souviennent de rien. Mais de quoi? Il y a parfois des événements qui n’en finissent pas et qu’on emmène avec soi jusqu’à la fin, sans qu’on n’en sache rien, ici et ailleurs, partout. Et ça reste comme la peur, comme le lit de la Lembe qui coulait déjà cet automne-là.
Jean Prod’hom
Découverte | Brigitte Célerier

Trifouiller la serrure. La vaincre, et entrer. Poser dans un coin sa valise. Aller, d'un pas qui se veut ferme, ouvrir les volets, et puis toutes les portes. Chercher où poser son sac et son mobile, pour l'appel des déménageurs. Et puis regarder.
Avec un peu de timidité, une prière, sans vouloir, encore, chercher les défauts éventuels – avec interrogation, une supplique, sans servilité, pour être acceptée.
Chercher à sentir l'espace, l'étendue d'air autour du point où on se tient, et sa qualité. Dire un ou deux mots. Ecouter le son que l'on a, là. Se faire nez, délicatement, pour sentir les odeurs endormies, les promesses.
Aller s'appuyer au mur, à côté d'une fenêtre et face à la porte. Tâter la peau du mur. Le caresser de la main, et lui donner une petite claque. Glisser pour s'assoir sur le carrelage. Sourire à la pièce et à l'avenir. Attendre.
Attendre.
Allonger les jambes. Fermer les yeux. Poser les mains à plat sur les tomettes. Se sentir là, dans cette pièce. Aimer cela.
Attendre - jusqu'à ce que la sonnerie (cette absurde corne de brume que vous avez choisie) vous jette debout, vers la porte et dans l'effroi des murs de cartons qui vont investir l'espace, entre les meubles que les voix grommelantes dans l'escalier annoncent.
Brigitte Célerier

écrit par Brigitte Célerier qui m’accueille chez elle dans le cadre du projet de vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.![]() Aedificavit et Tentatives
Aedificavit et Tentatives![]() Futiles et graves et Juliette Mezenc
Futiles et graves et Juliette Mezenc ![]() à chat perché et Hervé Jeanney
à chat perché et Hervé Jeanney![]() Lieux et Arnaud Maïsetti
Lieux et Arnaud Maïsetti ![]() L’employée aux écritures et Hublots
L’employée aux écritures et Hublots![]() Le blog à Luc et Enfantissages
Le blog à Luc et Enfantissages![]() Koukistories et Biffures chroniques
Koukistories et Biffures chroniques![]() Soubresauts et Kafka transports
Soubresauts et Kafka transports![]() Pendant le week-end et Kill that marquise
Pendant le week-end et Kill that marquise![]() Le Tiers livre et Fragments, chutes et conséquences
Le Tiers livre et Fragments, chutes et conséquences![]() Scriptopolis et CultEnews
Scriptopolis et CultEnews![]() Liminaire et Litote en tête
Liminaire et Litote en tête![]() Les lignes du monde et Abadôn
Les lignes du monde et Abadôn![]() Pantareï et Éric Dubois
Pantareï et Éric Dubois![]() Lignes de vie et Epamin'
Lignes de vie et Epamin' ![]() Les marges et Paumée
Les marges et Paumée
Jean Prod’hom
LVIII

Michel et Marjolaine reviennent de Toscane. Comme à leur habitude ils racontent aux habitués du café leur périple et montrent quelques photos. Leurs désaccords continuels nous font sourire, mais depuis le temps personne ne se formalise plus. Ça ne manque pas aujourd'hui encore.
– C'est dans la cathédrale de Pistoia et c'est la chaire de Giovanni Pisano, magnifique réalisation de la première Renaissance.
– Non chérie, c'est dans le baptistère de Pise, et il s'agit d'une réalisation de son père Nicola.
On se regarde, on sourit, eux aussi. Et Michel continue.
– Une belle soirée à Florence, sur une terrasse au bord de l'Arno.
– Mais Georges, tu te trompes, c'est à Arezzo.
– Lise, je t'en prie.
On ne se regarde plus, on ne sourit plus, c'en est trop, je me lève et m'éclipse.
Jean Prod’hom
Dimanche 31 janvier 2010

Encalminé d’avoir trop poussé la machine, il se retrouve les yeux grand ouverts, assis devant ce qui reste à faire, le corps dans un corset, las, des morceaux de paille au fond des yeux, du verre dans la bouche, avec pour seuls compagnons des machines domestiques qui ronronnent : le chat s’est tiré. Dehors le silence est cadenassé, des réverbères au milieu. Le jeune poète s’agite comme une poule dont la tête est au pied du billot, incapable de tirer le moindre plan, même foireux, il va et vient dans le lourd, il bégaie en espérant qu’un joli air viendra, que ses pieds battront le rappel. Rien, pas même la force de prier, aucun endroit dans la pièce pour cela. Rien n’y fait, pas le moindre vent pour le sortir de là, et le vent on le comprend – pourquoi viendrait-il jusque-là ?
Soudain ça remue, car la vie traînait par en-dessous, comme une maladie en rémission qui se réveillerait, comme une bousculade dans du solide, deux mots pendus sont tombés, tenus en réserve, usés, roulés, que le jeune homme ramasse. Deux mots qui brûlent, il les lâche, ils font un pas de deux, s’inclinent et versent dans la paralysie ce dont ils sont gros, tout remue; et la machine qu’il croyait morte l’emmène plus loin, l’oriente pour rejoindre par l’un des innombrables biais ce qui s’était refermé de l’intérieur, le vent l’a réveillé, il titube, un mot dans chaque main qu’il se passe comme au jeu du furet. Aveuglé par la lumière des réverbères, le jeune poète ferme les yeux, rameute toute la langue qui roule. Il y a tant à faire, elle lui brûle les doigts. Il aura suffi de jeter bien loin le couvercle qui lui avait permis de faire le décompte imaginaire de ce qu’il doit, pour courir sur ses pieds ailés. C’est bon comme sur une assiette dans le ciel, il repart pour un tour, il esquive, va allégé sur son erre jusqu’à la nuit.
Et plus tard, quand il dormira profondément, les dieux saleront l’océan et le chat reviendra.
Jean Prod’hom
L’empire céleste

Ils rejoignent
par vagues successives
les terres arables de l’île
assimilent
les curieux vestiges
des peuples sédentaires
leurs dialectes rustiques
les îlots marécageux de la lagune
c’est ainsi qu’ils s’élèvent
ils labourent
nourrissent les chats errants
et se lancent des oeillades
acceptent pour survivre l’incertain
le rien ils le partagent
plus tard la liberté
les idées fertiles
le récit de leur fondation
les lois de l’hospitalité
et celles du sol
plus tard la jalousie
plus tard
plus tard
Jean Prod’hom
Effet de serre

Ce que je ramène de ma résidence 2009 à Copenhague ? Un long poème de 807 vers, isolés par un vide sanitaire qui tiendra éternellement leur cœur au chaud.
C’est un homme engagé, et pour diminuer de moitié ses rejets de CO2 pendant la journée, Jean-Rémy respire une fois sur deux. En contrepartie il s’hyperventile tout au long de la nuit pour nourrir ses cactus et son gommier.
Surpris par la fonte des neiges le ruisseau coule la tête hors de l’eau.
Jean Prod’hom
23 janvier 2010
Le chemin du retour

Les circonstances les avaient rendus extrêmement prudents près d’Ussières en raison de la nuit qui était tombée. Les feux se mêlaient à la neige détrempée qui goûtait du toit et à des traces de doigts. L’homme et l’enfant grimaçaient pour parer à ces saletés, ils se faisaient petits, tout petits pour pénétrer incognito dans la nuit, comme des rescapés. Le bruit du moteur plongeait le peu qu’ils voyaient sur les bas-côtés dans cet inquiétant silence que sécrètent les images dans les salles vides des musées.
Zénon se confia.
- J’ai l’impression que nous sommes immobiles, que nous roulons sur place et que seul le le décor change. J’ai l’impression que nous avançons sur un ruban bouclé sur lui-même qui entraîne avec lui sur ses côtés un double décor. Mais c’est nous qui déroulons le ruban en avançant comme des otaries.
Il reprit un peu avant la Râpe avec le même gravité.
- Certains lieux se ressemblent et je les confonds. Le pont de Vers-chez-les-Rod, le bout droit d’avant Ussières, Palézieux. Le creux sous Corcelles qui est comme celui sous Mézières. Mais aussi la patte d’oie du bois de Ban qui ressemble à celle du bois Vuacoz. Tous ces lieux sont comme un seul lieu.
Zénon n’en dit pas plus. Peut-être songeaient-ils dans le silence qui se prolongeait que leurs respirations, les allées et venues, la crainte de se perdre, les morceaux de réalité cimentés par quelques vieilles certitudes prêtaient aux parties du monde une identité qu’ils n’avaient pas, paysages, idéogrammes fragiles qu’habitent nos vies sans éclat.
Ils avaient beau chercher, les indicateurs de direction avaient disparu. Il rentrèrent à tâtons dans l’autre nuit, ouvrirent la porte de la voiture. Le père et le fils se mirent à chanter dans la nuit déserte, c’était chez eux.
Jean Prod’hom
LVII

A la table voisine, l'homme en veut un peu à celle qu'il a épousée il y a un peu plus de trente-cinq ; il lui fait remarquer que si elle et sa Toyota lui avaient laissé le passage à l'entrée du parking, il n'aurait pas rayé gravement son 4x4.
Sans lever les yeux de l'illustré qu'elle consulte, sa femme lui répond :
- J'avais la priorité mon cher ami, j’avais la priorité.
L'homme opine, l’indépendance dans le couple est sans prix.
Jean Prod’hom
Pot au noir

C’est difficile de le dire mais je suis vivant, vivant dans un pays saccagé, le ciel nous a oubliés. On est au bout d’innombrables échecs et il n’y a plus rien, seulement un peu de vent et la solidarité qui se déchaîne dans la cour des petits hôtels. Je salue tout ceux qui suivent avec des yeux exorbités le charnier. Je vous rassure, le président n’est pas parmi les disparus, je l’ai eu au téléphone, le président a pris un moto-taxi.
J’habite sur le port. J’ai peur, mais je suis vivant et je n’ai pas honte, j’ai peur juste parce que tout s’en va et rien ne vient. C’est difficile de vous dire ce qu’on va faire, difficile de ne pas charger le premier venu, de ne pas dénoncer les petites commissions avec les amis tribaux tribords, difficile d’assumer la débandade. Je ne sais pas ce que nous allons faire, quoi ? difficile d’être clair dans les propos, difficile d’être cohérent.
Son chauffeur le lui a dit, dans certains quartiers on a hissé de nouveaux drapeaux. Ils ne sont pas tombés du ciel, ils indiquent d’où vient le vent. Je reste, il y a quelque chose à faire mais je ne sais pas quoi. On veut et on va vivre, comment je n’en ai aucune idée. Tout le monde est parti reste la charité, on est entre nous, je le dis c’est indécent, tout le monde savait, j’en veux à tout le monde mais l’heure n’est pas à la réplique.
Le sénateur était au parlement, il a perdu quatre agents de sa sécurité qui étaient là, qui travaillaient avec lui, alors laissez le dire, le lendemain il était à la radio, il en appelé à la bonne volonté de tous, il ne veut pas savoir qui a fait quoi, moi non plus, mais pourra-t-on pardonner ? Ce sera le salut ou le naufrage, il faut parler, ne pas laisser le silence faire le nid des arrière-pensées.
Quand on s’est réveillé il n’y avait plus d’école, on a voulu sortir les plans des tiroirs et il n’y avait plus ni plan ni tiroir, les archives sont détruites et tout le monde accourt. Pourquoi ça ne marche pas cette masse de dollars ? On a ingurgité un poison. Reste à sauver quelques vies et retrouver quelques miettes de notre passé.
Ça va et ça vient, les géants de la diplomatie et de la charité sont là, ils sont douchés à cette heure, ils nous aident à sauver ce qu’on peut sauver, on a le temps, il sera toujours assez tôt pour vendre notre terre. Et pour le moment notre terre on s’en fout.
Les gens de l’autre côté de la mer s’agitent, ils ont des taches d’envie sur tout le corps. Soixante lignes ont été mises à leur disposition pour qu’on ne soit pas seul. Ce sont les banques qui donnent le plus et les entreprises de télécommunications, et tous les appels sont bouleversants, remplis de simplicité. Les gens ont juste envie d’aider, ils ne veulent pas polémiquer, juste donner de l’argent, alors laissez-les donner, c’est une des plus belles journées de récolte de fonds, ils se sentent en harmonie et en communion totale avec nos morts. Ils pleurent, ici plus une goutte d’eau.
Mais demain si rien ne change on attaquera les camions, on ôtera à ceux qui ne veulent pas de nous le sentiment d’être des nôtres, on les foutra dehors, c’est une déclaration de guerre, nous avons faim, nous sommes des têtes pourries.
Jean Prod’hom
RSR1 / Forum, / Lundi 21 janvier 2010
Un peu avant la fin

Enclavée
au coeur du pire
assiégée coupée de tout
la paix
le voile se déchire
plumes lacs de pierre
turquoises et panaches
cortèges livres sacrés
mosaïques
tout cela va disparaître
c’est la fin d’un rêve
les exilés ont triomphé un instant
embarqués sur les flots
on les appelait sur le plateau
les héritiers ou les tard venus
en souvenir de leur lointaine migration
t’ensouviens-tu
Jean Prod’hom
Dimanche 24 janvier 2010

Je n’irai pas à Lourdes déposer mes difficultés, mes questions, mes soucis et ceux de mes proches, je ne me confierai pas à la Vierge Marie qui « médite toutes ces choses dans son coeur » et les transmet à son Fils. Je n’irai ni en pèlerin-malade, ni en hospitalier, ni en pèlerin heureux, ni en avion ni en train blanc de Sion ou de Genève, ni de jour ni de nuit, ni en car, je ne partirai ni dimanche ni lundi, je ne bénéficierai pas des offres préférentielles liées à mon âge et à mon état, je ne verserai pas les 14 francs pour l’assurance accident, décès, invalidité et frais de guérison, ni les 30 francs pour l’assurance annulation qui m’aurait évité de payer les 600 francs de couverture en cas d’empêchement de dernière minute. Je ne bénéficierai pas du transport de la gare ou de l’aéroport à l’hôtel et vice-versa, du logement dans de bons hôtels de rang moyen, des insignes, des documents, des pourboires et des taxes de séjour compris dans ce beau forfait voyage – à l’exception des boissons c’est bien de l’avoir précisé. Je ne préparerai pas ce pique-nique que vous avez conseillé aux usagers du car – c’est à l’entreprise Etoile filante que serait allée ma préférence.
Chers pèlerins, je ne vous retrouverai donc pas sur le seuil de la Grotte de Massabielle en mai prochain. Ce n’est pas parce que je n’en ai pas envie, ou que je ne trouve pas de solides et hautes raison, ce voyage à Lourdes est à coup sûr une immense expérience pour celui qui l’entreprend, qu’il soit malade ou pas.
Mais qu’on doive s’y rendre en prévoyant un billet de retour me bouleverse. Si je suis amené à faire un jour ce voyage à Lourdes, c’est d’abord pour ne pas en revenir comme je m’y suis rendu. Je ne veux pas de forfait aller-retour, je ne veux pas de forfait, je ne veux pas d’assurance sinon celle que j’en reviendrai par d’autres chemins.
Jean Prod’hom
En plus, comme n’importe quoi

- Tout de même tu penses à ton avenir ?
- Il n’y a pas d’avenir, tranchait Georges.
Pas d’avenir ? Qu’est-ce que cela signifiait ? Alors ça serait toujours pareil avec rien au bout.
- Jamais pareil, disait Georges. C’est pour ça qu’il n’y a pas d’avenir.
...
- ... Mais j’ai peur que ma vie soit en morceaux. Pas toi ?
- En morceaux si tu veux, dit Georges. Mais tu peux faire encore des morceaux avec des morceaux.
- Ça n’aboutit à rien.
- A rien. C’est pourquoi ça ne finit jamais, jamais.
André Dhôtel
![]()
Il y a le lierre au mur de la bergerie, le château trop étroit, le ciel si haut qu’il ne pèse plus sur rien. Il y a le silence dans le préau, des enfants dans la classe, il y a les tronçonneuses au fond des bois et Jean-Jacques qui y va.
Et toi tu avances d’un pas régulier sans te presser, sans vouloir non plus retenir quoi que ce soit, parfois tu baisses la tête parce que tu crois que ça pourrait te mener quelque part d’avoir l’esprit qui se retourne à l’intérieur, et tu y vas un bout, il y aurait de quoi faire mais faudrait d’abord trier. Tu entends soudain un oiseau, tu l’écoutes, c’est le premier que tu écoutes depuis longtemps, il s’est enfoncé dans la haie et t’a ramené à l’air libre, tu es seul mais tu ris parce que tu n’y crois pas tout à fait. Et tu te rappelles ce qu’une dame a écrit la veille dans son journal, cet oiseau c’était le premier qu’elle écoutait depuis trop longtemps. Etait-ce la même mésange ? La même que celle que tu as écoutée lundi en redescendant de Pra Massin ? T’en souviens-tu ? Et les corneilles tout à l’heure ? Tu les as oubliées n’est-ce pas ? Faudra apprendre à les aimer.
Il y a la ferme en ruines des Chênes, les carreaux cassés, du silence encore, il y a un avion dans le ciel, il y a une pomme dans ta poche et tu la tiens pour que vous soyez deux, il y a le bitume noir, des vapeurs sur l’horizon, un banc, un vieux biscuit dans l’autre poche. Tu ne cherches rien, à quoi bon, les choses passent toujours avec toi, ne t’inquiète pas, avec moi aussi il n’en reste rien. Et puis de toutes façons tout ça mis bout à bout est-ce que ça fait une vie ? Ça fait tout au plus une promenade, et les promenades où est-ce que ça mène ?
Peut-être qu’il faudrait qu’on mette tout ça ensemble toi et moi. Mais c’est pas si simple parce qu’en vrai rien ne va avec rien; tandis que les choses coexistent et les événements se succèdent sans nécessité, toi tu sautes du coq à l’âne. C’est ce disparate que j’aimerais nouer sans brin, ces mots s’ajouteraient aux mots et aux choses, aux souvenirs, au château, au lierre et à l’imprévisible. Tout ça n’est écrit nulle part, subordonné à rien, c’est en plus. Toi tu es en plus, moi je suis en plus comme n’importe quoi. Et à la fin il n’y aurait pas de fin, tu verrais sur le sable lisse l’ombre d’une vague qui s’est retirée, sur la neige l’empreinte d’un oiseau qui s’est envolé.
Jean Prod’hom
LVI

Tous ceux de Chez Progel sont là pour l'apéritif offert par Monsieur au café du Cygne à l’occasion du PNA, le petit nouvel an. Monsieur Progel règne parmi les siens, il regrette pourtant que cet apéritif ne lui rapporte rien, il piaffe. Un peu plus loin deux grosses femmes au dos nu tatoué ricanent, ce sont les secrétaires. L'une est grande, l'autre petite, et chaque fois que la grande avale sa salive la petite hoche la tête. Elles me rappellent quelque chose mais quoi? Près du bar Alfonso, c’est le responsable technique, il raconte avec entrain à Madame Progel sa rando prévue du côté de la Fouly. Elle sourit d'aise, ah ces montagnards! Alfonso a l'oeil brillant et fait des plans sur la comète.
Je remets enfin les deux secrétaires: elles se tenaient à l'entrée de l'immeuble en ruines de mon terrible cauchemar de la nuit passée. Ce soir elles tournent en silence sur elles-mêmes en grignotant des coeurs de France comme des castors. Elles font valoir leurs lourdes chairs que soupèsent les chauffeurs-livreurs. La noirceur du cauchemar et les fumées inhalées les ont rendues un peu poisseuses, elles gloussent d’aise pourtant.
Quant au contremaître de chez Progel qui pianote sur son portable et renifle à tous vents, il s'agit bel et bien du petit homme famélique qui surveillait l'entrée de l'immeuble en ruines qui trônait au coeur de ma nuit, c’est lui qui allait vomir continûment au pied du lampadaire pisseux.
C'en est trop, je prends peur et quitte le café du Cygne.
Jean Prod’hom
Dégel

La douceur de la veille et le soleil de l’après-midi ont transformé le ruisseau porté disparu depuis quelques jours en un filet d’encre noire que la neige n’a pas réussi à effacer. Hier il a dessiné la première lézarde, l’a élargie ce matin. Il retrouve son lit d’avant les nuits blanches et coule désormais la tête hors de l’eau.
Il grignote sur les deux berges la part de neige qui le fait grossir. C’est sûr il écrira ce soir dans son lit sombre quelques belles promesses. Pourtant le ruisseau ne chante pas, c’est pour plus tard, il médite plutôt, tout à son offensive souterraine, il ne prend aucun risque, le bois il connaît, il emprunte le trajet qui a toujours été le sien, il contourne sans ruse les fûts sombres avant de disparaître dans le creux en-dessous des nouvelles plantations.
L’abondance du duvet tout autour ne résiste pas, le manteau pied de poule fait voir sa doublure mitée, détrempée, les brindilles et les feuilles mortes en creusant d’innombrables cupules donnent un coup de main aux grands travaux du renouveau. Tout est noir tout est blanc au bois Vuacoz.
Dans quelques semaines le sol s’amollira, on se couchera dans la mousse et les traits d’encre s’éclairciront, rubans d’argent liquide sur lesquels flotteront les morceaux du ciel suspendu, avec dedans les nuages qui passent.
Jean Prod’hom
Plus tard

Personne ne le savait dans les îles
mais cette année-là deux univers
côte à côte séparés par un bras de mer
se découvrent par-dessus les années
l’élan semble irrésistible
mais ils n’ont pas dépassé
les îles la côte effleurée
pas au-delà
la même ignorance
se dresse aménage
méthodiquement son règne
un à un les derniers
lointains s’inclinent
Jean Prod’hom
Dimanche 17 janvier 2010

Qui fait passer un peu d’éternité d’une respiration à l’autre assure sa survie. Plus pourquoi pas, mais en usant de ce dont on dispose presque rien. Peut-on sérieusement aller au-delà d’un bout de journée sans étouffer ?
On m’a raconté les limites, j’ai lu quelques épopées qui ont donné du tempo à ce qui en manquait. Mais je me souviens surtout des comptines, des chansons qui reviennent, des jours et des nuits, du soleil à l’est, des promesse qu’on tient et du couchant. Vendeurs de camelote, courtisans passez votre chemin, allez respirer. Tu n’es pour quiconque d’aucun secours. Et si tu ne veux pas de mon indigence, va, je n’ai rien d’autre à t’offrir que d’être à tes côtés lorsqu’à l’aube ce quelque chose qui ne manque pas d’être là et qui m’effraie est là.
Jean Prod’hom
L'autre voie

Ne doit-on pas s'inquiéter de cette habitude tenace qui a attaché le gros de notre esprit au secret des mouvements qui font tourner la grande noria, à leur chiffre et à leurs résultats ?
Tu t'inquiètes toi-même de te retrouver à la fin du jour, insatisfait au milieu d’eux, à l'affût de la porte qui ouvrirait sur un pays d'essence plus haute, que ta précipitation éloigne et te fait manquer. Tu te débats pour obtenir un peu de vide dans ce trop plein, histoire de respirer, c'est peine perdue.
Faudra-t-il que tu acceptes encore la mainmise de ce que nous appelions faute de mieux le romanesque, qui nous éloigne non seulement de cet autre pays mais aussi du vieux pays qui invitait ses habitants à n'être qu'un presque rien s’ajoutant au presque rien, sans contrepartie, au milieu des morceaux d'un paysage incompréhensible que le mouvement de leurs paupières découpait ? Ils allaient presque immobiles dans l'à peine mobile, faseyant, déroulant sous leurs pieds les pièces du monde comme dans un film muet, un film aux raccords mal faufilés.
Oui, car c’est là qu’il fait bon vivre, loin des plaintes et des espérances, des courtisans et des complaisances. Souviens-toi d'Olympie, lorsque les athlètes s'en vont le stade est désert, croissent en bout de piste, derrière le talus, des ronciers et des chênes verts, ils annulent le récit de tous ces récits qui ne mènent nulle part, sinon au regret de ne pas avoir un jour emprunté au carrefour l'autre chemin.
Jean Prod’hom
LV

L'idée l'emballe, pas l'idée de l'adultère car Jean-Rémy est un homme à principes, mais rejoindre une chambre du troisième étage d'un Palace, où l'attendrait une maîtresse, en 4x4, ça aurait quand même une sacrée allure.
Jean Prod’hom
Dimanche 10 janvier 2010

Il faisait déjà nuit lorsque nous est parvenue de la chambre des enfants une mélodie d’autrefois portée par l’un de ces rais de lumière qui maintiennent tendus les interminables couloirs des maisons foraines. Qui s’avance jusqu’au seuil aurait aperçu par la porte entrebâillée une fillette incisive qui faisait ses grands travaux avant le clair de la lune. Nicolas, par quelle route vais-je prendre mon chemin? Je m'égarerai sans doute si tu ne me tends la main.
Inutile de lui tendre la main Nicolas, elle t’a oublié, c’est l’hiver, la fillette danse déjà la ronde du muguet. Regardez-la, des capucines et de gentils coquelicots ornent son front. Elle se lance, les doigts de sa main droite pincent les cordes de l’instrument qu’elle malmène, ils vont vite, invitent à des enjambées que la fillette peine à suivre, c’est qu’ils sont tenus de composer avec ceux de la main gauche qui décident de l’allure à l’avant de l’attelage, ils pressent, ses doigts s’emmêlent. La fillette reprend avec plus de vigueur encore, ça la démange, tout s’emballe, c’est la tarentelle. Elle donne volage son coeur au petit marchand d’galettes, petit berger ou petit cordonnier, à qui le veut, Frédéric ou Henri IV.
Elle joue, et chante Plumes plumes sur le pont d’Avignon, Sors escargot de l’étang plein de sardines à l’huile et ça la fait rire aux éclats.
Jean Prod’hom
1519

Sur le vaste territoire jusqu’à
la fatidique année – un roseau –
se sont succédé
s’élevant s’écroulant
les vagues
c’est la ligature des ans
trois cités, la vallée
les volcans couverts de neige
les bords de l’eau
le pouvoir
les steppes désertiques,
l’isthme la côte et le golfe
allaient s’effondrer
t’ensouviens-tu
Jean Prod’hom
Fin mai

Arrivée au sommet de la butte elle s’assit sur une vieille souche de foyard, retira le foulard jaune qui ceignait sa tête et rejeta ses cheveux en arrière, comme elles le font toutes.
Le cabanon n’était plus qu’un tas de cendres froides, les sacs d’ordures jonchaient le sol, l’eau ne coulait plus dans la fontaine. Restait à quelques mètres, indemne, le banc vert sur lequel plus personne ne prendrait place. Le silence était noir, les odeurs froides et humides.
Elle quitta son banc de fortune et s’avança, elle souriait. En bas la butte elle ne s’arrêta pas près des décombres, elle contourna la propriété sans jeter le moindre coup d’oeil aux pièces éparses d’un puzzle en ruines. Elle rejoignit les maigres berges de la rivière qui serpentait parmi les herbes folles, s’engagea sur la sente à peine visible qui longeait la rive gauche. Je la vis sourire deux fois encore, à la vue des iris d’eau et lorsque la brise se leva. Je la perdis de vue ensuite, pas toute cependant puisque j’aperçus longtemps encore après le foulard qu’elle tenait dans la main droite et avec lequel elle traçait de mystérieux caractères au travers de l’or-de-blé de la prairie et le vert-de-gris de la rivière. Si vous l’aviez vu sourire.
Jean Prod’hom
Sortie d’école

A l’instant où Corentin disparaît dans le bois pour rejoindre Pra Massin, les élèves du Riau lancent des cris à la ribambelle, ils courent en bas la côte les bras écartés, emmêlant cris et rires, poussant le trop-plein en avant d’eux. Ils hochent la tête, sourient à gauche nez à droite, sarabande de tignasses en bataille, écartent de la main les soucis encore maigres qui papillonnent dans leur dos et foulent aux pieds les jeunes pousses de la raison – les questions et les réponses c’est du pareil. Ils savent à peine leurs noms et ne répondent qu’à l’appel de la soupe. Mais la vieille école de pierre veille là-haut, elle occupe dans le coeur des enfants chaque nuit davantage la place la lune.
Et un jour tu t’arrêtes, tu as dix douze ans. Tu reviens sur tes pas pour ramasser le sac à dos oublié au pied du tilleul et tu repars un peu voûté. Les courses c’est fini, tu clopines et t’ouvres aux pensées, aux arrière-pensées, celles qui ont la vie dure, rivalités, avancements, paquets de glorioles, pépins et fugue d’embrouilles. Le temps passe, t’as bientôt la cinquantaine et tu n’as rien vu passer.
A quelle aventure as-tu renoncé lorsque tu es venu récupérer ton sac à dos au pied du tilleul et pourquoi t’es-tu éloigné de Corentin? Tu es parti en ville où tu as élaboré des plans, distingué l’utile et l’inutile, conçu des problèmes, bricolé des solutions. Mais tu le dis, le jeu sans fin des questions et des réponses a forclos ton existence dans un filet d’insatisfactions aux mailles toujours plus serrées. Le compte à rebours a commencé et tu te dis que si tu veux, un jour encore, faire corps avec la terre comme tu l’as fait ici enfant, il convient de te désencombrer sérieusement.
Souviens-toi, la vieille nous l’avait dit, la mort n’est pas triste, elle est la seule issue qui puisse nous conduire à nous réconcilier avec la terre et l’immédiat. Et c’est l’insouciance de l’enfant, et le souvenir de Corentin qui nous indiquent aujourd’hui la voie à suivre. Consentir et dire oui avant d’y être contraint, ne pas nous plaindre des peines endurées, oui à ce qu’il a fallu perdre pour retrouver un instant peut-être ce qui ne peut s’accomplir qu’à la fin, ne pas regretter le détour sans lequel on serait demeuré dans la nuit aveugle, la nuit des bêtes en sursis, celle des bêtes qu’on mène à l’abattoir. Nous restera-t-il assez de temps, assez de temps et de courage pour consentir à l’insoutenable légèreté de l’être?
Jean Prod’hom
LIV

Il y a plusieurs minutes que le coin des petits inauguré début août est désert, je m’interroge. Est-ce parce que, des deux boîtes de légo placées là naguère par les tenanciers, il ne reste que deux briques? Parce que les six gobelets en plastique qui contenaient de la pâte à modeler sont remplis de mégots? Ou encore parce que la boîte de biscuits bretons qui cachait douze crayons de couleur n'en cache plus aucun? Nos enfants ne sont plus là, ça c’est sûr et je m’en inquiète. Les conjectures sans consistance qui suivent ne m’empêchent pourtant pas de reprendre mon verre et la lecture du journal local que ma femme a bien voulu me céder.
On entend soudain des hurlements provenant de derrière la Grande Salle, des hurlements sinistres, semblables à ceux d'un cochon qu'on égorgerait. Deux fois, trois fois puis silence, l'enfer, un long et mortel silence.
Sandra est blême...
– Arthur! Louise! Lili!
Elle se précipite, je la suis de près, on contourne le bâtiment, notre coeur va lâcher... On aperçoit alors nos trois enfants alignés main dans la main, ils contemplent immobiles et stupéfaits le corps mort du cochon que le boucher vient d'abattre, portes ouvertes, dans le dernier abattoir de campagne de notre région.
Deux fois soulagés: de retrouver nos enfants vivants, de ne pas avoir à assister en leur compagnie à un événement constitutif de notre culture auquel il est préférable d’avoir toujours déjà assisté les yeux fermés.
Jean Prod’hom
19

Empêché pour des raisons historiques d’avoir comme son voisin un petit drapeau tricolore fiché dans le coeur, il avait placé dans un pot de grès une petite bannière rouge à croix blanche qui flottait et tournait au gré des vents, fixé été comme hiver aux fers de son balcon, et qu’il regardait songeur lorsqu’il lui semblait manquer de quelques chose.
Jean Prod’hom
Dimanche 3 janvier 2010

On comptait parmi ceux que les dieux avait placés au fin fond de l’un des sept bouts du monde pour garder un oeil sur ce que l’histoire laissait de côté. On habitait le Riau, la maison blanche sur le chemin qui mène au refuge de Ropraz, vous verrez c’est pas compliqué, une maison blanche aux volets verts sur les hauts de Corcelles, à peine un hameau une vingtaine d’habitants.
Tout autour des prairies humides, des flaques, des moilles, des haies. Derrière la Mussilly le bois Vuacoz, plus loin le bois Faucan. Avec nous des chats, le blaireau, des mésanges, des renards, des corneilles, quelques lièvres, des chevreuils, un ou deux chiens, des vaches du Simmental, les taupes et la neige l’hiver.

On y accédait par la Moille Cherry, il fallait bifurquer à droite après le cimetière du village, passer à côté du château puis de l’ancienne école, prendre à gauche du tilleul en direction du refuge de Ropraz et vous étiez chez nous. Ou alors par le plateau de Sainte-Catherine, laisser à gauche l’escargotière, le village des Italiens et la Moille Baudin, la Moille Cucuz, puis à gauche du tilleul. Et vous y étiez à nouveau.
- Et si vous ne trouvez pas demandez!
On ne s’aveuglait pas sur la marche du siècle, mais cette fois la messe est dite, il faut déménager. Les autorités communales nous ont envoyé une vraie lettre dans le style vrai des administrations.
Madame et Monsieur,
Suite à l’attribution de noms de rues et numéros de bâtiments de notre commune, nous avons l’avantage de vous communiquer, ci-après, votre nouvelle adresse officielle:
Chemin de la Moille Messelly 3A
Ce changement d’adresse est considéré au même titre qu’un déménagement.
L’histoire nous a rejoints, il faudra aller plus profondément encore dans les bois.
Jean Prod’hom
Douze sentinelles

La bataille fait rage au couchant tandis que la lune monte avant l’heure au-dessus de Teysachaux. Le ciel se colore d'un rose pâle, violet, ou mauve de cendre, avec en contrepoint les pleurs d’un enfant, je ne sais plus le nom des couleurs, je ne sais plus quoi faire. L’enfant se relève et va confier à sa mère les fantômes qui habitent sa chambre, il remonte avec une frontale, les paysans terminent de labourer le champ, on se retourne et on s'installe à deux pas de la nuit. Un homme n’a plus de bras, quarante-neuf médecins sont à son chevet, je lis. On entend quelques feux d'artifice du côté de Mézières, plus de surveillance, les arbres lèvent la tête, on aperçoit une coulée d'or. J'entre dans les bois par le chemin du Chauderonnet jusqu'à l'étang et reviens par le refuge de Corcelles. Près du réservoir du bois Vuacoz deux chevreuils sautent dans ma direction. Le premier s'arrête, puis plonge dans la combe. Le ciel laisse apparaître d’immenses plages de nuit sur ma tête. Je vais fermer aux poules, le ciel encore et sous lui le jardin noir.
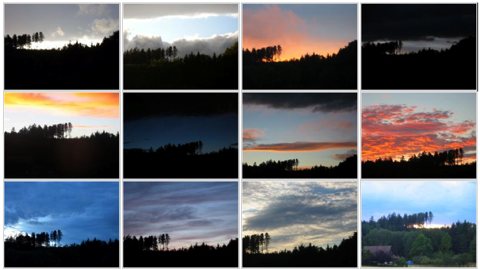
Jean Prod’hom
C'est une cohérence toute neuve | Pierre Ménard

C'est une cohérence toute neuve qui s'offre à nous, les shémas intérieurs se mesurent aux enclos des espaces naturels. C'est une façon de percevoir, j'entends par cela une précision d'horloger. C'est confirmer une sensation de déjà vu. Dernières tentations avec picotement de la pupille. L'enquête s'attache aux moindres intonations. Il suffit d'un shéma simple mais une forme controversée. La forme et le contexte ne s'expliquent pas, la seule concession étant l'origine des secrets. Depuis on peut se dire n'importe quoi dans un bruit assourdissant, cela coule de source, malgré les voix inconcevables d'un travail enfantin. Le bruit dans l'espace clôt une discussion dans un profond sommeil. L'image même de nos intérieurs investit l'espace dans la même dérision. À deux c'est le silence comme de toute constellation assumée, ce qui me laisse le champ libre. Sans doute l'attraction principale est la lumière bleue, la surprise brodée, cette autonomie fixée par nous seuls.
Pierre Ménard

écrit par Pierre Ménard qui m’accueille chez lui dans le cadre du projet de vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.
Et d’autres vases communicants ce mois ![]() Michèle Dujardin et Cécile Portier
Michèle Dujardin et Cécile Portier ![]() Anthony Poiraudeau et Brigitte Célérier
Anthony Poiraudeau et Brigitte Célérier ![]() François Bon et Marc Pautrel
François Bon et Marc Pautrel ![]() Elle c dit et fut il ou versa-t-il
Elle c dit et fut il ou versa-t-il ![]() Christine Jeanney et Juliette Zara
Christine Jeanney et Juliette Zara ![]() Zoe Ludicer et Mot(s)aïques
Zoe Ludicer et Mot(s)aïques ![]() Dominique Boudou et Anna de Sandre
Dominique Boudou et Anna de Sandre ![]() Luc Lamy et Frédérique Martin
Luc Lamy et Frédérique Martin ![]() Hélène Clemente et Isabelle Rosenbaum
Hélène Clemente et Isabelle Rosenbaum ![]() Arnaud Maïsetti et Daniel Bourrion
Arnaud Maïsetti et Daniel Bourrion![]() Pierre Chantelois et Hervé Jeanney
Pierre Chantelois et Hervé Jeanney
Jean Prod’hom






















































































































